Reconnaître les autorités, qu’elles soient établies ou tacites, est une difficulté pour tout groupe organisé.
Comment agir sans s’entraver dans des structures aliénantes ? Peut-on se passer de structure ?
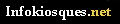
MOTS: Auto-organisation, expérimentations collectives
 La tyrannie de l’absence de structure
La tyrannie de l’absence de structure
Reconnaître les autorités, qu’elles soient établies ou tacites, est une difficulté pour tout groupe organisé.
Comment agir sans s’entraver dans des structures aliénantes ? Peut-on se passer de structure ?
 N’étudiez pas les pauvres et les sans-pouvoir
N’étudiez pas les pauvres et les sans-pouvoir
En février 2017, on découvre la thèse d’une personne de notre milieu qui décrit nos vies dans un récit “ethnographique”. On lui avait pourtant dit non, ou plutôt, les gens qui savaient avaient pu lui formuler un refus. Le contenu est nul, pas intéressant et accumule les clichés oppressifs. Il est aussi dangereux en ce qu’il révèle de nos modes d’organisations et de nos histoires personnelles, malgré la soi-disant anonymisation. Quand c’est arrivé, plusieurs personnes nous ont parlé d’expériences similaires de chercheur·ses dans des cercles militants et/ou minoritaires qui avaient utilisé leurs camarades comme “terrain”.
Le but de cette brochure est de comprendre pourquoi on laisse des chercheur·ses faire leur recherche au sein des luttes et/ou des minorités, et de nous donner des outils pour les combattre.
Dans chaque chapitre, on reprend un argument entendu qui défend la recherche puis on le déconstruit en 2 étapes : d’abord au travers d’une analyse générale, puis en prenant pour exemple ce qu’il s’est passé en 2017.
Cette brochure ne se destine pas aux chercheur·ses mais à celle·ux pouvant devenir objet d’étude.
 Tous les chefs ont tort !
Tous les chefs ont tort !
Pourquoi les chefs sont toujours nuisibles...
 L’autogestion c’est pas de la tarte
L’autogestion c’est pas de la tarte
Comment articuler réflexion, action et ressenti ?
Comment articuler individualité et
collectif ?
Quel degré d’investissement dans un
projet collectif ?
Quel degré de présence sur le lieu ?
Squatter, est-ce un travail ?
La spontanéité : un choix ? Un poids ? Une chimère ?
Quelle répartition des tâches ?
Pourquoi reproduisons-nous des normes ?
Quelle ouverture sur l’extérieur ?
Les chef-fes, comment s’en débarasser ?
Comment s’éloigner de la spécialisation ?
Quelle communication interne des informations ?
Quels moments de discussions/décisions collectives ?
Quelle communication des sentiments ?
Quelle communication vers l’extérieur ?
Comment sortir de la consommation ?
Comment atteindre l’autonomie alimentaire ?
Quels liens ville-campagne ?
Faut-il envisager la légalisation de nos squats ?
Toutes ces questions sont très présentes dans les squats puisqu’elles
touchent à la pratique de l’autogestion. On s’est dit qu’on se sentait un peu
isolé-e-s sur ces réflexions, parce que dans les revues anars et totos et tout
et toute on parle beaucoup de lutte et de théories mais peu de pratiques, et
que même dans les squats le temps ou l’envie de se poser ces questions
en face manquent souvent...
 La grève des loyers dans les foyers Sonacotra
La grève des loyers dans les foyers Sonacotra
Ces foyers créés dans les années 1950 avaient pour objectif l’hébergement et la gestion de la main d’œuvre immigrée, notamment algérienne. Marquée par l’héritage colonial, la Sonacotra va connaître au milieu des années 1970 un important mouvement de contestation mené par les résidents eux-mêmes.
Moment de lutte relativement méconnu, la grève des loyers dans les foyers Sonacotra menée par les travailleurs immigrés organisés autour du « comité de coordination » nous éclaire sur notre histoire sociale. Il place au centre la question de l’autonomie vis à vis des organisations politiques, mais aussi celle de l’organisation que chaque mouvement doit se doter (ou non) pour mener à bien la lutte. Contre le « foyer-prison », les augmentations de loyers, et la gestion paternaliste des « gérants », c’est bien une lutte pour une vie meilleure, menée dans et contre le dispositif du foyer lui-même, qui se donne à voir dans ce mouvement de grève.
 Cultures de la sécurité
Cultures de la sécurité
Voici un texte adapté de l’anglais, trouvé dans un chouette bouquin édité aux USA par CrimethInc. sous le titre Recipes for disaster — an anarchist cookbook.
Un texte adapté parce qu’on l’a lu, des bouts nous ont plu, mais pas tout, alors on l’a pris, malaxé avec nos petites mains pour en faire un truc qui nous convient mieux et que tu lis présentement.
La sécurité, c’est pas une notion qui nous plaît. Toujours une sorte de prétexte pour s’aplatir, se soumettre à l’État, à la norme qui circule pour faire de nos vies des chemins lisses, rectilignes, avec de jolis horizons pastels et policiers tout rassurants.
Pourtant, on ne va pas le cacher, nous aussi on a peur. On a la rage, mais on a peur. Peur de se faire chopper, des keufs, de la tôle. Et cette peur est paralysante. C’est cette peur qui me retient dans le droit chemin, quand tout le reste en moi m’inspire la sortie de route, la destruction de cet environnement lisse, apprivoisé, prévisible, lisible.
Alors quoi, construire les cultures de sécurité qui donnent son titre à cette brochure, c’est construire en groupe, entre complices, une confiance suffisante pour chasser la peur, faire tout notre possible pour que personne ne se fasse attraper.
 Jour après jour...
Jour après jour...
If you’re lost you can look - and you will find me
Time after time
If you fall I will catch you - I’ll be waiting
Time after timeSi tu es perdu, tu peux regarder - et tu me trouveras
Jour après jour
Si tu tombes, je te rattraperai - je t’attendrai
Jour après jour
— Time after time, Cyndi Lauper, 1983
C’est à tout le monde de donner du soin, de l’attention du temps et de l’énergie pour prendre en charge les violences interpersonnelles perpétrées au sein de nos communautés. Voici quelques pistes pour une prise en charge volontaire par le biais de rôles définis et clairement partagés afin d’éviter que tout le monde (ou personne) s’en mêle ! Le but est de nous outiller collectivement pour que plus de monde s’empare de ces questions et que chacun·e prennent ses responsabilités.
Devenez / redevenez / restez plus fortes, plus autonomes et plus responsables dans cette communauté qui vous / nous est essentielle !
Pour nous, ces outils devraient être toujours en chantier, toujours adaptés, toujours améliorés... Si vous le souhaitez, faites-nous part de vos pratiques ou de vos critiques à timeaftertime [à] riseup.net
 Accounting for ourselves
Accounting for ourselves
Les abus et agressions sexuelles continuent à pourrir les espaces anarchistes. En réponse, nous avons développé des processus pour que chacun.e se responsabilise en dehors de la sphère de l’État. Mais pourquoi semblons-nous échouer dans leur application ?
Cet essai examine le contexte dans lequel ces modèles de responsabilisation ont émergé et analyse les obstacles que nous avons rencontré en essayant de les appliquer. Pour sortir de l’impasse autour des violences sexuelles dans notre milieu, nous devons remettre en question l’idée même de communauté et amener notre résistance vers d’autres directions.
 La société contre l’État
La société contre l’État
3 textes de Pierre Clastres :
• Introduction de l’édition de Marée Noire.
• L’anthropologie politique, une interview de 1974.
• La question du pouvoir dans les sociétés primitives.
• La société contre l’État (chapitre 11).
• Repères biographiques
• Bibliographie
 Brûle ton école !
Brûle ton école !
Une critique radicale de l’école, sous forme de petits contes...
Une école tout à fait ordinaire...
I- Examens
II- Travaux pratiques
III- Histoire des sciences
IV- Message prioritaire du XXIIème au XXIème
Moralité : Brûle ton école !