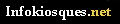Brochures
Le corps construit
mis en ligne le 5 juillet 2025 - Colette Guillaumin
Introduction
Il va de soi, et il est pourtant nécessaire de le rappeler, le corps est
l’indicateur premier du sexe. C’est l’une de ses fonctions sociales
que d’actualiser, de rendre visible ce qui est considéré comme la
division fondamentale de l’espèce humaine : le sexe ; division
fondatrice du système social et supposée implicitement devoir
l’être de toute société possible.
« The category of sex is the political category that
founds society as heterosexual. As such it does not
concern being but relationship (for women and men
are the result of relationships) [...] The category of sex
is one that rules as "natural" the relation that is at the base of (heterosexual) society [...]. »
Monique Wittig [1]
Autour de l’appareil reproducteur externe, femelle ou mâle, une
construction matérielle et symbolique est élaborée, destinée à exprimer d’abord, à mettre en valeur ensuite, à séparer enfin, les sexes. Cette construction double un rapport social matériel qui n’a, lui, rien de symbolique : celui de la division socio-sexuelle du travail et de la distribution sociale du pouvoir. Une telle construction fait apparaître comme hétérogènes l’un à l’autre, d’essence différente, les hommes et les femmes.
Ceci implique une intervention constante des institutions sociales tout au long de la vie des individus, intervention qui commence à la naissance, et probablement avant cette naissance elle-même, puisque depuis quelque temps il est désormais possible de connaître le sexe d’un enfant avant qu’il ne voie le jour. Et cette construction sociale est inscrite dans le corps lui-même. Le corps est construit corps sexué.
Les remarques qui suivent concernent concernent des formes sociales propres aux sociétés industrielles, mais celles-ci reposent sur un mécanisme de différenciation physique qui, lui, est de plus vaste étendue
et concerne l’ensemble des sociétés actuellement connues. En d’autres
termes si le corps sexué ne l’est pas de la même façon, il n’en est pas
moins construit (et non pas donné) dans les sociétés que nous
connaissons aujourd’hui. II n’est guère besoin de rappeler Margaret
Mead qui, dès les années trente, insistait sur la diversité des
impératifs, et même leurs contradictions, qu’imposent les sociétés à chaque groupe de sexe, alors même que toutes interviennent dans
le sens d’une différenciation entre les femmes et les hommes. Et plus
récemment, dans une perspective différente, Erving Goffman s’est
attaché a l’analyse de la codification des signes sexuels différentiels [2]. Ce ne sont pas partout les mêmes hommes et les mêmes femmes, cependant toujours il y a des « femmes » et des « hommes ». Et non pas simplement des femelles et des mâles.
Corps et conscience
L’hypothèse paraît admise dans toute société — où elle fonctionne comme fondement idéologique de la division sexuelle (qu’elle soit
celle du travail, de l’espace, des droits et obligations, de l’accès aux
moyens d’existence...) — que le corps humain ne peut être que sexué. Qu’il est sexué. Mais surtout qu’il ne peut pas ne pas être sexué, en vertu de quoi il convient d’intervenir dans ce sens. Car cette sexuation ne doit pas être si évidente qu’on le proclame
puisque le travail de le rendre sexué, de le fabriquer tel, est une entreprise de longue haleine, commencée très tôt, à dire vrai dès
les premières secondes de la vie, et qui n’est jamais achevée car chaque acte de l’existence est concerné et chaque âge de la vie introduit un chapitre nouveau de cette formation continue. Et que toutes choses
acquises : réflexes, habitudes, goûts et préférences, doivent maintenues soigneusement, entretenues méthodiquement par l’environnement matériel aussi bien que par le contrôle exercé par les autres acteurs sociaux. Cette « fabrication » ne se limite pas à des interventions purement anatomiques qui concernent la
seule apparence du corps et ses réactions motrices mais, par le biais de ces pressions et incitations physiques, elle construit également une
forme particulière de conscience.
La conscience individuelle, plus exactement la conscience propre d’un individu, celle de ses possibilités personnelles, de sa perception du monde, bref la conscience de sa propre vie, est déterminée par, et dépendante de, ces interventions physiques et mentales que pratique sa société. La continuité entre les conditions matérielles et les formes de la conscience est particulièrement marquée dans les
appartenances de sexe. « Quand céder n’est pas consentir. Des
déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie » est le titre, explicite, de l’étude que consacre Nicole-Claude Mathieu à cette corrélation [3].
De même les effets en retour de ces pratiques sur l’idéologie d’une société, sur son mode de pensée et son système d’appréhension du monde sont capitaux. Et si les femmes sont des objets dans la pensée et l’idéologie, c’est que d’abord elles le sont dans les rapports sociaux, dans une réalité quotidienne dont l’intervention sur le corps est l’un des éléments clefs [4]. Ces mêmes interventions jouent pour les hommes dans le sens de la construction d’un sujet, sujet de décision et d’intervention sur le monde, et tels ils sont donc dans la perception des choses propres a cette société.
Interventions directes sur le corps
Nous ne ferons que mentionner deux modes d’intervention majeurs dans la fabrication du corps sexué car aborder la question par leur unique biais tendrait à dissimuler des pratiques beaucoup moins visibles, on pourrait même dire largement in-visibles dans leur quotidienneté, de la formation d’un corps correctement inséré dans sa société comme corps de femme et corps d’homme. Et c’est à ces pratiques que nous nous attacherons. Néanmoins :
Interventions mécaniques (matérielles physiques)
D’une part nous rappellerons que les interventions mécaniques sur le corps, le plus souvent mutilantes, visent généralement le corps femelle, ou l’affectent de façon plus profonde. Il s‘agit des modifications du corps par chirurgie, par usage d’outils, ou d’objets, modifications propres à induire et à maintenir certaines transformations corporelles. C’est le cas des mutilations sexuelles mais aussi des ouvertures d’orifices (oreille, nez, lèvres…) de la réduction de membres (pied) ou de leur rupture (main, jambe, cheville...), des transformations de parties du corps : cou par élongation, taille par constriction, tête par compression, etc. Ce sont pour la majeure partie d’entre elles des interventions que l’on peut appeler ultimes, en tout cas définitives. Elles sont le révélateur
spectaculaire (et pour la majorité d’entre elles, déchirant) d’une manipulation et d’un contrôle social du corps. Sa forme majeure est, comme le montre Paola Tabet la manipulation de la reproduction elle-même [5].
Cependant ces manipulation et contrôle sont plus diversifiés dans leurs moyens d’action en ce qu’ils peuvent inclure des objets amovibles, externes, qui interviennent sur la motricité ou la liberté
du corps tels chaussures, entraves, corsets. Ces pratiques sont connues, sous une forme ou sous une autre, dans tous les groupes humains.
La mode, la présentation de soi-même et la morphologie
Nous ne nous arrêterons pas non plus à un phénomène, lui, au contraire, superficiel dans ses manipulations du corps et qui, au demeurant touche les deux sexes à peu près également, enjoignant des présentations différentielles du corps selon que l’on est femelle ou mâle : celui de la mode. Non pas seulement ni principalement les modes vestimentaires qui sont les premières à venir à l’esprit à l’énoncé du terme « mode ».
Pas davantage les maquillages ni les interventions superficielles diverses que sont les rajouts de couleur sur la peau, les modifications de la chevelure et du poil (épilations, rasages, perruques, teintures, défrisages et frisages...), le privilège et la mise en valeur de telle partie du corps (le torse, les fesses, l’oeil, la main...), bref, les manières de présentation de sa personne.
On sait que le corps humain est extrêmement varié
dans son allure, sa corpulence, son aspect anatomique, sa couleur, son grain de peau, ses cheveux, etc. et que les préférences d’une époque, d’un groupe social, d’un moment, élisent, choisissent une allure physique, un type musculaire, une couleur des yeux, de peau, une corpulence, comme étant le canon de la beauté et du souhaitable tant dans le type femelle que dans le type mâle, toujours soigneusement distingués et différenciés, et que l’on considère comme la réussite
de leur état respectif.
Ces formes d’intervention sur le corps, destinées à actualiser et mettre en scène le sexe, l’une étant superficielle et modifiable et en effet destinée a l’être : la mode, l’autre
au contraire profonde et irréversible qui modifie le corps à jamais, font bien partie de la construction sociale du corps sexué et nous devons les garder sans cesse présentes à l’esprit. Car leur brutalité lorsqu’il s’agit de mutilations, leur banalité lorsqu’il s’agit de modes, sont l’expression et l’emblème de la sexuation sociale du corps. Mais elles ne sont qu’une partie, généralement reconnue et que personne ne met en doute, d’un fait social plus profond encore et dont la mise en oeuvre est ininterrompue et dépasse infiniment ces deux formes d’actualisation.
La nourriture
La quantité et la qualité de la nourriture sont bien évidemment déterminantes dans la construction corporelle et l’état de santé dont jouit un individu. Or quantité et qualité ne sont pas identiquement distribuées entre les deux sexes. Si, d’abord, ces quantités et qualités sont dépendantes des ressources dont dispose une société ; si elles sont également variables selon les classes sociales a l’intérieur d’une même société, elles n’en sont pas moins en dernier ressort inégalement réparties entre les deux sexes.
Un certain nombre d’études se sont attachées à décrire les façons de nourrir l’enfant nouveau-né selon son sexe, tout comme le type de nourriture consommé par les adultes selon leur sexe. On sait, et depuis longtemps, que lorsque les enfants sont nourris au sein, les petits garçons le sont plus longtemps que les petites filles et ce dans un rapport qui va du simple au double : trois mois pour les unes, six mois pour les autres [6]. Chez les enfants comme chez les adultes la consommation de viande est plus élevée chez les hommes que chez les femmes. Et n’importe qui peut noter que le boucher taille des biftecks « pour les hommes », plus gros que ceux des femmes et des
enfants, les « ménagères »
en font la demande explicite si ce n’est pas le boucher qui le leur propose.
C’est un constat d’expérience courante et discernable quotidiennement avec un peu d’attention que, dans les restaurants populaires ou les parts sont préparées d’avance, s’il y a une portion plus grosse de quoi que ce soit (viande, fromage, dessert...) cette part sera, à une table mixte, servie à un homme. Dans les sociétés rurales traditionnelles de l’Europe, les femmes, debout, servaient
aux hommes, assis, les morceaux les meilleurs. Récemment un homme politique français de premier plan regrettait dans une
interview cette société où les femmes étaient ce qu’elles devaient
être. Lorsque enfin la quantité de viande est faible, elle va en priorité
aux hommes, ce dont tous les enfants de famille pauvre, quelle que
soit leur classe sociale — et quelle que soit leur société — savent très bien.
Comme c’est souvent le cas en Europe, dans certaines civilisations de chasseurs les femmes mangent les abats (les viscères de l’animal) alors que les hommes mangent la chair du gibier. Les abats
sont presque partout considérés comme une nourriture réservée aux subalternes : esclaves, domestiques, femmes. Ces aliments sont
généralement méprisés ou même craints car considérés comme
malsains hors des couches sociales qui les consomment. D’une
façon générale, ne plus, ne pas en consommer est considéré comme
un signe d’ascension sociale, ou de délicatesse dans les goûts.
Nous rappellerons pour mémoire une autre forme d’usage sexué
de la nourriture : celle de la consommation des excédents ou celle
des nourritures les moins saines. Il s‘agit incontestablement de l’un
des effets de la domination des hommes sur les femmes, bien plus
encore que dans l’occurrence précédente, car plus que de privation
ou de préférence il s’agit de contrainte. Et elle n’est pas sans effets
non plus sur la construction corporelle. Pour citer un exemple
extrême, le lait excédentaire saisonnier dans certaines civilisations d’éleveurs en zone désertique est entièrement consommé par les
femmes, bien au-delà de leurs besoins et de leur faim ; elles subissent ainsi une obésité saisonnière régulière et de considérables variations
de poids, répétées dans un laps de temps court [7].
La taille et la corpulence
Plus un pays a un niveau de vie élevé plus la taille se différencie
entre les hommes et les femmes. Ou si l’on préfère, moins un groupe dispose de nourriture, moins les femmes et les hommes se différencient et sont proches en taille et en poids. L’égalité se fait en quelque sorte par la rareté, et contrairement a ce qu’on pourrait attendre c’est dans les pays ou il n’y a pas de pénurie alimentaire que les femmes sont moins bien nourries que les hommes et non pas
dans les pays de relative rareté. Dans les sociétés « abondantes », les
individus mâles disposent d’une part protéique plus élevée qui leur assure une croissance plus marquée. Bien entendu tous les individus
sont dans ces sociétés plus grands et plus lourds qu’ils ne le sont
dans les sociétés pauvres, mais l’écart entre les sexes y est également
beaucoup plus net. Déjà la classe sociale influence la taille : au cours de la première moitié du XXe siècle, pour prendre un exemple, dans Paris intra muros l’écart de taille était de quelques centimètres, entre
les conscrits qui venaient des arrondissements populaires de l’Est
et ceux nés dans les quartiers bourgeois de l’Ouest. L’écart entre les
sexes est plus important encore.
Dans les sociétés riches plus encore que dans les autres les femmes sont plus petites que les hommes, et leur corpulence comme leur développement musculaire est moindre. Les normes
en matière de poids et de taille sont variables et il suffit parfois de
traverser une frontière pour le voir. Dans les pays latins, les balances
des pharmacies, destinées à peser les clients qui le désirent, affichent
des tableaux indiquant le poids idéal pour une taille donnée, et bien
entendu selon le sexe. Ces tableaux ne sont pas les mêmes selon que
l’on est en France ou au Portugal par exemple. Ainsi le poids idéal d’une Portugaise
est également celui d’un Français, mais la Française doit peser dix kilos de moins que le Français (ce qui est attendu...), mais par le même effet également dix kilos de moins que la
Portugaise, ce qui est plus surprenant. (Quoique a tout prendre le
revenu moyen étant plus élevé en France, les femmes en effet y doivent être plus légères que les hommes de façon plus marquée...). Il n’en reste pas moins que, quelles que soient ces variations, cet écart est considéré comme a la fois naturel, normal et souhaitable, faisant partie de l’ordre des choses.
Par ailleurs, l’écart d’âge au mariage est généralement pratiqué, la plus grande jeunesse de la femme, de deux à quatre années si l’on en croit les statistiques, étant requise et allant de soi. Donc, dans un couple la femme doit être plus petite, plus légère et plus jeune que l’homme. Ceci nous apprend une chose d’importance : à savoir que les caractéristiques physiques requises d’un homme et d’une femme vont par définition vers la différenciation. Plus encore, l’hétérogénéité de chaque couple particulier, elle aussi requise, redouble ainsi les impératifs sociaux statistiquement appréhendables qui imposent un corps différent aux hommes et aux femmes.
Le corps pour soi. La motricité personnelle
La construction du corps repose sur des techniques diverses. Les injonctions verbales en sont l’une des composantes, mais importante. Des ordres (« fais ceci »), sont donnés constamment durant l’enfance
et l’adolescence, de se conduire d’une manière déterminée propre au sexe auquel on appartient. Mais les interdictions (« ne fais pas cela ») également, vigoureuses ou répétées, ponctuent la conduite des enfants ou des adolescents. Les désapprobations (plus nuancées ou voilées) perdurent à travers la vie adulte, et de façon particulièrement marquée à l’encontre des femmes.
Les jeux de l’enfance, usage de l’espace, usage du temps
Ces injonctions ou interdictions concernent en premier lieu la façon de tenir son corps, régie par un code de la bonne et de la mauvaise tenue. Il ne s’agit pas tant des règles de politesse que d’une forme plus diffuse et plus profonde, un impératif de conformité a l’être des individus. Ce qui concerne les « façons » propres à chaque sexe de tenir son corps et d’en user, de le mouvoir dans la marche ou de le garder au repos, de le mettre en rapport avec les autres. Il y a des façons spécifiques de marcher pour les hommes et
pour les femmes, tout comme il y a des façons spécifiques de s’asseoir, de tenir les jambes une fois que l’on est assis, une façon spécifique de saisir les objets au repos ou de les attraper au vol [8].
Attraper et saisir les choses est l’objet d’un apprentissage qui se fait à traversles jeux de l’enfance, les jeux de balle par exemple : ceux des garçons font intervenir les pieds et les jambes plus que les mains ; les filles dans leurs jeux propres ne font pratiquement jamais intervenir leurs pieds comme moyen de propulsion.
Ces jeux sont probablement l’un des premiers moyens, et l’un des principaux, de transmettre et d’imposer une tenue du corps particulière à chacun des sexes. Les jeux spécifiques que pratique l’un des sexes à l’exclusion de l’autre y contribuent (bien que certains jeux tout de même sont communs aux deux sexes, plus d’ailleurs dans le domaine mental que dans celui de l’exercice corporel). Ces jeux physiques aboutissent par exemple au fait qu’une fille ne donne pas de coups de pied, ni d’ailleurs de coups de poing, au contraire des garçons, et comme
il est également requis des deux sexes de ne pas mordre ni tirer les cheveux, les filles se retrouvent sans défense cohérente dans les bagarres d’enfants, auxquelles au demeurant elles sont supposées ne pas participer. Mais plus encore que ces jeux spécifiques, le jeu en soi, ses circonstances, ses conditions sont déterminantes dans cette formation.
Jouer n’est pas une activité également répartie entre les deux sexes, et ce dès l’enfance. Si les filles et les garçons ont des jeux propres, cependant les uns jouent davantage que les autres. Par exemple le temps dont disposent les garçons pour se livrer au jeu est plus important que celui dont disposent les filles. Et de surcroît l’espace qui leur est ouvert, et dont ils usent librement, est considérablement plus vaste, sujet à moins de frontières et de limitations. Toutes choses qui ont des effets sur la tenue du corps, son aisance, son audace, l’amplitude des mouvements spontanés. Ces caractéristiques différentielles sont frappantes quand on voit côte a côte des hommes et des femmes adultes, l’utilisation qu’ils font de l’espace où ils se meuvent, qu’il s’agisse de la surface au sol ou du volume en élévation et en amplitude. Les unes occupent un espace moindre que les autres, moins librement, et marquent une propension à s’effacer, à restreindre le déplacement de leurs jambes, de leurs bras. Les autres au contraire tendent à accroître, de leurs genoux largement ouverts, de leurs bras posés sur les dossiers des sièges alentour, de leurs mouvements rapides, l’espace occupé. Ceci au repos. Il en est de même dans la marche où les hommes
occupent le centre des espaces disponibles, repoussant les femmes
à la périphérie, ou d’ailleurs elles vont de leur propre automatisme (si ce n’est vraiment de leur volonté).
Bien entendu ces caractéristiques différentielles sont d’autant
plus marquées chez les hommes qu’ils sont de classe plus populaire, chez les femmes qu’elles sont de classe plus aisée. Car les hommes des classes bourgeoises sont un peu plus proches des femmes par une sorte de réserve et de repli sur soi, en même temps que les
femmes des classes populaires sont un peu plus proches des hommes dans leur relative liberté de mouvement. Ces variations existent aussi en fonction du type de civilisation matérielle d’une société car
ces traits sont plus visibles et symbolisés plus fortement dans les sociétés les moins riches.
Ces différences dans l’emploi du corps que pratique chaque sexe ne relèvent pas de la volition, ni de la conscience claire, mais par contre elles ne sont pas sans effet sur cette conscience : restreindre son corps ou au contraire l’étendre, l’amplifier sont un rapport
au monde en acte, une vision des choses agie.
À quelques semaines de distance, circulant dans les rues d’un
quartier d’habitation, une fois à Montréal l’autre fois dans la banlieue de Paris, une fois à 5 heures de l’après-midi l’autre fois à la fin de la matinée, j‘ai remarqué deux scènes très ordinaires, fréquentes
et finalement identiques. Chaque fois il s’agissait d’un adolescent mâle, seul. Et qui jouait. Dans les deux cas avec une planche à roulettes, objet dont après une longue éclipse la mode revient aujourd’hui parmi les jeunes mâles. Leur façon de jouer à tous deux était à la fois nonchalante et acharnée et leur but, commun, était de monter quelques marches avec leur jouet. Échec à peu près constant et répété, mais remis en cause incessamment sans manifestations de découragement, et parfois l’effort était couronné d’un succès relatif mais dont on peut
penser que le temps qui lui est consacré, visiblement non limité (l’adolescent a devant lui un temps libre indéterminé), visiblement habituellement renouvelé, permettra en définitive d’aboutir à une maîtrise satisfaisante de ce projet. Dans mon propre quartier au centre de Paris, je vois fréquemment de jeunes garçons s’exercer au jeu de la planche comme à d’autres, et hier encore j’ai vu des jeunes hommes de 17-19 ans franchir sur patins a roulettes des barrages assez élevés de cageots à légumes vides (3 à 5 cageots) à l’aide d’un tremplin improvisé formé d’une porte posée à terre sur des cales,
dans une pratique renouvelée, productrice de bien plus d’échecs que de réussites car il s’agit de techniques difficiles, mais dont la liberté d’espace et de temps est la condition sine qua non de leur
exercice et l’aisance corporelle le résultat à tous coups.
Je n’ai vu qu’une seule fois en quelques années une enfant femelle
participer à ces sortes de jeux (et l’observation de ces enfants et
adolescents montrait qu’elle était davantage avec eux qu’elle ne
faisait partie de leur groupe). Et par ailleurs depuis de longues
années je n’ai pas vu dans des rues urbaines fréquentées des enfants femelles jouer à quelque jeu que ce soit. Les jeux de corde et les jeux de balle au mur d’il y a quelques décennies, s’ils se jouent encore
dans les villages et les petites villes, ou dans des quartiers très tranquilles, ont disparu des rues du centre. Ces jeux de filles qui consistaient à sauter sur place pour éviter une corde en un mouvement
vif mais immobile qui maintient le corps sur le même lieu précis, ou
à lancer contre un mur et rattraper selon diverses modalités une
balle de la taille d’une orange, ou à suivre à terre en sautant sur un
pied les cases d’un dessin quadrillé couvrant un espace de deux mètres carrés environ, étaient de plus limités dans le temps par les activités « normalement » requises des petites filles comme aller
faire un certain nombre de courses d’alimentation ou s’occuper des
plus jeunes enfants. Cette dernière tâche, comme ces jeux, sont
implicitement considérés comme une marque de la féminité au
point que lorsque nous avions une dizaine d’années l’un de nos
camarades qui jouait avec nous tout en surveillant sa petite soeur
nouveau-née faisait une chose si incongrue qu’il était considéré, à la façon diffuse propre aux enfants jeunes, comme un futur « pédé ».
La limitation de l’espace redouble celle du jeu lui-même, car les filles jouent dans leur quartier d’habitation, souvent sous les fenêtres mêmes des personnes de leur famille ou amies, exposées à un
contrôle non dit mais parfaitement exercé. Ces jeux sont donc
caractérisés par une limitation de l’espace et une limitation du
temps mais également par une limitation de la liberté mentale qui
résulte des deux précédentes, et que de toute façon la surveillance
exercée rendrait déjà impossible. Plus, ces jeux impliquent une pratique du corps orientée vers un espace corporel réduit ; sans doute développent-ils l’équilibre et l’habileté manuelle mais ils
réduisent en même temps l’extension possible du corps et de ses
mouvements, car ils mettent en oeuvre sans cesse un retour sur son propre espace, et de surcroît un espace restreint.
La disposition de temps et d’espace, outils de formation de la
maîtrise corporelle, est spécifique aux enfants et adolescents de sexe
mâle, et elle ne cesse nullement par la suite.
Ce matin encore je voyais un homme jeune (il avait 24 ou 25 ans) s‘exercer à coté de la station d’autobus où j’attendais, à se tenir en équilibre sur le bord d’un banc public, sans y accorder plus qu’une
attention distraite, se livrant à un pur exercice physique dont il
paraissait quasi absent mentalement, sans doute absorbé par d’autres soucis que celui de se tenir en équilibre sur ce banc. Activité que ne pratiquent pas les femmes dont au contraire les impositions de
la société, a la fois de dissuasion et d’injonction, les éloignent
systématiquement alors même qu’elles y invitent et y aident les
hommes constamment. De la poursuite des boîtes de conserve
rencontrées sur leur parcours à coups de pied footballeurs — poursuite souvent collectivement menée —, jusqu’à l’équilibre sur les murs d’enceinte ou la course derrière les bus, trams ou divers camions, les activités de maîtrise de soi-même et de maîtrise du
milieu ambiant, d’occupation large de l’espace public, sont le fait des garçons. Les filles en sont spectaculairement absentes. Et cette absence signifie que, de cet apprentissage-là, elles sont privées. Et
sans doute même exclues.
L’immobilisation des femmes
Il est constant d’entendre des interprétations naturalistes d’une telle situation, explicites ou implicites elles sont considérées comme
allant de soi et l’expression même du bon sens.
L’abstention des filles est supposée dériver d’un éloignement « instinctif » de ces activités sans qu’on songe semble-t-il à prendre en considération deux facteurs d’importance dont l’action conjuguée rend impossible ce genre d’exercices. La canalisation d’abord de
leur propre corps dans une contenance réservée et une immobilité
idéale a laquelle elles doivent tendre, ce qui ne suffirait peut être pas à garantir leur manque de maîtrise de l’espace comme de leur
propre corps si en même temps la limitation extrême de leur
déplacement dans I’ espace et la limitation de leur usage du temps n’en
assurait la réalisation.
L’emploi du temps des individus femelles est beaucoup plus
strictement surveillé que celui des individus mâles. Mais plus
encore cette surveillance en ce qui concerne les individus femelles
perdure tout au long de la vie, le mari prenant le relais des parents.
Et, de surcroît, ce qui est peu noté, les enfants sont d’efficaces contrôleurs de leur mère, toujours en poste, à la fois volontairement — on connaît les réactions de ceux-ci aux allées et venues et absences de leur mère, leur attention jalouse (oui) à sa présence — et involontairement en ce que leur charge, leur soin, leur surveillance reposent entièrement sur la mère dès qu’ils ne sont pas en main des institutions diverses auxquelles ils sont confiés quelques heures, que ce soit l’école, les sports, les mouvements de jeunesse, les groupes religieux ou les familles amies (où d’ailleurs une autre mère...). Le lien aux enfants, cette chaîne imbrisable sauf à encourir l’ostracisme et le mépris tranchant de l’entourage et de la société, est l’un des impératifs sociaux les mieux appliqués et les moins remis en cause. L’efficace de ce double contrôle, volontaire et involontaire, sur les possibles maîtrises de l’espace et du temps
une femme, est redoutable.
Or celles-ci sont au moins corrélatives et probablement constructrices de l’autonomie et de la maîtrise de son propre corps. Ces dernières à leur tour conditionnent l‘indépendance d’esprit et l’audace intellectuelle. Et c’est bien en vue d’une telle limitation mentale, de l’apprentissage de la soumission et de l’acceptation de « l’état des choses », que ces dispositions sont prises et maintenues. Que ce soient les enfants des classes aisées européennes, au XVIIIe siecle :
« Toute l’enfance des filles est employée a réprimer
chez elles les principes d’action contre la nature, à modérer, à borner son activité et souvent même à létouffer. »
« Toujours assise sous les yeux de sa mère, dans une chambre bien close, [elle] n’ose se lever, ni marcher, ni parler, ni souffler, et n’a pas un moment de liberté pour
jouer, sauter, courir, crier, se livrer à la pétulance naturelle à son âge [9] »,
que ce soit, aujourd’hui, envers toutes les femmes dans une société
explicitement fondée sur la soumission des femmes :
« Toutes les activités et actions [des femmes] doivent
être programmées en fonction de ce principe. Ne vous éloignez pas de la maison et ne vous en séparez pas. »
« Lors des tous premiers jours de la république, ce fut le corps des femmes qui fut l’objet de la première
tentative de prise de pouvoir [...] Le port du voile,
obligatoire pour les femmes et ce, au nom de la “lutte
contre la prostitution” constitue l’image la plus
frappante de cette domination [...] mentionnons ici
un slogan qui fut assez significatif dans ces circonstances : “Ya rusasri ya tusari”, ce qui veut dire le
voile ou les coups sur la tête. On recourait d’ailleurs
ouvertement à la violence [...] on remit à l’honneur les
principes dits “de la modestie”, par lesquels on
détermine la façon de regarder, de rire, de parler et de faire des mouvements en public [10] »,
ou que ce soit dans une ville d’une métropole industrielle ou elles viennent entraver le travail salarié lui-même :
« [Le] déplacement territorial de la serveuse est non
seulement le signe que les mâles dominent et, par
conséquent, que les femmes n’ont pas le droit de
contrôler l’espace du bar, mais il complique en outre
le travail de la serveuse. »
« Alors qu’il existe un tabou très fort qui empêche
les clientes-femmes d’envahir les territoires masculins les plus importants, aucun tabou, ni le pouvoir très réduit de la serveuse n’empêche les hommes d’envahir son poste. »
« Elle a appris a répondre posément aux injures, aux
invitations et aux violations physiques de son espace intime.
Elle sourit, rit, repousse les mains avec patience, ne tient pas compte des questions qu’on lui pose et se met hors d’atteinte sans faire d’histoires [11] »,
les limitations physiques et spatiales ne cessent jamais leur pression.
Dans ces conditions, la relation physique qu’entretiennent les hommes et les femmes est factuellement une relation de confrontation dissymétrique. Ils y mettent en oeuvre les apprentissages de leur enfance si méthodiquement et constamment pratiqués. Dans les
espaces communs, qu’ils soient publics (la rue, les commerces, les
cafés, les lieux de divertissement, et encore et toujours la rue...), ou
privés (la maison, l’automobile, les domiciles des amis et parents...)
les femmes restreignent sans cesse leur usage de l’espace, les hommes le
maximalisent. Voyez les bras et les jambes de ces derniers qui
s’étendent largement sur les sièges, les dossiers, leurs gestes ouverts
et parfois brusques dans les déplacements. Au contraire voyez les
jambes jointes, les pieds parallèles, les coudes rapprochés, le
déplacement mesuré des femmes, même dans leur hâte. Cela devrait
fonctionner très bien et c’est le plus souvent ce qui arrive : le
minimum d’espace de l’un répondant au maximum d’espace de
l’autre. C’est ce que d’aucuns nomment « complémentarité » ou considèrent
comme une utilisation « harmonieuse » des disponibilités. Plus simplement on y voit l’effet concret d’une
fabrication corporelle qui a appris aux uns la maîtrise de l’espace et
l’extension du corps vers l’extérieur, aux autres le repli sur son propre espace corporel, l’évitement de la confrontation physique... et l’attention aux autres comme nous le verrons.
Manifestations de l’impatience physique et occupation de l’espace
Si vous êtes dans un café, un bar, ou un lieu public quelconque où
se trouvent des tables, des comptoirs, des surfaces planes nues,
vous entendez parfois (souvent) tambouriner sur ces surfaces,
marquer des rythmes du bout des doigts, rapides en général,
réguliers ou syncopés — musicaux ou simplement rythmiques. Si
vous regardez qui frappe ainsi du bout des doigts, ébranlant le plus
souvent tout le comptoir, ou la table qui reçoit d’autres personnes,
ou le dossier du siège occupé par un autre individu, sans y prêter
d’attention, vous remarquerez que toujours ou presque c’est un
homme (un homme jeune, un jeune homme, un adolescent) qui
pianote de cette façon rêveuse ou semi-attentive, absorbé dans sa
propre motricité sans aucun souci des effets que peuvent avoir ses
gestes sur son environnement matériel.
De même dans la rue, aux comptoirs des cafés, aux stations
d’autobus les mêmes jeunes hommes — et non les jeunes femmes
sauf de façon exceptionnelle (en fait rarissime) — agitent en cadence
la partie de la jambe qui va du genou au pied dans un très rapide
mouvement régulier qui marque, lui, franchement l’impatience.
Impatience purement motrice d’ailleurs, car elle ne semble pas du
tout les affecter mentalement.
Ces gestes font partie de la sociabilité muette des hommes, ils
communiquent à leur entourage à la fois leur présence ET leur
désintérêt de la situation présente. Et parfois ces tapotements de
doigts accompagnent une conversation avec une femme, ce qui
semble un bien sombre pronostic sur la relation qui se déroule sous
de tels auspices. Ils manifestent ainsi le poids de leur personne dans
une sorte de mise en scène de sa propre importance que ne pratiquent
pas les femmes, du moins sous cette forme musculaire,
immédiatement corporelle.
La rue, les cafés, les espaces publics sont des espaces bruyants. Ils
le sont par les activités qui s’y déroulent, circulations, travaux, mais
ils sont par ailleurs le lieu du déploiement volontaire de bruits
déclenchés ou émis par les individus mâles. L’usage des sirènes
professionnelles par exemple (police, services de secours, voitures
gouvernementales...) n’est pas toujours d’absolue nécessité, et le
plaisir visible que prennent leurs déclencheurs à ce qui manifeste
non seulement leur droit prioritaire a l’espace mais également leur
présence (et certes pas muette) fait partie de la quotidienneté urbaine.
Les interpellations à voix puissante, les sifflements à
significations diverses (amicales, dragueuses ou de simple signal)
peuplent l’espace sonore des lieux de plein air. Dans les lieux fermés
(cafés, restaurants, bars...), selon les modulations qu’imposent les
habitudes de classe, les conversations masculines rendent impossible le plus souvent, par leur volume, les conversations voisines,
qu’il s’agisse de tablées d’hommes d’âge mur en repas d’affaires, de
simples camarades qui se retrouvent ou de groupes d’adolescents rassemblés autour
de flippers et autres jeux (en eux-mêmes bruyants)
pratiqués par eux dans les lieux publics [12].
Le contrôle du volume de la voix est imposé fortement, et tôt, chez
les filles. Cette longue restriction rend la prise de parole publique
(de meeting, de travail, d’assemblée de quelque nature que ce soit)
difficile a la majorité des femmes dont la voix habituée de longue
date à la fois à un faible volume sonore en public et à un débit
précipité, ne porte pas, et n’est souvent pas entendue. De même,
dans les espaces publics extérieurs la voix des femmes ne devient
forte et ne s’impose qu’en situation d’urgence ou de danger. A
l’inverse de celle des hommes, elle n’est pas aisément, ni constamment, présente.
Les outils corporels
Au contraire des êtres humains de sexe femelle dont la construction
de la résistance physique est orientée vers le soutien d’autres êtres
humains et le maintien de leur existence, les êtres humains de sexe
mâle construisent leur résistance dans et sur un monde d’objets, et
par l’usage d’outils et d’instruments extérieurs au corps ils visent à
la transformation du monde matériel [13]
L’usage ludique du corps qui joue un si grand rôle dans la
formation et la vie des hommes présente un caractère particulier dont sont dépourvues les activités des femmes. Les hommes usent,
dans un très grand nombre de cas d’un prolongement matériel de
leur corps, d’un objet rajouté dans lequel se projette le mouvement
de la machine corporelle, à travers lequel la motricité, les muscles,
déploient leur potentialité. L’exercice physique « fait corps » avec,
au sens propre de l’expression, une sorte de supplément matériel
qui accroît les possibilités du corps. De la planche à roulettes à la
boite de conserve poussée du bout du pied, du ballon projeté
habilement ou puissamment au couteau de poche, la liste de ces
prothèses masculines est vaste.
Les armes
Avec ce même couteau de poche nous entrons dans un domaine
spécifique du prolongement corporel. Il présente la caractéristique
notable d’être a peu près totalement l’exclusivité des hommes et
d’être de surcroît pratiquement interdit aux femmes. Car si les
ballons et les planches à roulettes ne sont pas pratiqués par les
femmes elles n’en sont pas cependant explicitement et formellement empêchées. Le cas des armes est plus complexe en ce que leur
interdiction aux femmes, si elle n’est pas dite, est néanmoins
rigoureusement appliquée à travers diverses sanctions auxquelles
s’exposent celles qui touchent et manipulent les armes, et un réseau
de précautions qui en conserve la disposition, le maniement et
l’usage aux acteurs mâles de nos sociétés.
Les armes sont un prolongement corporel d’une efficacité particulière : elles transforment le monde à distance. Nous ne faisons pas allusion ici à l’agressivité (supposée naturelle) mais plus simplement et immédiatement au rapport que les armes instaurent au
corps propre de celui qui les manipule, d’une part, et à l’espace
qu’elles intègrent d’autre part. Bref à leur caractère de médiation
entre motricité et milieu matériel [14]. Plus encore que de la possession
des armes il s’agit de leur usage, et précisément de l’expérience de
la modification du monde à
distance qu’elles entraînent, du prolongement de l’action corporelle bien au-delà
des frontières du corps. Là où les hommes expérimentent leur corps à distance, le
projettent ou le prolongent à l’aide d’objets divers ou d’armes, et cela depuis
les jeux de leur enfance, les femmes ont, elles, l’expérience de la limitation à leur propre espace corporel. Les jeux qu’elles pratiquaient enfants tendent à fermer le corps, à le
tourner vers lui-même, à limiter même l’extension possible de celui-ci par un
contrôle des gestes, une contrainte de la tenue des bras et des
jambes, une restriction des déplacements
et la délimitation de zones à éviter.
Dans les sociétés rurales de la Méditerranée et et de l’Europe du Sud
la chasse est un fait normal, intégré dans la quotidienneté. Et dans
les sociétés urbaines, bien que non quotidienne elle reste, avec la
possession de fusils toujours à portée de la main,
une réalité. Réalité répandue, familière à une importante fraction de la population
masculine, ou la concernant même si elle ne la
pratique pas. De plus, la chasse est souvent relayée ou remplacée par
la pratique des armes en salle de tir ou en terrain d’exercice,
le ball-trap est un divertissement pratiqué par les hommes ruraux ou urbains.
Dans ces pays les armes sont un fait concret.
Les véhicules
L’usage de l’automobile, prolongement utilisé par les deux sexes
au contraire des autres objets corporels, confirme la différenciation
sexuelle de l’appropriation de l’espace. L’usage de l’automobile est
pour les femmes une pratique à peu prés uniquement utilitaire, et
sur des distances courtes ou moyennes peu éloignées du domicile,
les déplacements des enfants et les courses y occupent une place
prépondérante. Les hommes en ont aussi un usage utilitaire, professionnel
le plus souvent, mais s’ils circulent également sur des distances courtes et moyennes ils parcourent aussi de longues distances dont en pratique les femmes sont absentes. Si elles s’y
aventurent c’est à titre exceptionnel et non régulièrement. Les longs parcours, les grandes distances entre villes, la « route » enfin est occupée par les conducteurs mâles en écrasante majorité. Alors que
les abords des villes, l’entrée dans les banlieues montrent un
nombre de conducteurs femmes qui approche celui des conducteurs
hommes. Par ailleurs l’usage sportif de l’automobile est un fief
masculin, à l’exception du type de compétition particulier qu’est le
rallye que pratiquent — parcimonieusement — les femmes. Les hommes ont
enfin, pour certains d’entre eux, le plus souvent jeunes,
et qui ne sont pas des conducteurs professionnels pour autant, une
pratique ludique de leur automobile. Pratique peu fréquente chez
les femmes pour ne pas dire exceptionnelle.
Le corps pour les autres. La proximité physique
Les deux sexes font l’apprentissage de la proximité physique. Et
les deux sexes l’apprennent également dans le corps à corps. Mais ce
n’est pas du même corps à corps qu’il s’agit. Et sans doute est-ce là
l’un des points clés de l‘apprentissage corporel sexué, de ce qui fait
un corps de femme et de ce qui fait un corps d’homme et conditionne leur réaction immédiate au monde environnant et aux autres êtres humains.
C’est la que se construisent leur attitude sociale et les pratiques de
relation à ceux qui les entourent.
L’apprentissage de la coopération entre pairs, les hommes
Les enfants garçons apprennent à lutter. Certains l’acceptent mal,
d’autres le font dans la crainte, la plupart s’y livrent avec délices,
mais quelle que soit leur attitude ils doivent presque tous s’y plier.
Des bagarres de petits garçons à la mêlée de rugby, des confrontations d’adolescents à la pratique des sports de combat, de la lutte
à la boxe, les hommes apprennent à confronter d’autres corps au plus près.
A ne pas craindre ce contact et à le sentir spontané et naturel.
Dans la sphère publique (la rue, le café, les espaces de réunion et
de sport) le corps des hommes est proche du corps des autres
hommes, depuis le simple côtoiement détendu et plus ou moins
intime selon les classes sociales et les sociétés jusqu’au contact
physique d’empoignement dans certaines activités (lutte, rugby,
football, boxe... [15]). Les lieux de détente (bordels, saunas, salles de sports...) y contribuent.
Mais plus : le corps masculin est en même temps construit par ce
biais, spontanément solidaire du corps des autres hommes. La
coopération ludique de la rue que pratiquent les enfants et
adolescents continue sous une forme utilitaire dans l’âge adulte.
La rue et tous les lieux publics sont l’aire d’exercice de la coopération
spontanée et immédiate des hommes. Sans concertation préalable,
ni échange verbal, des hommes inconnus les uns des autres soulèvent
ensemble une voiture pour la déplacer, transfèrent un matériau
lourd d’un endroit à l’autre, coordonnent leurs mouvements pour
parer à un imprévu où ils interviennent spontanément. Bref,
ils mettent en oeuvre une prise en charge commune, et coordonnée,
d’événements imprévus dans les mille difficultés de la vie
quotidienne publique.
Ainsi le corps à corps des hommes est une confrontation avec des
pairs. Tout antagonistes qu’ils soient dans l’enfance, l’adolescence
ou le sport de l’âge adulte, ces combats — car il s’agit bien
combats — introduisent a la solidarité et à la coopération. La
coordination matérielle entre les individus s’y forme. Les hommes
ont une connaissance expérimentale de la parité, qu’ils mettent en
oeuvre à chaque moment dans les lieux publics. Car en effet le corps
à corps des hommes est une affaire d’espace public. Espace qui est
le leur, celui de leur activité et de leur maîtrise, et dont les femmes
sont exclues, dont ils excluent les femmes.
L’apprentissage de la dissymétrie, les femmes
Dans cet espace public qui n’est pas le leur, la fabrication du corps des femmes repose sur l’évitement et non pas sur la confrontation. Les enfants filles ont appris à éviter le combat et la lutte physique que les adultes veillent à leur interdire dès l’enfance. Adultes, les femmes sont conditionnées à éviter le contact, ou même la simple proximité. Pas de rugby pour les femmes, mais pas non plus de flânerie semi-attentive dans un lieu libre, parmi des pairs potentiels,
seulement une marche surveillée parmi des prédateurs potentiels. Le corps des femmes est construit coupé des autres corps pairs, isolé et enclavé dans un espace de restriction. L’éducation des femmes vise à la privation de leurs potentialités physiques, ou du moins à une large restriction de celles-ci.
C’est dans l’espace privé que se construit le corps-pour-les autres
des femmes. C’est là qu’elles font l’expérience d’un corps à corps
bien différent de celui des hommes. La proximité physique leur
deviendra tout aussi « spontanée » et « naturelle ». Mais elle sera
d’aide et de soutien et non pas d’antagonisme et de coopération.
Leurs jeux mêmes sont l’apprentissage du soin à donner aux autres,
de l’attention à porter. Tenir des enfants nouveau-nés dans les bras,
les conforter, les nourrir leur est demandé très tôt, dans les faits et
pas seulement dans le jeu. Elles auront à soutenir d’autres êtres
humains, malades ou affaiblis ou vieillis. A les laver, à les nourrir,
à les entourer de soins matériels.
Toutes ces choses composent un long processus. Car si les hommes cessent plus ou moins tôt dans l’âge adulte le combat ludique et sportif, les femmes,
elles, ne cessent jamais, même dans leur
vieillesse, de s’occuper du corps des autres et de le soutenir,
hommes, femmes, enfants. Et la proximité qu’elles apprennent ne
doit pas être antagonique, jamais. même si elles sont réticentes,
même si elles refusent ces contacts, elles ne pourront pas les
transformer en combat. Mais elles ne pourront pas non plus les
transformer en coopération. Car leur corps à corps n’est pas égalitaire.
On a fabriqué aux humains femelles un corps « proche » : proche
aux enfants, aux malades, aux invalides, aux
humains âgés, à la sexualité des hommes [16]. La fréquence de l’inceste ne s’explique
peut-être pas autrement que par cette disponibilité exigée des
femmes mais plus encore, et mieux : apprise,
par la soumission inquestionnée, intériorisée, aux personnes de
la « famille » et de l’entourage. L’éducation de surcroît leur fabrique
un corps résistant aux charges écoeurantes, à la maladie, au nettoyage
des autres humains quel que soit leur état, aux excréments (et pas seulement
ceux des enfants), à la mort. Le traitement de la nourriture et sa
transformation, qui ne sont pas si « propres » que l’imaginent ceux
qui ne les pratiquent pas, en font également partie.
Dans cette sphère dite privée, les hommes, inversement à ce qui
se passe pour ceux dans l’espace public, ont appris l’évitement, ceci
aux côtés de femmes qui y pratiquent au contraire
l’extrême proximité. En effet les enfants ont accès pratiquement librement
au corps de leur mère, il leur est disponible par définition pour s‘y jeter, s’y
abandonner, s’y agripper, le frapper même. Il en est de même pour
l’époux ou le compagnon. Dans cet espace fermé le corps des
hommes n’est, lui, accessible que sur demande, ou sur incitation de sa part.
Les corps à corps des femmes sont inégalitaires. Elles sont
confrontées soit à la faiblesse physique, au chantage affectif, à la
pression psychologique. Ou bien au contraire elles le sont à la force,
à la contrainte face à des humains qui sont plus forts qu’elles, soit
socialement, soit physiquement. Les femmes n’ont pas libre accès alors
qu’elles mêmes sont d’accès libre à tout un chacun. Leurs confrontations
physiques ne sont pas des contacts avec des pairs (entre pairs). Les
femmes sont éloignées physiquement de leurs égaux possibles par
le manque d’un espace public commun. Elles sont privées de la
connaissance expérimentale de la parité.
C’est bien de parité dont il est question, et non de solidarité.
L’exercice de la solidarité entre femmes, réelle, constante, est une
expérience personnelle, particularisée. Ce sont ses amies, ses soeurs,
ses voisines, des femmes de sa famille, bref des proches, qui lui
donneront un coup de main ou à qui elle donnera un coup de main.
Plus, ce coup de main s‘appliquera à des taches personnalisées,
concernant des êtres humains non seulement connus mais familiers. Si les femmes sont solidaires — et elles le sont à un haut degré — elles ne sont cependant les « paires » de personne. Elles ne
rencontreront pas, dans un espace public, de façon indéterminée et
régulière, des humains inconnus, potentiellement partenaires d’une
éventualité imprévisible, en quelque sorte complices bien qu’inconnus, à la fois présents et étrangers, ni dépendants, ni dominants.
Car elles sont construites physiquement dans un réseau de dépendance, à la fois d’implication violente et de coupure radicale.
Conclusion
Pour conclure je souhaiterais faire une remarquer à première vue
paradoxale. L’entreprise de fabriquer aux femmes un corps à la fois
fermé sur soi-même et librement accessible (ce qui n’est pas
contradictoire mais bien complémentaire), de l’éloigner du contact
avec des pairs et d’en briser l’audace (ou du moins de ne pas la
construire...) a des conséquences mentales comme je l’ai souligné
à plusieurs reprises dans ce texte.
Mais c’est une entreprise qui n’est pas gagnée à tout coup, et qui
de toute façon est longue à mener à bien. On sait que ce n’est pas avant dix-sept ans que les performances sportives des filles marquent
un fléchissement, ce qu’on pourrait dire sous une autre forme :
l’intégration des impératifs du genre « femme » et de son idéal corporel
ne sont pas réalisés, achevés, dans l’enfance et dans
l’adolescence. Il y a quelques mois, une enfant de onze ans,
séquestrée, a réussi à s‘évader du cinquième étage d’un immeuble
en descendant par la façade extérieure, de balcon en balcon, avec
une audace, un sang-froid et un courage qui vaudraient à n’importe
quel être humain adulte de sexe mâle le témoignage de la plus vive
admiration, et qui, curieusement, ne semblent pas avoir frappé
outre mesure l’opinion. Angélique, de surcroît, a accompli cet
exploit après une journée et une nuit où elle avait été confrontée à
la peur, à la contrainte sexuelle, au dépouillement de ses vêtements,
elle avait même été attachée [17].
L’indomptabilité et le courage moral de cette enfant qui lui sont
particuliers en tant qu’ individu, car ils sont étonnants, rares, laissent
penser par ailleurs que la réserve et l’accessibilité physique des
femmes sont une entreprise de longue haleine. Elles reposent sur un
empêchement des potentialités, sur la canalisation de l’énergie de
l’individu femelle dans un corps spécifique mais aussi sur la
répression de cette énergie et en dernier ressort sur une censure de
soi. Ce qui rend la stabilité de ce corps construit incertaine et explique le caractère jamais terminé de cette construction.
[1] Monique Wittig, « The Category of Sex », Feminist Issues, Berkeley, Californie,
1982, Vol. II, n°2. La version française de ce texte est disponible sur [infokiosques.net-1619].
[2] Margaret Mead, Moeurs et Sexualité en Océanie, Paris, Plon, 1963 (édition originale 1935). Erving Goffman, « The arrangement between the sexes », Theory and Society, 4 (3).
[3] Nicole-Claude Mathieu, dans N.-C. Mathieu, éd., L’Arraisonnement des femmes, Essais en anthropologie des sexes, Éditions de l’École des Hautes Études en sciences sociales, Paris, 1985. (Texte publié in N.-C. Mathieu, L’ Anatomie politique, Paris, éd. côté-femmes, 1991.)
[4] Sur l’analyse de la corrélation entre relations sociales matérielles et idéologie dans les rapports de domination (et particulièrement dans les rapports de sexe), voir Colette Guillaumin, « Pratique du pouvoir et idée de Nature », supra p. 11.
[5] Paola Tabet, « Fertilité naturelle, reproduction forcée », L’Arraisonnement des femmes…, op. cit. En ce qui concerne les interventions sur l’anatomie sexuelle elle-même, dans la perspective d’un rapport social inégalitaire, cf. Sylvie Fainzang, « Circoncision, excision et rapports de domination », Anthropologie et Sociétés, Québec, 1985, 9, n°1.
[6] Irène Lezine, Le Développement psychologique de la première enfance, PUF, Paris, 1965. Sur la question de la nourriture, voir le développement et les références bibliographiques de N.-C. Mathieu dans « Quand céder n’est pas consentir... », ibid.
[7] Y. Elam, The Social and Sexual Roles of Hima Women : Nyabushosi Country, Ankole, Uganda, Manchester, Manchester University Press, 1973. Je remercie Paola Tabet d’avoir attiré mon attention sur ce fait.
[8] Sande Zeig, « The Actor as Activator : Deconstructing Gender Through Gesture », Feminist Issues, 1985, vol. V, n°1, où l’auteur décrit et analyse cette imposition différentielle de la gestuelle et en montre la possible reconstruction (et reconquête). Et également : Marianne Wex, Let’s Take Back our Space. « Female » and « Male » Body Language as a Result of Patriarchal Structures, Hambourg, Frauenliteratur Verlag, Hermine Fees, 1979.
[9] Ces textes sont des remarques des pédagogues du XVIIIe, ils sont cités par
Philippe Perrot, Le Travail des apparences ou les Transformations du corps féminin,
XVIIIe-XIXe siècles, Paris, Le Seuil, 1984.
[10] Minoo Moallem, Pluralité des rapports sociaux, similarité et différence. Le cas des
Iraniennes et Iraniens à Montréal, thèse de doctorat de sociologie (Ph. D.), Université
de Montréal, 1989. La premiére de ces citations est extraite par l’auteur de « Les
points de vue d’Ayatollah Beshesti sur les femmes », Zan-e-rouze, n° 237 (en parsi).
[11] James P. Bradley, Brenda J. Mann, Les Bars, les Femmes et la Culture. Femmes au
travail dans un monde d’hommes, Paris, PUF, 1979. (Traduction de The Cocktail Waitress.
Woman’s
Work in a Man’s World, John Wiley and Sons, 1975.)
[12] L’occupation de l’espace sonore par les hommes, les diverses actualisations
de ce fait, l’importance de cette libre disposition des espaces publics dans la maîtrise
de soi-même et du monde environnant m’ont été rappelées par N.-C. Mathieu.
L’essentiel des remarques qui figurent ici à ce propos sont en fait les siennes.
[13] La réflexion sur l’usage des outils techniquement les plus avancés a été initiée par Paola Tabet, « Les mains, les outils, les armes », L’Homme, XIX (3-4), juil.-déc. 1979. Le regard, totalement neuf, porté sur le rapport entre sexes et niveau
technique de l’outillage employé, ceci dans les sociétés de chasseurs cueilleurs mais
dont la portée dépasse cette aire, a changé la perspective classique en ce domaine
qui était purement distributive (tel objet/tel sexe d’usager). L’importance qu’elle a
dévoilée de l’usage et du non-usage de ces médiations matérielles à l’environnement
que sont les outils et les armes, les conséquences qui en découlent dans la vie des
individus, a rendu possible une réflexion qui n’aurait pas été envisageable sans cela.
[14] 14. Ceci a été écrit avant l’attentat de Montréal (décembre 1989) où quatorze femmes ont été abattues par un homme
armé d’un fusil semi-automatique de
calibre .223. La gravité, l’importance
politique de ces meurtres (explicitement
revendiqués comme antiféministes) m’incitent à laisser telles quelles, à ne rien
changer ni rien ajouter à ces remarques
qui visent à montrer l’importance de l’usage
des armes dans la différenciation corporelle de sexe. Voir « Folie et
norme sociale... », infra p. 143.
[15] La réticence des hommes a l’entrée des femmes dans la pratique
et l’univers du sport, particulièrement quand il s’agit de sports populaires
et collectifs, est plus que vive. Le football, le cyclisme sont d’une pratique
difficile et ouvertement ou
sournoisement empêchés aux femmes (la conquête du cyclisme
de compétition est récente). Le rugby reste le domaine de la virilité sacrée et ses
pratiquants entendent bien,
et le font savoir, qu’il le reste. La boxe est interdite de compétition aux femmes,
et dans la boxe française où on distingue deux types de pratique : l’« assaut » et le
« combat », ce dernier est interdit aux femmes ; c’est aussi
celui où il est permis de
porter les coups. (Ces précisions concernant la boxe m’ont
été données par Brigitte Lhomond.) Pour un développement sur les implications
du sport et de la compétition en ce qui concerne les femmes, voir : Helen Lenskyj,
Out of Bounds. Women, Sport and Sexuality, Toronto, Women’s Press, 1986.
[16] On aura bien sûr remarqué que ce texte n’aborde pas la sexualité. C’est
pourtant la première chose qui vient à la réflexion
lorsqu’on parle de corps sexué.
Mais elle y vient trop facilement, et ce n’est qu’elle
seule qui vient : elle occupe toute
l’attention. La sexualité est sans aucun doute
dépendante de, et soumise à, la
fabrication du corps comme « corps de femme »
et « corps d’homme », mais le corps
sexué est autre chose qu’un outil de plaisir et de
reproduction, beaucoup plus que
l’exercice de la sexualité. Cette question, certes,
est de toute première importance.
Et ce d’autant plus que les formes socialement imposées de la sexualité construisent
à leur tour le corps et qu’elle occupe une place centrale dans les rapports sociaux.
Toutefois la perspective adoptée ici est celle du travail social sur le corps humain, de
sa quotidienneté, du caractère discret, quasi invisible de ses interventions. L’abord
de la sexualité, conduite puissante et fortement
investie de sens, à la fois extrême de la contrainte et extrême de la liberté, est l’objet d’un autre article.
[17] En août 1989, à La Rochelle (France), cf. Libération, 3 août 1989.
« Le corps construit » est extrait du livre de Colette Guillaumin Sexe, Race et
Pratique du pouvoir – L’idée de Nature (pp. 117-142), paru à Paris en 1992 aux
éditions Côté-femmes, dans la collection « Recherches ».
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (759.9 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (670.8 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (981.6 kio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (988.3 kio)