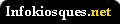A
Ah ! Ça INRA, ça INRA … !
Reportage historique dans les champs du progrès
mis en ligne le 25 septembre 2023 - Z (revue)
Ah ! Ça INRA, ça INRA … !
Reportage historique dans les champs du progrès
De la création du maïs hybride au décollage des premiers drones de surveillance des cultures, l’Institut national de recherche agronomique est au cœur de l’uniformisation du vivant et de l’industrialisation de l’agriculture. Histoire d’une institution qui a sacrifié les paysans à l’agronomie moderne.
Depuis le XVIIème siècle, sur le plateau d’Anglès, entre les monts de Lacaune et la Montagne noire, on cultive le maïs. C’est une région particulièrement froide du Tarn, où ni l’altitude ni le climat ne permettent à cette plante étrangère venue des hauts plateaux du Mexique d’arriver à maturité. Alors on l’utilise comme culture fourragère, pour nourrir les bêtes. Dans les années 1940, de beaux épis repérés par un paysan du coin servent à fournir des graines ressemées systématiquement chaque printemps. Le maïs ainsi obtenu est particulièrement précoce et résiste au froid. Satisfait, le cultivateur distribue ses semences autour de lui : elles arrivent jusqu’au chercheur André Cauderon. Une fois entre ses mains, ces semences vont être au cœur de l’un des basculements les plus décisifs du siècle : le choix politique du maïs hybride, lequel précipite l’avènement d’une agriculture industrielle, exportatrice et uniformisatrice.
André Cauderon travaille au département « de l’amélioration des plantes » au sein d’une nouvelle institution publique. En 1946, l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) vient de naître [1]. Les pénuries vécues pendant la guerre, le rationnement qui se poursuit sur certains produits et la dépendance aux importations encouragent l’État français à s’occuper plus sérieusement de l’administration de la production agricole nationale – avec l’aide du plan Marshall. Il faut « nourrir la France », les agronomes de l’INRA vont relever le défi. Le maïs est au cœur de cette mission : il sert à nourrir les bêtes et soutient donc la production de viande et de produits laitiers, au moment où l’élevage intensif va lui aussi révolutionner les campagnes. Pour cultiver du maïs, comme n’importe quelle céréale, il faut d’abord semer. Et pour semer, il faut des semences : des grains capables de donner naissance à une nouvelle plante. Pour le paysan, deux possibilités cohabitaient alors depuis toujours : prélever les semences dans son propre champ – sur les plus beaux épis de préférence [2] – ou bien s’approvisionner ailleurs. Depuis le début du XXe siècle, cette seconde option se développe avec la structuration de trois métiers opérant en amont de la culture de céréales : sélectionneur-obtenteur, multiplicateur et négociant. Les semenciers prennent désormais en charge ces trois métiers et vont devenir un interlocuteur majeur des agriculteurs (voir l’encadré « Techniques de semenciers »). « Une répartition des tâches que l’INRA va contribuer à graver dans la roche, explique l’historien des sciences Christophe Bonneuil, autour d’un café montreuillois. Elle orchestre la fin de l’autonomie des paysans qui continuaient à sélectionner eux-mêmes les semences dans leurs champs. » À la station d’amélioration des plantes, à la fin des années 1940, l’équipe d’André Cauderon ne se contente pas de sélectionner les meilleurs épis, elle va « fabriquer » des semences originales, comme c’est déjà la norme aux États-Unis [3]. Les agronomes Luc Alabouvette, Jean Bustarret ou encore Daniel Brisebois s’y rendent d’ailleurs en mission. En croisant la variété récupérée auprès du paysan de Lacaune avec une variété américaine, l’INRA se lance dans la production de maïs hybride.

Les semences de maïs coûteront du blé
Les variétés hybrides offrent un rendement régulier malgré la diversité des sols et des climats. Là où un maïs de pays était adapté à un territoire particulier, le maïs hybride passe partout. Pourtant, les paysans résistent. L’étude sur les paysans du Béarn publiée en 1967 par Henri Mendras dans son célèbre opus La fin des paysans montre que l’augmentation du rendement n’est pas un argument décisif pour eux. Car l’autre particularité du maïs hybride est qu’il dégénère si on utilise les grains issus de la première récolte pour semer à nouveau. Chaque année, il faut donc obligatoirement se fournir en semences de maïs hybride première génération [4]. « Comme on dit souvent : “Il faut l’acheter avant de le récolter, ce maïs.” Le maïs du pays, lui, au contraire ne coûtait que du fumier et du travail », raconte Mendras. Après avoir acheté les semences, il faut encore payer l’engrais (en plus grande quantité que pour du maïs de pays) et donc les désherbants chimiques (plus il y a d’engrais, plus il faut de désherbant). L’hybride accompagne enfin la mécanisation de la récolte. « Sur les 52 agriculteurs motorisés que nous avons interrogés, 43 avaient acheté leurs tracteurs à la suite de l’adoption de l’hybride, tandis que ceux qui ne les ont pas imités ne sont pas encore motorisés. […]. D’autres se sont motorisés, souvent à crédit, et sont venus ensuite à l’hybride, peut-être pour rembourser leur dette », précise Henri Mendras. À l’époque, l’emprunt est presque inexistant chez les agriculteurs, qui le voient comme une marque de mauvaise gestion [5]. Le conseiller agricole fait aussi irruption dans les fermes. Alors que l’agriculteur avait toujours su comment cultiver le maïs, un technicien vient désormais lui apprendre comment apprivoiser le délicat nouveau venu.
Mais dans le Sud-Ouest, qui pâtit d’une réputation de région retardataire et arriérée jusqu’aux années 1970 [6], le maïs hybride est perçu comme une chance pour les plus entreprenants : bientôt les coopératives en pointe atteignent un haut niveau de technicité et se proposent de produire elles-mêmes les semences. Devenues foyers de modernisation, elles incitent à l’adoption des hybrides. Et propulsent localement ce basculement décisif « d’une production domestique autarcique vers une production pour le marché [7]
Avec la propagande de la presse professionnelle, les réunions de vulgarisation et l’imitation entre voisins, le maïs hybride gagne donc finalement la partie : dans l’ensemble du Sud-Ouest, 80 % des agriculteurs le cultivaient en 1958 [8]. « Nom de Dieu, il a fallu que je l’avale, ce maïs hybride ! » s’exclame dans les pages de Mendras un récalcitrant finalement converti. Comme le résument très bien les chercheurs Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas dans le petit ouvrage Semence : une histoire politique, « de même que les ouvriers et leurs syndicats ont globalement consenti, en échange d’un niveau de vie accru, à la modernisation industrielle conduite par les ingénieurs et les directions des entreprises, les paysans français ont acquiescé à leur transformation en “exploitants agricoles” du fait des avantages politiques (une forte influence du syndicalisme agricole sur les politiques des années 1950 et 1960) et économiques (un revenu en hausse jusqu’en 1970 pour les jeunes agriculteurs qui se modernisent, des coopératives qui émancipent les paysans des notables et des négociants d’autrefois) qui en résultaient. Ces années sont aussi celles de l’arrivée dans les campagnes françaises de l’électricité, de la voiture, des appareils ménagers, de l’accès aux soins et aux médicaments. Par rapport à ce qu’était la situation de subordination du métayer moyen à l’égard du propriétaire ou du marchand, le nouvel agriculteur semble à cette époque mieux maîtriser son destin économique (coopératives, accès à la retraite, régulation des marchés) [9]. »
Modèle fordiste et étatisation du biologique
En moins de dix ans, la production est multipliée par quatre. En 1959, la France devient pour la première fois exportatrice de maïs. « Nourrir la France » ? Trop facile ! Il s’agit désormais de « nourrir le monde », pour faire de la « ferme France » une puissance sur les marchés internationaux. « L’objectif [assigné à l’agriculture] est aussi qu’elle produise davantage avec moins d’actifs, afin de libérer de la main-d’œuvre pour l’industrie et le tertiaire, et qu’elle se fasse en retour davantage consommatrice de biens et de services [10] », soulignent Bonneuil et Thomas. L’économiste et ingénieur en agronomie Gilles Allaire, aujourd’hui retraité de son poste de directeur de recherche à l’INRA, parle d’une application du modèle fordiste industriel à l’agriculture : efficacité, gros volumes de production, standardisation des pièces, décomposition des étapes de production, prévisibilité, stabilité de performances élevées [11] « l’INRA organise activement, à la plus grande satisfaction de la filière spécialisée en semences qui s’affirme, l’élimination des variétés de pays de la carte de France, à présent vues comme des obstacles au progrès », reprennent Bonneuil et Thomas [12]. La France a imposé depuis 1932 un « catalogue » recensant les espèces et variétés de plantes autorisées. Seules les semences inscrites peuvent être vendues et même échangées [13]. En 1956, les maïs de pays sont supprimés du catalogue des semences, à l’exception d’Étoile de Normandie et de Millette de Finhan. L’heure est à la standardisation étatique, il ne faut garder que les meilleures : tant pis pour les semences adaptées à tel ou tel terroir.

Aujourd’hui, la région Midi-Pyrénées compte 36 semenciers, dont les firmes internationales Monsanto, Pioneer (venues des Etats-Unis) ou Limagrain (le champion français, poussé par l’INRA) et les grandes coopératives et entreprises régionales comme RAGT et Caussade Semences. « Pioneer : la génétique en marche », peut-on lire sur des panneaux placés en lisière de champs de maïs, le long des routes du Tarn-et-Garonne. Presque tous produisent également des intrants chimiques.
Une utopie technicienne
Dès les années 1970, la critique écologiste se fait entendre. De rares agronomes comme René Dumont ou François de Ravignan [14] (membre de l’INRA Toulouse) « dénoncent la technoscience et la vision naïve du progrès dont elle se réclame [15] ». Un comité de défense de l’INRA est créé contre la subordination de la recherche agronomique au modèle productiviste. En 1979, le département « Systèmes agraires et développement » (SAD) est créé. Pour la première fois, les agriculteurs sont considérés par les agronomes comme des partenaires légitimes de recherche [16]
[16]. Mais, plus largement, il est déjà difficile d’ignorer la question de l’impact du productivisme sur l’état de la planète. Le célèbre rapport dit « du club de Rome » [17]
[17] expose au grand jour « les limites de la croissance » et alimente des réflexions jusqu’au sommet de l’INRA, au contact notamment d’un cercle de réflexion nommé « groupe des dix ». Bonneuil et Thomas racontent : « Pour eux, la crise marque le déclin d’une économie et d’une société basées sur la chimie et la mécanique, et il faut à présent investir sur l’information et les biotechnologies, mettre au service de l’homme les capacités productives des microsystèmes vivants. Prend alors corps l’utopie d’une modernisation économique, écologique et sociétale centrée sur une solution technique, le génie génétique, supposée résoudre l’équation entre croissance et environnement [18]. »
Au tournant des années 1980, l’INRA s’engouffre la tête la première dans les biotechnologies naissantes, qui proposent de modifier les caractéristiques génétiques d’êtres vivants à des fins industrielles (dans les domaines des matières premières, de l’agroalimentaire, de la chimie, de l’industrie pharmaceutique). Les partenariats avec les firmes privées se multiplient et l’INRA fait de plus en plus de place à la recherche « fondamentale » en génétique et biologie végétales. Avec cet argument classique : si nous ne le faisons pas nous-mêmes, les Américains le feront pour nous. C’est l’époque où les chercheurs, enthousiasmés par les progrès des cultures in vitro [19], commencent à rêver de semences totalement artificielles pour générer des plantes parfaites.

La controverse autour des OGM symbolise pourtant le premier coup d’arrêt porté à la toute-puissance de l’INRA. Dès 1987, des expérimentations en plein champ sont menées. Les plantes génétiquement modifiées incarnent le nouveau virage modernisateur, le progrès que les agriculteurs français sont bientôt censés mettre massivement en œuvre. La modification qu’elles subissent doit leur permettre de mieux fixer l’azote ou de résister aux maladies, et elles incarnent à ce titre les promesses de la nouvelle économie « verte ». Où l’on produit plus tout en limitant drastiquement les besoins en engrais et en produits phytosanitaires [20]
[20]. Après une dizaine d’années, les multiples mobilisations vont faire subir une série de défaites à ce projet : autorisations de mise sur le marché retardées, moratoire sur la mise en culture commerciale, questionnement officiel sur les impacts. Les promoteurs des OGM en France doivent se résoudre à constater que la conversion massive des champs français à leur technologie génétique n’est pas pour aujourd’hui. « La crise de légitimité qui s’en est suivie a permis le renforcement de préoccupations, voire de stratégies d’innovation, autrefois marginalisées, qui obtiennent alors droit de cité au sein de l’INRA (recherches pour l’agriculture biologique et l’agroécologie, sélection participative et gestion dynamique à la ferme de la biodiversité cultivée) », analysent Bonneuil et Thomas.
Si douce intensification écologique
Terme popularisé par le mouvement international paysan Via Campesina pour définir des pratiques de résistance au productivisme, l’agroécologie subit aujourd’hui dans les programmes de l’INRA un travestissement sémantique. Les nouvelles « prises de conscience » face au changement climatique et aux dégâts causés par les produits chimiques [21]
amènent le gouvernement socialiste à miser sur le terme d’agroécologie dès la fin 2012. Jusqu’alors insensible à la question, l’INRA doit vite suivre le mouvement et identifier les projets qui pourraient être mobilisés sous cette étiquette. Quelques axes de recherche moqués auparavant se retrouvent soudain dans la lumière, mais rien ne change dans l’affectation des moyens et des postes. En 2014, l’INRA débloque finalement 700 000 euros pour onze projets de recherche sur l’agriculture biologique, soit environ 0,08 % d’un budget annuel, qui approche les 900 millions d’euros.
La définition de l’agroécologie retenue par le gouvernement associe « bon niveau de rendement » et « réduction des engrais de synthèse », pour rester « en phase avec les besoins alimentaires ». L’INRA lui donne aussi le doux nom d’« intensification écologique ». « En 2050, il n’y aura pas assez de production alimentaire pour nourrir le monde », justifie André Gravaland, responsable du domaine expérimental de l’INRA Toulouse-Auzeville, faisant mine d’oublier que surproduction et famine cohabitent déjà très bien. « On n’est plus dans l’affrontement entre agronomie et écologie, agriculture productiviste et écosystème, mais dans leur réconciliation », se félicite son supérieur en 2013 dans le quotidien Le Monde [22].
Le 17 juin 2015, le fleuron de la recherche agricole consacre à cette « réconciliation » une journée de présentation à Auzeville, sur l’agrobiopôle toulousain. On y découvre des expérimentations de cultures associées : cultiver ensemble une céréale et un protéagineux, comme la lentille et le blé ou encore le soja et le tournesol. Bien meilleure pour les sols et la biodiversité, cette association permet de contrer la monoculture céréalière, destructrice des sols. « Nous avons perdu le savoir-faire paysan. Avant, ils faisaient tous ça », reconnaissent les agronomes qui font la visite. Étrange époque. Le petit programme « Mic Mac » propose d’ajouter à ce principe de cultures associées un robot permettant de désherber mécaniquement les champs – sans produits, donc. « Sur l’essai 2014-2016, on a fait de la vraie écologie, on a des semences non traitées », se félicite le très enthousiaste chercheur Eric Justes. Une réflexion qui n’a cependant d’yeux que pour la grande culture céréalière : les petites fermes n’existent pas dans le cadre de pensée dominant de l’INRA.

Un champ de robots sous un ciel de drones
« L’agriculture de demain, c’est l’agroécologie, qui va mobiliser aussi bien l’agronomie que la robotique, le bio-contrôle, les biotechnologies et le numérique », déclare François Hollande en février 2015 [23]. Une déclinaison de l’agroécologie que l’on devine plus proche de la Silicon Valley que de la Via Campesina. Sur le terrain, l’INRA s’occupe d’appareiller les champs de tout un tas d’outils informatiques, et promeut « l’agriculture de précision ». L’alliance de la localisation par GPS, d’un progiciel (un logiciel professionnel de gestion) intégré au tracteur et des photos satellite est présentée comme le moyen de produire autant avec moins de produits. En effet, sans cet appareillage, les agriculteurs sont tentés d’arroser leurs parcelles au maximum afin de garantir le rendement. Grâce à la connaissance, mètre carré par mètre carré, de l’état de leur champ, leur logiciel calcule la dose nécessaire. Ni plus ni moins : le produit n’a pas disparu, mais la dose se veut parfaite. Un jeune salarié agricole, rencontré quelques semaines avant dans la ferme tarnaise de son père, raconte : « Je bosse dans une exploitation ultramoderne, le top de ce qui se fait aujourd’hui. En gros, mon boulot, c’est de faire faire le demi-tour au tracteur au fond du champ. Le logiciel ne sait pas encore faire les demi-tours. Par contre, le tracé est programmé, les quantités de produit sont calculées automatiquement. Un capteur vérifie que je suis bien assis dans le fauteuil, alors je ne peux pas descendre, mais le tracteur n’a pas besoin de moi. L’état des plantes est vérifié par des photos satellite, ça permet d’ajuster les traitements. On jette un œil quand même dans le champ, mais le logiciel ne se trompe quasiment jamais. D’ici une dizaine d’années, peut-être qu’on n’aura plus besoin de moi. » Bien que ces techniques sophistiquées et coûteuses ne concernent que 10 % des exploitants – les plus gros – , l’INRA met les moyens pour perfectionner cette machinerie déjà à la mode de l’autre côté de l’Atlantique. Monsanto a ainsi racheté en 2013 une entreprise de « big data », Climate Corp., qui s’est spécialisée dans l’agriculture de précision. L’un des patrons de cette boîte est un ancien de Google [24].
Aujourd’hui, les chercheurs affinent leur argumentaire en faveur de l’utilité d’un nouveau joujou : le drone. Pour l’instant, il s’agit de petits hélicoptères télécommandés sur lesquels s’accroche un appareil photo. Contrairement au satellite, le drone peut photographier même lorsqu’il y a des nuages. Celui utilisé au centre d’Auzeville a de belles formes arrondies. Estampillé « Agriculture intensive durable », il a été prêté par le constructeur Airinov. Ce 17 juin, il ne peut pas voler car « les rafales à 40 km/h le déstabilisent trop ». « C’est pour ça que ce serait mieux si les exploitants en avaient chez eux, car, lorsqu’ils font appel aux prestataires, on ne sait jamais quelle sera la météo », avance l’ingénieur Philippe Burger.
Ce n’est pas pour aujourd’hui, vu les réglementations de vol encore très restrictives. En attendant, généticiens et roboticiens s’entendent bien. Les premiers veulent obtenir des informations toujours plus précises sur l’apparence des plantes qu’ils trafiquent ; les seconds proposent des solutions techniques pour obtenir ces informations sans même qu’un humain ait à s’approcher des plantes. Invités et chercheurs de la journée de présentation à l’INRA s’enthousiasment donc pour ce drone sachant « observer sans détruire », ou pour ce robot recueillant tout seul des données dans les champs que l’institut devrait acquérir en 2016. « Bientôt il n’y aura plus aux champs de gens qui savent observer les plantes. C’est angoissant. », commente Isabelle Goldringer, chercheuse de l’INRA qui participe au contraire à une expérience minoritaire de sélection à la ferme, en association avec des paysans.

Les semenciers sont aux premières loges, comme Antoine Bedel, « chef produit fourragères » chez Caussade Semences, invité de la table ronde qui clôt cette journée consacrée à l’informatisation de l’agriculture. À ses côtés, un roboticien du LAAS (néophyte du domaine agricole mais « expert » ès robots) et le responsable du pôle agronomie de Qualisol, une coopérative agricole férue de technologie et d’agriculture raisonnée [25]– qui vend aussi des produits phytosanitaires. L’INRA sait s’entourer. Le négociant en semence, ne s’embarrasse pas de l’enrobage écolo du jour : « L’agroécologie, ça nous rajoute du temps et de la main-d’œuvre. » Pourquoi s’embêter avec ces bêtises environnementales et perdre du profit ? Par contre, la high-tech, c’est l’avenir. « Tout le monde va s’y mettre, comme pour le i-Phone. »
C’est ainsi que les paysans, toujours plus éloignés de leurs terres, se retrouvent devant des machines électroniques dont ils doivent gérer les bugs et les mises à jour. Quid du savoir-faire, du rapport à la terre, des liens avec les générations précédentes ? Les agriculteurs ont-ils encore le choix de faire ce métier sans dix mille capteurs qui calculent à leur place ce que demande la terre ? Le collectif Faut pas pucer s’interroge : « A-t-on choisi de devenir éleveur pour se retrouver derrière un ordinateur ? » Aujourd’hui, ces éleveurs de brebis et leurs soutiens se battent pour ne pas identifier leurs animaux avec des puces électroniques, comme le veut la réglementation depuis 2010 [26]. D’autres paysans, selon la même démarche d’autonomisation, proposent de réintroduire la sélection à la ferme. « Les semences de maïs coûtent très cher, et c’est avec cet argent-là que les semenciers financent les recherches sur les OGM et les autres technologies similaires, signale Raphaël, paysan savoyard qui sélectionne lui-même ses semences. Si tu ne leur achètes pas de semences, tu leur mets un petit grain de sable dans la mécanique [27].
Encadré 1
TECHNIQUES DE SEMENCIERS ?
Trois métiers différents interviennent en amont de la culture du maïs.
Le sélectionneur-obtenteur est celui qui choisit ou élabore la variété de maïs.
Le multiplicateur est un agriculteur qui cultive une céréale dans le seul but d’en extraire les semences, afin de les vendre à un négociant.
Le négociant, de son côté, revend les semences à la masse d’agriculteurs qui cultivent le maïs afin de le vendre en tant que tel.
Le semencier est l’entreprise qui maîtrise l’ensemble du processus, soit qu’elle intègre les trois métiers dans son organisation interne, soit qu’elle s’appuie sur des agriculteurs sous contrat pour multiplier et sur des réseaux de commercialisation (type Gamm Vert) pour vendre ses semences.
Encadré 2
LIGNÉES PURES
En plein air, pour donner naissance à une nouvelle plante, un individu maïs en féconde un autre, ce qui entraîne une diversité génétique, même au sein d’une population relativement homogène. En quête d’une plante standardisée – « homogène » et « stable », selon la nomenclature officielle –, les chercheurs ont mis en place une démarche de sélection qui aboutit au maïs hybride, appelé aussi « hybride F1 ». D’abord, l’humain force la plante à s’autoféconder (en l’entourant d’un petit sac plastique empêchant tout contact avec le pollen d’un autre individu maïs), ce qui garantit un patrimoine génétique quasiment identique sur plusieurs générations d’une même lignée : c’est une « lignée pure ». Au bout de quelques générations, on croise deux de ces « lignées pures », éloignées génétiquement entre elles de préférence, et ce croisement donne les semences hybrides diffusées aux agriculteurs.
Encadré 3
ÉVANGÉLISER À COUP DE FONDS PUBLICS
Le site Internet de l’INRA Toulouse présente fièrement la société DECIDAE, fondée en 2014 grâce au programme d’aides gouvernemental « Investissement d’avenir ». Elle fédère des compétences précieuses, telles que celles de Météo France, d’Agricampus, mais aussi de la Compagnie d’aménagement des coteaux de Gascogne (CACG), responsable du fiasco des barrages de Sivens et du col del Four [*], ou encore du Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes (LAAS), le lieu de la robotisation du monde [**]. Ces experts de tout poil sont réunis dans une boîte privée abreuvée de fonds publics, et ce afin d’affiner les nouvelles pépites technologiques vouées à envahir les champs. Et d’imaginer comment les faire passer, en s’appuyant sur des « living labs » permettant « d’accroître l’acceptabilité des innovations ».
Encadré 4
DÉCLARATION DE LA PRÉSIDENCE DE L’INRA
Institut National de la Recherche Agronomique
741, rue de l’Univers Cité
75336 Paris Cedex 07
www.inra.comDéclaration de la présidence
Fermeture définitive de l’Institut national de la recherche agronomique
Paris, le 22 avril 2016
Le fleuron national de la recherche agronomique que j’ai eu l’honneur de diriger ces quatre dernières années s’apprête à fêter son soixante-dixième anniversaire. Je tiens avant tout à saluer les équipes de recherche qui ont porté si haut le flambeau de l’excellence pendant ces sept décennies. Leur détermination et leur courage en cette époque agitée mériteraient tous les honneurs. L’heure n’est pourtant pas à la fête. Des décisions difficiles s’imposent, dans un esprit de responsabilité, le seul qui convienne face à l’ampleur des troubles que traverse notre institution.
Dans nos territoires, l’autorité de l’État est chaque jour remise en cause. Les échanges sauvages de semences se multiplient, il n’est plus un seul projet d’infrastructure qui ne soit bloqué par des opposants irresponsables. Un institut comme le nôtre n’a de sens que si l’État se donne les moyens d’appliquer partout les recettes que nous inventons pour l’agriculture de demain. Après des années de fauchages, ce sont maintenant nos drones qui sont abattus en plein vol expérimental. Est-il encore possible de chercher en sécurité, ou devrons-nous désormais vivre sous la menace permanente des terroristes verts, devenus innombrables ?
Partout dans le monde, l’agriculture que nous défendons pour répondre aux enjeux du changement climatique est contestée. Les populations locales, manifestement mal informées, rejettent le développement massif des biocarburants de deuxième génération. Dans un réflexe égoïste, les paysans semblent déterminés à défendre leurs petites cultures vivrières, au détriment de la production mondiale nécessaire au soutien d’une industrie automobile déjà en difficulté. La semaine dernière, le gouvernement brésilien, aux prises avec la violence de rébellions et d’occupations de terres sans précédent, a lâchement demandé au reste du monde de cesser de prendre son pays pour un terrain de jeu et annoncé que, dorénavant, la terre serait à ceux qui la travaillent. Force est de reconnaître que cette déclaration scandaleuse remet en cause la possibilité même de la poursuite des programmes INRA liés de près ou de loin aux agrocarburants.
La belle maison que je dirige a œuvré depuis ses origines afin que le progrès scientifique soit toujours au service des grands enjeux agricoles, via une synergie forte avec les acteurs privés. Aujourd’hui, ils sont injustement mis en cause. Les prétendument agriculteurs victimes des pesticides qui n’ont de cesse de poursuivre nos partenaires industriels sont surtout des paysans malhabiles. Ayant déjà fait un mauvais usage de produits pourtant bien utiles si on y fait un petit peu attention, ils mettent maintenant en danger la profession par leur acharnement judiciaire. Comment continuer à innover si les tribunaux vous condamnent pour les trouvailles du siècle passé ? La reconnaissance officielle de la maladie de Parkinson comme maladie professionnelle liée aux pesticides est également un coup porté à ceux qui travaillent à une agriculture plus performante. La mobilisation « citoyenne » prend de l’ampleur pour que la liste des produits interdits s’allonge indéfiniment. Résultat : les investisseurs désertent le secteur des biotechnologies, où le retour sur investissement est chaque jour plus incertain. À quoi bon faire fonctionner un institut de recherche public s’il n’y a plus d’entreprises privées pour mettre à profit ses résultats ?
Débouchés commerciaux en déroute, crises diplomatiques sans fin, occupations mesquines de nos locaux toulousains par d’obscurs contestataires : le vase était presque plein. La grève déclenchée le mois dernier par une partie du personnel, sous le prétexte fallacieux de ne vouloir « ni participer ni cautionner » une recherche qui se ferait « contre la société », fut le coup de grâce. J’ai donc présenté ma démission au président de la République, qui l’a acceptée et m’a chargé de vous informer de la fermeture définitive de l’Institut national de la recherche agronomique.
François Boulet, président de l’INRA
[1] Sur les décombres de l’Institut des recherches agronomiques, lui-même fondé en 1921
[2] Cette sélection des plus beaux épis au sein de la récolte, d’année en année, constitue ce qu’on appelle la sélection massale
[3] En 1930, au congrès international du maïs à Pau, Charles de Carbonnières, gros exploitant du Tarn, se fait le chantre des avancées américaines en matière d’hybride. Alors inexistant en France, celui-ci recouvre déjà 90 % de la surface cultivée des Etats-Unis.
[4] Une opération qui, associée aux brevets déposés sur ces semences, revient à privatiser le vivant en confiant sa reproduction à des entreprises, comme l’a le premier dénoncé l’ancien agronome de l’INRA Jean-Pierre Berlan. Voir La Guerre au vivant. OGM et mystifications scientifiques, Agone, 2001, et sa « Lettre ouverte aux agriculteurs progressistes qui s’apprêtent à semer du maïs transgénique », disponible sur www.infogm.org
[5] Les emprunts représentent 2 % des charges des agriculteurs en 1954, contre 21 % en 1974. Source : Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, Semences : une histoire politique éditions Mayer, Paris, 2012. p. 117.
[6] Avant l’essor de l’élevage intensif de volaille.
[7] Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, op. cit., p. 83.
[8] Henri Mendras, La fin des paysans, réédition de 1984 chez Actes Sud, Arles. p. 165.
[9] Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, op. cit., p. 67.
[10] Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, op. cit., p. 36.
[11] Voir l’article de Gilles Allaire, « Émergence d’un nouveau système productif en agriculture », publié en 1996 dans la Revue canadienne d’agroéconomie. Cité dans Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, op. cit.
[12] Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, « L’introduction du maïs hybride en France : une technologie fordiste », in Sciences, chercheurs et agriculture. Pour une histoire de la recherche agronomique. Quae-L’Harmattan, 2008, p. 169.
[13] Excepté, pour l’instant, les échanges en vue de la sélection, la conservation, l’expérimentation et l’autoconsommation de la récolte.
[14] Auteur des ouvrages Les Sillons de la faim, 1980, La Faim, pourquoi ?, 1983, et L’intendance ne suivra pas, 1988.
[15] Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, op. cit., p. 119.
[16] Le département SAD existe encore et a la réputation parmi les autres chercheurs d’être « anti-progrès ».
[17] Donella H. Meadows, Dennis L. Meadows, J. Randers et W. W. Behrens III, Halte à la croissance ?, Paris, Fayard, 1974. Ce rapport, commandé par le Club de Rome, a été réalisé par une équipe du Massachusetts Institute of Technology, à l’aide d’un modèle informatique de prévision.
[18] Christophe Bonneuil et Frédéric Thomas, « Du maïs hybride aux OGM. Un demi-siècle de génétique et d’amélioration des plantes à l’INRA », intervention au colloque « L’amélioration des plantes, continuités et ruptures », Montpellier, octobre 2002.
[19] En laboratoire, par opposition à in vivo, aux champs
[20] Trente ans plus tard, l’un des seuls types de caractères présents dans les OGM commercialisés est la tolérance au glyphosate (les fameux Round-up Ready), qui permet à la plante de tolérer une quantité toujours plus importante d’herbicide total, du type Round-up de la firme Monsanto.
[21] Les dégâts des nombreux produits aspergeant les champs et les agriculteurs finissent par être reconnus. En février 2012, la victoire d’un céréaliculteur charentais, Paul François, qui avait intenté un procès contre le géant américain Monsanto a constitué une première en France. La firme a été jugée responsable de l’intoxication de l’agriculteur par les vapeurs d’un de ses herbicides, le Lasso – retiré du marché en 2007 en France, alors que sa dangerosité était connue depuis plus de vingt ans.
[22] Philippe Lemanceau dans l’article d’Angela Bolis « L’agroécologie, un chantier prioritaire pour l’INRA », Le Monde, 24 avril 2013.
[23] Dans une interview à l’agence de presse agricole Agra Presse.
[24] Voir l’article paru le 9 avril 2015 dans le quotidien britannique The Guardian, « Can Monsanto’s big data play really help farmers and the environment ? ».
[25] Lancé en 2002, « Agriculture raisonnée » fut le nom d’un label certifié sous contrôle de l’État, concurrent de celui d’ « Agriculture Biologique », avec un cahier des charges très réduit. Sa promotion en était faite par un réseau (le FARRE) dont sont membres actifs la FNSEA, plusieurs semenciers et marchands de pesticides, entre autres. Le label a été supprimé en 2013, et le FARRE s’est mis à parler d’agroécologie.
[26] Le collectif Faut pas pucer réunit, depuis 2009, des collectifs de paysans et d’individus hostiles à la numérisation de toutes les activités. Voir les entretiens avec des bergers publiés dans le premier numéro de Z sous le titre « Mes brebis comme des machines » ou encore « Les androïdes rêvent de moutons électriques. Pas nous ! », texte publié dans le Z n° 8 de l’été 2014.
[27] Citation tirée du texte « Des graines dans les rouages », écrit par Alexandre Hyacinthe dans le Z n° 6, automne 2012. Un article qui explore les stratégies de résistance à partir d’une ferme haute-savoyarde où se cultivent des céréales non standardisées.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (9.7 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (10.7 Mo)