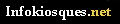Brochures
Guerre à l’IA !
L’industrialisation de l’« intelligence artificielle », stratégie des bourgeoisies dans un capitalisme de plus en plus brutal
mis en ligne le 23 septembre 2025 - Anonyme
Sommaire :
Démocratiser l’IA, pour qui et pour quoi faire ? (page 2)
L’« intelligence artificielle », au service de la militarisation de la société capitaliste (page 5)
La généralisation de la surveillance de masse et de l’autoritarisme par l’IA en france (page 8)
Sur les infrastructures nécessaires à l’IA : data-centers, usines à IA et supercalculateurs (page 13)
Même les data-centers peuvent brûler… (depuis sansnom.noblogs.org) (page 19)
(Annexe) Quelques exemples des innovations des entreprises militaires en matière d’IA (page 21)
(Annexe) Le profil de Cédric O : figure de la politique française actuelle en matière d’IA (page 23)
(Annexe) « Les sites clés en main France 2030 » (page 25)
(Annexe) Quelques réflexions sur la question de l’approvisionnement électrique de l’IA (page 29)
(Annexe) Au sujet des techniques de climatisation et de refroidissement des data-centers (page 30)
Démocratiser l’IA, pour qui et pour quoi faire ?
Les IA génératives (comme ChatGPT, DeepSeek, Mistral IA ou d’autres) sont de plus en plus utilisées pour nous faciliter la vie, notamment face aux contraintes de l’école et de l’emploi. Beaucoup les utilisent pour faire une affiche complexe à partir d’une idée simple, rédiger un exposé, écrire une lettre de motivation, synthétiser les grandes lignes d’un sujet qu’on a pas eu le temps de réviser… Certain.e.s s’en servent même pour écrire leurs ruminations afin que l’appli les aident à mettre de l’ordre dans leurs pensées et leur fasse des recommandations (qui, comme on l’imagine, vont toujours dans un sens qui nous amène à continuer à utiliser l’application). Plus besoin de rompre avec un quotidien invivable le temps d’une randonnée en forêt ou de chercher de l’aide auprès de personnes qui respectent nos aspirations, on peut laisser l’application faire le point sur notre vie. Un peu comme avec les centrales nucléaires et la généralisation du chauffage électrique dans les logements, on a le droit à un confort supplémentaire pour aménager notre cage (pas si) dorée dans la société du travail. Et tout cela sans en savoir plus sur les fondements étatiques de ces technologies : leurs intérêts militaires, industriels et policiers qui nous empoisonnent la vie. On prendra du temps dans cette brochure pour faire ressortir ce « cadavre dans le placard » de l’IA.
Il est difficile de deviner les conséquences que peuvent avoir l’industrialisation de l’IA financée par des plans d’investissement à coups de centaines de milliards. Selon l’économiste Claude Serfati, l’IA « offre / aux États / des potentialités d’utilisation contre les êtres humains dans tous les domaines de leur vie en société en tant qu’ils sont à la fois salariés, citoyens et ‘civils’ menacés par les guerres ». Pour le politiste Félix Tréguer, spécialiste de l’histoire d’internet et des innovations algorithmiques, elles accentuent le contrôle social et la fonction policière des services administratifs de l’État et de l’économie [1]. Un rapport de sénateurs et sénatrices français.e.s de juin 2021, après la crise sanitaire, donne une idée des fantasmes qu’ils et elles aimeraient voir à l’œuvre avec le développement de l’IA. Il est question d’exploiter des données génétiques pour identifier les personnes supposément réceptives à un variant très rare d’un virus ou à un vaccin, ainsi que les dossiers médicaux de chacun pour administrer des traitements médicaux adaptés selon certaines déductions. Il est également question de contrôler les déplacements (détection automatique de la plaque d’immatriculation par les radars, portiques de contrôle dans les magasin, contrôle des fréquentations via l’utilisation obligatoire d’appareils connectés, contrôle des transactions…).
Le « cadavre dans le placard » de l’IA a été dénoncé par les mobilisations des employé.e.s de Google et d’Amazon contre les usages militaires qu’ils et elles participent à produire. En 2018, 3000 salarié.e.s de Google publient une lettre ouverte demandant à leurs patron.ne.s qu’ils et elles ne soient pas impliqué.e.s dans le business de la guerre. On pourrait penser que cette initiative porte ses fruits : un partenariat public d’IA militaire entre Google et le département américain de la Défense est rompu et la charte de Google inscrit que leurs travaux en matière d’IA ne doivent pas être utilisés pour développer « des armes ou d’autres technologies dont le but principal ou la mise en œuvre est de causer ou de faciliter directement des blessures à des personnes ». Mais une enquête récente a dévoilé que Google (mais aussi Amazon et Microsoft) proposent des services pour héberger les données de l’armée israélienne en lien avec la surveillance de masse en Palestine. En réaction, une lettre anonyme de 300 salarié.e.s d’Amazon et de 90 salarié.e.s de Google, parue dans The Guardian, réitère la demande d’arrêter de collaborer avec l’armée israélienne, et appelle plus généralement à cesser de contractualiser avec toutes les organisations militarisées et celles qui « facilitent les activités de surveillance et de contrôle ». Ils y dénoncent une tendance à la militarisation (en évoquant des contrats avec le ministère américain de la Défense, l’Agence américaine de contrôle des frontières et des douanes, des services de polices locaux).
Après plusieurs actions de désobéissance civile autour du slogan « No Tech For Apartheid », réprimées par la police, je ne sais pas où en est ce mouvement. Mais Google assume ouvertement sa participation à la militarisation en supprimant le 4 février 2025 le principe de leur charte qui laissait entendre l’inverse. Il sont ainsi clairs sur le fait qu’ils et elles font comme toutes les autres grandes entreprises du secteur. Bien qu’empreint de citoyennisme (par l’appel aux autorités publiques pour s’opposer à cette collaboration de Google) et de technophilie (en portant l’idée que l’IA devrait servir à tout le monde et non à la guerre), ces mobilisations ont le mérite de contester le fait que ces technologies servent des intérêts capitalistes qui nous dépassent, et consistent notamment à nous faire la guerre. Ces applications d’IA génératives s’alimentent et se renforcent grâce aux usages de chaque utilisateur individuel (qui font travailler leurs algorithmes et alimentent leurs banques de données). À l’inverse, les industriels qui achètent des usages de ces applications peuvent disposer d’une version privatisée des bases de données de l’application ou s’en servent avec une sécurisation de bout en bout. Ainsi leurs données sont protégées. En utilisant des IA génératives, on ne contribue pas au patrimoine commun de l’humanité, mais plutôt aux intérêts des industriel.le.s et des gouvernant.e.s.
Dans les domaines industriels et administratifs, les usages sont multiples. Dans certains secteurs (notamment des grands groupes qui produisent en masse), ces technologies améliorent la planification de la production. Les chaînes de production peuvent être simulées pour tester des changements et des mises à niveau afin d’optimiser au maximum le temps de production. Mais c’est surtout pour tout ce qui est traitement de données écrites et textuelles que l’IA générative leur fait gagner beaucoup de temps : pour écrire des compte-rendus de réunions, gérer des agendas, assimiler des rapports de réunion, des retours d’interventions techniques, des documents techniques, et en dresser des résultats et des recommandations. Ils servent également à générer des publications destinées à la communication de masse par email ou sur les réseaux sociaux. Il est difficile de savoir tous les usages que peuvent avoir l’IA dans l’économie étant donné que les grands groupes l’utilisent depuis seulement quelques années et que l’industrialisation de l’IA ne fait que commencer. L’enjeu d’acceptation de ces technologies concerne aussi leur utilisation par des petites entreprises (PME) souvent sous-traitantes de grands groupes dans une chaîne de production plus vaste.
On peut considérer que l’IA repose, comme l’ensemble des applications des conglomérats industriels numériques, sur un vol massif de données au profit des industriels. Elles leur servent à potentialiser leurs technologies et à faire du profit. Quelques jours après l’investiture du président des états-unis Donald Trump en 2025, de nombreux « executive orders » (l’équivalent d’un décret présidentiel) ont été abrogés pour passer au-delà de la protection de données personnelles aux états-unis (ainsi que dans l’union européenne). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si chaque puissance (inter)étatique essaye de trouver sa propre application ouverte en IA : comme l’état français (et avec lui l’union européenne) avec l’application « Le Chat » de l’entreprise Mistral IA. Pour ne pas nourrir ces technologies d’IA avec nos données, il faudrait également déserter toutes les applications dont les propriétaires développent des algorithmes d’IA (comme Google, Apple, Microsoft, suite Office, Youtube, Gmail, Bing, Linkedin, Outlook, Facebook, Instagram, Messenger, Twitter, Snapchat, Spotify...). Si l’on a l’habitude de se servir d’un smartphone comme d’une prothèse technologique constante, on leur donne des données innombrables sur nos relations, nos déplacements, nos opinions, nos habitudes ou le rythme de notre corps. Qu’il s’agisse de l’état américain, de l’état russe, de l’état chinois ou de n’importe lequel, ces données serviront à contrôler leurs populations respectives et à faire la guerre aux populations assignées à ces États rivaux.
L’« intelligence artificielle », au service de la militarisation de la société capitaliste en france comme ailleurs
Les marchés de la guerre font de la militarisation un terrain propice pour les industries qui produisent des armes (et pour les intermédiaires politiques qui négocient les conditions de leurs ventes). Ça booste la croissance nationale et le Produit Intérieur Brut et ça fait partie de l’effort collectif pour lequel chaque « citoyen » est sommé d’accepter voire de contribuer pour le profit des vampires qui commandent. C’est d’autant plus le cas lorsque ces guerres permettent d’acquérir des minerais indispensables à l’économie. Rien d’étonnant à ce que la militarisation s’accentue dans un contexte de limites des ressources que la civilisation capitaliste consomme dans sa quête infinie d’accumulation de profit. Si l’avenir nous apparaît cauchemardesque, c’est aussi parce que le capitalisme arrive aux limites de ses crises. Il nous appartient d’intervenir pour contribuer à ce que ce système ne surmonte pas ces crises par toujours plus de brutalisation ; et de partager des manières de vivre-ensemble qui désertent les cadres autoritaires, nationalistes, industriels et militaristes qui reposent sur les mêmes structures que les états-nations.
Ceci étant dit, l’« intelligence artificielle » est une solution technologique qui se place au coeur de ces enjeux. Dans les territoires d’ukraine, où la guerre contre les armées russes perdure, les entreprises qui y prennent part disposent d’un terrain de mise en pratique qui donne à leurs produits une valeur ajoutée. Selon Laure de Roucy-Rochegonde, chercheuse à l’Institut français des relations internationales : « Toutes les entreprises spécialisées dans l’IA de défense se ruent en Ukraine, car c’est l’occasion pour elles de tester leurs produits sur le terrain et de récolter énormément de données opérationnelles, une mine d’or ». Les guerres, pour les armées et les entreprises qui développent et se servent de ces technologies deviennent donc de nouveaux terrains d’exploitation pour engranger de la donnée sur de potentiels adversaires. Cet enjeu n’échappe pas au ministère ukrainien de la Défense qui propose à toute armée ou entreprise pouvant les soutenir dans leur guerre en la présentant comme « un gisement précieux d’informations : les millions d’heures de séquences filmées par leurs drones », « de quoi repérer 12 000 équipements russes par semaine ».
Les IA militaires permettent de détecter plus rapidement des cibles et de les neutraliser, tout comme elles permettent d’approfondir le ciblage et d’améliorer les possibilités d’attaque [Voir en annexe quelques innovations militaires d’entreprises d’IA des économies américaines et européennes]. Pour Antoine Bordes, vice-président de l’entreprise militaire Helsing : « Les cycles d’innovation dans le domaine militaire prennent des années, voire des dizaines d’années. Là en deux ans de conflit, on a déjà eu plusieurs révolutions technologiques sur la façon de faire la guerre ». Les données collectées pour la surveillance de masse en palestine par l’armée israélienne (et hébergées par Amazon, Google et Microsoft) servent notamment à évaluer chacun.e suivant la probabilité qu’il soit un.e membre du hamas, ou selon la probabilité qu’un téléphone soit celui d’un.e membre du hamas. En fonction, l’armée israélienne choisit de cibler ou non une personne par frappe aérienne, d’artillerie, ou par drone (avec un nombre de mort.e.s civil.e.s acceptables aux alentours, soit 15 à 20 morts pour un membre « junior » suspecté du hamas) [2]. À l’aide de cette technologie, les ripostes de l’armée israélienne aux massacres du 7 octobre 2024 se sont faites d’une manière quasi automatisée en ciblant ce que les algorithmes analysaient sur le moment.
Les technologies d’IA transforment les guerres et les manières de faire la guerre, et cela concerne aussi les armées françaises. Depuis 2018, les entreprises militaires et numériques Thales et Atos, par le biais de leur société commune Athea, travaillent au programme d’IA militaire « ARTEMIS » lancé sous la direction de l’ancienne ministre des armées Florence Parly. Elles étaient chargées de fédérer toute une chaîne de production parmi des start-ups, PMEs, grands groupes, organismes de recherche divers (dont l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, le Centre national de la recherche scientifique ou le Commissariat à l’énergie atomique). Ce projet a abouti au programme Scorpion : l’interconnexion des armements de ces armées par, selon les mots de l’ancienne ministre, de « multiples capteurs embarqués dans les avions de combat, les véhicules blindés, les satellites, les frégates… ». Les informations remontent par leurs capteurs afin d’identifier et de neutraliser un ennemi plus rapidement.
Parmi 2 milliards d’euros consacrés par l’état français pour l’IA de défense entre 2024 et 2030, 300 millions d’euros par an sont destinés à la création de l’Agence ministérielle pour l’intelligence artificielle de défense (Amiad). Dirigée par Bertrand Rondepierre, auparavant employé du laboratoire d’IA de Google (DeepMind), elle devrait mobiliser d’ici à 2026 300 ingénieurs, chercheurs et doctorants civils et militaires afin de « conceptualiser, voire fabriquer l’intelligence artificielle dans les grands programmes militaires, actuels comme futurs ». Dans ce cadre, une IA générative sous le nom de « GénIAl » a été créée pour les agents du ministère des armées et les anciens combattants dès fin 2024. Il s’agit de numériser et d’automatiser tous les documents qu’ils utilisent, et de gérer les populations de soldats et les fonctionnaires de l’armée via leurs téléphones personnels. Le pôle de recherche de l’Amiad serait basé à Palaiseau (Essone, 91), sur le site de l’École Polytechnique, et son pôle technique à côté de Rennes (Ille-et-Vilaine, 35). Cette agence disposerait d’un « super calculateur classifié » situé sur le Mont-Valérien à Suresnes (Hauts-de-Seine, 92) qui « permettra de traiter souverainement des données secret-défense ».
Dans la continuité du programme ARTEMIS, le projet d’IA militaire de Thales nommé « CortAIx » a été financé à hauteur de 500 millions d’euros par le ministère des armées pour la période 2019-2025. Le 21 janvier 2025, Thales a ouvert les portes du CortAIx Lab à Palaiseau (sans doute en relation avec l’Amiad) pour faire de l’innovation en IA et en faire profiter ses clients dans les domaines de la défense, l’aéronautique, l’aérospatial et la sécurité, qui concernent à la fois le militaire et le civil. 600 chercheurs et ingénieurs y travaillent (pour certains ailleurs qu’à Palaiseau). Selon son PDG Patrice Caine : « Nous sommes le premier déposant européen de brevet en IA dans nos secteurs d’activité et nous avons déjà une centaine d’usage réels, intégrés ou en cours d’intégration ». Thales a déjà développé plus de 100 produits embarquant de l’IA dans la lutte anti-drones, le contrôle automatique d’essaims de drones, le perfectionnement des radars pour réduire le nombre de fausses alertes et des sonars pour mieux distinguer les mines, biométrie, amélioration des communications… Lors du dernier salon de la défense et de la sécurité Eurosatory, Thales et le CEA-List (la filière du CEA spécialisée dans l’IA) ont annoncé un partenariat pour introduire de l’IA dans le commandement des opérations militaires et accélérer la prise de décision sur le champ de bataille.
La généralisation de la surveillance de masse et de l’autoritarisme par l’IA en france
Depuis plusieurs années, Thales et Idemia s’allient avec l’INRIA et la Préfecture de police de Paris pour travailler à la reconnaissance faciale, au contrôle des foules, et d’autres applications de ce type. L’ancien secrétaire d’État au numérique Cédric O, et actionnaire de la société d’IA Mistral [voir son profil présenté en annexe], favorise dans les parlements l’application de ces technologies car « expérimenter la reconnaissance faciale est nécessaire pour que nos industriels progressent ». Celui-ci a participé à négocier les conditions du règlement européen sur l’« intelligence artificielle » (IA Act), entré en vigueur le 2 février dernier, qui pose un cadre pour que les États européens légifèrent en ce sens. Ce cadre permet d’utiliser la reconnaissance faciale pour rechercher des personnes présentes dans les fichiers des personnes recherchées pour trouble à l’ordre public et/ou pour des enjeux de sécurité nationale. Cette recherche pourrait se faire sur la base de la « race, opinions politiques, affiliation à une organisation syndicale, convictions religieuses ou philosophiques, vie sexuelle ou leur orientation sexuelle » ou sur la détection du « port d’un insigne ou d’un accessoire, lorsque cette personne est impliquée dans l’extrémisme violent ou présente un risque terroriste ». Ce cadre autorise l’utilisation de la « reconnaissance émotionnelle » contre toute personne « exclues de la définition de l’espace public », notamment en prisons ou zones de contrôle aux frontières. Il s’agit, lors d’interrogatoires et sans avertir les personnes interrogées, d’essayer d’évaluer avec plus ou moins de fiabilité leur degré de nervosité pour essayer d’en déduire si elles mentent.
Selon la Quadrature du net [3], et ce avant les Jeux Olympiques 2024 qui ont officialisé l’usage, plusieurs décrets autorisaient (et préparaient) la surveillance de masse par l’intelligence artificielle en france. Cette programmation s’appuie sur les fichiers du TAJ (Traitement des Antécédents Judiciaires [4]) et du TES (Titres Électroniques Sécurisés). Le TAJ inscrit toute « photographie comportant des caractéristiques techniques permettant de recourir à un dispositif de reconnaissance faciale (photographie du visage de face », ainsi que toutes « autres photographies » dans le but de « comparer à la base des photographies signalétiques du traitement, les images du visage de personnes impliquées dans la commission d’infractions captées via des dispositifs de vidéoprotection ». Un rapport parlementaire de 2018 explique qu’il « existe 18,9 millions de fiches de personnes mises en cause et plus de 87 millions d’affaires répertoriées dans le TAJ », et que « le TAJ comprend entre 7 et 8 millions de photos de face » [5]. En france donc, une personne sur dix pourrait avoir sa photo dans le TAJ. On peut donc ajouter à cette programmation le fichier TES qui comprend les noms, domicile, taille et couleur d’yeux et même l’image numérisée du visage de toute personne qui a ou a demandé un passeport ou une carte d’identité. Consultable auparavant par les services de police pour des questions de terrorisme, il l’est depuis la loi de programmation militaire de 2013 contre tout ce qui est contraire aux « intérêts fondamentaux de la Nation » (indépendance nationale, prévention du terrorisme ou de la prolifération d’armes de destruction massive ; politique étrangère et exécution des engagements européens de la France, intérêts économiques, industriels et scientifiques ; « atteintes à la forme républicaine des institutions » et « violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique » [6]). Chaque fois que le logiciel de comparaison faciale trouve une correspondance, les données (noms, prénoms, date de naissance, adresse, etc.) issues de la fiche TES d’une personne peuvent être transférées dans le fichier TAJ pour venir garnir une fiche.
Des programmes de vidéosurveillance automatisée (VSA) ou des applications de justice prédictive existent dans plusieurs villes (ou dans des supermarchés pour prévenir le vol). Les premiers consistent à repérer automatiquement, sur les images de vidéosurveillance, des évènements « suspects » pour avertir les agent.e.s qui, de fait, ne passent pas leur temps à scruter tous les écrans des centres de supervision urbain (CSU) qui centralisent ces images dans une ville. Les seconds consistent à croiser des données (celles de la police, des villes, de l’État, d’opérateurs télécoms, des réseaux sociaux…) pour faire des recommandations aux stratégies policières de manière à anticiper là où des crimes pourraient probablement arriver sur le parcours d’une manifestation ou d’émeutes localisées ou dans la ville en temps normal. Selon la sociologue américaine Jacquie Wang, ces dispositifs de justice prédictive créent des « zones de paranoia policière », des « faux positifs qui peuvent être utilisés pour promouvoir ses produits » et « élude pourtant un fait important : en utilisant des données sur la criminalité recueillies par des policiers afin de déterminer dans quel secteur faire les patrouilles, on envoie simplement les policiers dans les quartiers pauvres où ils avaient l’habitude d’aller lorsqu’ils étaient guidés par leurs intuitions et leurs préjugés ». Elle rappelle que ces technologies ont été développées aux États-Unis alors que l’institution policière était largement délégitimée suite aux émeutes d’Oakland en 2009, de Ferguson en 2014 et du mouvement Occupy en 2011. En 2011, le John F. Kennedy School of Government de l’Université d’Harvard et le National Institute of Justice publiaient un article conjoint qui appelait à « développer l’aspect scientifique du travail policier pour préserver la légitimité et le soutien de la police dans la population ».
C’est un aspect important de l’impact social que peut avoir l’IA : le fait qu’elle est pensée comme rationnelle, dépourvue de biais humains, et qu’elle puisse s’affirmer comme une raison supérieure. Bien qu’elle ne pose souvent que des recommandations, celles-ci apparaissent scientifiques et les exécutant.e.s n’ont plus à réfléchir au-delà de ces programmes. Cette dimension n’est pas nouvelle, elle est intrinsèque à la techno-science qui fait fonctionner la machine industrielle. Mais en plus de cela, les ingénieurs peuvent programmer l’IA en fonction de notions qui n’existent que comme des constructions sociales (comme celles de « race » ou d’« orientation sexuelle ») et continue à les faire exister par l’intermédiaire de l’IA. Une fois programmée, il est évident que l’IA n’a aucune faculté de réfléchir, de douter, de s’opposer à son programme en fonction d’une éthique, d’une intuition. Et elle impose ce principe à celles et ceux dont le travail est subordonné à sa logique. Cela rappelle les idées qui servent de caution scientifique à l’eugénisme, qui fabriquent les présupposés de la pensée capitaliste et ses délires racistes, sexistes, validistes, comme quelque chose de naturel.
Pour en revenir à des questions plus techniques, Mark Andrejevic écrit dans son livre Infoglut que l’IA « permet de dégager des régularités qui sont beaucoup trop complexes pour que les hommes puissent les détecter. Il permet aussi, en réalisant des simulations, de mettre au jour des tendances émergentes qui, autrement, défieraient notre pouvoir prédictif ». Il ne faudrait pas en conclure que l’introduction de ces technologies puisse nous empêcher de trouver des brèches pour que nos révoltes s’attaquent aux racines de la domination. Ces stratégies sont établies à partir d’une masse de données accumulée sur des habitudes passées, mais des attaques partielles (éventuellement coordonnées ou généralisées) peuvent trouver des voies inventives, non systématisées dans des algorithmes, bien que ceux-ci peuvent apprendre de chaque nouvelle invention dévoilée. De plus, les données sur lesquelles les IA prennent prise pour nous contrôler ou nous faire la guerre circulent par des flux (électriques et électroniques) qui sont régulièrement la cible d’attaques. Selon la même logique, il est possible de se détacher le plus possible de ces technologies qui fabriquent des données sur nous-mêmes pour tenir la répression de l’IA à distance.
Lors des révoltes de Hong Kong en 2019-2020, des insurgé.e.s ont fait des actions de brouillage et de sabotage, en utilisant des parapluies, en pointant des lasers vers l’optique des caméras et des drones ou en couvrant les dômes des caméras de vidéosurveillance par de la peinture pour aveugler les systèmes de reconnaissance faciale. Une brochure intitulée « Comment empêcher les technologies de reconnaissance faciale de t’identifier » (traduite et accessible sur notrace.how/) référence plusieurs techniques qui fonctionnaient dans des environnements de tests (sans doute au moment de sa parution en 2020). Selon cette brochure, la partie du visage la plus susceptible d’être utilisée par ces algorithmes est l’endroit du visage où les yeux, le nez et le front se rejoignent, ainsi que les lèvres. Empêcher les caméras de voir toute portion de ses yeux, ou dissimuler même un seul œil, peut suffire à saper les algorithmes. Les techniques les plus simples pour se dissimuler peuvent être de se faire pousser la barbe (ce qui ne suffit pas à duper les logiciels mais peut faciliter avec d’autres techniques), de porter un masque, des lunettes, une casquette, une capuche, ou encore d’utiliser ses cheveux, du maquillage ou de l’anti-cernes. Pour le maquillage, il faut penser que la lumière atteint et éclaircit le teint des parties proéminentes (nez, sourcils, pommettes) davantage que les orbites, et la technique est donc d’assombrir une partie des premières et d’éclaircir une partie des deuxièmes (l’opposé de comment les humains appliquent typiquement du maquillage en Occident). Pour l’anti-cernes (qui reproduit une couleur de peau classique), c’est utile d’en appliquer sur des cicatrices, grains de beauté, tatouages et autres marques identifiables.
Sur les infrastructures nécessaires à l’IA : data-centers, usines à IA et supercalculateurs
En amont du sommet de l’IA en février 2025 à Paris, le cabinet du ministère de l’Industrie et de l’énergie de l’État français déclarait : « On parle souvent de l’IA sous l’angle des usages. Mais, sans infrastructures, rien n’est possible ». C’est à ces infrastructures que sont dédiés les grands plans d’investissement récents : 109 milliards d’euros annoncés pendant le sommet de l’IA pour la france (50 milliards ont été annoncés pour la belgique) puis 200 milliards par la Commission Européenne en avril 2025. Les deux premiers ont pour but de construire des centres de données (data-centers) dédiés à l’IA soutenus par des centres de recherche ou des usines à IA. Le troisième, dans le cadre de l’« AI Continent Action Plan », de développer des usines à IA (« AI Factories ») et des giga-usines à IA (« AI Gigafactories »). Il s’agit de laboratoires qui rassemblent et génèrent des grands volumes de données au service de modèles et applications d’IA commandés par des start-ups et des industries européennes. C’est tout particulièrement à l’encontre de ces infrastructures que des actions directes peuvent être envisagées pour s’attaquer à l’IA, l’empêcher de se développer, y mettre fin [7]...
À l’occasion du sommet pour l’IA à Paris, plusieurs centres de données dédiés à l’IA ont été annoncés. La secrétaire d’État chargée du Numérique et de l’IA Clara Chappaz a annoncé que ces infrastructures seront construites d’ici 2027 parmi 35 sites « clés en main France 2030 ». On dispose de peu d’informations sur cette liste, mais il y a un enjeu à savoir où ils se trouvent, d’autant plus que les procédures administratives et juridiques sont accélérées pour que ces projets aboutissent rapidement. Ces sites pourraient être intégrés dans les SCOT (Schémas de Cohérence Territoriale) pour une meilleure implantation dans les réseaux électriques et numériques et bénéficier du statut PINM (Projets d’Intérêt National Majeur). Ce statut est prévu pour les projets « les plus stratégiques » [8] et leur permet de bénéficier d’une mise en comptabilité prise en charge par l’État des documents d’urbanisme, facilite l’obtention d’une dérogation à l’obligation de protection de certaines espèces protégées, et permet une accélération des procédures administratives pour un raccordement à l’électricité. Un « campus de centres de données, en lien avec l’essor de l’intelligence artificielle » opéré par Google, a récemment été annoncé sur une parcelle de 195 hectares dans la zone d’activités d’Ozans à l’est de Chateauroux, sur la commune d’Etrechet (Indre, 36). Étant donné que ce site fait partie des 55 « Sites prêts à l’emploi » annoncés dans le cadre d’une loi de 2023 sur l’« industrie verte » et dont la liste est publique [Voir en annexe des informations sur ce dispositif et sur cette liste], on pourrait penser certains sites des 55 font ou feront partie des 35 dédiés à des infrastructures d’IA.
Parmi les investissements annoncés pendant le sommet de l’IA à Paris, 10 milliards d’euros du fonds canadien Brookfield seront investis dans un datacenter partagé avec Data4 à Cambrai (Nord, 59) sur une friche industrielle dans le parc E-Valley. Fluidstack et Sesterce (qui exploite déjà une quinzaine de centres de calcul dédiés à l’IA) ont annoncé vouloir racheter l’ancien pôle Ecotox sur l’Ecoparc Rovaltain de Valence Romans Agglo (Drôme, 26) pour en faire une sorte d’usine à IA qui devrait entrer en service en 2026. Le groupe suédois Evroc [9] prévoit d’investir 4 milliards d’euros dans un data-center à Mougins (Alpes-Maritimes, 84) dans un bâtiment existant de 8000 m² (propriété de Valimmo Reim) sur la technopole de Sophia Antipolis et pour une mise en service fin 2025. DataOne a racheté deux grands datacenters, dont l’un à Eybens près de Grenoble et l’autre à Villefontaine en Isère (38), pour créer d’ici à la fin de l’année 2025 une infrastructure à grande échelle dédiée à l’intelligence artificielle [10]. Eclairion devrait également ouvrir un data-center dans la Sarthe sur le site d’une ancienne papeterie Arjowiggins. Le plus gros investissement est de 30 à 50 milliards d’euros destinés à un projet de campus géant associant data-centers, calcul de haute performance, formation et recherche sur l’IA prévu pour une mise en service d’ici 2028 (et un démarrage des travaux qui devraient commencer au second semestre 2026). Prévu en Île de France, on ne sait pas plus précisément où ce projet est envisagé.
Chacun peut en apprendre plus sur l’un ou l’autre de ces projets et les entreprises qui les mettent en œuvre. Une simple recherche sur internet via le programme Tails, sur le campus géant de data-centers financé à hauteur de 30 à 50 milliards permet d’en savoir un peu plus. Ce projet a été signé entre l’entreprise des Émirats Arabes Unies MGX, l’entreprise française Mistral AI, l’entreprise américaine NVIDIA et les fonds Bpifrance. L’entreprise de Travaux Publics Bouygues s’occupera de la construction du campus. EDF devrait conseiller en terme d’approvisionnement d’énergie décarbonée d’une capacité totale de 1,4 GW (GigaWatts) d’ici 2030 et RTE doit opérer la connexion du site au réseau d’électricité. C’est l’opérateur télécom Sipartech, spécialisé dans les réseaux très haut débit, qui fournit la connectivité fibre à haute capacité pour relier le campus aux pôles numériques européens. L’École polytechnique y participera également par la création d’une chaire IA, de projets de recherche collaboratifs et de doctorats en partenariat avec l’université Mohamed Bin Zayed des Émirats Arabes Unis. Pour émettre quelques hypothèses à partir de la liste des 55 sites « prêts à l’emploi », ce site pourrait être celui de « La Bonde » à Massy (Essonne, 91), en raison de sa proximité avec les « grands pôles numériques » (notamment des supercalculateurs de Paris-Saclay), ainsi que de l’École Polytechnique, mais ce site n’est prévu que pour 30 hectares. Il serait ainsi plus probable que ce projet soit annoncé sur le site de 177 hectares de Paris-Villaroche (Seine et Marne, 77). La maturité du premier site est annoncé pour 2025-2027 et la maturité du second pour 2027-2030 alors que, d’après les annonces, ce projet de campus d’IA commencerait les travaux en 2026 pour une mise en service en 2028. Il reste tout à fait possible que ce projet soit prévu encore ailleurs.
Selon Stéphane Raison, directeur d’EDF en charge de l’installation de grands sites de consommation, les 6 premiers sites de ces infrastructures d’IA se situeraient sur d’anciens sites de production d’EDF (dans le Grand-Est, l’Ile de France, l’Auvergne Rhone Alpes). Ils disposeraient déjà d’un poste de transformation d’électricité RTE, dont la proximité est nécessaire pour les besoins en électricité de ces projets. Les nombreuses demandes de raccordement au réseau électrique à haute tension de ces data-centers posent beaucoup de problèmes à RTE, chargé d’opérer graduellement leurs raccordements. L’inflation des demandes a entraîné un allongement des délais de raccordement et plusieurs projets sont abandonnées car l’industrialisation en cours nécessite trop d’énergie, d’infrastructures de liaison et de câbles. Les territoires autour de Paris et Marseille sont saturés et ne pourraient accueillir de nouveaux projets pour l’instant. En ce qui concerne la métropole du Grand Paris, selon Philippe Schmit (président de la Mission régionale d’autorité environnementale d’Ile de France), certaines portions des lignes à haute tension (225 000 volts) qui alimentent Paris et la grande couronne (depuis la seule ligne Très Haute Tension [400 000 volts] qui entoure la métropole) seraient régulièrement en tension maximale à cause de l’activité des centres de données [11] . Il faut avoir en tête que plusieurs scénarios prévoient que l’IA consomme entre 20 % et 25 % de l’électricité produite au bout de son industrialisation [Voir en annexe quelques réflexions sur la question de l’approvisionnement énergétique de l’IA].
Aujourd’hui (et sans prendre en considération l’accélération des démarches administratives), il faudrait environ trois ans entre l’acquisition du terrain et l’inauguration d’un data-center mais le délai pourrait monter jusqu’à cinq ans. Parmi les quelques 315 centres de données en france, la moitié se trouverait en Ile-de France et une autre bonne partie à Marseille [12]. Leur installation nécessite des infrastructures de fibre optique suffisantes (cela explique qu’il n’y en a pas en dessous de la Méditerranée hormis en Afrique du Sud). Parce qu’ils entretiennent ces réseaux de fibre optique (qui devraient recouvrir la totalité de la france en 2030), les opérateurs télécoms sont nécessaires à la faisabilité des projets d’industrialisation de l’IA. Le trafic internet mondial emprunte trois circuits majeurs de câbles sous-marins : les axes transatlantique, transpacifique et la Méditerranée. La majorité des câbles des deux derniers axes, selon l’Élysée, « passent en France pour relier directement l’Afrique, l’Asie et l’Amérique ». L’avantage pour des centres de données de se positionner près des zones d’arrivée (ou points d’atterage) de ces câbles sous-marins est de ne pas avoir à construire des raccordements terrestres, ce qui diviserait les coûts par 10 [13] . Parmi les actions coordonnées fin juillet 2024 contre les Jeux Olympiques, celles qui ont visé les « autoroutes » longue distance de la fibre optique à haut débit (« backbone »), en sectionnant (à ras parfois) des sections de câbles sous des bouches d’égout, dans au moins dix départements (Ain, Aude, Ardèche, Drôme, Hérault, Bouches du Rhone, Oise, Marne, Meuse, Vaucluse) ont ralenti voire arrêté des data-centers [14] . Selon un responsable du groupe Inherent de Maxéville (54), dont 2 des 14 data-centers ont été arrêtés : « Deux énormes pannes simultanées sur les réseaux entre Nancy et Paris, et Nancy et Lyon. L’une sur un réseau de 100 gigabits par seconde, cela n’arrive jamais. D’ordinaire, nous roulons sur une autoroute. Là, il y a un accident. Donc, on a fait passer nos clients par des nationales. Le trafic a donc été fortement ralenti, voire coupé pour certains. Les cables ont été sectionnés par paquets. Pour les founisseurs, cela prend du temps pour réparer. ».
L’union européenne a annoncé la construction de 13 AI factories [15] (usines à IA), mais peut être que d’autres seront annoncées. Ces usines à IA dépendent de supercalculateurs, des infrastructures qui développent une grande puissance de calcul. Le supercalculateur Alice Recoque se situe sur la Plateau de Saclay, plus précisément sur le site du Commissariat à l’Énergie Atomique (CEA) à Bruyères-le-Châtel (Essonne, 91) et devrait entrer en service en 2026. L’AI Factory française a pour partenaires l’association France HubIA, les centres de recherche CNRS, l’INRIA, le CEA, le réseau French Tech, l’incubateur Station F et l’agence ministérielle pour l’IA de défense (Amiad). Avec un budget de 30 millions d’euros sur 3 ans (la moitié financée par l’État français et l’autre moitié par l’union européenne), elle devrait démarrer au deuxième semestre 2025 pour une pleine production visée début 2026. L’usine Eviden à Angers (Maine-et-Loire), spécialisée dans la construction de supercalculateurs, serait la seule à être en capacité d’assembler des supercalculateurs en Europe (et a construit une grande partie de Jupiter et sans doute d’autres supercalculateurs). Elle est en pleine reconstruction pour doubler ses capacités de production d’ici 2027. L’entreprise SiPearl (basée à Maisons-Laffitte) conçoit également des processeurs nommés Rhea pour des supercalculateurs de nouvelle génération (notamment Jupiter et Jules Verne).
À l’occasion du sommet pour l’IA, la plateforme d’IA britannique Fluidstack a annoncé la construction d’un supercalculateur de 1GW d’ici 2028 (dont le lieu d’implantation n’a pas été dévoilé), financé à hauteur de 10 milliards d’euros. Elle prévoit également de construire un supercalculateur pour Mistral AI sur le site d’Éclairion, à Bruyères-le-Châtel (Essonne, 91), près du Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du CEA. Toujours sur le Plateau de Saclay, le supercalculateur Jean Zay devrait également servir, entre autres, à l’IA. InstaDeep, l’un des leaders mondiaux de l’IA décisionnelle, a également annoncé la construction d’un supercalculateur dans centre Equinix de Saint-Denis. L’entreprise numérique Atos a elle dévoilé un nouveau supercalculateur de nouvelle génération (« exascale ») nommé BullSequana XH3000. L’Amiad (l’agence d’IA du ministère des Armées) dispose également d’un supercalculateur (le plus grand d’Europe selon le ministère) sur le Mont Valérien à Suresnes (Hauts-de-Seine, 92), qui devrait être opérationnel fin 2025. Selon le ministère, il « ne sera pas connecté à internet et sa maintenance sera réalisée par des citoyens français habilités au secret de la défense nationale », toujours selon le ministère. On peut pourtant imaginer que celui-ci soit connecté (sans doute par des réseaux de fibre optique) à d’autres pôles de recherche et d’information, même si ce réseau est peut être indépendant du réseau général. D’autres supercalculateurs servent également à d’autres choses que l’IA, notamment sur le site du CEA à Bruyères-le-Châtel [16] .
Même les data-centers peuvent brûler… (depuis sansnom.noblogs.org)
Une info échappée à grand’peine au milieu de l’insoutenable pesanteur quotidienne faite d’urgences et de dispositions décrétées par les autorités.
Mercredi 10 mars à 00h47, un incendie s’est déclaré à Strasbourg au sein de l’un des quatre énormes data-centers de OVH, multinationale française de web hosting (c’est-à-dire de services télématiques). Malgré le déclenchement immédiat de l’alarme et malgré que soient intervenus sur place plus d’une centaine de pompiers — avec l’aide de moyens arrivés jusque de l’Allemagne voisine —, quelques heures plus tard il ne restait plus rien du data-center SBG2. Du silicium aux cendres. Les flammes, avant d’être domptées, ont aussi durement frappé le bâtiment de SBG1, dévastant plus de la moitié de ce dernier.
Le data center totalement détruit occupait un bâtiment de 500 mètres carrés divisé en cinq étages. C’est là qu’étaient hébergés des milliers et des milliers de serveurs, qui stockaient des milliards de données (dont celles relatives à la campagne vaccinale organisée par le gouvernement français contre le covid19). Tout, ou presque, est parti en fumée, perdu pour toujours, y compris les fichiers de millions de clients. Il semble que l’incendie ait mis hors service 3.600.000 sites, pas seulement en France mais aussi en Belgique, provoquant des dégâts littéralement incalculables et irréversibles.
Les 300 caméras de surveillance présentes à l’intérieur du siège de la compagnie n’ont rien pu voir, le dispositif de détection de fumée installé dans les locaux n’ont rien pu opposer, les exercices anti-incendie suivis tous les 6 mois par le personnel n’ont rien pu faire, rien n’a pu empêcher qu’en quelques heures se consume « la plus grande catastrophe industrielle de l’histoire d’OVH« .
Selon les premières investigations, l’incendie serait parti d’un groupe de continuité électrique (un ondulateur), appareil servant à remédier aux anomalies imprévues dans la fourniture du courant électrique normalement utilisé, c’est-à-dire à protéger les équipements électroniques de risques comme une surcharge de tension. Au cours de la matinée précédant l’incendie, un de ces groupes de continuité avait subi des travaux de maintenance, et selon des experts les premières étincelles seraient parties de ces ondulateurs. Le mega data-center de OVH aurait donc été détruit par ce qui aurait dû en garantir la sécurité…
Tandis que le responsable affligé d’OVH déclare que la soudaineté de ce qui s’est passé l’ « interroge sur comment ça a démarré et pourquoi ça a démarré », nous pensons plutôt qu’il serait opportun de se poser bien d’autres questions. Sur comment le sourire de l’arrogance industrielle est voué tôt ou tard à se transformer en grimace, sur comment l’omnipotence technoscientifique peut découvrir sa propre fragilité en quelques heures, ou sur comment cela n’a pas de sens de se laisser anéantir par la stature de l’ennemi, et donc sur comment cesser d’attendre que de telles catastrophes industrielles se produisent…
[traduit de l’italien de finimondo, 13 mars 2021]
(Annexe) Quelques exemples des innovations des entreprises militaires en matière d’IA
Anduril, spécialisée dans la mise au point de systèmes autonomes avancés pour la détection de drones et intrus, a annoncé l’ouverture d’une plateforme de 460 000 m² aux État-Unis pour la « production en masse de systèmes et d’armes autonomes ». Elle espère fabriquer « des dizaines de milliers de systèmes autonomes par an » (selon un communiqué de l’entreprise). Elle a conclu plusieurs contrats ; avec l’US Air Force pour développer et de tester de petits prototypes d’avions de combat sans pilote et en livrer au moins 1000 ; avec l’US Special Operations Comand pour la lutte contre les drones ; et avec Open IA (ChatGPT) pour concevoir des solutions d’IA de pointe pour la sécurité nationale et les usages militaires. Son projet est de produire en série les prototypes qu’elle met déjà en vente pour intensifier l’approvisionnement en armes des armées des États-Unis et de ses autres clients. Une autre est Skydio, qui fabrique des drones autonomes qui peuvent suivre une cible, filmer de nuit et transporter de petites armes (grenades principalement), pour aider les patrouilles de police et forces armées. Ces drones sont déjà utilisés, en dehors des États-Unis, par les forces armées ukrainiennes, canadiennes, israéliennes, britanniques et indiennes. Hermeus, qui fait voler des avions à plus de 6 000 km/h, est elle aussi soutenue par des investissements du CEO d’OpenAI Sam Altman, et a conclu en 2021 un contrat de 60 millions de dollars avec l’US Air Force.
En Europe, l’entreprise d’origine allemande (mais aussi implantée en France) Helsing est également passée en mode « production de masse ». Financée dès ses débuts en 2021 par le milliardaire suédois et fondateur de Spotify Daniel Ek, a recruté Antoine de Braquilanges, passé par Palantir et Amazon Web Services, et Antoine Bordes, ancien codirecteur des laboratoires de recherche en IA de Meta. Elle est présente depuis deux ans sur les terrains de guerre en Ukraine et a levé au moins 788 millions d’euros auprès d’investisseurs. Elle a récemment signé un contrat pour livrer 4 000 minidrones (fabriqués par un partenaire dont l’identité n’est pas révélée) qui embarquent leur logiciel d’« intelligence artificielle » en Ukraine entre la fin de l’année 2024 et le printemps 2025. Ces drones d’attaque, grâce à ce logiciel, résistent au brouillage électromagnétique, peuvent continuer à naviguer sans signal GPS en exploitant des algorithmes d’analyse d’images couplés à des données cartographiques embarquées, jusqu’à détecter une cible et l’identifier. Ils peuvent à présent envisager une production en grande série (plusieurs milliers d’exemplaires par mois) pour les armées clientes. Un autre de ses drones d’attaque nommé « HX-2 », équipé à l’arrière d’un aileron en forme de croix de Saint-André avec un rayon d’action d’une centaine de kilomètres grâce à une motorisation électrique, peut être opéré par un seul soldat. Il pourrait être produit en masse et voler en essaim. Elle a noué des partenariats avec le consortium européen Eurofighter et Saab, ainsi qu’avec KNDS France pour améliorer la précision des canons Caesar (notamment face aux brouillards électromagnétiques). Selon Antoine Bordes : « Pour des soucis évident de confidentialité, nous ne pouvons pas donner tous nos clients, mais aujourd’hui tous les grands noms regardent ce que l’on fait ».
Une autre entreprise d’IA militaire, Preligens, a reçu des investissements de 220 millions d’euros en étant acquise par Safran (une grande entreprise militaire française dont l’actionnaire principal est l’État français). Elle avait signé en 2022 un contrat à hauteur de 240 millions d’euros avec la Direction générale de l’Armement (DGA) pour le traitement en masse de données pendant sept ans. En apprenant à reconnaître la forme des objets à partir d’une bibliothèque riche d’environ 6 millions d’images qualifiées, leurs services ont appris à identifier de multiples équipements militaires (avions de transport ou de combat, les véhicules blindés ou civils, les navires…) et à produire ses propres images de synthèse en 3D pour alimenter sa bibliothèque. Cela lui permet à partir de millions d’images captées chaque jour par satellite à repérer des objets évoquant une menace et une concentration d’objets militaires sur des sites stratégiques. Elle permet à un analyste d’interpréter ensuite la situation. Ses services sont certifiés « combat proven » (ayant fait leur preuve au combat). Les armées américaine, britannique, japonaise, l’Otan et l’Union européenne font partie de ses clients. Cet achat par Safran l’amène à proposer ses services aux constructeurs aéronautiques qui peuvent les produire en masse. Comand IA, une autre entreprise française, développe des produits pour améliorer les décisions des chefs militaires dans la planification et l’analyse d’opérations. Elle est fondée par d’anciens salariés de Palantir et OpenAI. Un ancien officier de l’armée de terre et un ancien conseiller politique au commandement maritime de l’OTAN font également partie de l’équipe. À partir de l’analyse des opérations passées avec un retour d’expérience automatisé, elle distribue plusieurs décisions toutes faites dans la planification d’opérations, en fonction de la doctrine militaire du client et de celle des autres forces en présence, et les chefs militaires choisissent celle qu’ils préfèrent. Elle a annoncé en décembre dernier une levée de fonds de 8,5 millions d’euros pour développer et vendre sa suite de logiciels dans plusieurs pays de l’OTAN.
(Annexe) Le profil de Cédric O : figure de la politique française actuelle en matière d’IA
Cédric O, fils d’un chef d’entreprise coréen et d’une enseignante lyonnaise, et frère de la diplomate Delphine O, a un profil classique de technocrate (ces gens de pouvoir qui alternent postes de hauts fonctionnaires d’État et postes de décisionnaires dans des grandes entreprises pour provoquer des changements technologiques majeurs). Il représente la politique actuelle en matière d’IA.
Il est directeur adjoint de la campagne présidentielle de François Hollande en 2012, puis devient, sur les conseils de Pierre Moscovici (et alors qu’il était évoqué pour devenir ministre), chargé de mission auprès de la grande entreprise militaire Safran et responsable de production de Safran Aircraft Engines entre 2014 et 2017. Il quitte ces engagements pour rejoindre les équipes du palais de l’Élysée après la victoire d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de mai 2017, après avoir été l’un des organisateurs de la soirée French Tech à Las Vegas en 2016, qui aurait été un point de départ de la campagne présidentielle de Macron. Par la suite, il participe au lancement du parti En Marche (devenu La République en marche puis Renaissance), en dépose les statuts et organise la levée de fonds pour la campagne présidentielle en tant que premier trésorier. Il est toujours membre du bureau exécutif du parti depuis 2017. Ses relations étroites avec les décisionnaires du pays et avec plusieurs patrons de « licornes » (des grandes entreprises qui innovent dans de nouveaux domaines) lui permettent d’avoir de l’influence.
Il est officiellement conseiller chargé des participations publiques et de l’économie numérique du président de la République et du premier ministre entre 2017 et 2019 et défendrait les intérêts des grandes entreprises du numérique au sein de la politique numérique du gouvernement. Il organise plusieurs évènements visant à inciter les multinationales du numérique à investir dans l’économie française. Il est par la suite nommé secrétaire d’État chargé du Numérique auprès du ministre de l’Économie et des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes publics. Il défend l’idée d’une création par l’État d’un « Conseil de l’ordre des journalistes » pour combattre la circulation des fausses informations pendant le mouvement social des Gilets Jaunes, les accusant de s’informer sur des médias qui font le jeu des ingérences étrangères (comme RT et Sputnik) mais sa proposition déclenche une vague d’indignation au sein de la presse. Il annonce également vouloir créer avec la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) une instance de supervision et d’évaluation de la reconnaissance faciale. Friand de contrôle social total, il est pendant la pandémie de Covid-19 responsable du projet qui mène à la création de l’application StopCovid. Il exerce également son influence dans le développement des réseaux 5G sur les territoires occupés par l’État français.
Au lendemain de l’élection présidentielle de Macron en mars 2022, il se reconvertit à nouveau dans le secteur privé et entre au conseil d’administration de l’entreprise de conseil dans le secteur numérique Artefact, ainsi que dans le conseil stratégique de Plateforme Formation, un institut de formation privé spécialisé dans les nouvelles technologies. Il défend alors la dérégulation en termes d’« intelligence artificielle », pour faciliter la course à l’innovation des entreprises françaises de ce secteur, et parvient à influencer le gouvernement en ce sens. Il est en avril 2023 l’un des cofondateurs de Mistral AI, ainsi que l’un des actionnaires, puis devient membre du comité de l’intelligence générative créé en septembre 2023 par la première ministre Elisabeth Borne, directement rattaché au pouvoir exécutif, avec Arthur Mensch, cofondateur et patron de Mistral. Il est considéré comme le grand artisan des positions françaises au sein de l’IA Act de la Commission européenne.
(Annexe) « Les sites clés en main France 2030 »
Les sites « clés en main France 2030 » sont sélectionnés et administrés par les services de l’État pour accélérer au maximum les procédures administratives, de manière à s’assurer que les conditions de maturité de ces sites soient vite remplies. Ils sont sélectionnés en fonction de l’attractivité économique du site (localisation, proximité des axes de transport, accessibilité, bassin d’emploi…), de la limitation des incidences environnements (notamment d’artificialisation des sols), de la maitrise foncière du site, du potentiel de maturité du site et de la pertinence et intégration au projet de territoire.


Liste des sites et anticipation de leur progression (informations d’avril 2024) :
Sites dont la maturité est prévue pour 2024 :
– Site Mérieux Rovaltain (5 hectares) à Alixan (Drôme, 26)
– Parc d’activités Ozans (187 hectares) à Étrechet (Indre, 36)
– Base logistique Intermarche Alloinay (17 hectares) à Alloinay (Deux-Sèvres, 79)
– Mazeran Genvia (111 hectares) à Béziers (Hérault, 34)
– Site industriel et portuaire d’Arles (25 hectares) à Arles (Bouches du Rhône, 13)
Sites dont la maturité est prévue pour 2025-2027 :
– Montpertuis Palazol (125 hectares) à Bellerive-sur-Allier (Allier, 03)
– Espace industriel responsable et multimodal Inspira (340 hectares) à Salaise-sur-Sanne (Isère, 38)
– Ondaine 2026 (5 hectares) à Unieux (Loire, 42)
– Sugar (20 hectares) à Clermont-Ferrand (Puy de Dôme, 63)
– Friche Nordéon Hub multimodal Nordéon (15 hectares) à Chalons-sur-Saône (Saône et Loire, 71)
– Lucy (20 hectares) à Montceau-les-Mines (Saône et Loire, 71)
– Espace du Cruguil (3 hectares) sur le Pôle Pégase à Lannion (Côte d’Armor, 22)
– Zae Drusenheim-Herrlisheim Axioparc (100 hectares) à Drusenheim (Bas-Rhin, 67)
– Elpa (55 hectares) à Burnhaupt-Le-Haut (Haut-Rhin, 68)
– Zac de Bioéconomie du Grand Reims (66 hectares) à Pomacle (Marne, 51)
– Zia Phase 1 (55 hectares) à Loon-Plage (Nord, 59)
– Zone d’activités La Salmagne (120 hectares) à Vieux-Reng (Nord, 59)
– Bois Sauvage (5 hectares) à Évry-Courcouronnes (Essonne, 91)
– La Bonde (30 hectares) à Massy (Essonne, 91)
– Terrain Lu (17 hectares) à Ris-Orangis (Essonne, 91)
– Cyrano (35 hectares) à Lieusaint (Seine-et-Marne, 77)
– Linandes Est - Aerocity (6 hectares) à Cergy (95, Val d’Oise)
– Espace économique Henri Cornu (25 hectares) à Saint-Paul (La Réunion, 97)
– Site Ford Axtom (50 hectares) à Blanquefort (Gironde, 33)
– Gabriélat 2 (24 hectares) à Pamiers (Ariège, 09)
– Arcelor Mittal (48 hectares) à Laudun-l’Ardoise (Gard, 30)
– Pyrénia (189 hectares) à Ossun (Hautes-Pyrénées, 65)
– Les Portes du Tarn (198 hectares) à Saint-Sulpice-La-Pointe (Tarn, 81)
– Plateforme industrielle Saint-Auban (61 hectares) à Château-Arnoux-Saint-Auban (Alpes de Haute Provence, 04)
– Aérodrome Aix Les Milles (22 hectares) à Aix-en-Provence (Bouche du Rhône, 13)
– Innovex (11 hectares) à Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône, 13)
– Tonkin (20 hectares) à Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône, 13)
– Ecoplateforme de Provence (77 hectares) à Meyreuil (Bouches du Rhône, 13)
Sites dont la maturité est prévue pour 2027-2030 :
– Parc industriel de Guerlesquin - Morlaix Communaute (14 hectares) à Guerlesquin (Finistère, 29)
– Aero Parc (16 hectares) à Châteaudun (Eure-et-Loir, 28)
– Friche Afpa (5 hectares) à Blois (Loir et Cher, 41)
– Reconversion du site militaire de Domgermain (47 hectares) à Domgermain (Meurthe et Moselle, 54)
– Site de La BTT de Thaon-Les-Vosges (50 hectares) à Thaon-Les-Vosges (Vosges, 88)
– Requalification Parc Premium des Soufflantes (38 hectares) à Escaudain (Nord, 59)
– Friche Jacob Delafon – Noyon (6 hectares) à Noyon (Oise, 60)
– Zae Quai du Rivage (9 hectares) à Noyelles-Godault (Pas-de-Calais, 62)
– Terrain Lu (17 hectares) à Ris-Orangis (Essonne, 91)
– Paris Villaroche (177 hectares) à Réau (Seine et Marne, 77)
– Friche Saint-Louis Sucre (33 hectares) à Cagny (Calvados, 14)
– Site industriel Sud Grand Canal (54 hectares) à Gonfreville-L’Orcher (Seine Maritime, 76)
– MTV (Ex-Cipha) (75 hectares) à Grand-Couronne (Seine Maritime, 76)
– Friche Sco/Yara (41 hectares) à Oissel (Seine-Maritime, 76)
– Site de Moulineaux (ex-site Renault CKD) (60 hectares) à Oudalle (Seine-Maritime, 76)
– Site industriel Est A29 (16 hectares) à Oudalle (Seine-Maritime, 76)
– Site industriel Ouest A29 (50 hectares) à Rogerville (Seine-Maritime, 76)
– SNPE (177 hectares) à Angoulême (Charente, 16)
– Restitution des sites Totalenergies EP France Plateforme Mourenx Pardies Besingrand (277 hectares) à Lacq et Pardies (Pyrénées-Atlantique, 64)
– SAM (6 hectares) à Decazeville (Aveyron, 12)
– ZI portuaire Montoir de Bretagne - Plate Forme Est (40 hectares) à Montoir de Bretagne (Loire-Atlantique, 44)
– Cavaou (20 hectares) à Fos-sur-Mer (Bouches du Rhône, 13)
– Lavera Ouest (44 hectares) à Martigues (Bouches du Rhône, 13)
(Annexe) Quelques réflexions sur la question de l’approvisionnement électrique de l’IA
Cette industrialisation dépend en grande partie du projet de relance de l’énergie (pour ne pas dire « du nucléaire » en oubliant les autres énergies qui contribuent à cette relance), à savoir de production en série de réacteurs nucléaires EPR2, de petits réacteurs nucléaires SMR et de parcs éoliens offshore (maritimes). Sans forcément que ces projets alimentent directement des usines à IA ou data-centers d’IA, ils sont indispensables pour produire davantage d’énergie dans le réseau de distribution français et libérer l’alimentation nécessaire à ces projets (a priori proches de transformateurs d’RTE).
Étant donné que la mise en service de la première paire d’EPR2 prévue à Penly est annoncée pour 2038-2040, que la production en série de SMR pourrait être rendue possible autour de 2030, les projets de parcs éoliens offshore (prévus entre 2025 et 2030) peuvent amorcer l’alimentation nécessaire aux premiers projets d’industrialisation de l’IA. On peut se demander si cette situation ne peut pas amener les nombreux investisseurs privés intéressés par l’industrialisation de l’IA à participer au financement des réindustrialisations énergétiques, comme c’est le cas aux États-Unis. Google (via sa maison mère Alphabet) a signé un accord avec Kairos Power pour construire sept petits réacteurs nucléaires (SMR) entre 2030 et 2035 pour approvisionner ses futurs datacenters, Amazon contractualise avec Talen Energy un site pour datacenters alimenté par la centrale nucléaire voisine de Susquehanna (Pennsylvanie), Oracle doit alimenter un data-center par trois petits réacteurs nucléaires privés et Microsoft a signé un contrat de livraison d’électricité pendant vingt ans par l’unité 1 de la centrale de Three Mile Island (qui redémarrerait donc en 2028 après avoir été arrêtée en 2019). Pas étonnant donc que Donald Trump met la pression sur les pouvoirs qui administrent plusieurs territoires (au canada, au groenland, au panama ou en ukraine) pour accéder à des matières premières à bas prix, qu’il s’agisse d’uranium ou de terres rares. C’est le serpent qui se mort la queue : il faut faire la guerre pour accéder à des matières premières nécessaires à l’industrialisation comme il faut de l’industrialisation pour faire la guerre pour des matières premières, et vice versa.
(Annexe) Au sujet des techniques de climatisation et de refroidissement des data-centers
Ces centres de données tournent autour de 34°C et ont besoin d’être refroidis régulièrement pour ne pas surchauffer et brûler d’eux-mêmes. La majorité fonctionne par refroidissement à air (« Free Cooling ») qui utilise l’air extérieur en le faisant passer par un échangeur de chaleur (pour ne pas détériorer le matériel), lorsque les températures sont inférieures. D’autres sont équipés par un refroidissement à sec ou dry cooler qui ne consomme pas d’eau. Mais la solution la plus efficace est le refroidissement liquide, par un circuit d’eau en boucle fermée. Selon Laurent Bataille, président de Schneider Electric France (qui réalise l’ensemble des infrastructures électriques de ces data-centers ainsi que le refroidissement, la gestion de l’humidité et des flux d’air), les datas-centers qui utilisent le refroidissement à air devraient devenir obsolètes au profit du refroidissement liquide. Le passage de l’un à l’autre nécessite d’installer des échangeurs thermiques et de remplacer des serveurs pour laisser passer la tuyauterie. Certains expérimentent un système de refroidissement à huile (comme un liquide de refroidissement basique pour voitures, qui par ailleurs est inflammable), dans lesquels les composants sont immergés, relié à un circuit d’eau tiède, qui permet de ne pas utiliser de ventilateurs et d’économiser de l’espace.
[1] Il en donne différents exemples : « Que ce soit la dématérialisation de nombreuses démarches administratives, l’automatisation partielle de l’affectation post-Bac avec Parcoursup, l’automatisation de l’accompagnement des demandeurs d’emploi avec le projet « Mon Assistant Personnel » expérimenté par Pôle Emploi, l’automatisation de la lutte contre la fraude sociale par les caisses d’allocation familiale ou de la lutte contre la fraude sociale par le fisc, l’automatisation du contrôle d’identité via la reconnaissance faciale des bornes PARAFE installées dans plusieurs aéroports, ou encore l’automatisation des communications ou comportements suspects au sein des services de police ou de renseignement, nombre de pratiques administratives sont aujourd’hui de plus en plus articulées à des algorithmes semi-autonomes. ».
[2] Les stratégies militaires du hamas, de manière nationaliste, ne distinguent pas plus que celles d’israel les personnes « civil.e.s » qui participeraient ou non à ces stratégies.
[3] Voir le texte plus complet à ce sujet « La reconnaissance faciale des manifestant.e.s est déjà autorisée (18 novembre 2019) – Quadrature du net » accessible sur notrace.how/
[4] Ce fichier regroupe depuis 1995 plusieurs données (noms, adresse de domicile, photographie, faits reprochés…) de toutes les personnes qui ont été mises en causes comme complices, coupables ou victimes par la police et la gendarmerie.
[5] Il peut s’agir de photos prises en gardes en vue dans le cadre d’une affaire, ou prises sur la base d’un papier d’identité ou récupérée sur internet dans n’importe quel cadre.
[6] Dans sa décision du 23 juillet 2015, celui-ci a défini concrètement ce à quoi renvoient certaines de ces notions. Les « violences collectives » recouvrent ainsi les « incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal ». Parmi ceux-ci, l’article 431-4 sanctionne le fait de « continuer volontairement à participer à un attroupement après les sommations » de se disperser. L’article 431-9 sanctionne le fait d’organiser une manifestation non-déclarée ou interdite. Pour toutes ces situations, policiers et gendarmes sont donc à présent autorisés à accéder aux photographies contenues dans le fichier TES.
[7] En ce qui concerne les sabotages, les sites attaque.noblogs.org et sansnom.noblogs.org sont de bonnes références pour s’informer sur ce qui peut avoir lieu. Pour s’informer sur la répression et les manières d’y échapper, la plateforme notrace.how/ est très utile également. Il existe sans doute d’autres sites internet de ce type, d’autant plus si l’on ne se limite pas à la francophonie. Et d’autant plus de moyens de s’informer dans la vraie vie. Pour s’informer sur internet de manière anonyme, utiliser Tor voire même Tails est préférable.
[8] Il avait déjà été attribué pour l’usine de production de panneaux photovoltaïques de la société Carbon situé sur la commune de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, 13), pour l’usine de recyclage moléculaire des plastiques de la société Eastman à Saint-Jean-de-Folleville (Seine-Maritime, 76), pour l’usine de production de minerais de fer réduit et d’hydrogène de la société Gravithy à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône, 13), et pour le site d’extraction et de transformation de lithium de la société Imerys à Échassières (Allier).
[9] Ce groupe prévoit d’investir dans deux autres sites en 2025, dont un sans doute à Mougins.
[10] Nécessitant un raccordement au deux lignes haute tension de 225 000 volts du réseau RTE est envisagé d’ici à un ou deux ans.
[11] Dans certains cas extrêmes, comme pendant le confinement, des centres de données (comme ceux qui diffusent des matchs de foot) anticipent des pics d’activité en préparant des gros stocks de câbles et de fioul pour assurer la continuité de leur service.
[12] Selon une étude du cabinet de conseil Arcadis, Paris serait la quatrième ville, et Marseille la cinquième, en Europe derrière Francfort (Allemagne), Londres (Royaume-Uni) et Amsterdam (Pays-Bas) en termes d’« attractivité » pour les data-centers.
[13] C’est notamment le cas à Marseille où 17 câbles sous-marins arrivent à proximité d’un data-center prévu dans une ancienne halle au sucre sur le territoire du Grand port maritime avec comme clients Microsoft, Meta, Oracle, Disney Plus, les opérateurs télécoms français, le projet Iter et Eaux de Marseille.
[14] D’une manière générale, ces attaques ont interrompu ou ralenti la circulation haut débit de données internet par la fibre optique, la téléphonie ou le trafic des data centers.
[15] Sept premiers sites ont été sélectionnés en finlande (près du supercalculateur LUMI), en allemagne (près du supercalculateur HammerHAI), en grèce (près du supercalculateur Daedalus), en italie (près du supercalculateur IT4LIA), au luxembourg (près du supercalculateur L-AI Factory), en espagne (près du supercalculateur MareNostrum 5) et en suède (près du supercalculateur Mimer). 6 autres sites ont été retenus en allemagne (près du supercalculateur Jupiter), en autriche, en bulgarie, en france (près du supercalculateur Alice Recoque), en pologne et en slovénie.
[16] Le supercalculateur Jules Verne doit être installé en 2025 dans le Très Grand Centre de Calcul (TGCC) du Commissariat aux énergies alternatives et à l’énergie atomique (CEA) à Bruyères-le-Châtel (Essonne, 91). Il serait dédié au développement de l’énergie de fusion (nucléaire), à l’analyse rapide des données génomiques pour les mutations virales et à la gestion du changement climatique par la fourniture de modèles de prévisions météorologiques à plus haute résolution. Le CEA dispose d’un autre supercalculateur dédié à la simulation nucléaire au sein de la branche militaire du CEA à Bruyères-le-Châtel (Essonne, 91), nommé EXA1, et dont la puissance de calcul aurait plus que quadruplé récemment pour devenir (apparemment) le plus puissant de France. Il est dédié à la simulation numérique de la mise au point des armes atomiques françaises (qui aurait remplacé les essais atomiques depuis 1996). Le second plus puissant serait l’Adastra qui équipe le Centre national de calcul intensif des universités à Montpellier.
Brochure disponible sur infokiosques.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (4.7 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (7.3 Mio)