Brochures
L’En-Ville 3
Récits de transformations urbaines sur Montreuil et Bagnolet (Janvier 2016 – Mai 2020)
mis en ligne le 30 septembre 2020 - Collectif Prenons la ville
L’En-Ville #3 - Récits de transformations urbaines sur Montreuil et Bagnolet, par le Collectif Prenons la ville, est paru en mai 2020 dans la banlieue est de Paris.
Sommaire
Edito
La rue interdite aux pauvres
- Des barrières anti-biffins et anti-SDF à Montreuil
- Carte des dispositifs anti-biffins et anti-SDF (voir version PDF)
- Les biffins, ces habitant.e.s indésirables
- Montreuil sous haute surveillance
Nouvelles lubies pour mieux dégager
- Le budget participatif, le gros bluff
- Une expérience du budget ou le tri des populations
- Une gestion urbaine à la cool
- Du squat Emerson à l’artist-run space
- Le collectif Wonder, ou l’art au service de la gentrification
- Squatsolutions et Camelot Europe
- Résidentialisation, privatiser l’espace
Lutter pour habiter
- 13 familles à la rue, errances et luttes
- Squat Gambetta et Savart, récupération humanitaire
- La carte des squats, des lieux vides et des expulsions
- Des lieux toujours vides, on vous fait la liste...
- L’Echarde, sauter sur l’occasion
- Occupons les maisons, détruisons les prisons
- Tentative de vol par effraction en réunion
- Mécasolid, le garage solidaire place de la Frat’
Les Baras toujours là !
- Des nouvelles du collectif Baras
- Rue Bara, la disparition du foyer
Projets à combattre
- Le café qui ne vend pas du rêve
- Ilôt Volpelier
Docu-graphie critique
Edito
Voici un nouveau numéro de L’En-ville, avec
une nouvelle série de récits sur Montreuil et
Bagnolet, entre janvier 2016 et mai 2020, dans la
suite des deux autres numéros (L’En-ville 1 en juin
2013 et L’En-ville 2 en avril 2016).
Les projets urbains et immobiliers avancent, les
expulsions sont toujours plus nombreuses, les
contrôles sur la rue se renforcent, les quartiers se
gentrifient, enfin tout ce sale système continue.
Et il se pare de gadgets tendances, de soupes
d’artistes, de fêtes, de fleurs et d’arbres, de
mobiliers sympathiques, pour faire passer la pilule
à ceux et celles qui pourraient s’énerver. Mais la
pilule est un peu grosse, et on ne voudrait pas
s’y méprendre, alors il nous semble nécessaire
de continuer à écrire sur la violence que la ville
capitaliste génère sur nous, nous qui n’acceptons
pas ou qui subissons l’ordre existant. Voici donc
pourquoi ce troisième numéro se fait et espère
avoir une suite.
L’En-ville est un fanzine écrit par le collectif Prenons la ville qui se réunit une fois par mois depuis 2011. Le Rémouleur, local auto-organisé de Bagnolet,
qui accueillait et soutenait ce collectif, a fermé son
portail en juillet 2019.
Après 8 ans de permanences, de projections et de
rencontres autour de sujets d’actualités, les gens
du Rémouleur ont décidé - de manière partagée - de fermer le local. Les raisons sont multiples et simples : un loyer très cher, des envies différentes,
moins d’énergies et moins de temps à dédier à
l’organisation du lieu, notamment pour cause d’investissement dans les grosses mobilisations
de cette année, désirs de s’ouvrir à d’autres
expériences et envies, etc.
Même si attristé.e.s par la fin d’une expérience
de lutte et d’auto-organisation bagnoleto-montreuilloise, le collectif Prenons la ville continue de se réunir et propose toujours de réfléchir et de
lutter contre la manière dont la ville s’est faite et se
fait encore aujourd’hui.
Continuons à partager les outils, les stratégies et
les expériences autour de nos pratiques, pour se
renforcer, se questionner et permettre à nos luttes
de s’étendre !
De multiples initiatives de solidarité ont existé
pendant la période du confinement liée au covid-19. Elles ne sont pas racontées ici dans ce numéro de
L’En-ville 3, il semble plus intéressant de prendre
un peu de recul avant de raconter l’histoire de
notre point de vue. Mais ne vous inquiétez pas,
dans L’En-ville 4, il y aura tout ça ;)
Bonne lecture !
La rue interdite aux pauvres
Des barrières anti-biffins et anti-SDF à Montreuil
Depuis quelque temps, un florilège de barrières
s’amasse autour de la Porte de Montreuil
entre la rue de Paris et la rue de Lagny. Disposées
en lignes simples, en double épaisseurs, en
double épaisseurs croisées, elles encombrent les
trottoirs, bloquent les pistes cyclables et débordent sur la rue.
La mairie veut restaurer la chaussée ? Un grand
chantier de rénovation de la voirie est prévu ? Rien
de tout ça n’est annoncé. Alors à quoi peuvent
bien servir ces barrières ?
Le mystère reste entier, a priori, car rien n’est
expliqué, aucun panneau, aucune communication
sur ce phénomène, rien n’indique à qui elles
appartiennent, qui les a mises en place. Elles
paraissent être temporaires, pourtant certaines
sont là depuis plusieurs années. Et elles sont
disposées seulement dans certaines rues, surtout
celles qui bordent le périphérique, et notamment
là où il y a des immeubles de bureaux, de banques
ou d’administrations.
En fait, elles empêchent l’installation des
vendeurs de rue appelés les biffins. Car à Porte
de Montreuil le marché aux puces déborde depuis
toujours de ces petit.e.s vendeurs/vendeuses
de rue illégaux qui s’installent sur les trottoirs,
proposants aux passant.e.s d’acheter des objets
récupérés.
Ces rues étaient occupées par eux/elles mais aussi
par quelques autres personnes qui dormaient dans
leurs voitures, installées le long des bâtiments
sur les places de parkings. Les barrières sont
situées exactement là où ces gens dormaient,
vivaient ou bien faisaient leur commerce.
Il n’y a donc pas de hasard. Le suspens s’arrête
là. L’objectif des pouvoirs publics, puisque c’est
forcément eux qui ont dû valider l’installation de
ces barrières sur l’espace public, est de contrôler
ces rues pour les vider d’occupant.e.s informel.
le.s. Pour eux, la rue n’est pas un lieu pour dormir,
mendier ou commercer à la sauvette, elle sert
à la circulation ou à la vente de marchandises
légales et réservées à ceux et celles qui ont le
privilège de pouvoir les consommer. Le quartier
autour de la porte de Montreuil se métamorphose
radicalement depuis quelques dizaines d’années,
accueillant de plus en plus d’entreprises privées et
donc toute une nouvelle population de travailleurs/
euses et d’habitant.e.s plus fortunés. Ainsi les
populations, habituées à cet espace, se voit
reléguées à déguerpir car elles ne correspondent
pas à l’évolution de ce quartier.
Donc que ces barrières soient « déguisées » en
pots de fleurs géants ou en ruban de chantier,
elles ont toutes la même fonction : le contrôle
social et physique de l’espace public.
Les biffins, ces habitant.e.s indésirables
En l’automne 2019, la Ville de Paris a publié les
résultats du concours « Reinventing cities » concernant la Porte de Montreuil. Le projet lauréat est porté par Nexity, Engie et le Crédit Agricole
Immobilier. Comme dans toutes les soupes de
ce genre (« Réinventer Paris », « Réinventer
la Seine », « les places parisiennes », etc.), il est bien évidemment question de « circulations douces », de « végétalisation », de « coworking » et « coliving », de concertation, d’espaces pour les associations, l’animation et même d’ « espaces dédiés à l’économie circulaire ». Mais
d’abord il faut bien sûr tout faire pour flinguer les
pratiques qui existent déjà et qui ne plaisent pas
aux décideurs.
La chasse aux pauvres
Dans le numéro précédent de L’En-Ville, on avait
décrit comment, côté Bagnolet, les biffins avaient
été chassé.e.s du square Eugène Varlin à coups
de grillages et de flicages. Depuis, sans surprise,
le marché des biffins s’est déplacé, depuis, un peu
plus vers le sud, dans la zone comprise entre la
rue de Paris, l’avenue Benoit Franchon, la rue de
Valmy et la rue Armand Carrel.
Chaque week-end, en soirée, les biffins s’installent
là où les flics sont déjà, ou pas encore, passés.
Leurs client.e.s les attendent, patient.e.s et
nombreureuses, sur place. Quand les flics débarquent, ils confisquent et/ou fracassent tout ce qui est exposé à la vente, à savoir
des objets et des fringues récupérés par
les biffins dans les poubelles.
Il nous semble que, ces derniers temps, les flics
ont arrêté de gazer les gens et de les malmener
physiquement, mais n’empêche, quand ils arrivent
tout le monde se disperse vite, souvent en laissant
sur place les marchandises. Plus rarement, certain.e.s biffins protestent ou essayent de négocier pour au moins récupérer leur récup’, en vain.
En plus des descentes régulières de police, le
volet de la guerre sociale qui consiste à chasser
les biffins du secteur comporte d’autres stratégies
: des grilles amovibles ainsi que des arbres dans
des bacs ont été posés le long des trottoirs pour empêcher l’installation du
marché informel (et l’installation tout court de
familles sans abris).
La mairie organise aussi des réunions
publiques et des ateliers de concertation
pendant lesquels la plupart des intervenant.e.s,
que ça soit des élu.e.s, des habitant.e.s, des
commerçant.e.s ou des employé.e.s des services
municipaux s’accordent sur la nécessité de
poursuivre « la chasse aux biffins ... enfin ... la chasse à une activité, bien sûr, pas
aux humains » , selon les mots d’un membre du service Tranquillité publique et prévention.
La dernière réunion « sur le marché sauvage » a
eu lieu le 20 mai 2019 dans les locaux de l’école
Paul Bert. Elle faisait suite, comme celle du début
février, à une manifestation contre les biffins
organisée par des riverain.e.s (une cinquantaine
de personnes à tout casser) un samedi matin
d’octobre 2018.
En début de réunion, un mec de la Tranquillité
publique constate que « le marché sauvage » s’est
déplacé vers la rue de Paris. Il nous explique que « ces publics sont organisés et qu’ils communiquent entre eux par les réseaux sociaux ». Il informe
l’assistance que les marchandises auraient
changé de nature : ça serait « moins de la biffe »
que du « tombé du camion », ça serait carrément
« des produits fabriqués et copiés ». Ceci est sans cesse repris tout le long de la réunion, comme s’il
s’agissait d’un argument en plus en faveur de la
« suppression de cette activité », ou alors dans
l’espoir que ce scoop gagne en vérité grâce à sa
répétition ... Mais non, ça ne marche pas. Il suffit de
traîner quelque fois sur le marché des biffins pour
constater empiriquement que la marchandise n’a
pas changé, que c’est toujours et pour la plupart
de la récup des poubelles.
Ordures, urines, biffins, dans
le même panier d’une traque
méthodique...
Autre constat pour les agent.e.s de la tranquillité
publique : malgré les efforts – entre autres le fait
d’avoir retiré des bancs – contre les biffins, « il n’y
a que la police qui marche ».
En ce qui concerne les « 60 tonnes » de
marchandises réquisitionnées, il est hors de
question d’en faire autre chose que de les jeter,
car « la benne coûte cher et le tri aussi ».
Il est ensuite question de rats et d’excréments
humains : la mairie essaye de limiter la prolifération
des premiers et plaint les jardiniers qui doivent
ramasser les deuxièmes, ce qui est « très dur ».
Sans compter les « relents d’urine »... Le gérant
du café à côté de la CGT, s’affiche comme étant
au bord du craquage, il dit songer à quitter le
quartier car il perd « quatre jours de travail par semaine » alors qu’il paye 3 500 euros de loyer par mois. « Vous m’avez renvoyé tout chez moi ! » crie-t-il avant de quitter théâtralement la réunion
car « il doit aller travailler ». Une salariée de la
CGT justifie la véhémence de ces propos : « nous
on se retrouve à gérer la misère du monde sur le
parvis ! ». Une mère de famille se dit, elle, gênée
« d’avoir à expliquer cette misère » à sa fille. « Les enfants », dit-elle tristement « sont peut-être mieux ailleurs ».
Attristée à son tour par tant de souffrance, le maire
nous rassure : « tout le monde est très sensible à
la situation que vous vivez ». Une copine propose
alors, avec calme et clarté, d’aborder le problème
d’un autre point de vue : la biffe permet aux
personnes qui la pratiquent de gagner un
peu d’argent et c’est une activité qui réduit
le gaspillage . On pourrait alors la valoriser, on
pourrait aller vers les biffins, discuter avec elles
et eux, trouver des solutions communes et non répressives.
L’un des membres de l’association Amélior, qui
réunit des biffins et organise des marchés deux
fois par mois sous le hall du marché de Croix-de-
Chavaux, intervient à son tour en appuyant les
propos de la copine et en insistant sur la nécessité
d’attribuer davantage d’espaces à la biffe.
Une lutte des classes à ciel ouvert
L’assistance grogne et bouillonne. Une meuf
affirme qu’aucun dialogue n’est possible avec les
biffins. Le maire, faussement débonnaire, appelle
au respect mutuel et le débat – qui n’en est pas un – reprend sur le « droit à la tranquillité », les rats, le pipi, et les « progrès dans l’ordre public » que la Ville a pu assurer.
Une fois de plus, on a le sentiment que ces réunions
ne sont qu’un moyen pour renforcer, par sa mise
en scène publique, le discours anti-biffins et
plus généralement contre des habitant.e.s
perçu.e.s comme « trop pauvres et trop
étranger.e.s », menaçant.e.s, avec leurs
pratiques de subsistance et leur manières
d’être En-Ville, la ville propre, lisse et « tranquille » qui plaît aux décideurs et aux « militants du cadre
de vie » et qui est censée être plus rentable sur le
marché « grand-parisien ».
Montreuil sous haute surveillance
En mal de « tranquillité publique », la
municipalité montreuilloise a pris la décision
en 2019 de renforcer le contrôle de la rue. Pour
cela, elle a décidé : d’installer un maximum
de caméras de surveillance, d’augmenter les
effectifs de keufs municipaux, de créer une
« brigade de propreté » (voir ci-dessous) et de
rénover entièrement l’éclairage public.
Le programme est glaçant, et il est déjà une réalité.
On trouve actuellement 5 caméras sur la rue du
Capitaine Dreyfus, il y en a 22 nouvelles sur la
rue de Paris depuis juin 2019 et le boulevard de
la Boissière devra bientôt connaître le même sort.
En plus de ça, il existe 13 caméras mobiles qui
peuvent être installées à n’importe quel moment
par la « brigade de propreté » dans les rues.
Derrière toutes ses caméras, il y a les agent.e.s de
la « tranquillité publique ». Dignes d’un roman de
Georges Orwell, ils sont attitré.e.s pour visionner
24h-24 les vidéos depuis un centre de supervision
urbain situé à l’Hôtel de ville. Ils peuvent
sanctionner les malheureuses et malheureux qui ne respectent pas les volontés du pouvoir et ne correspondent pas à son idéal ordonné.
Mais ne vous inquiétez pas, la mairie garantit un
comité éthique qui se réunit deux fois par an pour
décider d’une charte afin de « veiller au bon respect
des libertés publiques ». Ouf, on aura eu peur que
toute cette flicaille punisse de manière arbitraire et
sévisse n’importe comment. Sauf qu’on ne gobera
pas leur mensonges, la vidéosurveillance quelque
qu’elle soit est une atteinte aux libertés. Pour
couronner le tout, la mairie se sert des collabos
comme un certain « tissu associatif (...) et le bon
voisinage, qui préservent (le) vivre ensemble » (voir Le Montreuillois n°75). Ils veillent à faire respecter les règles et discipliner les habitant.es.
Pour compléter son programme sécuritaire, notre
« chère » municipalité prévoit un plan budgétaire
de 12 millions d’euros pour remplacer l’éclairage
public et les feux tricolores des rues de la commune.
Cette dernière mesure n’est pas anodine,
l’éclairage public a toujours été un outil majeur
du contrôle social. Historiquement au XVIè
siècle, les premiers lampadaires ont été installés
par la police, non pas pour mieux s’orienter la
nuit dans les rues, mais pour mieux surveiller.
Les lampadaires, encore aujourd’hui servent à
assurer un contrôle permanent de l’espace public,
à débarrasser les rues de ce qui peut causer du « désordre » pour le pouvoir.
Cette logique sécuritaire qui teinte la politique
locale à Montreuil est grandissante et elle a un
coût élevé. La ville est prête à tout pour se
rendre attractive auprès des bourgeois qui
veulent s’y installer en toute tranquillité sans
risquer d’être cambriolé, bousculé, ou de marcher
sur une crotte de chien.
L’installation de caméras et la présence des flics
sont des paramètres de plus en plus intégrés dans
les aménagements urbains. C’est-à-dire que l’on
opte pour des solutions de voiries qui facilitent
l’intervention des flics, on élimine les dispositifs
favorisant la fuite ou la possibilité de se cacher,
on quadrille les espaces de vidéosurveillance, etc.
Le fait d’aborder la question de l’espace urbain
sous l’angle de la surveillance est issu de la
théorie appelée « prévention situationnelle ».
L’objectif est de créer des « espaces défendables » par les pouvoirs locaux qui peuvent dissuader la venue de conflits sociaux, ou pour, s’ils adviennent
les réprimer efficacement.
Afin de maintenir l’ordre, la surveillance est
donc de mise. Ne laissons pas ce processus de
contrôle et de normalisation des espaces où l’on
vit prendre le dessus. Attaquons-nous à leur vision
sécuritaire. Les caméras et la flicaille sont des
poisons qui pourrissent nos vies et rendent
les espaces urbains de plus en plus nuisibles
surtout pour les corps de ceux et celles jugés
suspects, indociles ou superflus.
La « brigade de propreté » :
La « brigade de propreté » est une nouvelle
flicaille, présente à Montreuil depuis 2016, 7
jours/7, pour faire payer les « mauvais citoyens » de leurs « mauvais comportements ». Ils sillonnent les rues de Montreuil et traquent les
dépôts d’ordures ou de déchets jugés illégaux
dans les rues. Et pour pincer les fautifs et les
punir, ils se servent de caméras mobiles qu’ils
installent temporairement (mais on ne sait pas
comment ni où).
Nouvelles lubies pour mieux dégager
Le budget participatif, le gros bluff
En novembre 2018, Montreuil a accueilli
la troisième édition des « rencontres
nationales du budget participatif ». Très médiatisé,
l’événement a réuni un beau monde d’édiles,
d’expert.e.s et de supers citoyen.ne.s engagé.e.s.
Le budget participatif, à la mode
La mise en place de ce processus, que les pouvoirs
appellent de la « démocratie participative », n’est
pas née à Montreuil, elle émerge à Porto Alegre
en 1989 lorsque le Parti des Travailleurs et des
associations locales négocient entre eux qu’une
partie du budget de la commune soit redistribuée
aux habitant.e.s par l’intermédiaire des « comités
de quartier ». Le projet n’a jamais suscité l’engouement des populations, et a plus été de l’ordre de la subvention que de la redistribution
de richesses. Il a surtout permis de pallier des
carences majeures dans des quartiers défavorisés
en les dotant d’infrastructures routières ou de structures sociales.
La mode des budgets participatifs atterrit en
France dans les années 2000, avec un renouveau
très médiatisé en 2014 dans des communes dites
« de gauche », comme Grenoble, Rennes ou Montreuil. L’objectif est d’encourager les individus à proposer de petits investissements urbains et
ensuite de les financer avec l’argent public. À Montreuil, le budget participatif représente 5% du budget d’investissement de la ville, c’est-à-dire 2,5 millions d’euros pour les 14 quartiers (28 €/habitant.e par édition), et 500 000 euros
supplémentaires attribués pour des projets qui
concernent au moins 3 quartiers ou toute la ville.
Ce budget serré n’est redistribué qu’à celles et
ceux qui proposent des idées « compatibles avec
les grands projets d’aménagement de la ville » donc qui ne remettent pas question l’ordre urbain des décideur.se.s.
Des projets superficiels et pas chers
Depuis 2015, l’équipe municipale de Montreuil
a proposé deux saisons de budget participatif,
en 2015 et en 2017. En dehors de quelques-unes, la plupart des propositions visent surtout des aménagements de voiries, l’installation de
mobiliers, ou l’entretien d’espaces verts, choses
habituellement prises en charge dans les budgets
municipaux. Le processus soi-disant innovant
remplace un système de service public vers des
points « à gagner de l’aménagement ». À celui
qui réussira à décrocher le plus beau « dos d’âne » dans sa rue !
La concurrence est rude, surtout au vu du montant
très serré offert par la municipalité pour l’ensemble
des projets. Leur « démocratie participative »,
politique de pacification et de contrôle, à un prix et
il est très bon marché.
Les gens sont poussés à s’approprier ce budget à
cœur joie pour s’impliquer, main dans la main avec
les pouvoirs publics, dans le contrôle intégral de
l’espace urbain, et ce à très peu de frais pour les municipalités.
La politique du chiffre et de la com’
Avant le dépôt des projets les auteur.e.s sont
sollicité.e.s par la mairie, pour présenter leurs
idées publiquement lors « d’agoras citoyennes »,
sortes d’ateliers publics que chacun.e peut
organiser grâce à un guide disponible sur une
plateforme internet dédiée. Après ce grand raout
démocratique, vient le temps d’inspection des
projets pour juger de leur fiabilité et de leur respect
des principes édictés précédemment. Pendant
quatre ou cinq mois, l’équipe municipale et les
services techniques sont chargés d’examiner les
projets déposés et de sélectionner en interne ceux
qui seront ensuite soumis au vote public. Ce vote
est organisé à la fois sur internet et, matériellement
dans certains lieux d’accueil comme à la mairie.
Ouvert à tou.te.s les habitant.e.s de Montreuil, le
vote dure moins d’un mois. Les votes en ligne ont
rassemblé plus de 5 000 participant.e.s, selon le
site de la municipalité, chiffre qui ne représente
finalement qu’une infime partie des habitant.e.s
recensé.e.s de Montreuil, mais en plus qui
semble peu représentatif de la participation
au vu de la facilité à gruger les votes (avec
plusieurs adresses mail différentes, une personne
peut voter plein de fois).
Au final, une trentaine de projets ressortiront
vainqueurs de ce grand jeu, chaque quartier
de la ville se verra attribuer deux ou trois projets,
et trois projets s’appliqueront à l’ensemble de la
ville. Encadrés par les équipes municipales, les
projets sont alors quadrillés dans le temps pour
être réalisés au maximum sur deux ans, jusqu’au
prochain round de subventions. La démarche
s’attelle à construire des résultats visibles, sur le
court terme, permettant d’alimenter la propagande
électoraliste de la municipalité et ainsi d’être
montré lors d’une « visite guidée en bus », par
exemple, pour des « rencontres nationales du
budget participatif » en 2018.
Un outil pour des spécialistes
Sans critères de participation a priori, le
budget participatif prône la volonté de s’ouvrir
à « tous les habitants » de la ville. Les velléités
équitables affichées par la mairie sont pâles face
à la réalité des faits. Il s’avère bien difficile pour
des habitant.e.s non initié.e.s à des pratiques
d’organisation comme celles-ci de se mobiliser sur
de nombreuses réunions et ateliers, ainsi que de
participer activement au montage du projet.
À chaque étape du processus, la démarche
demande un certain savoir-faire et une grande
disponibilité. Héloïse Nez, sociologue, qui a
travaillé sur les budgets participatifs en Europe, démontre que « ceux qui prennent part aux budgets participatifs appartiennent souvent
aux classes moyennes et aux professions
intellectuelles supérieures (...) la grande majorité
est investie dans des associations et près de la
moitié est affiliée à un parti politique, ce qui montre
bien que les citoyens s’impliquant dans le budget participatif sont déjà organisés ».
En effet, les projets lauréats à Montreuil, en
dehors des petits aménagements de voirie ou de
mobilier urbain, sont portés principalement par
des collectifs d’habitant.e.s ou des associations
locales comme le Sens de l’Humus, le Collectif 14,
les Colibris, les EnChantières, etc.
Pour mieux situer, prenons l’exemple du projet « 2 Toits à nous », porté par l’association le Sens de
l’Humus sur le site des Murs à Pêches, remporte
haut la main le vote final à l’échelle du quartier.
L’association est ancrée dans le quartier depuis
longtemps, elle a de nombreux/nombreuses
bénévoles, elle accueille en plus des gens en
insertion professionnelle. Et elle participe à la
transformation des Murs à Pêches main dans la
main avec les aménageurs depuis de longues années.
Sa visibilité et ses liaisons lui offrent de manière
peu surprenante la possibilité d’accéder
facilement au budget participatif. La facilité
s’avère aussi structurelle, avec les travailleurs/
euses (en insertion, bénévoles, ou salarié.e.s) déjà
présent.e.s au sein de l’association, la réalisation
du projet, dessin et construction, peut être géré
en interne. Alors les 70 000 euros attribués par le
budget prennent avant tout en compte le coût des matériaux.
La richesse et la faisabilité du projet qui à séduit la
grande majorité des votant.e.s est très lié aux pré-requis de l’association.
Le projet « 2 Toits à nous » propose l’installation
d’un abri et de deux serres pour développer leurs
activités pédagogiques et culturelles autour du
jardin. L’installation de ces « bâtiments » légers
oblige le dépôt en mairie d’une « déclaration
préalable de travaux » (pour une conformité
aux règles d’urbanisme), ainsi que l’aval d’un
architecte des bâtiments de France car le site des
Murs à Pêches est classé patrimoine historique).
Les embûches techniques et administratives sont
très nombreuses pour permettre l’aboutissement
légal d’un projet comme celui-ci. Malgré tout, les
compétences de l’association, habituée de ces
démarches et au contact perpétuel avec ce type
d’acteurs institutionnels, va la rendre fiable pour
réaliser le projet.
Au final, la capacité à proposer un projet dans le
budget participatif pour ce type de structures,
répond plutôt à un besoin de subvention dont
nombres d’associations souffrent aujourd’hui, sur
Montreuil et dans bien d’autres villes.
Le budget participatif, loin d’amener, comme il
est vanté par la mairie, à une redistribution de
richesses, émiette plutôt des micros-financements
pour des habitant.e.s déjà structuré.e.s.
Une neutralisation des rapports
sociaux entre les habitant.es
Rassemblées sous le mot de « démocratie participative », les pratiques de budgets s’insèrent dans un panel plus large d’artifices émancipateurs
autour de la ville. Habitat participatif, projets
urbains concertés, apparaissent partout. Des
processus où seuls participent des habitant.e.s
inoffensif.ve.s, dont il n’y a rien à craindre du
choix raisonnable de la couleur des pots de fleurs
ou celui de l’emplacement de l’aire de jeux pour enfants.
Ces processus jouent un rôle déterminant dans
la neutralisation des conflits et entretiennent le
mensonge de la cohésion sociale qui défend l’idée
d’un dialogue d’égal à égal où le bon sens
et le bien commun triompheraient entre des
protagonistes qui n’ont pas le même pouvoir et les mêmes intérêts.
Lorsque l’action de chacun.e est docilement
encadrée et filtrée par des équipes municipales
qui sélectionnent et font le tri parmi les projets soumis
au vote, on peut difficilement imaginer des projets
contradictoires avec les volontés politiques locales.
Malgré tout, les slogans municipaux scandent très
sérieusement : « Prenez le pouvoir et décidez
comment utiliser une partie de vos impôts (...) » !
Avec ça, Montreuil devient le laboratoire idéal pour
renforcer les pratiques d’illusion émancipatrice,
dont le but va être de liquider toute conflictualité,
toute prise de position politique et sociale
contradictoire aux pouvoirs.
Une certaine image de la ville...
L’objectif du budget participatif vise, selon la mairie,
à une « reconquête urbaine » par les habitant.e.s
sur chacun des quartiers de la ville afin de
permettre une valorisation et un embellissement
des espaces, notamment pour la voirie. Les
propositions de prises en main des rues de la ville
se résument à mettre en place des délires de vie
plus sécurisée et plus propre sous des aspects
de ludisme et de jouissance.
Ces assignations visent en traduction à multiplier un
contrôle et une définition stricte des usages et des
fréquentations de la rue pour le « bonheur » d’une
certaine population qui peut alors s’y sentir bien
et s’investir dans l’espace public. Les occupations
sont moralisées, impossible de squatter en fumant
ou de pisser dans certains endroits où des bacs à
fleurs ont été installés, bas les pattes ces usages néfastes.
Une nouvelle image de la ville, branchée et
attractive, est récupérée par les promoteurs, bureaux d’études, investisseurs et possédants, car ces formes de vie urbaines apportent des plus-values dans lesquels ils peuvent investir.
Aperçu des projets des deux saisons du budget participatif par thématique :
- la végétalisation d’espaces publics : « le bac à plantes et murs végétalisés », « des
arbres rue des Groseillers ! » ;
- les espaces de jeux : « réaménagement du
city stade des Ruffins », « réaménagement
d’un terrain de basket existant et fréquenté » ;
- le réaménagement de square : « aménagement du square de l’église Saint-Pierre Saint-Paul », « des bancs dans le
square Patriarche » ;
- le réaménagement de rues : « place de
la République en zone piétonne », « des coussins berlinois pour les Montreuillois » ;
- des espaces de jardins et d’aménités
collectives : « Les cocottes du Bel Air, un
poulailler participatif », « aménagement du
terrain pêche-mêle : pour jouer, pique-niquer et jardiner ! » ;
- de l’événementiel : « triporteur-bar à thé du
quartier », « théâtre de marionnettes » ; etc.
Une expérience du budget ou le tri des populations
Lors de la « saison 1 », une copine et moi avons déposé deux projets. Le premier
était un projet d’habitat, le deuxième visait à
l’ouverture d’un espace collectif pour ateliers,
réunions, permanences d’aides aux démarches
administratives, aides aux devoirs. Les deux
projets, co-signés, n’étaient en fait qu’un seul. Il
s’agissait, en effet, d’utiliser le budget participatif
pour poursuivre une lutte commencée en 2013
avec des voisin.e.s vivants en bidonville sur la friche Barda (rue de Paris).
Une partie des habitant.e.s de ce bidonville
avaient auparavant vécu dans le squat de la
Frat’, ouvert en 2007 avec des riverain.e.s. L’été
2012, le squat de la Frat’ avait été expulsé. Une
partie de ses habitant.e.s avaient été relogé.e.s,
dans le cadre de la « MOUS Roms » [1], dans les
logements-passerelles, rue Emile Zola. Celles
et ceux qui ne rentraient pas dans les critères,
arbitraires et hypocrites, de la MOUS, s’étaient
alors retrouvé.e.s à la rue et avaient construit des
baraques sur la friche Barda. La mairie leur file
vite fait quelques poubelles et peut-être aussi des
bâches en plastique, fixées sur les grillages pour
qu’on ne les voient pas trop depuis la rue.
En mai 2013, le bidonville est expulsé, et
ses 60 habitant.e.s environ, se retrouvent
à errer dans le quartier . Puis ils et elles
s’installent sur un bout de pelouse à Porte de
Montreuil. La police les harcèle sans cesse. La
mairie, propriétaire de la pelouse, les fait expulser
à plusieurs reprises. En août 2015, elle fait
construire un grillage autour de la pelouse. Ils se
retrouvent sur le trottoir.
Après des manifs, des actions et des tentatives de
négociations diverses et variées avec la mairie, nous
nous disons qu’on peut peut-être mettre de côté
notre antipathie envers la « participation citoyenne
» et se servir du budget participatif pour pousser
l’équipe municipale à céder aux revendications
des voisin.e.s, qui demandent juste de pouvoir se
réinstaller sur un terrain dans le secteur sans que
la police ne vienne les violenter chaque nuit.
Et, à partir de là, reprendre un peu plus « tranquillement » leur vie quotidienne : « faire
la ferraille » pour la trier et la revendre au poids, ramasser dans les poubelles du
quartier des trucs à recycler et à vendre
au marché informel autour des Puces
de la porte de Montreuil, poursuivre les
démarches administratives (domiciliation,
AME, inscriptions scolaires, etc.), trouver
du boulot salarié comme femme de ménage
ou ouvrier. C’est comme ça - « petit à petit »,
comme disait souvent une jeune du groupe – qu’elles et ils comptaient s’y prendre pour se sortir de la galère.
On monte donc les deux projets en faisant gaffe
à être dans les clous indiqués dans le guide du
budget participatif. On rentre en effet dans le volet « solidarité ». On y tartine un peu d’écologie, de mutualisation de l’espace collectif avec d’autres
associations, du partenariat avec un collectif de
jeunes archis et avec d’autres groupes locaux/
départementaux déjà engagés dans des projets
similaires et voilà nous déposons dans l’urne nos
projets. On se coltine, aussi, pas mal de réunions
institutionnelles et « participatives » dans le but
de montrer que nous sommes bien là, qu’on suit
et qu’on porte le projet. Les échanges mails avec
les services de la mairie, qui nous demandent des précisions byzantines et tordues (histoire de montrer qu’il y a un suivi) - mais qui ne donnent
pas suite à nos demandes de rdv pour faire le
point – nous offrent peu d’espoir.
La machine de sélection des projets avance, nous
sommes toujours dans le tableau Excel. Mais juste
avant la grande messe du « speed date », nous
sommes convoquées à la mairie où, avec un kilo
de vaseline, on nous explique que notre projet
est « trop expérimental », trop « novateur », que
les services ne l’ont pas compris, que le budget
participatif n’est qu’à sa première « saison » et
donc forcément il y a des couacs comme c’est le
cas pour nos deux projets, qui sont donc recalés.
Nous n’avons qu’à réessayer, « dans deux ans »
nous dit-on.
Au Conseil de Quartier, des élus et des voisin.e.s
nous font remarquer que l’un des titres des projets,
« Du bidonville à la ville », avait été très mal choisi
car « bidonville » est un mot « qui fait peur ». Nous
réexpliquons notre démarche : certes, habiter une
platz dans une tente ou une baraque n’est pas top,
mais le fait d’avoir l’accord de la mairie permet de
se poser et de s’organiser avec les moyens du
bord, sans les flics aux trousses et sans la crainte
d’une expulsion pouvant arriver à tout moment.
La demande d’un terrain est la demande
d’espace-temps permettant de demeurer
« en-ville ». C’est la revendication d’une
légitimité à être là, dans la ville où on habite
depuis des années.
Puisque la mairie refuse de mettre en place, avec
les premier.e.s concerné.e.s, un projet de style
MOUS, puisque l’obtention d’un logement social
n’est pas envisageable, puisque le 115 est saturé,
alors la seule possibilité d’habiter qui leur reste
c’est celle d’un terrain et de l’auto-construction « accompagnée » par des pros et des assoc’. Nous rappelons que des expériences similaires
existent déjà à Montreuil et en Ile-de-France, et
donnent des fruits. Mais rien n’y fait. « Bidonville »
fait peur, tandis que la réalité de la rue sèche
subie tous les jours par ces voisin.e.s – qui sont
parmi les plus touché.e.s par la guerre sociale en cours – est visiblement tout à fait acceptable, voire utile aux « militant.e.s du cadre de vie » faisant
des familles à la rue les boucs émissaires de leurs
délires hygiénistes et sécuritaires.
Pour la petite histoire, un projet qui se veut dans
la même lancée - mais porté par et pour d’autres
personnes et sans l’espace collectif - est parmi les
lauréats de la « saison 2 » du budget participatif.
Il porte le titre de « Montreuil, vivre ensemble »
et projette de construire plusieurs « tiny houses »
pour « jeunes isolés », à poser et bâtir de manière,
bien sûr, « participative » et « écologique » sur des
espaces libres.
« Le programme génétique de Montreuil » (bonjour la métaphore !) « depuis des décennies comporte deux principes fondateurs : l’accueil
solidaire des personnes / familles dans le
besoin et le développement de politiques de la
commune en collaboration avec des associations
et les habitants pour rendre l’intégration de ces
personnes réelles grâce à l’éducation, la santé, la
culture et l’emploi ».
Le rédact.eur.rice de la fiche du projet 345 à dû
oublier le troisième principe, qui est celui du tri des
populations, que nous avons vu maintes fois à
l’œuvre dans la ville.
Une gestion urbaine à la cool
Avez-vous déjà entendu parler du Wonder-Liebert, du jardin d’Alice, du REV’café
ou de la Station E ? Ce sont des noms de lieux
apparus à Montreuil ou Bagnolet depuis quelques
années. Ils s’ouvrent dans des anciennes usines,
des bureaux désaffectés ou des terrains dits en
friche et proposent des activités autour de la
fête, de l’art, de la restauration. Ils sont tenus
par des artistes, des architectes, des designers,
des férus de l’événementiel, enfin tout un tas
de personnes ambitieuses, innovantes et
avides de créations atypiques s’inscrivant
parfaitement dans la start-up nation. Mais leur
existence est courte, souvent au bout de quelques
mois ou quelques années ils ferment pour laisser
la place à des projets immobiliers.
Ouvrir pour mieux contrôler
La mise en place de ces lieux n’a rien d’informel,
ils sont légalisés et installés par les décideurs et ne
s’applique pas seulement à Montreuil ou Bagnolet,
c’est plutôt une logique en vogue à l’échelle des
Métropoles comme celle du Grand Paris, où de
multiples espaces de la sorte poussent comme
des champignons. Il existe même un terme
spécifique à ce processus dans la langue des
aménageurs, on parle « d’urbanisme temporaire ».
Cette désignation ne déclare rien de précis mais
a pour but de donner un aspect soi-disant cool
aux évolutions capitalistes de la ville. Il a en
fait une fonction de contrôle social de la
propriété qui est revendiqué ouvertement : « ne pas laisser des lieux à l’abandon », « consolider
la programmation future du site », « amorcer de
nouveaux usages », « rendre fréquentable », etc.
Derrière ces intentions se cachent bien des choses
néfastes pour un grand nombre d’habitant.e.s, notamment les plus pauvres.
Parce que oui, l’objectif principal à travers ces
occupations temporaires légalisées c’est d’investir
continuellement chaque interstice de la ville pour
empêcher l’ouverture de squats et l’installation
d’habitant.e.s qui auraient des usages non
conformes à une tranquillité bourgeoise. Alors,
l’occupation permanente et contrôlée de chaque
lieu devient un moyen de se débarrasser de
toutes oppositions aux objectifs rentables de la
ville. La tendance ce n’est donc plus seulement
de conquérir de nouveaux territoires, mais de
progresser en intensité et d’encadrer
toutes les dimensions temporelles de la
ville. Le contrôle des formes d’occupation permet
de créer continuellement des potentiels attractifs
en faveur de logiques marchandes pour chaque
lieu et à toutes les étapes de son évolution.
Dans cette logique, il y a Est-Ensemble, la « super-structure aménageuse » [2], qui lance chaque année
depuis quatre ans un appel à manifestation
d’intérêt (AMI) pour recruter des équipes qui
mettront en place des activités sur des espaces
dits en friche situés sur les futures zones de projets
urbains. L’objectif affiché est de « procurer aux
riverains et aux visiteurs un espace de rencontre,
de découverte et d’échange sur le devenir du
quartier » raconte Est-Ensemble sur son site. En
traduction cela signifie : installer des activités
ludiques pour faire accepter aux habitant.e.s
un projet qui va détruire une grosse partie
de leur quartier en faveur de plus riches. Un bon
moyen pour faire passer la pilule et éviter toute contestation.
Ainsi la « station E » située au 236 rue de Paris [à Montreuil] s’est ouverte en juin 2018. C’est un « espace culturel
et festif autour des énergies renouvelables », « où on peut faire la fête en sauvant la planète », « #écologie, #transition, #économie circulaire » peut-on lire sur le site internet du lieu. Ces objectifs
sont totalement flous, mais projettent des valeurs
soi-disant communes qui feraient consensus à
leurs yeux.
En fait, les gestionnaires de ces lieux ne proposent
que des activités qui répondent, ou en
tout cas qui ne s’opposent pas, au futur
projet urbain qui viendra après. Ici, la station-E
est située sur une partie de la future ZAC « de la Fraternité » qui veut transformer une grosse partie du Bas-Montreuil avec 800 logements
nouveaux, des bureaux, des commerces, des
écoles, impactant en grande partie les possibilités
de vie des habitant.e.s majoritairement pauvres du
quartier. Toutes les formes hostiles à l’expansion
du projet des aménageurs sont donc rejetées.
Toutes les occupations critiques en actes de la
propriété privée sont interdites. Alors, on pioche
dans tous les nouveaux concepts tendances pour
inventer un lieu où la bière se vend 8 euros.
L’occupation temporaire choisie et légalisée
est un outil qui permet d’attirer des populations
branchées au capital économique élevé sur des
territoires qu’elles ne fréquentaient pas ou peu
avant. L’intérêt est que celles-ci peuvent être les
potentiels propriétaires des futurs logements de
la ZAC et font augmenter la valeur économique
du quartier. Alors, pendant qu’ils et elles viennent
s’amuser à la Station E en se disant que « Montreuil/
Bagnolet c’est sympa », les promoteurs se frottent
les mains. La com’ est parfaite et la friche devenue
tendance sert de vitrine commerciale.
Des gardiennages utiles socialement
Dans cette opération, le choix des gestionnaires
du lieu est primordial puisqu’ils doivent en effet
légitimer l’ordre urbain existant et garantir une
plus-value.
Le contrôle des résident.e.s s’exerce par un
encadrement sous forme de bail temporaire ou
de convention. Les durées d’occupations sont
réduites à quelques mois ou quelques années,
limitant toute construction de liens permanents au
quartier, garantie pour le propriétaire qu’aucune
résistance ne s’organise. Et puis de toute manière
les populations qui fréquentent assidûment ce
genre de lieux ne s’opposent que rarement à leur
fermeture puisqu’avec leur fort capital économique
et culturel ils et elles auront toujours un moyen
d’en retrouver d’autres, quitte à y mettre le prix.
Les occupant.e.s ont donc avant tout un
rôle de gardien.ne des lieux pour empêcher
toutes formes d’occupations « dangereuse
pour la paix sociale » et qui mettraient en danger
le futur projet des aménageurs. L’exigence est de
n’accepter que des occupations utiles, ni galérien.
ne.s, ni sans papiers, ne seront accepté.e.s comme
les gardien.ne.s fiables d’un lieu. Ce processus
est rentable pour un.e proprio ou un.e aménageur.
se qui se retrouve alors à ne plus devoir
gérer des expulsions ou faire appel à une
société de gardiennage coûteuse. De plus,
ielles peuvent miser sur la culture et l’art comme
éléments attractifs qui valorisent foncièrement les
lieux. Double banco !
Prenons l’exemple du squat Emerson, au 124
rue Gallieni à Bagnolet, qui fut occupé par des
personnes du collectif Bara en 2014. Leur expulsion programmée mais finalement précédée d’un incendie va permettre au propriétaire d’installer
sur les lieux des artistes quelque peu prétentieux
constitués sous le collectif « Wonder ». Les
sans papiers faisaient tache. Les artistes eux
ne demandent rien que des espaces vides pour
exercer leur art égo-centré et leur vision de la
ville rentable.
Leur occupation sera encadrée par un bail. Et
pendant les deux ans, ils et elles occuperont le lieu
sagement en rendant les clés en temps voulu sans
résistance. Les artistes deviennent les cerbères
des lieux dont le professionnalisme de
bon chien-chien est validé en amont par le
propriétaire.
Occupant.e.s spécialisé.e.s
En effet, les collectifs, comme le « Wonder », sont
choisis méthodiquement : ce sont des expert.e.s
en la matière ils et elles ont déjà plusieurs
expériences de la sorte à leur actif en Île-de-France. Souvent en mal de lieux pas cher où s’implanter, ces personnes naviguent pour survivre
et concrétiser leur petite entreprise artistique.
Le métier « d’occupant temporaire conciliant » se développe et devient une expertise urbaine comme une autre. Un nouveau marché s’offre
aux propriétaires et aux pouvoirs publics qui n’ont
qu’à se servir au gré de leurs désirs. Et comme
la concurrence est rude pour celles et ceux qui
cherchent des espaces, l’exigence du choix des
occupant.e.s est forte, c’est à celui qui répondra le
mieux aux critères.
L’enjeu principal pour les aménageurs est de
pouvoir récupérer les clés quand bon leur semble,
pour engager ensuite la construction et la vente
de nouveaux biens immobiliers sur les lieux. La
neutralisation politique des occupant.e.s est donc primordiale. L’art consensuel et
la culture docile participent d’une certaine
forme au maintien de l’ordre social. Elles sont à priori les meilleurs formes d’occupations possibles pour garder le contrôle total de l’espace urbain.
Les lieux de fêtes, d’arts et de cultures temporaires, comme le Wonder-Liebert ou la Station E, sont un nouveau moyen de gestion de la ville pour favoriser
l’arrivée de classes sociales aisées et l’éviction
des pauvres en faveur de projets urbains
qui permettent aux propriétaires et aux
pouvoirs publics de spéculer toujours plus
sur l’espace. Les jolis concepts sur palettes en
bois et poscas fluos sont parfois les plus terrifiants.
Du squat Emerson à l’artist-run space
Courant 2013, la multinationale Emerson
Network Power délaisse un grand bâtiment
de 4 étages situé sur l’avenue Gallieni à Bagnolet.
Pendant la même période, dans le quartier, de
nombreuses personnes sont à la rue. Parmi celles-ci, 200 personnes environ s’étaient retrouvées sans abri, en mai, suite à l’expulsion du bidonville
de la friche Barda (rue de Paris, Montreuil) et à
l’expulsion du squat que le Collectif Baras venait
d’ouvrir rue Rapatel (Montreuil).
Après plusieurs mois de galères, agrémentés par
le harcèlement des polices nationale et municipale
ainsi que par le mépris absolu tant du préfet que
des élus locaux – qui n’ont qu’une idée en tête,
à savoir : les faire dégager – certain.e.s décident
de s’organiser ensemble et occupent, fin octobre 2013, le bâtiment Emerson.
Ils et elles l’habitent, à 220, dans un confort
relatif et sans conflits majeurs, sous le
mode de l’autogestion, pendant 10 mois.
Après avoir rangé le bordel laissé par les anciens
occupants, ils et elles réorganisent les espaces,
entretiennent les locaux, mangent, dorment, vont
travailler ou à l’école, ont de la visite et font même
de l’hébergement, se réunissent, organisent des
soirées, font le lien avec les élus et aspirants élus,
s’organisent pour défendre la maison en justice
et proposent même au proprio de lui payer un
loyer par le biais d’une convention d’occupation temporaire.
Mais non.
Par décision du juge le squat Emerson est
désormais expulsable. Début août 2014, les
habitant.e.s sont expulsé.e.s. Les cinq familles
vivant sur place sont relogées.
Les hommes du Collectif Baras, célibataires, se
retrouvent à nouveau à la rue [3].
Le bâtiment Emerson reste longtemps vide
et surveillé 24h/24 par des maîtres chiens .
Mi-février 2017, les Ateliers Wonder-Liebert y installent un « artist-run space », c’est-à-dire « un lieu pensé, créé et construit par des artistes pour des artistes ».
Les 40 artistes en résidence ont signé, avec
le propriétaire des locaux, une convention
d’occupation temporaire d’un an par l’intermédiaire
de l’association Plateau urbain, qui a comme
mission « d’identifier les locaux vacants pour y
héberger des projets culturels ». Plateau Urbain
n’est pas directement impliqué dans l’expulsion
des 220 habitants du squat Emerson. Néanmoins,
sa « vision » de la ville fait froid dans le dos, pour
ne pas dire qu’elle donne la gerbe, on vous en
donne un extrait dans l’encadré juste après.
Leur volonté de « redonner vie » ou de développer
un « vivier d’économies méconnues » à travers
l’occupation encadrée et réglementée des lieux
abandonnés par leur propriétaire tend à faire
de chaque espace de la ville un potentiel
rentable à toutes les étapes de son
évolution. Ils sont des « agents
d’entretien » qui s’occupent de redonner une
plus-value foncière et ainsi de rendre d’autant plus
rentable l’investissement futur du site.
Plateau Urbain, un agent immobilier qui n’en paraît pas :
« Plateau Urbain entend fédérer
les réflexions en cours sur le recyclage
des bâtiments et les circuits courts, pour
permettre aux porteurs d’accéder à une offre
de ressources techniques et matérielles
diversifiée et développer leur projet à moindre
coût. L’occupation des locaux vacants,
moyennant le paiement des charges et des
taxes, permet aux propriétaires d’annuler le
Banderole des Baras devant le squat Emerson, 2014
coût souvent sous-évalué que représentent
les charges, le gardiennage, la sécurisation et
le maintien en état d’un site inoccupé.
Trouver un occupant temporaire est un
vivier d’économies méconnu, à l’heure où
les entreprises mais aussi les collectivités
territoriales cherchent à comprimer leurs coûts
immobiliers. (...) Plateau Urbain noue des
partenariats avec les propriétaires. Plateau
Urbain vise à redonner vie (...) à un certain
nombre de bâtiments, pour réanimer des
zones pour l’instant délaissées afin d’orienter
leur attractivité. »
Extrait du site de l’association Plateau Urbain.
Le collectif Wonder, ou l’art au service de la gentrification
[Publié initialement en février 2017 sur Squat.net.]
Gentrification : nom féminin. On expulse des sans-papiers, et on fout des artistes branchés à la place.
« Je ne m’en fais pas trop pour le moment quant à la récupération, nous avons une longueur d’avance sur la liberté. »
Nelson Pernisco, du collectif Wonder (interview sur le site de Manifesto XXI)
Il y a deux ans et demi, un squat situé au 124 avenue Gallieni, à Bagnolet, ouvert dix mois auparavant par le collectif Baras, un collectif de sans-papiers majoritairement maliens, était expulsé par la police. Récemment, des artistes branché-e-s et opportunistes ont récupéré le bâtiment qu’ils occupaient. Ils et elles organisaient lundi dernier une soirée-événement, « Dirty Pepax » d’après leur brochure distribuée à l’entrée. Cet événement, organisé dans le cadre des « lundis du Pavillon Neuflize » du Palais de Tokyo, a réuni des centaines de personnes. Bonnets trop petits, moustaches fashion, pantalons taille haute et lunettes à montures épaisses étaient de sortie, pour s’enjailler autour d’œuvres d’art contemporain « DIY », directement inspirées de l’esprit des squats d’artistes et de l’art « underground ».
On est nombreuses et nombreux à se souvenir de ce squat, de son ouverture en octobre 2013 à deux pas du Transfo, à son expulsion et à la lutte qui a tenté de l’empêcher durant l’été 2014. Les assemblées dans le hall pour s’organiser pour être présent-e-s les matins où on sentait l’expulsion imminente et les rassemblements matinaux pour attendre les keufs. Autant dire que la nausée nous a saisi lorsqu’on est entré-e-s dans l’enceinte, halluciné-e-s. Un fier logo « Liebert » trône maintenant sur le mur du bâtiment. Des artistes benêts aux crinières de feu et autres fashionistos occupent maintenant les lieux.
On a cherché à en savoir plus. On a navigué ainsi, de surprise en surprise. Apprenant là qu’ils s’occupent du gardiennage du lieu, ici qu’ils le louaient à 5000€ par mois pour 20 occupants. Ils sont passés par Plateau Urbain, une espèce d’entreprise spécialisée dans la mise en location de locaux vacants. Ces ordures mettent en avant l’intérêt qu’a le propriétaire à ne plus avoir à gardienner son immeuble, et toute une soupe éco-citoyenne de développement de l’usage immobilier (blablabla). Les occupants, donc, c’est le collectif « Wonder », un ramassis d’artistes écervelés qui érigent l’apolitisme en valeur première. Ils disposent d’un an avant la démolition, lorsqu’on leur demandera de partir ils quitteront bien gentiment le lieu, leurs airs faussement rebelles cachant en réalité une docilité minable. Coucouche panier, l’artiste subversif.
Le pire est peut-être de croire que certain-e-s écoutent et croient encore à la chiasse qui leur coule de la bouche. À les entendre, la gentrification n’a rien à voir avec eux. Eux, ce qu’ils font, c’est pas politique. Déjà parce que c’est légal, ça n’a rien à voir avec qui occupait le lieu avant. Si la police a expulsé le squat, comment cela pourrait-il être de leur faute ? De toute façon c’est simple, chaque lieu a un karma. Tout cela, dixit eux-mêmes, ça faisait flipper de les entendre se justifier de la sorte.
L’un d’entre eux nous a même sorti : « c’est pas parce qu’il y a des artistes-hipsters que la police expulse les sans-papiers », ce à quoi on lui a répondu que « c’est parce que la police expulse les sans-papiers qu’il y a des artistes-hipsters ». L’histoire de ce « Liebert » résonne d’ailleurs avec celle du « Jardin d’Alice », qui a été tranquillement réinstallé par les pouvoirs publics avec une convention d’occupation en 2015 dans un lieu précédemment squatté par le même collectif Baras, rapidement expulsé par la police. Artiste ou sans-papier, choisis ton camp.
Ça nous a dégoûté, alors on leur a dit. On l’a aussi écrit sur leur façade. On se disait qu’on pourrait être plusieurs à leur rappeler ce qu’on pense de leur cas, par les moyens qu’on affectionne. C’est au 124 avenue Gallieni à Bagnolet, il y a plein de fenêtres à un jet de pierre du trottoir…
Squatsolutions et Camelot Europe, une histoire de capitalisme urbain
[Publié initialement en décembre 2018 sur Squat.net.]
Si tu possèdes un bien immobilier (un studio, un appartement, un atelier) et que tu le laisses vide parce que « dans quelques années je pourrai le vendre/louer plus cher », ou parce que « je n’ai pas le temps de m’en occuper » ou bien car « c’est compliqué, on n’arrive pas à trouver une solution avec les autres co-propriétaires », il est possible qu’entre-temps des galérien.ne.s y trouvent un abri.
Il arrive souvent que pendant des années des appartements, voire des immeubles entiers, soient laissés vides par leurs propriétaires. C’est à ce moment là que les « junkies » (comme le chef de Squatsolutions aime les définir) entrent en action. Ce sont des migrant.e.s, des chômeu.se.r.s, des précaires, des travailleu.r.se.s, des personnes seules ou avec famille, qui n’ont pas les bons papiers, les bons dossiers pour l’agence immobilière et/ou pas assez d’argent pour payer des loyers désormais exorbitants.
Au fil des années, des agences sont nées pour faire face au « problème » des squatteurs et des squatteuses. Aujourd’hui, les plus connues sont Camelot Europe et Squatsolutions.
Qui est-ce ?
– Squatsolutions [https://squatsolutions.com/] se définit comme « leader européen spécialisé dans le rachat de biens en situation complexe ou problématique ». Ils rachètent tout bien immobilier squatté en l’état AVEC les occupant.e.s sans ni droit ni titre. Ils s’occupent aussi de gérer les indivisions conflictuelles.
Yan Collet, le responsable acquisition, a plusieurs collaborateurs : des notaires, des avocats (dont maître Raphaël Richemond et maître Grégory Cherqui), des huissiers de justice (dont maître Alleno), la police nationale, la police municipale, des mairies, des généalogistes, des syndics de copropriété et des pompes funèbres. De plus, des agences immobilières des régions PACA, Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France lui envoient des dossiers immobiliers placés dans des « situations complexes ».
Squatsolutions travaille uniquement en France.
– De l’autre coté, Camelot Europe [https://fr.cameloteurope.com/] est un spécialiste de biens vacants au niveau international. Ce promoteur permet aux propriétaires de louer leurs locaux temporairement vacants pour pas cher, mais avec plein de contraintes pour les locataires : pas d’animaux, pas de tabac, pas d’enfants, pas de fêtes, pas plus de 18 mois d’occupation. Et un bon nombre d’obligations aussi : signaler tout dysfonctionnement ou toute intrusion illégale, respecter le règlement intérieur, etc. Des visites de contrôle sont prévues tous les mois pour vérifier le bon état du bâtiment. Leur objectif est de surveiller et protéger les biens de leurs clients afin d’éviter que des gens les occupent illégalement. Avec cette démarche, ils permettent de créer de la plus-value sur les biens immobiliers. Leur slogan est « protection par occupation » (bleah !). Ils travaillent aux Pays-Bas (où ça a été créé, en 1993), en France, en Belgique, en Finlande, en Angleterre, en Irlande et en Allemagne.
Comment ca marche ?
– Squatsolutions. Après avoir compris qui sont les occupant.e.s, ils commencent des procédures judiciaires pour les expulser. Lors des procès, l’avocat de la boîte cherche à faire condamner les occupant.e.s à indemniser les propriétaires, mais souvent c’est des gens qui ne peuvent pas payer. Ils se chargent aussi de l’obtention de tous les diagnostics indispensables en vue de la signature du compromis de vente.
– Camelot Europe. L’agence s’occupe de trouver des résident.e.s temporaires pour les immeubles à louer selon des critères de sélection très stricts. L’offre de résidence temporaire s’adresse à un public cible de travailleurs et travailleuses de tous âges, avec une préférence pour les célibataires. Pour vérifier la fiabilité des postulant.e.s, il y a un entretien où il faut fournir les documents originaux.
Tout ça c’est dégueulasse !
Une autre histoire de chasse aux pauvres et de capitalisme urbain
Si on regardait les choses du point de vue de celles et ceux qui galèrent pour s’abriter plutôt que du point de vue des promoteurs et des pouvoirs publics qui livrent la ville au capitalisme urbain, l’histoire serait racontée d’une autre manière. Dans les faits, les inégalités sont criantes.
Parce qu’ils/elles ont besoin d’un endroit où se loger, les squatteurs/squatteuses essayent de s’installer dans un bien qui est laissé vide par son/sa propriétaire. Souvent, ces mêmes squatteurs/squatteuses ne peuvent pas accéder aux logements sociaux ou aux aides de l’État car ils/elles n’ont pas le bon bout de papier, ils/elles ne remplissent pas tous les critères requis, ou bien parce qu’il n’y a pas assez de place pour loger tout le monde. Et à cause de ce système qui défend le droit de propriété et qui préfère spéculer plutôt que donner un toit à tout le monde, les squatteurs/squatteuses sont le plus souvent expulsé.e.s par la police sans aucune proposition sérieuse de relogement.
Parmi les occupant.e.s des bâtiments vides, certain.e.s squattent non seulement pour des raisons économiques mais aussi par choix politique, pour contrer la spéculation urbaine, pour faire vivre des espaces laissés à l’abandon et pour créer des dynamiques collectives hors du cadre institutionnel. Eux et elles aussi subissent le même traitement.
Face à cela, le squat nous apparaît comme légitime, voire salutaire. Tandis que la possession de (plusieurs) biens immobiliers inoccupés (murés, surveillés, gardiennés) pendant des mois et des années nous semble, elle, ignoble et illégitime, comme toute forme de spéculation.
Au lieu d’essayer d’empêcher tout type d’occupation illégale, il vaudrait mieux réfléchir aux problèmes sociaux existants et à la remise en question du modèle capitaliste et égoïste qui caractérise notre société.
Les entreprises comme Squatsolutions et Camelot Europe font du profit sur la galère des gens et encouragent l’affaiblissement des solidarités entre les personnes.
Il pourrait donc être intéressant de faire signe à ces entreprises cupides, juste pour leur rappeler qu’il ne suffit pas d’expulser les gens pour s’en débarrasser…
Le cabinet de l’huissier Alexandre Alleno se trouve au 39 avenue du Président Wilson, 93100, Montreuil.
Celui des avocats Richemond et Cherqui se trouve au 15 rue de Lubeck, 75116, Paris.
L’adresse postale de Camelot Europe se trouve au 46 rue de l’Echiquier, 75010, Paris.
Tissons des solidarités dans les quartiers et ne nous laissons pas faire !
Si le jeu c’est la chasse aux pauvres, nous ne voulons pas jouer avec vous. La seule chasse qui nous plaît, c’est la chasse aux maisons vides !
[Version PDF, tract de 4 pages A5.]
Résidentialisation, privatiser l’espace
C’est quoi la résidentialisation ?
Gros mot qui vient tout simplement du terme
« résidence » et renvoie au fait d’apporter un
caractère privé à une habitation, ce qui lui donnerait
alors un standing, parce que les portails, digicodes
ou barrières sont associées à un standard élevé
de type d’habitation. L’idée est de rénover
l’image d’un immeuble ou d’un quartier,
en lui donnant un aspect chic, privilégié et
protégé du monde extérieur.
L’histoire de ce coup de neuf commence dans les
années 1990 en France, d’abord avec l’ANRU
(Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine),
qui est renforcée en 2003 avec la « loi Borloo »
puis avec les programmes PNRU, NPNRU, tous
instaurent des mesures de rénovation des « quartiers prioritaires de la politique de la ville » (voir ci-dessous).
En clair, ces programmes proposent la
transformation et la destruction partielle
des quartiers pauvres et défavorisés. Le
renouvellement urbain standardise l’espace
et intègre ces quartiers à des normes de villes bourgeoises et pacifiées. En fait, il met souvent
plus une couche de vernis sur des logements qui
restent en piteux état à l’intérieur. Il fait disparaître
les stigmates extérieurs de l’habitat social.
La disparition symbolique est aussi physique,
puisqu’une partie de ces rénovations entraîne
le déplacement des activités des habitant.e.s en
dehors de ces quartiers. Tout simplement parce
que les nouvelles grilles empêchent l’accès
à des espaces qui, avant, étaient fréquentés
sans restrictions par les personnes du quartier
(pelouses, jeux d’enfants, bancs, cheminements, etc). Le projet est de transformer des quartiers défraîchis qui ne cachent plus
une misère devenue trop voyante.
De plus, cela apporte une plus-value. Proches
de centres urbains avec l’urbanisation massive et
connecté aux transports, ces quartiers sont plus
attractifs. La rénovation urbaine opère comme
un moyen d’augmenter la valeur symbolique des
espaces devenus rentables pour la spéculation.
Là-dedans, la résidentialisation agit comme
un point central en cherchant à mieux définir la
distinction public/privé et à sécuriser les espaces.
L’État (qui subventionne) veut transformer la
trame urbaine des quartiers populaires, casser
le modèle du grand ensemble et imposer des
manières d’habiter pour soi-disant remédier aux problèmes sociaux.
L’objectif correspond à une volonté
sécuritaire, d’encadrement des pratiques
sociales des classes populaires. Dans
le but de « gérer » les usages sociaux d’un
territoire à travers la morphologie urbaine, la
résidentialisation génère des dispositifs visant
à discipliner les habitant.e.s. Malgré la volonté
d’impliquer ces derniers dans les opérations
afin de leurs « permettre l’appropriation des
lieux de vie », ces résultats visent toujours à la normalisation de l’espace et des modes d’habiter
vers un standard de vie unique. La distinction entre
bon.ne et mauvais.e utilisateur/trice entraîne donc
l’augmentation du contrôle social. Les solutions
envisagées par les pouvoirs publics impliquent de
limiter les « mauvais » usages de l’espace. C’est-
à-dire de faire disparaître tout ce qui génère du
conflit social.
Cela vient comme un mécanisme de régulation
par l’état, car il craint celles et ceux qu’il a
marginalisé et expulsé. Squat dans les cages
d’escaliers, barbecue en bas de l’immeuble,
réparations de voitures sur les parkings, parties
de foot sur la route, etc. Les activités qui créent
le lien social et qui renforcent les solidarités sont
restreintes voir disparaissent complètement avec
les nouveaux aménagements. Le désir délirant
de « tranquillité sociale » distillé dans
l’ensemble de la population quel que soit sa
classe sociale, et le repli sur soi caractéristique de
la société individualiste explique l’acceptation
sans opposition
du renforcement
sécuritaire dans l’urbanisme.
Malgré tout, malgré la contrainte forte exercée
sur ces quartiers, les habitant.e.s mènent parfois
des offensives très embêtantes pour les pouvoirs
publics et les bailleurs. On a ainsi pu voir des
« maisons du projet » [4] finir en feu sur Paris, en
banlieue ou ailleurs.
C’est quoi la résidentialisation à
Montreuil ?
A Montreuil, la montée en puissance de la folie sécuritaire est assez discrète quoiqu’elle se pare
d’attributs bien visibles comme la multiplication de
grillages et de digicodes. A l’initiative de bailleurs ou
de copropriétés, une partie des bas d’immeubles
se ferment et se privatisent.
Par exemple, avenue de la République, en face du
Décathlon, il y a un ensemble de tours de logement
social qui était ouvert, c’est-à-dire que n’importe
qui pouvait traverser l’espace entre les immeubles
pour aller plus rapidement rue de Paris, se poser
sur un banc ou seulement se promener. Il y avait
aussi une personne qui avait trouvé un abri sous le
toit du hall d’entrée, et qui en avait fait sa modeste
maison. Aujourd’hui tout cela n’est plus possible,
car des grilles entourent toute la cité, et il faut un
digicode pour y entrer. Un exemple parmi d’autres,
cette fois dans le haut Montreuil, c’est la cité des
Roches (rue des Roches) qui en 2018 est devenue
« Résidence des Roches » suite à l’installation
de grilles. Pour qui avait connu le lieu avant, le
paysage a complètement changé en faveur
d’une montée en standing (à l’apparence) !
Cas similaire dans d’autres rues du quartier,
les nouvelles constructions HLM ou non, sont
aujourd’hui automatiquement fermées, les vieux
immeubles eux sont transformés progressivement
pour être aussi fermés.
Le Bas-Montreuil fait partie d’un grand programme
de renouvellement urbain qui s’inscrit dans
des financements d’État (le Plan National
de Requalification des Quartiers Anciens et
Dégradés). La résidentialisation progressive de
plusieurs îlots d’habitation dans ce quartier s’inscrit
donc dans les mêmes logiques de rénovation
urbaine que celle en cours dans les quartiers de
logements sociaux avec les programmes ANRU.
Le quartier prend de la valeur chaque année
et accueillent de plus en plus de personnes
appartenant à classes sociales plus favorisées
par rapport aux personnes qui habitent déjà le
quartier. Un remplacement lent se met ainsi en
place. La partie de la population qui s’installe,
plus aisée, aspire à des types de vies urbaines
leur permettant de protéger leur propriété, leurs
privilèges et donc au contrôle de leur zone de vie. Le quartier change d’aspect et l’une de ses évolutions principales s’inscrit dans la privatisation progressive de l’espace . La vie dans ce quartier se replie sur le privé et se retranche à l’échelle du logement.
Les résistances sont très peu nombreuses et
n’aboutissent pas à un empêchement de cette
tendance sécuritaire dans le quartier. Alors les
portes et les bas d’immeubles se ferment. Mais
nous ne sommes pas dupes de cette supercherie,
les digicodes et les barrières peuvent se détruire,
et les bas d’immeubles se ré-ouvrir.
La rénovation urbaine, qu’est-ce que c’est ?
Il y a l’ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine) créée en 2003, elle gère
les QPV (Quartiers Prioritaires de la Ville) pour
le compte de l’État par le biais de subventions,
en mettant en oeuvre le PNRU (Programme
National pour la Rénovation Urbain) et le
NPNRU (Nouveau Programme National de
Renouvellement Urbain) depuis 2014.
Lutter pour habiter
13 familles à la rue, errances et luttes
Le 28 juillet 2016, une quarantaine de
personnes, réunies en 13 familles, se font
expulser de leur lieu de vie au 250 boulevard
de La Boissière. Il s’agit d’un local d’activité
désaffecté ni confortable ni vraiment digne pour y
vivre à 40, mais au moins pratique pour les activités
de la biffe et de la ferraille qui permettent à ces
familles de subsister. Au moment de l’expulsion,
elles vivaient à cette adresse depuis 6 ans. Elles
avaient une convention d’occupation temporaire
avec le propriétaire, la Ville de Montreuil.
L’année précédente, à l’automne 2015, la mairie
avait déjà tenté de dégager ces 13 familles suite à
un incendie qui s’était déclaré dans la parcelle d’à
côté (qui était la baraque d’un homme qui avait été
expulsé, avec 60 autres personnes, de la friche
Barda rue de Paris, en mai 2013). L’incendie
tombait bien car le chantier de l’éco-
quartier de la ZAC Acacia-Boissière (créée
en 2010) allaient bientôt commencer. Mais
une certaine mobilisation autour de l’affaire avait,
peut-être, contribué à retarder l’expulsion, qui s’est
donc faite une année plus tard et au beau milieu
des vacances d’été.
40 personnes, dont 19 enfants (dont plusieurs
bébés et des filles et des garçons scolarisé.e.s
en primaire et collège) se sont ainsi retrouvées
à la rue. Elles ont essayé de s’installer (ou au
moins de se poser) au parc des Beaumonts, sous
les halles du marché de Croix de Chavaux et au
square Marcel-Cachin mais à chaque fois les
flics les ont dégagés tout en jetant leurs
affaires à la benne et en les menaçant de
leur coller des OQTF (Obligation de Quitter
le Territoire Français) . L’expulsion du square
Marcel-Cachin a été particulièrement ignoble car
elle a eu lieu à la veille de la rentrée scolaire 2016-2017.
Le groupe a longtemps « campé » place Jean-Jaurès, d’abord devant le théâtre et puis derrière, subissant tous les jours toute sorte de pressions
policières. Certaines personnes ont essayé de
s’installer à la friche Barda, mais au bout de 48h
les flics les ont chassés. Onze personnes, dont 6
mineurs, ont occupé, fin septembre, un atelier rue
Faidherbe. Le lieu était vide et aucun permis
de démolir n’avait été déposé. Pourtant, le
proprio est venu avec des copains pour
chasser les occupant.e.s, puis, un matin à
l’aube des flics en civil ont fait irruption dans la
maison terrorisant tout le monde et tabassant une
femme. Dans la foulée, le proprio a fait démolir le
toit du bâtiment.
Dans les mêmes jours, un diagnostic social est
mené par la Préfecture de Région comme d’hab’
à la va-vite, via la plateforme régionale AIOS
(Accueil, Information, Orientation, Suivi), spécial
« occupants des campements illicites d’Île-de-France ». Suite à cela, sont proposés aux expulsé.e.s des nuits d’hôtel. La mairie, qui n’a
pas arrêté de bassiner aux premiers concernés
et aux personnes solidaires qu’il n’y avait que le
115 comme solution, est ravie. Bessac & co. sont
soulagé.e.s de se sortir du pétrin soi-disant par
le haut. Et les personnes solidaires légalistes – qui s’étaient dissociées de l’occupation de la rue Faidherbe – font pression sur les expulsé.e.s
pour qu’ils et elles acceptent la fausse solution
des hôtels. En effet, les hôtels sont très loin (Les
Ulis, Fontainebleau, ...). On ne peut pas y faire la
cuisine. Et il n’est pas pratique - et très coûteux - de faire des allers-retours quotidiens pour accompagner les enfants à l’école et pour le travail
de la biffe/ferraille. Une partie des expulsé.e.s finit
par accepter, mais revient au bout de quelques
jours dans les tentes sur la place Jean-Jaurès car
le rythme et les frais de transport sont intenables.
Entre temps, l’hiver est arrivé. Dans les tentes il
fait très froid. Les « soutiens » sont divisés. Parmi
les expulsé.e.s, la tension monte.
A la mi-décembre une nouvelle proposition est
faite : il s’agit d’un lot de chambres groupées dans
un même hôtel et dans une ville du département.
Les familles seraient donc ensemble. On leur fait
comprendre que si elles n’acceptent pas cette
proposition des OQTF risquent d’être distribuées.
Certaines personnes disparaissent alors dans la
nuit avant le transfert. Celles qui acceptent
la proposition montent dans le bus qui
est venu les chercher sans savoir où se
trouve exactement l’hôtel et pour combien
de temps elles pourront y rester. Finalement, une seule grande famille passe l’hiver dans l’hôtel - qui s’avère être à Saint-Denis – tandis que d’autres partent en Roumanie.
Entre la mi-février et la mi-mars 2017, une bonne
partie du groupe revient à Montreuil et s’installe
aux abords du cimetière, avenue Jean-Moulin,
avec des voitures qui servent d’habitations. La
plupart des enfants est à ce moment déscolarisé.
Les flics harcèlent le groupe avec des amendes,
des brimades, des menaces. L’intervention de la
mairie consiste en la distribution quasi quotidienne
de sacs poubelles, car il faut bien sûr préserver
le cadre de vie des Montreuillois.e.s. Un groupe
de personnes solidaires parvient à convaincre un
centre social municipal du secteur à organiser une
soirée sur le thème des migrations et de l’accueil.
Il serait évidemment question d’aborder aussi
l’affaire des « 13 familles ». Tout est prêt, mais à
la dernière minute la mairie menace d’annuler la
soirée si le programme implique l’intervention de
certains collectifs de lutte (ce qui est le cas).
Mi-octobre 2018, les pressions pour que les gens
dégagent de l’avenue Jean-Moulin se concrétisent.
Des voitures-maisons où les familles vivaient
finissent à la fourrière. Les flics expliquent que d’ici
quelques jours toutes les voitures subiront le même
sort. Une grosse mobilisation a lieu devant
la mairie. Le même soir, il semblerait qu’un agent
de police (nationale ? municipale ?) indique au
groupe une maison vide rue des Néfliers tandis
que la mairie donne discrètement son accord pour
qu’un petit terrain pas loin soit investi par l’une des
familles. Au bout de deux ans d’errance, ces
40 personnes ont ainsi retrouvé quelque
chose qui ressemble à un toit dans la ville
où elles ont choisi de vivre.
Le Montreuillois (n. 8-21, nov. 2018) évoque vite
fait l’événement dans une double page intitulée
« A Montreuil, en cas de coup dur une main se
tend ». La Ville y est décrite comme étant « très
impliquée dans l’insertion de la population rom ».
« Les 13 familles qui campaient dans la contre-
allée de l’avenue Jean-Moulin ont aujourd’hui
trouvé abri dans un local inoccupé ». Dans ce
même numéro, la double page précédente est
consacrée aux habitants du foyer Bara « mis à
l’abri dans les locaux vides de l’ex-AFPA ». Dans
les articles qui suivent on apprend que « Ernest-Savart reçoit les femmes isolées et les familles avec enfants » et que « Montreuil est une des rares
communes de la Seine-Saint-Denis à organiser
volontairement l’accueil des SDF ». Ah ! tout va
bien dans le meilleur des mondes alors ... Quelle
bande d’hypocrites ! Leurs mensonges nous font
gerber.
Hors cadre / Hors bulle
Une bonne partie des personnes expulsées
du 250 boulevard de La Boissière se sont
retrouvées en errance à plusieurs reprises
pendant une dizaine d’années.En novembre 2009, juste avant le Salon
du livre de la jeunesse, elles avaient été
expulsées de la friche Barda afin que les
visiteurs du salon ne soient pas dérangés
par la vision de leurs baraques auto-construites.Les expulsé.e.s avaient ouvert quelques
tentes et amassé les quelques affaires
épargnés par les flics et les bulldozers sur
le trottoir à l’angle rue Étienne Marcel-rue
Gutenberg. Des personnes solidaires, y
compris d’ailleurs des visiteur.euse.s du
Salon, leurs avait apporté leurs soutiens
et étaient entrées en lutte avec les
expulsé.e.s.En décembre, ces dernier.e.s s’installent
sur un terrain avenue du Président Wilson,
puis, à nouveau expulsés, certains d’entre
elleux ouvrent un squat dans le 20e,
mais suite à un incendie se retrouvent à
nouveau à la rue.Pour connaître les détails de la période
d’errance et de luttes 2009-2011 on peut
lire la BD Dosta.
Squat Gambetta et Savart, récupération humanitaire
Du squat à la rue, à un autre squat
à toujours la rue : histoire de
l’occupation de la rue Gambetta et d’une
autre ouverture en non mixité qui dure
moins d’un week-end.
Début octobre 2017, la mairie de Montreuil expulse
une quarantaine de personnes qui squattaient un
immeuble dont elle était propriétaire, situé 30 rue
Gambetta. L’argument principal est qu’il y a une
rumeur comme quoi les habitant.e.s se seraient
fait escroquer par un homme qui leur avait fait
signer un faux bail, et leur faisait donc payer un
loyer assez cher. Après leur expulsion, ces
personnes restent plus de deux mois à
camper devant l’immeuble, sans que rien
ne se passe. Les voisin.e.s sont solidaires : iels apportent de la bouffe, des couvertures et certain.e.s offrent un hébergement temporaire.
Le projet de la mairie pour cet immeuble est de
le céder au bailleur social Freha, qui prévoit d’y
créer huit logements « très » sociaux (y laisser les
gens qui y habitaient déjà et éventuellement les
régulariser, ne serait pas mieux ?). En décembre
les personnes commencent à partir de la rue à
cause du froid et le samedi 9 décembre, en début
d’après-midi, un nouveau squat ouvre au 17-21 rue Ernest Savart.
Ce squat non-mixte, où s’installent environ
25 femmes, dont la plupart sont des
migrantes venant de Côte-d’Ivoire, et qui
ont été expulsées de la rue Gambetta , a pour
objectif d’être à la fois un lieu d’habitation et un lieu
d’activités publiques ouvertes à toutes et tous. Le
propriétaire du bâtiment est l’UGECAM, l’Union
pour la Gestion des Etablissements des Caisses
d’Assurance Maladie. Ce bâtiment avait été laissé
vide pendant longtemps, depuis l’ouverture de
nouveaux locaux en place du Général de Gaulle.
Après une première visite de flics en voiture, la
directrice de l’organisme propriétaire débarque
arrive. Elle est assez rapidement conciliante
et envisage même un accord pour convention
d’occupation, bail précaire ou autre. Elle se monte
sensible à la situation. Mais son empathie ne sert
pas à grand-chose car juste avant les 48 heures du
constat d’occupation par les forces de l’ordre, en
tout début d’après-midi le lundi 11 décembre, les
flics arrivent en nombre, pour expulser le bâtiment,
suite à un « arrêté préfectoral ». Évidemment, cela
se fait en l’absence de la directrice de l’UGECAM,
qui a pourtant sa part de responsabilité dans cette
décision de mettre à la rue 25 femmes deux jours
après leur avoir promis qu’elles passeraient l’hiver
au chaud dans ce même bâtiment. Retenons
que malgré la compréhension de prime abord
de certains proprios, leurs changements d’avis
potentiels en leur faveur ou les pressions qu’ils
peuvent avoir, ne permettent en aucun cas de les
considérer comme des alliés.
Ce lieu devient quelques mois après un
Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU).
Étrange coïncidence, car ce n’est pas la première
fois qu’une occupation devient un centre d’accueil
après son expulsion. Qu’est-ce que nous devons en tirer de tout
ça ? Que les initiatives spontanées et non-institutionnelles d’auto-organisation sont reprises par les institutions dès qu’elles le peuvent, et
parfois par le tissu associatif « collabo », pour en
faire la même chose, sous un autre nom, et avec
plus de flicage et de contrôle social. Ils veulent
s’en approprier, les gérer à leur sauce et mettre
leur firme dessus en tuant toute liberté individuelle
et ne laissant pas les habitant.e.s se gérer eux mêmes et à leur manière.
Du squat au CHU :
Des occupations qui se font récupérer par les
institutions et transformer en centre d’hébergement
d’urgence nous pouvons en trouver deux autres
exemples à Paris (et sûrement d’autres ailleurs) : le
lycée Jean Quarré à Place des Fêtes et le Stendhal,
squat qui été au 5, ensuite puis au 50, rue Stendhal.
Le premier, ancien collège désaffecté, est occupé
le 31 juillet 2015 par environ 700 migrant.e.s (qui
seront plus de 1 300 vers la fin de l’occupation).
Avant, ils et elles s’étaient fait expulser de leur
campement, le scénario se répètera avec le lycée,
le 23 octobre 2015. Le second, rue Stendhal, est
occupé par un collectif culturel et artistique pour
organiser des expositions, événements, spectacles
vivants, ateliers, des réunions, etc. Le collectif sera
expulsé en mai 2014.Le bâtiment du lycée Jean Quarré, après
l’expulsion, est mis à disposition des associations
par la Mairie. Et le 3 février 2016 il devient un CHU
de 150 places, géré par Emmaüs Solidarité (qui
se la pète pour cet acte de solidarité incroyable).
Ceci est un exemple clair de la manière dont
les associations humanitaires, en lien avec les
pouvoirs publics, récupèrent les actions qui ne
viennent pas d’eux pour en tirer profit à la faveur de
leurs politiques pour des questions électoralistes
ou de subventions.De l’autre côté, le 15 mars 2017, le 5 rue Stendhal
devient un centre d’hébergement de 90 places pour
jeunes hommes de 18 à 27 ans, géré par le Centre
d’action sociale de la ville de Paris (CASVP [5]).
[Tract des habitantes du squat de la rue Savart + récit du samedi au lundi, sur Squat.net.]
La carte des squats, des lieux vides et des expulsions
En avril 2018 le collectif Prenons la Ville a
fabriqué une carte des expulsions du bas
Montreuil et d’une partie de Bagnolet.
Pourquoi une carte ?
D’abord, pour montrer ce qu’il se passe : on
expulse, il y a de gros problèmes de logement.
Le quartier se transforme, le Grand Paris arrive à
grand pas !
Pourquoi ce périmètre ?
Parce que Montreuil et Bagnolet sont des villes où
certain.es d’entre nous habitent, parce qu’on s’y
retrouve souvent, qu’on s’y organise.
Qu’est-ce qu’on veut
dire
par « expulsion » ?
Lorsqu’on est poussé hors de son logement ce sont
les forces de l’ordre ou de gros bras qui viennent
nous déloger, c’est le feu qui nous fait fuir, ou la
pression qui est telle qu’on en vient nous-mêmes à
quitter le logement - parce qu’on est juridiquement
expulsable, parce qu’on subit des menaces... On
peut être dans plein de situations différentes avant
de se faire expulser : on a arrêté de payer son
loyer, un petit pavillon abandonné nous a tendu la
main, on plante sa tente sur un bout de pelouse ou
de trottoir, on dort dans sa voiture...
Si on a mis toutes ces histoires sur la même carte,
c’est parce que chaque expulsion n’est pas
un phénomène isolé. Elle s’inscrit dans une
logique plus large : la défense de la propriété
privée bien sûr, mais aussi, particulièrement
pour nos contrées, une transformation urbaine
visant à repousser plus loin du centre beaucoup
de personnes ayant peu de moyens et ne
correspondant pas à la nouvelle image de la ville que le capitalisme tente de dessiner. Or récemment,
pouvoirs publics et entreprises privées se donnent
la main pour accélérer le changement de certains
quartiers. Ils parlent de « requalification », de
« renouvellement », ils dessinent des ZAC, des
ZSP et signent des PNRQAD... Plein de mots
compliqués avec lesquels ils voudraient nous
faire croire qu’ils rénovent pour le bien de tou.te.s.
En réalité, très rares sont les personnes qui sont
relogées et rarissimes sont celles qui sont relogées
sur place. La plupart des personnes expulsées ne
sont pas relogées du tout et se retrouvent exclues
du quartier dans lesquelles elles habitaient.
Alors on a eu envie de montrer tou.tes ces « rayé.es de la carte », de rendre visible ce qu’on cache
habituellement, de se souvenir, de garder des
traces. De faire une carte différente de celles
proposées par les spécialistes que l’on a l’habitude
de voir.
Cette carte est donc en cours de fabrication, c’est
une carte collective : à chacun-e d’y ajouter des
informations. Les limites de la carte ne demandent
qu’à être élargies ; à plus nombreux.euses, ce
sera sans doute plus facile.
Et on abat nos cartes !
L’idée de cette carte est aussi de créer des
rencontres, des discussions. De favoriser
entraide et solidarité. De s’organiser contre
les expulsions, de s’opposer ensemble à
la restructuration urbaine actuelle et à ses
dynamiques de tri et d’exclusion.
Le projet est de la compléter (et pourquoi pas de
l’agrandir à toute la région parisienne ?), alors
n’hésitez pas à faire signe si vous avez des infos.
Et voilà là carte avec la mise à jour de février 2020 !
Des lieux toujours vides, on vous fait la liste...
Mise à jour depuis L’En-ville 2 en ce mois
de mai 2020, les lieux vides le sont
toujours et si ça continue, ils le seront encore longtemps.
- Rue Barbès, Montreuil
Pavillon jadis occupé par une famille locataire, il
est vide depuis plusieurs mois quand des migrants
à la rue essayent de l’occuper pendant l’hiver
2012-2013. Une porte anti-squat est posée dans
la foulé. Un grand projet concernant le pavillon et
plusieurs parcelles avoisinantes, à peine esquissé,
fait flop vers 2015. Le pavillon est toujours vide.
- Squat de la Frat’, Montreuil
Ouvert en 2007 par des familles à la rue avec le
soutien des plusieurs riverains, le bâtiment est
vidé de ses habitant.e.s en juin 2012. Une partie
de ces dernier.er.s est relogée, dans le cadre de
la MOUS Rom, dans les logements-passerelle de
la rue Émile Zola. Celles et ceux qui soi-disant
ne rentrent pas dans les critères de la MOUS
bâtissent un bidonville sur la friche Barda (rue de
Paris). Le bidonville sera expulsé début mai 2013.
Ses 60 habitant.e.s se retrouvent à la rue avec
quelques propositions de relogement en chambre
d’hôtel pendant quelques jours. Tant le bâtiment
sis place de la Fraternité que la friche sont depuis
inoccupés et visiblement sans projet.
- Rue Bara, Montreuil
Ce pavillon avec jardin est vide depuis plusieurs
années quand des personnes migrantes à la rue
l’occupent un samedi matin de 2016. Le lundi, le
propriétaire possédant plusieurs parcelles dans
ce même îlot – fait expulser tout le monde, pose
l’énième porte anti-squat du quartier et fait murer
toutes les fenêtres.
- Rue Rapatel, Montreuil
Appartenant au Conseil Départemental, ce grand
lieu (bâtiment + espace vert) a été longtemps
délaissé par le proprio. Plusieurs fois occupé et
expulsé, il l’est une fois de plus fin avril 2013.
Cette fois-ci ce sont 80 personnes migrantes (le
naissant collectif Baras), à la rue depuis 2 mois,
qui s’y installent. Ils se font violemment expulser
le 6 mai 2013. Actuellement, il y a un permis de
construire affiché sur la façade, le bâtiment est vide.
- Ancienne PMI rue Voltaire, Montreuil
En automne 2011, des négociations informelles
entre la mairie et le proprio (une société immobilière
« solidaire ») permettent à des familles expulsées
en juillet du squat des Sorins d’occuper le bâtiment
en rue Voltaire, vide suite à la fermeture de la
PMI. En 2013, face à la menace d’expulsion, des
copines se mobilisent au côté des habitant.e.s de
l’ex-PMI. Les accords sont renégociés en faveur
des occupant.e.s. En octobre 2014, l’expulsion à
lieu. Les familles sont relogées la veille dans une
autre ville du département. 20 personnes, dont 3
femmes, passent des longues semaines dans un
campement installé en mode lutte au square de la
République. Le proprio avait déclaré avoir hâte de
récupérer l’immeuble pour y installer une structure
dédiée aux personnes sortant de prison. Depuis,
bien muré comme il faut et protégé par le regard
plein de zèle de certain.e.s voisin.e.s, le lieu est vide.
- Le Transfo, Bagnolet
Squat d’habitation et d’activité occupé en novembre
2012 par une vingtaine de personnes (migrant.e.s,
militant.e.s, galérien.ne.s, les trois à la fois, ...). Il
est expulsé manu militari à l’aube du 23 octobre
2014. Zéro proposition de relogement. A la place des locaux d’activité surgit actuellement un grand
immeuble d’habitation. Des jeunes Tchadiens
essayent de ré-occuper le lieu début juin
2019, mais ils se font expulser. Les appartements
donnant sur l’avenue de la République demeurent
vides et gardiennés.
- Avenue du Président Wilson, Montreuil
Un grand pavillon avec jardin, appartenant à une
fondation pour la recherche médicale, occupé
depuis mai 2013 par le collectif Baras est expulsé
en juillet 2015. Des travaux semblent se mettre
en route par la suite, mais le chantier n’a jamais
vraiment démarré.
- Rue Carnot, Montreuil
Un grand pavillon avec jardin, vide depuis
longtemps, est occupé en août 2015 par plusieurs
dizaines de personnes du collectif Baras qui
viennent de se faire expulser de leur lieu de vie.
Quelques jours plus tard ils se font expulser de là
aussi, et le lieu reste vide.
- Salamatane, Montreuil
C’est l’histoire d’une association d’artistes qui
occupe avec un bail précaire, depuis plusieurs
années, un bâtiment sis au 119 bis rue de Paris.
Avec le temps, le bail arrive à échéance et la
mairie, propriétaire des locaux, fait le mort face
aux demandes de négociation des habitants. Le
18 janvier 2017, l’expulsion a lieu. 20 personnes
se retrouvent à la rue sans solution de relogement.
Cette semaine-là il fait jusqu’à -8 degrés la nuit. Les
expulsé.e.s dorment pendant plusieurs semaines
dans des tentes devant l’immeuble. Depuis, la
maison est vide.
- Rue Faidherbe, Montreuil
Un atelier vide depuis longtemps est occupé mi-
septembre 2016 par l’une des familles qui est à
la rue depuis fin juillet suite à l’expulsion du 250
boulevard de la Boissière (propriété de la Ville).
Le 20 septembre à l’aube la police débarque,
tabasse, terrorise les enfants et expulse tout le
monde. Le même matin, le proprio fait démolir le
toit de l’atelier. Il n’a rien déposé comme permis
de démolir/construire mais il est grave pressé
de récupérer son bien. Une plainte est déposée
à l’IGPN et le défenseur des droits est saisi. Si
la plainte est classée sans suite, le défenseur de
droit constate, en mars 2018, le caractère illégal
de l’expulsion. Il définit aussi non nécessaire et
disproportionné l’usage de la force de la part des
flics. L’atelier, lui, est toujours vide.
- Ancien Pôle Emploi, rue René Alazard, Bagnolet
Occupé par le collectif Baras, expulsé du bâtiment
Emerson en août 2014, le proprio s’agite de
plus en plus pour récupérer son bien. Il sollicite
la mairie, qui sollicite le préfet d’IdF, qui sollicite
les occupants par le biais d’un travailleur social
allant sur place leur jouer du pipot. En juin 2017,
l’expulsion a lieu. 100 personnes environ se
retrouvent encore une fois à la rue. Le proprio a
plein de projets et a hâte de rentabiliser son bien
car, nous dit-il, à cause de l’occupation il est limite
en faillite. La limite devait être large car l’immeuble
est toujours muré et vide.
- Rue Gambetta, Montreuil
L’immeuble délaissé, appartenant à la Ville, est
occupé en août 2017 par plusieurs dizaines de
personnes migrantes, dont des enfants et des
femmes enceintes. L’expulsion, sans proposition
de relogement, a lieu le 6 octobre 2017. Les
expulsé.es dorment pendant plusieurs semaines
dans des tentes devant l’immeuble. Des riverain.
ne.s et le DAL soutiennent leur lutte. Fin octobre,
une décision du TI de Montreuil condamne
l’expulsion demandée par la mairie (car illégale) et
somme celle-ci à reloger les habitant.e.s. Depuis
octobre 2017 le bâtiment est en chantier pour être
réhabilité et créer 8 logements « très » sociaux.
- L’Écharde, rue Garibaldi, Montreuil
Squat d’habitation et d’activité rue Garibaldi, il est
ouvert le 1er octobre 2018, le jour même où le
collectif Jardin d’Alice « rend les clés », après
3 ans de bail. L’Écharde est expulsée le 27 mars
2019. Avant l’automne 2015, ce grand bâtiment
vide a été gardienné pendant plusieurs années.
On verra pour combien de temps encore l’EPF-IdF,
qui en est propriétaire, le gardera inoccupé (les
travaux n’ont toujours pas commencé, le bâtiment
est actuellement vide).
- Rue Michelet, Montreuil
Un immeuble délaissé occupé par une trentaine
de personnes migrantes depuis plusieurs
années. Expulsion musclée et sans proposition
de relogement le 2 mai 2018. Quelques jours
plus tard sur la façade du bâtiment apparaît la
pub de squatsolutions.com. Aujourd’hui en novembre 2019, l’immeuble
semble avoir été restructuré et remis sur le
marché, mais les logements eux ont l’air plutôt vides.
- Squat Robespierre, rue de Paris, Montreuil
Un café abandonné et 2 étages occupés en
mode furtif par une vingtaine de mecs en
galère. Le lieu est expulsé à deux reprises en
2017 et à l’été 2018. Un incendie s’y déclare
quelque temps après. Depuis il est muré et vide.
L’Echarde, sauter sur l’occasion
Lundi 1er octobre 2018, alors que des artistes
du Jardin d’Alice allaient sagement rendre
les clefs du bâtiment situé au 19 rue Garibaldi à
Montreuil, une trentaine de personnes ont perturbé
leur plan en occupant le lieu. Effectivement,
c’était une occasion à ne pas rater ! Après 3 ans
de gardiennage, cet endroit devait être rendu au
géant de l’immobilier Nexity qui gère le bâtiment
pour le compte de l’EPFIF (Établissement Public
Foncier de la région Île-de-France).
Mais pourquoi des artistes occupaient le bâtiment ? Pour mieux comprendre, il faut d’abord parler de ce que l’on définit habituellement par « squat
d’artistes ». Né dans les années 1990, (peut-être avant), ce concept identifie une occupation illégale par des artistes de toutes sortes. Malgré
leur volonté de pratiquer un art de manière libre,
en dehors du cadre institutionnel, la plupart des
« artistes-squatteurs » ont eu depuis le début
des démarches visant à se faire bien voir des « pouvoirs publics », des institutions. Et ceci, afin de se faire légaliser et d’obtenir un bail précaire,
leur permettant pouvoir rester le plus longtemps
possible dans les lieux. Dès le début, ils activent
donc une séparation entre bons squats « utiles
socialement » et mauvais squats « dangereux pour
la paix sociale ».
Et la machine spéculative-marchande de l’État a compris très vite qu’elle peut
tirer profit de ce concept sympathique et
pas très subversif. Les mairies, les Conseils Régionaux, les entreprises ou d’autres organismes
institutionnels ont commencé à attribuer des
bâtiments vacants, ou des friches urbaines,
directement à des collectifs d’artistes, afin de les
occuper temporairement, en attente de la mise en
place du projet officiel (souvent pas encore clair
dans la tête du propriétaire) - des bureaux ou des
logements neufs dans la majorité des cas. L’étape
initiale de l’occupation illégale a donc été substituée, dans la plupart des cas, par une attribution légale,
à l’aide d’outils techniques tels que des appels
à projet ou à manifestation d’intérêt (AMI) [6]. La
présence, de plus en plus bien vue, de ces lieux
conventionnés permet à une collectivité locale,
selon le discours officiel, d’avoir une animation
culturelle et artistique « alternative » et d’offrir à
ses habitant.e.s des espaces d’expérimentation
accueillants en dehors du cadre institutionnel. Mais derrière ce beau discours, il n’y rien de tout ça . Ce sont des espaces où les logiques marchandes se reproduisent, et où les publics participant aux initiatives sont toujours les mêmes : ceux qui contribuent à faire augmenter les prix du quartier. Ce sont des espaces extrêmement
normés, a-critiques et « apaisés » où les activités
politiques et toute remise en cause sociale,
sont volontairement laissées à l’écart
pour éviter tout conflit avec les chères
institutions qui ont attribué le lieu.
Mais pourquoi parle-t-on de gardiennage alors ?
C’est souvent écrit dans le contrat d’occupation
précaire signé par les occupant.e.s : la présence
dans les lieux d’un collectif choisi par le propriétaire
a la fonction de gardienner un endroit afin d’éviter
toute occupation de la part de squatteureuses.
C’est un rapport gagnant-gagnant : le propriétaire
évite les frais de gardiennage, et perçoit un loyer.
Et le collectif ou groupe d’artistes a, pendant un
certain temps, un lieu où pratiquer son art. Par
contre, il y a toujours des gens qui dorment à la
rue, ou qui galèrent, qui n’ont pas de logement. Et
l’image de la ville change à la faveur des bourgeois : cette manière d’occupation temporaire à l’apparence « cool », rentre parfaitement
dans des dynamiques spéculatives et de
protection de la propriété privé qui empêchent
toute expérience ou initiative spontanée, autogérée
et non institutionnelle.
Mais revenons à l’histoire de l’Écharde, le squat
qui se forme au moment de la remise des clés
par les artistes. Depuis le début, ce lieu, en plus
d’être habité par des personnes, devient un espace d’auto-organisation et d’activités
politiques, notamment autour du logement,
contre les frontières, la taule, et toutes les formes d’enfermement. Le souhait était de faire résonner les luttes qui existaient déjà et être « un espace d’élaboration pour attaquer ce qui nous opprime ».
Des rendez-vous réguliers étaient proposés : permanence de l’infokiosque l’Épinoche (tous les lundis), bar à prix libre (tous les jeudis), assemblée
du lieu (tous les dimanches) et des repet’ d’une
batucada [7]. D’autres événements ponctuels
étaient organisés, comme des rencontres anti-carcérales, des cantines ou des soirées de soutien
(notamment à Bure ou à un collectif anti-spéciste),
des projections et des groupes de lecture. On
trouvait aussi à l’Écharde un espace de gratuité.
Ce lieu se voulait anti-autoritaire et anticapitaliste,
un espace non-marchand, et contre toutes les
formes de domination, sans partis ni syndicats.
Mais le mardi 4 décembre 2018, le squat est
assigné au tribunal d’instance de Montreuil pour
une procédure d’expulsion. Le procès a eu lieu
dans une petite salle prêtée par la mairie pour
l’occasion car la veille un incendie volontaire
avait endommagé le bâtiment du tribunal. C’est
l’avocat du Jardin d’Alice, défenseur
de nombreux « squats d’artistes », qui
attaque le plus la pratique des squatteur.euses . La justice n’a pas accordé le moindre délai aux habitant.e.s, néanmoins les activités
ont continué à l’Écharde jusqu’au 27 mars. Ce
jour là, au petit matin, l’expulsion du lieu met fin
à cette expérience d’auto-organisation de 5 mois
dans le bas-Montreuil. Pour conclure, nous ne
répéterons jamais assez que le conventionnement
d’immeubles vacants par des collectifs d’artistes
est, la plupart du temps, une pratique
anti-squat et une arme de gentrification
permettant à des propriétaires de se faire payer un
loyer par les artistes plutôt que d’embaucher des
vigiles ou de laisser des « occupants responsables » potentiels à l’État ! Squat partout !
C’est quoi l’EPFIF ?
« L’EPF-Île-de-France est l’opérateur public
foncier des collectivités franciliennes. Sa
mission : accroître l’offre de logements et
soutenir le développement économique », annonce le site. En gros, il achète du foncier (du terrain) à des collectivités locales pour
le requalifier et le revendre, à priori sans en
faire augmenter le prix. Il a prévu d’acheter
les terrains qui accueilleront le futur village
olympique des JO 2024. Il est également
propriétaire d’une grande partie des terres du
Triangle de Gonesse, où devait être construit
EuropaCity, un méga projet de commerces
et loisirs porté par le groupe Auchan et le
groupe Wanda, et qui a été abandonné en
novembre 2019. Le bâtiment squatté par le
Landy Sauvage à Saint Denis lui appartient aussi. Et aussi, surprise ! Les trois parcelles
de Mécasolid sont à lui, et la maison rue des
Néfliers squattée par les Rroms.
Occupons les maisons, détruisons les prisons
Le 16 février 2018 a lieu à Montreuil
une manif en solidarité
avec les squats, les lieux
auto-organisés et toutes
les personnes en galère
de logement. Il y a environ
250 personnes. Avant
le départ, des prises
de parole s’enchaînent
(pourquoi cette manif, le collectif Baras, un petit
récit de l’histoire d’A., sur l’occupation à l’université
de Paris-8, le collectif Gambetta, ...). Ensuite la
manif part : des tracts sont
diffés, des affiches collées,
des slogans contre la taule
(et pas que) sont entonnés,
des tags sont faits et des
oeufs de peinture sont
lancés principalement sur
des agences immobilières
et des banques. La manif
a donc plutôt bien réussi !
Ci-dessous, le tract distribué pour l’occasion, ici en PDF :
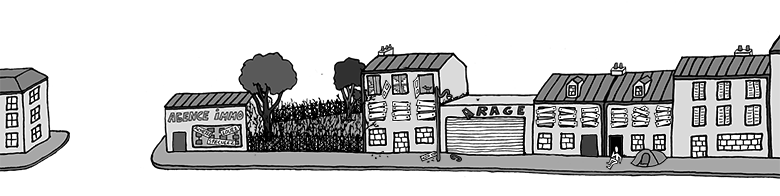
Manifestation vendredi 16 février 2018, à 19h, RDV à l’entrée de la rue piétonne, Croix-de-Chavaux, Montreuil.
Des problèmes de logement à Montreuil ?!
Bah oui ! Ici c’est une galère de se loger quand on n’a pas les bons papiers, les bons garants, la bonne fiche de paie ou des problèmes avec la CAF. Une galère pour celles et ceux qui ne veulent pas, ne peuvent pas se plier à toutes les conditions que demandent les propriétaires, attendre des années pour un logement social, serrer les dents à chaque réforme des APL.
En juillet 2016, plusieurs familles de Rroms sont expulsées de leurs logements à la Boissière par la mairie et se retrouvent à la rue ; les Baras, collectif de sans-papiers, sont contraints de quitter Montreuil après plusieurs ouvertures et expulsions ; en décembre 2017, une trentaine de femmes déjà expulsées deux mois plus tôt par la mairie, se font virer d’un bâtiment rue Ernest Savart ; le foyer Bara se fait détruire à petit feu, régulièrement de nouvelles habitations sont murées ; en 2017, de nombreuses autres personnes sont expulsées de leur logement.
Ça se passe à Montreuil, mais ça pourrait être ailleurs, dans le « Grand Paris » à venir ou dans n’importe quelle ville concernée notamment par la restructuration urbaine et la gentrification.
Ici et ailleurs, l’État, la mairie, les spéculateurs et les flics, avec la collaboration de quelques citoyens-vigilants, font la chasse aux plus pauvres en augmentant le coût de la vie, en laissant se détériorer leurs conditions d’existence pour les pousser au départ, quand ce n’est pas simplement en les expulsant.
Alors que des logements sont vides et des gens à la rue, ils sont à l’affût de toute occupation d’une maison ou d’un bout de trottoir, usant de toutes les « armes » en leur possession, arrestations, contrôles, coups et pressions. Ils ont la loi pour eux et quand ce n’est pas le cas, ils la modèlent à leur guise.
La Justice, trouve par exemple des moyens de pénaliser le squat, en inculpant les personnes de dégradations ou de vol. Une personne est en prison à Fresnes depuis octobre 2017, accusée de vol lors d’une tentative d’ouverture de squat à Arcueil, et en novembre trois personnes ont passé une semaine en prison avant d’être relaxées pour une supposée tentative de vol dans un logement vide à Montreuil.
Par sa politique du logement, couplée à diverses mesures sécuritaires, l’État trie, gère et met la pression sur les plus précaires, traçant des chemins entre le centre d’hébergement d’urgence et le centre de rétention, la cité HLM et la prison, pour qu’au final tout le monde marche au pas.
Refuser de se soumettre à ces logiques, c’est pouvoir profiter parfois d’un logement plus décent, c’est tenter d’échapper au contrôle de nos vies (travail, papiers…), c’est expérimenter des situations de solidarité, d’entraide, de débrouille, c’est pouvoir remettre en cause concrètement la propriété.
Tant que ce monde s’appuiera sur la propriété, tant qu’il y aura des gens à la rue, tant qu’il y aura des prisons, nous continuerons à occuper des maisons et à prendre la rue !
Occupons les maisons, détruisons les prisons !
[Récit de la manifestation « Occupons les maisons, détruisons les prisons » publié le 20 février 2018 sur Squat.net.]
Tentative de vol par effraction en réunion
Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15
novembre 2017, trois copines ont été
contrôlées dans une rue de Montreuil et emmenées
au commissariat. Un « voisin vigilant » les
aurait vues à proximité d’une maison
inoccupée et a appelé les flics.
Elles ont alors été placées en garde-à-vue pour : « tentative de vol par effraction en réunion ». Elles n’ont rien déclaré durant la GAV et ont refusé
de donner leurs empreintes et photos, ce qui leur
vaut d’être également poursuivies pour « refus de signalétique ». L’une d’entre elles est également accusée de « provocation à
s’armer contre l’État » sans qu’on sache à quoi se réfère ce dernier chef d’inculpation.
Après plus de 24h de garde-à-vue elles ont été
déférées au TGI de Bobigny le jeudi 16 pour
passer en comparution immédiate. Toutes les trois
ont refusé d’être jugées immédiatement et ont
demandé un report afin de préparer leur défense.
N’ayant pas pu être assistées de l’avocat.e de leur
choix, elles se sont retrouvées avec une avocate
commise d’office qui a refusé en partie de jouer
son rôle de défense des inculpées. Le procureur
demande le mandat de dépôt pour les trois dans
l’attente de leur procès. Lorsque la juge annonce
la mise en détention des trois copines jusqu’au
procès fixé le 7 décembre, des cris de rage et
de protestation fusent dans la salle et les flics dégagent tout le monde en bousculant et en frappant, taser à la main, d’abord de la
salle puis du tribunal.
Sans s’avancer sur les circonstances exactes de
ces arrestations, il est de plus en plus fréquent
que des histoires d’ouverture de squats soient
qualifiées de « tentative de vol par effraction » pour justifier des grosses amendes et des peines de prison ferme. Un rassemblement de solidarité sera organisé le 18 novembre. Ensuite, les trois
personnes font une demande de mise en liberté
(DML), qui est acceptée et elles sortiront de
prison le 23 novembre en attendant leur
procès en décembre.
Le jour du procès, une centaine de personnes se
sont retrouvées au tribunal de Bobigny en solidarité
avec les trois personnes en procès pour tentative
de vol. Nous n’allons pas faire ici le récit de cette
journée, car il est trouvable en ligne sur Squat.net, mais nous rapportons seulement la décision de justice.
Finalement, la relaxe totale est prononcée, avec annulation de la garde-à-vue pour la copine, entre autres liée à un vice de procédure pendant la garde-à-vue.
Crève la propriété, la justice, et leurs
défenseurs !
Liberté pour tou.te.s !
Mécasolid, le garage solidaire place de la Frat’
Depuis mars 2019, Mecasolid, atelier
de réparation auto-moto, a ouvert
au 161 rue Étienne Marcel [à Montreuil]. Nous avons
rencontré trois membres de l’association,
Simon, Laurie et Vincent, pour qu’iels nous
expliquent dans le détail leur projet.
L’entretien est à lire directement dans la version PDF, aux pages 50-54.
Les Baras toujours là !
Des nouvelles du collectif Baras
Le collectif Baras a été créé par un groupe
de migrants d’Afrique de l’Ouest, arrivés à
Montreuil entre l’été 2012 et mars 2013, afin de
lutter ensemble pour le droit à un toit et pour la régularisation.
Après nombreuses ouvertures de squats
et beaucoup d’expulsions, début 2017 le collectif entame
des discussions avec le propriétaire du bâtiment
qu’il occupe – l’ancienne agence Pôle Emploi de
Bagnolet – ainsi qu’avec la mairie et le préfet afin
d’obtenir un bail. Les négociations échouent et,
en juin 2017, le lieu est expulsé. Les Baras se
retrouvent encore une fois à dormir sous le pont de Gallieni.
Ils occupent, par la suite, une ancienne
blanchisserie rue des Bruyères (Les Lilas). Un an
plus tard ils en sont expulsés. Ils campent alors
à nouveau sous l’échangeur avant d’occuper, fin
septembre 2018, les locaux de la Sécurité sociale
de Bagnolet. Comme beaucoup d’autres en Seine-Saint-Denis, cette agence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie allait vers sa fermeture.
Depuis 2015, elle avait été mise « en période de
transition » : un bureau au rez-de-chaussée recevait
vaguement du public deux jours par semaine et il a été
fermé pendant tout l’été. Les autres pièces de ce
grand bâtiment de 2 étages étaient vides. Début
novembre 2018, à la veille de l’énième passage
du collectif devant le juge pour occupation sans
droit ni titre, à la surprise générale le maire de
Bagnolet réquisitionne le bâtiment pour que les
Baras puissent y demeurer.
Quelques semaines plus tard, le tribunal
administratif annule la réquisition, car le juge
estime qu’elle n’est pas assez solide sur le
plan juridique. Entre temps, des négociations
concernant la vente de l’édifice commencent entre
la CPAM, la mairie et l’Office Public de l’Habitat de Bagnolet. Au cours de ces négociations, la proposition de rachat émanant d’une association
caritative bouddhiste ayant siège en Australie est
écartée. L’OPH, devenu finalement propriétaire de
l’ancienne sécu, est actuellement en discussion
avec les Baras pour fixer les termes d’une
convention d’occupation d’environ 3 ans.
Pour les Baras, les enjeux sont les suivants :
continuer à habiter en autogestion,
mais enfin, pour une durée donnée et
indépendante du bon-vouloir du préfet ; avoir, enfin, une domiciliation là où on habite et pas chez une association, au CCAS [8] ou chez
des copain.e.s ; avoir des quittances de « loyer » individuelles et nominatives (utiles, elles aussi, côté paperasse) ; trouver un accord avec l’OPH
pour que la redevance mensuelle soit raisonnable
par rapport à la qualité de l’hébergement (simples chambres collectives) et aux ressources faibles et
aléatoires du collectif Baras, qui sont pour la très
grande majorité des travailleurs sans-papiers.
Nous ignorons les raisons qui ont poussé le maire
de Bagnolet à réquisitionner l’ancienne sécu, à
en favoriser l’achat de la part de l’OPH et, plus
largement, à accepter de négocier avec les Baras.
En effet, si pendant la première partie du mandat
son hostilité à l’égard du collectif Baras était nette,
l’équipe municipale a fini par reconnaître, et de
manière plutôt concrète, leur droit à « l’En-ville ». Est-ce parce que, depuis 2013, les Baras ont réussi à instaurer un rapport de force à travers
l’action directe et notamment la pratique du
squat ? Est-ce à cause du soutien que les Baras ont reçu de la part de certain.e.s Bagnoletais.es - qu’on pourrait qualifier de notables - en particulier suite à l’expulsion musclée du 8, rue de Chassagnoles ? Est-ce pour émuler la réquisition
de l’AFPA (fin septembre 2018) de la part du maire
de Montreuil ? Est-ce pour qu’à terme la Ville,
via l’OPH, récupère le bâtiment pour un projet de
résidence pour personnes âgées ?
Dans cette affaire, l’équipe municipale a bien
évidemment ses propres enjeux. Les élections
approchent, et Toni Di Martino, le maire de
Bagnolet, a peut-être envie de complaire
l’électorat de gauche tout en grillant les
autres candidats de gauche à travers son
action en faveur du collectif Baras. Par cette
dernière, il s’achète aussi un peu de paix sociale :
si une convention d’habitat est signée, les Baras
auront moins de raisons de se pointer en nombre
et à l’improviste lors des conseils municipaux et/ou dans et devant la mairie pour se faire entendre, comme ils l’ont fait à maintes reprises depuis 2014.
Ils n’auront plus besoin non plus, dans les années
à venir, de camper sous l’échangeur, ce qui fait
quand même désordre au niveau du sacro-saint « cadre de vie », n’est-ce pas ?
Dans tout ça, via l’OPH, la Ville récupère aussi
la propriété de la parcelle et du bâtiment de
l’ancienne sécu, autant de fonciers attractifs tant
à l’échelle de la commune qu’à celle du Grand Paris.
Une dernière question se pose par rapport à la
gestion des réquisitions par la municipalité : est-ce qu’elles ne sont pas un moyen pour contrôler ce qui se passe à l’intérieur et la manière
dont est géré le lieu comme une mise sous
tutelle ? La volonté des Baras est d’habiter en autogestion, alors leur dilemme est grand : comment acquérir une autonomie tout en
ayant une main-mise de la municipalité sur ces lieux ?
En tout cas, au bout de presque 7 ans de lutte, de
galères de lieu en lieu, une petite victoire semble
s’annoncer pour le collectif Baras, au moins côté habitat.
Résumé des ouvertures et des expulsions du collectif Baras :
Après avoir passé plusieurs mois à la rue aux
abords du foyer Bara, fin avril 2013 le collectif
a occupé un immeuble vide, rue Rapatel (Montreuil).
Suite à l’expulsion de celui-ci, un pavillon situé
avenue du Président Wilson (Montreuil) a
été occupé. Le bâtiment était cependant trop
petit pour héberger tout le monde.
Ainsi, en octobre, le collectif a occupé
un immeuble délaissé par l’entreprise multinationale Emerson dans l’avenue Gallieni (Bagnolet). Le squat Emerson, où
vivaient aussi plusieurs familles avec enfants - pour la plupart issues de l’expulsion de la friche Barda (mai 2013) - a été expulsé début
août 2014 [9].
Si les familles ont été relogées par la
préfecture et par les CCAS de Montreuil et Bagnolet, les membres du collectif Baras,
tous majeurs et célibataires, se sont retrouvés
de nouveau à la rue, cette fois-ci sous
l’échangeur à Gallieni.
Deux semaines plus tard, ils ont occupé une
ancienne agence Pôle Emploi, rue René
Alazard (Bagnolet).
Finalement, les Baras ont pu habiter dans
ce bâtiment pendant presque trois ans.
En revanche, les membres du collectif qui
étaient restés dans le pavillon de l’avenue
du Président Wilson à Montreuil en ont été
expulsés fin juillet 2015.
Ils ont alors occupé une ancienne entreprise
rue Chassagnoles (Les Lilas, limite Bagnolet,
fin août 2015), mais le préfet les a délogés au bout de quelques jours...
Rue Bara, la disparition du foyer
Le soir du 25 septembre 2018, un arrêté
municipal est affiché sur le portail du foyer
Bara. Plusieurs personnes, surtout des habitants
du foyer, discutent dans la rue en le lisant.
L’objet de l’arrêté est le suivant : « extrême urgence
concernant le foyer Bara sis au 18 rue Bara (...) pour grave risque de sécurité ». Après la liste des « considérants » - entres autres : « considérant
l’état de dégradation de l’immeuble occupé par près de 250 personnes que des risques graves et imminents sont avérés tant pour la sécurité de l’immeuble que des habitants » - on arrive au fin mot de l’histoire : « article 1 – l’accès à l’immeuble (...) ainsi que l’habitation dans les lieux sont
strictement interdit à compter de l’affichage sur
place du présent arrêté jusqu’à ce que la sécurité
des personnes soit garantie dans les lieux ».
Nous essayons de déchiffrer le texte et la situation
paradoxale : le portail est ouvert, le foyer est plein
de monde, la vie quotidienne dans la cour suit
son cours, mais à partir de maintenant « l’accès
à l’immeuble ainsi que l’habitation dans les lieux
sont strictement interdits ».
« C’est la fin du foyer Bara », synthétise un
copain qui, comme beaucoup d’autres dans le
secteur, fréquente la cantine du foyer pour ses
bons et copieux repas chauds à 1,80 €.
Le foyer ferme, en effet, fin novembre. Le
relogement de ses habitants est un
immense cafouillage dont les résidents
qualifiés de « surnuméraires » dans le langage
officiel - c’est-à-dire les personnes vivantes au
foyer de manière informelle, sans contrat nominal
avec le gérant Coallia - paient le prix fort.
Petit historique
Quelques jours avant, le 20 septembre 2018 vers
23h, le maire, Bessac, avait posté une vidéo sur
Facebook : on le voyait, la chemise blanche un
peu déboutonnée, circuler à l’intérieur du foyer en
affichant stupeur et indignation face à la vétusté des lieux.
Cette attitude a quelque chose de grotesque et
d’obscène vu qu’à ce moment-là il était maire
de Montreuil depuis 2014, et bien avant le début
de son mandat, ça faisait déjà des années
que des résidents du foyer se rendaient
régulièrement au Conseil de Quartier pour
informer les autres habitant.e.s du secteur
et les élu.e.s de l’état de délabrement du
bâtiment. De plus, en février 2013, le protocole
du programme de « desserrement » du foyer Bara avait été signé par l’État, la maire
(Dominique Voynet) et Coallia. Cette signature
avait d’ailleurs été faite en grande pompe et la
maire Voynet s’en était prise tout le mérite, alors
que l’opération était liée au « Plan étatique de
traitement des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) » datant de 1997 et à la circulaire de 2006 concernant la transformation de certains FTM,
notamment les plus dégradés, en résidences sociales.
Pour les nombreuses personnes habitant le foyer
Bara de manière informelle (pour la plupart
sans-papiers) il n’y a évidemment pas de
place au sein de ces résidences sociales.
Ce problème de taille a été soulevé à maintes
reprises, entre autres, lors des réunions publiques
dans le quartier. À demi-mots, les élu.e.s s’étaient
engagé.e.s à reloger tout le monde le jour où le foyer aurait fermé.
En mars 2016, la résidence sociale de la rue
des Hayeps est inaugurée. Une quarantaine de
personnes quittent le foyer Bara pour s’y installer.
Ça ne se fait pas de manière indolore,
car parmi ces personnes il y en a qui, à Bara,
hébergeaient un jeune proche, chose qui n’est plus tolérée dans les nouveaux locaux. Des situations de ce genre se produisent aussi lors
de l’ouverture de la résidence sociale bâtie rue
Voltaire (automne 2016, 115 places). Certains des
résidents se plaignent, aussi, en découvrant qu’il
n’y a aucun espace collectif dans la résidence.
Pendant ce temps, les fenêtres des chambres du
foyer qui se sont vidées sont murées. D’après des
personnes qui habitent le foyer, même les portes
de ces chambres ont été murées alors que les
autres sont sur-occupées, que des gens dorment
dans les couloirs et que des nouveaux arrivants,
dont plusieurs mineurs, peuvent se reposer
seulement quelques heures par nuit à même le sol
dans la cantine.
Les chambres murées rendent plus concrète l’idée
que la fermeture du foyer approche. Certains des
habitants du foyer, ainsi que d’autres citadin.e.s
fréquentant le foyer, commencent à s’inquiéter
pour la suite des événements. Le foyer Bara est,
en effet, non « seulement » un lieu d’habitation
pour 800-1200 personnes (selon les époques
et les estimations) depuis la fin des années 60,
mais est aussi un haut lieu de ressources et
d’échange pour la diaspora d’Afrique de l’Ouest
à l’échelle régionale. Par ailleurs, son petit
marché informel, sa cafet’, sa salle de
prière et surtout sa cantine sont fréquentés
au quotidien par des nombreux/ses
habitant.e.s du secteur.
L’inquiétude partagée n’arrive cependant pas à
se transformer en collectif de lutte. Les premiers
concernés sont divisés entre eux (jeunes / vieux, résidents officiellement enregistrés par Coallia / « surnuméraires », nouveaux arrivants / personnes qui sont là depuis longtemps, délégués / « délégants », ...) et ont sans doute du mal à se
représenter comme étant en capacité de créer un rapport de force.
La grande précarité de leur situation n’aide pas,
tout comme le manque d’informations claires. La
rumeur dit que tout le monde va être relogé et
finalement on en reste là.
La fin du foyer Bara
Le jour après l’affichage de l’arrêté « d’extrême
urgence », le maire réquisitionne les anciens locaux
de l’AFPA (Centre de formations professionnelles
qualifiantes pour adultes) à Montreuil, mais
l’incertitude règne. Les habitants du foyer ne
savent pas s’il vaut mieux déménager à l’AFPA ou rester à Bara : des listes de noms circulent ... il faut s’inscrire ou pas ? L’info comme quoi la préfecture
aurait réquisitionné un terrain dans le secteur de
la rue de Rosny pour y loger des résidents circule,
mais pour l’instant on en sait pas plus. Au foyer et
dans la rue l’ambiance est tendue et rien n’apparaît
clair. On discute sur quoi faire et on se questionne :
pourquoi un arrêté « d’extrême urgence » est pris
là maintenant tout de suite vu que l’immeuble est
dans le même « état de dégradation » depuis
des années ? Une possible réponse vient d’une
personne salariée chez Coallia qui nous dit que
si les travaux de démolition ne commencent pas
avant la fin de l’année, les financements attribués
au projet seront perdus.
Ces jours-là, par petits groupes, des gens
commencent à s’installer à l’AFPA. D’autres
refusent de quitter le foyer Bara d’autant plus
quand, à la mi-octobre, la réquiz de Bessac est
suspendue par le tribunal administratif.
Puis, le 29 novembre 2018, le foyer ferme et
ceux qui étaient au foyer n’ont plus d’autres
solutions que de bouger vers l’AFPA. A l’AFPA les
entrées sont filtrées. Devant le bâtiment, environ
300 personnes attendent pour pouvoir entrer et
poser leurs affaires. Au bout de 3 jours et 3 nuits
quasiment tout le monde parvient à rentrer grâce,
aussi, à une grosse mobilisation des premiers
concernés et d’associations et collectifs franciliens
qui sont venus les soutenir. Certains habitants
« surnuméraires » du foyer Bara passent de longs
mois renfermés à l’intérieur de l’AFPA car ils n’ont
pas de carte de résident AFPA et s’ils sortent
ne peuvent plus rentrer. Des vigiles contrôlent
tout le monde sur le seuil 24h/24. Les cartes
distribuées aux habitants de l’AFPA sont,
paraît-il, de deux sortes : les unes donnent
droit à une résidence « illimitée » et les
autres seront périmées à la fin de la trêve hivernale.
Les forgerons qui avaient leur atelier au rez-de-
chaussée du foyer Bara travaillent maintenant
dans un local du centre commercial de La Noue,
là où une cantine a aussi été installée.
La situation reste en suspente, mais plutôt stable,
si ce n’est pour les rafles de sans-papiers qui se
poursuivent - comme c’était le cas aux alentours
du foyer Bara et ailleurs – et s’intensifient
même, pendant l’été, aux abords de l’AFPA. Cela s’estompe un peu grâce à une mobilisation d’habitants de l’AFPA et de personnes solidaires.
Ces rafles ont peut-être un lien avec la construction
de préfabriqués sur le fameux terrain qui s’avère
être rue Brûlefer, où la préfecture compte loger
les anciens habitants « avec titre » du foyer Bara (250 personnes environ, comme les 250 auquel l’arrêté de septembre 2018 faisait référence... tout ça se tient) en attendant que les chantiers du
« desserrement » se terminent. Ce relogement a
lieu courant octobre 2019.
Le 138 avenue de Stalingrad
Pour les autres habitants du foyer, ceux « sans titre », rien n’est prévu, évidemment. Ils se retrouvent ainsi à la rue lors de l’expulsion de
l’AFPA, fin octobre 2019, après presque un an
d’occupation. À ce moment, les habitants du foyer
écrivent un tract pour réclamer leurs droits à la mairie.
Après quelques jours et quelques nuits sous la
flotte à même le trottoir, un nouveau bâtiment
est ouvert, pour ces galériens, au 138 avenue de
Stalingrad. Il s’agit d’un ancien lieu d’activité avec
quelques bureaux et un grand hangar aux rez-de-chaussée. C’est l’EPFIP qui l’a en gestion. On ne sait pas qui a ouvert ce
lieu, mais on se doute que la mairie y est pour
quelque chose, comme ça a été le cas pour ce qui
est devenu, par la suite, le foyer des Sorins, rue de Papillons et, plus récemment, pour une maison rue des Néfliers (toujours en gestion EPFIF), habitée
depuis octobre 2018 par des familles mises à la
rue, par la mairie même, en 2016.
Au 138, c’est mieux qu’à la rue mais ce n’est
pas la joie, loin de là : la mairie fait livrer des lits
superposés, ouvre trois pauvres fenêtres sur un
côté du hangar et fait poser quelques douches
et WC à l’arrache, mais ça reste indigne et
surpeuplé par rapport à la surface du lieu. Pour les environ 300 personnes qui habitent le 138, les conditions de vie sont les mêmes qu’à
Bara, voire pire. L’EPFIF, de son côté, a demandé l’expulsion du lieu.
La pandémie du COVID-19 n’a rien arrangé : ces
personnes sont confinées dans un endroit où les
lits sont collés les uns aux autres et les possibilités
d’aération sont très limitées. L’électricité saute dès
que plusieurs réchauds électriques sont branchés,
et comme la cantine du centre commercial a fermé,
rapport au coronavirus, un sérieux problème de
nourriture se rajoute aux autres.
Après deux semaines de confinement, une
vingtaine d’habitants (les plus âgés et les plus
fragiles) ont été relogés, sur le volontariat, sans
être forcés, dans un hôtel à Bondy pour deux mois.
Le problème est qu’à l’hôtel il n’y avait rien
à manger, donc les personnes revenaient
au squat pour se nourrir. Les autres ont refusé
d’être dispersés dans des hôtels sans garanties
sur la suite. L’Armée du Salut allait deux fois par
jour amener des repas froids.
Entre temps, sur les barrières du chantier de
démolition de l’ancien foyer Bara sont apparus
des panneaux qui annoncent la résidence
sociale à venir, ses 160 places en studios et
son « aménagement paysager apaisé en cœur d’îlot ». Le paysage de Montreuil continue ainsi sa lente transformation cachant les pauvres derrière
de beaux apparats ou les reléguant vers des lieux
toujours plus infâmes .
[Le tract écrit par les habitants du foyer Bara en octobre 2019 est dispo dans la version PDF en page 62.]
Le programme de « desserrement » :
Cela consiste à construire des « résidences
sociales » d’un nouveau genre (dans le
quartier on en trouve, rue des Hayeps, rue
Voltaire, rue Étienne Marcel, rue Émile Zola et
rue Bara même, à la place de l’ancien foyer
qui est actuellement en démolition) : dans ces
nouveaux bâtiments, chaque résident officiel
habite un studio et ne peut le partager avec un
proche que pour une courte période donnée.
Dans ces nouveaux bâtiments, pas de cantine
commune et ouverte au public, ni de cafet’, pas
de salle de prière, pas de marché informel à
l’entrée, pas de forgerons, pas d’hébergement
ni d’accueil pour quelques nuits dans les
parties communes. A moyen-long terme, les
résidents officiels, pour la plupart âgés, seront
remplacés au fur et à mesure qu’ils repartent
au pays, en EPHAD ou au cimetière par
d’autres galériens de tout bord au nom de la
sacro-sainte « mixité sociale ».
Projets à combattre
Le Rêv’Café : un café qui ne vend pas du rêve
Une expérience gentrificatrice du
bas Montreuil vue de l’intérieur.
Comme vous avez pu remarquer, ça fait un
moment (depuis l’été 2017) que la place de la
République, à Robespierre, est la cible d’un projet
de rénovation assez ahurissant.
Des premières réalisations ont été menées à
l’été 2018 : piétonisation d’une partie de la place,
amélioration de l’éclairage public et pose de mobilier
urbain en bois de la part du collectif Quatorze. Pendant quelques
mois en 2018, des ateliers de concertation ont été
proposés aux habitant.e.s pour récolter leurs idées
et leurs envies sur la transformation de la place. Il
y avait environ une vingtaine de personnes pour
chaque réunion, ça n’attirait donc pas les foules...
Les urbanistes en charge de la concertation ont
donc élaboré un projet, se basant sur ce qui est
sorti lors de ces moments de “partage”, qui prévoit
l’augmentation de la végétation, la création de
zones piétonnes et une zone de circulation douce
autour de la place (limite de 30 km/h), la création
d’une agora au cœur de la place, l’élargissement
de l’aire de jeux, l’amélioration du composteur, la
création d’un terrain de pétanque et d’une table de
ping-pong, des toilettes,... En somme, un projet
qui a du bol ! Mais très appétissant (pour certaines
personnes, bien entendu) en apparence, ce
programme n’est pas pour tou.te.s. C’est ce que
nous allons voir dans cet article.
Pour l’instant revenons au sujet du titre : le Rêv
Café. C’est le bar qui a ouvert à l’été 2018 (au
même moment que la concertation citoyenne
du projet de la place débutait, dis donc quelle
coïncidence !) rue Robespierre, en face de l’arrêt
du 318. Ce lieu est un exemple de complice
de la rénovation urbaine qui encourage, de manière sournoise, mais aussi explicite, la chasse aux pauvres. En effet, il participe au
projet de réaménagement du square avec Yes We
Camp, Quatorze, Remake, le Sens de l’humus et Bouq’lib.
Mais c’est quoi ce lieu ?
Le Rêv est un « café solidaire “sans cage, sans
case” où il est possible d’offrir un café, un gâteau ou
un repas suspendu au prochain venu. Un lieu de vie
participatif où chacun est invité à s’impliquer dans
le projet en participant à la programmation ou en
occupant la cuisine le temps d’une soirée ». Voilà
ce qui est explicité sur leur site. La programmation
est « en lien avec les acteurs montreuillois tout en
s’inscrivant dans le processus de transformation (c’est-à-dire de gentrification [10]) de la Place de la
République ».
Produit de saison, circuit court, zéro déchets,
encouragement de la production locale sont leurs
orgueils, tout comme l’organisation d’arpentages
de livres, de cours de langues de signes, de cours
de danse, de débats, d’ateliers,... Ce café a aussi
pour but déclaré d’agir pour « renforcer la vitalité
du Bas-Montreuil en matière de vie de quartier, de
solidarité, et de mise en œuvre de projets à impact local ». Ça parle aussi de réseaux, de solidarité, d’économie circulaire et d’amélioration du cadre
de vie. Et enfin on peut manger sur place à des
prix exorbitants (plat végétarien à 9,5 € ou
poisson/viande à partir de 11,5 € - wtf ?) ou bien
privatiser le local pour des événements.
Sans grand enthousiasme nous avons visité
plusieurs fois ce lieu tant répugnant que
fascinant (pour celleux qui ont le goût du trash),
et nous y avons interviewé une personne qui
travaille là-bas pour en savoir plus.
L’entretien est à lire directement dans la version PDF, aux pages 66-68.
Yes We Camp
Depuis 2013, Yes We Camp est une asso qui
revendique de « mettre en place des processus
de transformation d’espaces définis en micro-territoires ouverts, généreux et créatifs » (en clair : faire de l’occupation contrôlée de friches
ou de bâtiments abandonnés). Ils disent
« vouloir maximiser l’usage des ressources
(foncières notamment), et encourager
l’implication citoyenne » (en clair : faire de
la gestion de lieu avec des acteurs précaires
type asso qui pourront développer leur projet).
Ils sont basés à Paris et à Marseille. C’est eux
qui ont mené le projet des Grands Voisins, à
Paris, et le Coco Velten, à Marseille.Remake
Filiale du groupe REI Habitat (un promoteur
immobilier), ReMake accompagne la création
de rez-de-chaussées commerciaux « riches
de sens » (d’après eux). Avec ses artisans-designers, ReMake anime également une démarche d’upcycling (quoi ?!) et de réemploi et
révèle des espaces publics à travers des
chantiers participatifs (ce qui donne les fameux
jardins de palettes à la mode que l’on voit de plus en plus).Quatorze
Collectif d’architectes, d’urbanistes et de
paysagistes, ayant pour ambition de : « promouvoir, expérimenter et transmettre une
approche de l’architecture sociale et solidaire,
une approche de la ville agile et résiliente. »
Ils interviennent sur des espaces publics
ou bâtiments en organisant des chantiers
participatifs (eux aussi) et en promouvant
l’auto-construction.Sens de l’Humus
Asso loi 1901 basée sur Montreuil depuis
longtemps et notamment aux Murs à pêches.
Gérant plusieurs parcelles de jardins, ils
mettent en place des composts partagés dans
les rues de la ville et sont associés à des
projets urbains en terme de végétation.Bouq’Livre
Asso montreuilloise qui fait circuler des livres
gratuitement dans des points de dépôts
sur toute la commune : au cinéma, chez le
boulanger, le café, etc mais aussi dans des
boîtes à livres installées de manière pérennes dans la rue.
Aujourd’hui sur la place [de la République, à Montreuil], il y a plein de personnes qui zonent ou qui se posent sur un banc pour
faire une sieste, manger ou discuter. Ce sont
ces personnes qui sont la cause du sentiment
« d’insécurité » chez les nouveaux et nouvelles
arrivant.e.s, à qui la place doit faire envie, ou chez
des personnes appartenant à une certaine classe
sociale (on vous laisse deviner laquelle). Les
mêmes qui ont participé en majorité aux ateliers
de concertation.
Bien sûr que tout ce qui est proposé dans ce
projet a l’air pas mal, mais la question à se poser
est : pourquoi veut-on rénover la place
avec du mobilier et des installations
standardisées ? Pourquoi ouvrir un bar à
forte connotation « bobo », donc pour une
population bien particulière ?
A la fin des travaux, la place de la République
rassemblera à n’importe quelle place, de n’importe
quelle ville française contemporaine. La réponse
va de soi : toute cette mascarade participativo-citoyeniste ne sert qu’à créer des endroits agréables pour la partie de la population qui va
dans les bars pour boire une bière artisanale à
8 €, qui travaille dans les co-working et qui
laisse ses épluchures dans le bac à compost
pendant que son enfant joue dans l’aire de jeux
100 % bois recyclé. Que ça soit clair, on n’est
pas contre le compost, le recyclage ou
des espaces de convivialité, mais contre
tout ce qu’ils représentent et le type de
population qu’ils attirent (et celle qu’ils repoussent).
Rappelez-vous des mécanos sauvages qui
étaient rue Barbès. Eux ça fait des années
qu’ils ne peuvent plus exercer leur activité à côté
de la place car ils ne sont plus les bienvenus,
même si beaucoup de personnes allaient là-bas pour réparer leurs voitures.
Un autre exemple dans le coin, c’est le « bar à
fromages » sur la place de la Fraternité, entre
Montreuil et Bagnolet.
Dans son camion jaune, le gérant vend du fromage
depuis septembre 2016, se vantant de proposer
du « fromage suspendu » (c’est-à-dire laisser la
possibilité à ses client.e.s d’acheter du fromage
pour les gens qui n’ont pas les moyens). Son
objectif est de « fraterniser et faire vivre la place » et se « réapproprier d’une place abandonnée sur
laquelle les gens n’osaient plus venir à cause des
dealers et des alcooliques » (ah bon ? Si c’est lui
qui le dit...).
Dans un article du Figaro daté du 15 février 2019,
concernant les agressions des commerçant.e.s
en Seine Saint-Denis, il se dit aussi touché par
le « fléau de l’insécurité ». En effet, il dit avoir
été menacé, harcelé ou bien son camion a été
endommagé à plusieurs reprises par différentes
personnes qui n’aimaient pas trop sa présence
sur la place [11]. Peut-être parce qu’il n’est pas
le bienvenu puisque sa soi-disant mission qui est « d’aider les plus démunis et de refaire revivre la
place » (carrément pas nécessaire car la place
était déjà très fréquentée et animée sans lui) n’est
qu’un prétexte ?
Ils servent à justifier l’imposition d’opérations
de transformation urbaine et de « chasse
aux pauvres » qui ont commencé il y a
longtemps et suivent des processus très
lents et insidieux.
Gardons les yeux ouverts !
De l’impasse Volpelier au passage de la Fraternité
Samedi 13 avril 2019, certain.e.s de nous sommes parmi les 40-50 personnes qui participent à la « présentation du projet de réhabilitation et visite
du passage Volpelier ».
Rdv au 198 rue de Paris. Des adjoint.e.s du maire
sont là ainsi que des salarié.e.s des services
municipaux. Il y a des commerçant.e.s de la rue de
Paris (qui savent depuis quelques années que leur
bail ne sera pas renouvelé et qu’ils devront quitter
leurs emplacements). Il y a d’autres habitant.e.s
du quartier (locataires, proprios, squatteurs).
La venelle est charmante et désormais inhabitée.
Des grillages amovibles clôturent les recoins et
la petite cour côté est. Les portes des bâtiments,
tous apparemment vides, sont ouvertes. Les gens
rentrent pour jeter un coup d’œil aux intérieurs.
L’espace du fond (anciens ateliers Citroën),
d’habitude fermé, est aussi accessible. On y
découvre trois bâtiments encore et un gardien
avec son chien. Mais les portes sont là aussi grand
ouvertes, tout le monde se promène aux rez-de-
chaussée et aux étages et nous de même, jusqu’à
quand une employée de la mairie nous suit dans
les anciens bureaux Citroën et nous demande
de sortir, car « la visite c’est après le discours du maire » (sauf que quand nous sortons la porte de ce bâtiment-là est aussitôt fermée).
Du coup, en attendant le maire et son discours
on regarde les perspectives dessinées à l’ordi
par les architectes affichées sur des panneaux
posés dans la cour et on discute avec certains
des commerçants qui vont se faire virer. Nous
apprenons que le boucher halal (le seul dans le
quartier, après c’est à Croix-de-Chavaux ou dans
la rue d’Avron) cherche un autre emplacement
dans le coin mais tout est très cher. Le gérant du
Tacos, qui est sans doute propriétaire, espère,
lui, une bonne indemnisation. Pourtant, à leur emplacement actuel, le programme prévoit toujours des commerces. « Oui, mais la mairie ne veut pas que ça soit repris par nous. Ils veulent y installer d’autres types de
commerces », on nous dit. On sait par ailleurs qu’en face aussi il y aura des gros changements : l’épicier du Cours des halles attend toujours de
savoir quand il devra dégager. De même pour le
Bazar Sud. Un peu plus bas, toujours rue de Paris,
une voisine a reçu il y a quelque temps déjà un
courrier de Soreqa comme quoi il faudra déguerpir.
Paniquée, elle a appelé Soreqa. La personne au
téléphone lui a dit « bah oui madame, votre maison
est insalubre ». Pourtant la voisine, qui a acheté
il y a une vingtaine d’année pour rester dans sa
ville natale, a fait pas mal de travaux mais surtout
aucun.e technicien.ne n’a mis les pieds chez elle,
donc aucun diagnostique d’insalubrité n’a pu été établi.
Le maire fini par arriver. Il nous dit avoir été retenu
dans un club de foot pour un problème qui a l’air
grave, vu la tronche qu’il fait. Il rebondit finalement
assez vite et il improvise une homélie faux derche à souhait dans laquelle le mot « insalubre » revient sans cesse. Sauf qu’à ce qu’on voit on dirait qu’il s’agit de la même « insalubrité » déclarée a priori que celle de chez la
voisine (ou en tout cas d’une insalubrité tout à fait
remédiable). L’idée est que, dans sa lutte contre
l’insalubrité, la mairie héroïquement s’attaque
à l’impasse pour en faire un passage ouvert sur
la rue Etienne-Marcel, un haut lieu de « mixité
sociale », un pan de « ville nourricière » avec plein
de potagers urbains, un « village du réemploi » populaire/solidaire mais en même temps – ne vous inquiétez pas – tout à fait calme et respectueux de
la tranquillité publique.
La parole passe à l’architecte du projet lauréat.
Dans son exposé poussif et pédant, il insiste
d’abord sur un détail passionnant : il n’a pas travaillé
sur commande, il a été mis en concurrence avec
d’autres archis. C’est comme ça que son projet a
été choisi. « On ne fera pas tabula rasa » – il nous rassure – on gardera en effet quelques unes des bâtisses de l’ouest de la venelle ainsi que celle en
briques de chez Citroën, et on remettra en valeur
les anciens pavés de la chaussée. En revanche
– ce qu’on comprend en creux – tout le reste va
être démoli et il y aura, à la place, des immeubles
neufs et bien sûr « innovants », dont un tiers de
logements sociaux (qui ne sont pas nommés en
tant que tels par l’archi, ni par le maire). Il y aura
notamment des « co-living » (avec « petite salle
de sport » et salle commune) très pratiques, nous
explique l’archi, car abordables au début de la
vie active, lors des passages de vie délicats et/ou pour les familles mono-parentales. En gros, on comprend que c’est des appartements conçus
pour la colocation, mais si on dit « coloc » ça
évoque peut-être « jeunes » et/ou galérien.ne.s, donc ce n’est pas bon pour la
tranquillité publique.
L‘assistance commence à bouillonner. Il y en a qui voudraient poser des questions ou réagir. Mais non. Comme d’hab, le déroulement de la
présentation/visite fait qu’il n’y a pas de place
pour un débat. Il ne faut surtout pas que
quelqu’un pourrisse le groove du maire & cie avec, on ne sait jamais, un peu
d’esprit critique... L’adjoint répond vite fait à
quelque question d’intérêt général, n’est-ce pas,
concernant la hauteur des bâtiments (« je suis
inquiète pour l’ensoleillement de chez moi ») ou
les vis-à-vis (« je ne voudrais pas des fenêtres
donnant sur mon jardin ») et quand il réalise qu’il
y a pas mal de mains levées pour essayer d’en
placer une, il déclare que le moment est venu de passer à l’apéro.
Certain.e.s ne se désistent pas et le suivent pour
continuer à discuter. Une dame l’interpelle
à propos de sa crainte que des squats
s’installent avant le début de travaux, les
dépôts des permis de construire n’étant prévus
que fin 2019 ou 2020. L’adjoint nous dit alors
qu’une occupation éphémère est prévue, « à partir
de tout de suite », pour empêcher cela. La dame
est aussi inquiète à cause des squatteurs d’à côté.
L’un des copains concernés est là et répond lui-même aux questions de tranquillité publique qui la tourmentent. Si elle semble rassurée, un couple
saute sur l’occasion pour lui poser une rafale de
questions portant sur le nombre d’occupant.e.s,
leurs profils sociologiques, leurs activités sur place (« Quoi ?! Vous faites de la mécanique auto ?! Il va y avoir des gaz ! Ça va polluer ! »).
Eh oui, l’enfer, c’est les autres. Et il y en a
partout. Dans ces conditions, rester
bourgeois [12] c’est un combat de tous les
jours dans ce quartier ! Il y a les biffins avec
leur marché informel du week-end – heureusement que le maire et le préfet leur font la guerre depuis 2014. Il y a les familles qui dorment à la rue – mais la Ville pose des grillages pour les chasser ou
amène les voitures-maisons à la fourrière. Il y avait
le foyer Bara, et là aussi Saint Patrick de la Réquiz
a enfin soulagé le quartier en faisant déménager
tout le monde à l’AFPA en l’attente de la démolition
du foyer et de la reconstruction d’une résidence
sociale sans cantine, sans salle de prière et surtout
sans étalages de marchandises, forgerons et
bouchers. Il y a toujours des squats, hélas, malgré
la mairie qui donne l’exemple en faisant expulser
ses propres bâtiments squattés (250 boulevard
de la Boissière, juillet 2016 ; Salamatane, janvier
2017 ; 30 rue Gambetta, octobre 2017). Il y a les
commerces « peu attractifs », « trop homogènes »
et débordant sur le trottoir de la rue de Paris,
mais là aussi ça va dégager. Il y a même, selon
certain.e.s habitant.e.s du quartier, trop de gosses
des logements sociaux dans certaines écoles,
voire une trop grande concentration de logements
sociaux côté « faubourg ».
Ainsi, les décideurs gardent un petit bout par-ci et
par-là – quelque ancien bâtiment, quelque logement
peut-être un peu abordable (pour des galérien.
ne.s auparavant trié.e.s par les services sociales),
du « réemploi » écolo-social-cool (mais surtout
pas celui pratiqué par les biffins) – et chassent
celles et ceux qui, par leur présence et
leurs activités, font déjà depuis longtemps
de ce quartier un quartier qui demeure populaire
malgré la gentrification, hétérogène, où l’on trouve
des solidarités concrètes et où on pratique le recyclage.
A coups de pelleteuse, d’expulsions, de flicages
divers et variés mais aussi de « novlangue » et
de com’, Bessac & cie poursuivent leur objectif de
« ville apaisée » et grand-parisienne.
Nous ne sommes pas resté.e.s pour l’apéro.
Docu-graphie critique
- Mainmise sur les villes, de Claire Laborey et Marc Evreux, documentaire, 2013, 1h29
- Push, chassés des villes, de Fredrik Gertten, documentaire, 2020, 1h30
- Nos poumons c’est du béton, par un Collectif, documentaire, 2016, 0h22
La docu-graphie critique est à lire intégralement dans la version PDF, aux pages 74-76.
[1] La Maîtrise d’Oeuvre Urbaine et Sociale (MOUS) a pour objectif de promouvoir l’accès au logement des personnes défavorisées.
[2] Est-Ensemble est une institution publique qui gère huit villes de Seine-Saint-Denis. Elle a été créée lors de la mise
en place de la Métropole du « Grand Paris ».
[3] Après plusieurs semaines de campement
devant la mairie de Bagnolet, puis sous l’échangeur de
Gallieni, ils ouvriront un nouveau squat au 72 rue René
Alazard, à Bagnolet (voir L’En Ville 2 et Squat.net).
[4] Maison du projet : dispositif de « démocratie participative » des pouvoirs publics qui consiste à installer un
espace au milieu d’un quartier (au plus près des gens) et où sont organisés ateliers, réunions, etc. lors de « dispositifs
participatifs » pour faire croire que l’avis des habitant.e.s est pris en compte pour l’avenir de leur quartier.
[5] Établissement public qui anime une action générale de prévention et de développement social
dans la commune parisienne, en étroite liaison
avec le Département, les institutions publiques, les
associations et différents organismes.
[6] Ce sont des mécanismes mis en place par les financeurs pour l’attribution d’une subvention.
[7] Genre de musique avec des percussions
traditionnelles du Brésil, souvent présent durant les
manifestations, en France et ailleurs.
[8] Au-delà des aspects pratiques (courir après
son courrier au bout d’un moment ça devient pénible),
les domiciliations chez les associations et les CCAS ne
sont pas acceptées par la préfecture lors du dépôt de
la demande de régularisation.
[9] Le bâtiment a été démoli pour faire place au
projet de Vinci Immobilier (architecte Maud Caubet
Architectes). Il prévoit la construction d’un grand
édifice appelé « Live » où il aura des bureaux, des
co-workings, des incubateurs d’entreprises, des
commerces, etc. C’est un projet d’ « Inventons
la Métropole du Grand Paris » (IMGP), appel
à projets qui permet aux villes de la Métropole
d’identifier et de sélectionner les meilleurs projets
de développement urbain.
[10] La gentrification, ou embourgeoisement urbain, est un phénomène urbain par lequel des personnes plus aisées s’approprient un espace initialement occupé par
des habitant.e.s ou usager.e.s moins favorisé.e.s. Cela
transforme le profil économique et social du quartier au
profit exclusif d’une couche sociale supérieure.
[11] Pour info, le fromager est parti de « l’ingrate
place » pour se réfugier à Saint-Denis, où, depuis
novembre 2019, il a ouvert une fromagerie, pour
continuer sa « mission civilisatrice » (et la gentrification
de la banlieue parisienne).
[12] A. Collet, Rester bourgeois. Les quartiers
populaires, nouveaux chantiers de la distinction, La
Découverte, 2015.
Retrouvez tous les numéros de L’En-Ville ici.
Plus d’infos sur les luttes concernant le logement à
Montreuil et Bagnolet :
https://fr.squat.net/tag/bagnolet/
https://fr.squat.net/tag/montreuil/
Contact : degage-onamenage@@@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (47.9 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (26.2 Mio)


