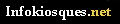Brochures
Le règne ténébreux de l’artificiel
Naissance et essor de la chimie industrielle
mis en ligne le 11 septembre 2025 - Maciej Puszcza
Le 2 décembre 1984, la nuit est agréablement fraîche à Bhopal dans le Madhya Pradesh, un État au centre de l’Inde. Dans l’usine chimique du géant étasunien Union Carbide, aujourd’hui absorbé par un des plus grands producteurs chimiques, Dow Chemical, des ouvriers travaillant dans les ateliers de fabrication d’isocyanate de méthyle (« MIC » dans le jargon des industriels) ressentent des picotements aux yeux et des maux de tête. Une des trois cuves de stockage de ce produit intermédiaire à la fabrication d’un puissant pesticide carbaryl, commercialisé sous la dénomination de Sevin, est en train de fuiter. Ce n’est pas une première dans cette usine implantée en 1969 dans le cadre de la dite « révolution verte », l’industrialisation de l’agriculture dans le tiers-monde. Des dizaines d’ouvriers ont déjà été intoxiqués par des expositions aux produits terriblement toxiques que sont l’isocyanate de méthyle et le gaz phosgène qui entre dans son processus de production. Cette nuit-là, la fuite ne peut pas être colmatée : un énorme nuage de gaz toxique s’échappe des cuves. Les vents poussent le brouillard toxique vers les bidonvilles avoisinant l’usine. Vers 1h30, la foule y est prise de panique : en sortant de leurs habitats de fortunes, les gens suffoquent sous l’effet des gaz, d’autres deviennent aveugles. D’autres quartiers sont touchés à leur tour. Dans les jours qui suivent, plus de 8000 personnes meurent. Les autorités admettent un chiffre de 260 000 blessés. Au cours des années qui suivent, plus de 20 000 personnes meurent à cause de leur exposition au brouillard toxique lors de cette nuit infernale, 500 000 autres sont atteintes de séquelles graves et continuent, encore aujourd’hui, à mourir des conséquences de ce qui est considéré comme le plus grand désastre industriel de l’histoire.
Pour les autorités, les accidents industriels sont au plus des rappels à l’ordre : il faut réguler pour endiguer les défaillances techniques, les manquements sécuritaires, instaurer des commissions d’experts. Pour d’autres, ils viennent rappeler ce qui est au centre même du progrès industriel. « Nous vivons tous à Bhopal », titrait la revue écologiste radicale Fifth Estate au lendemain de la catastrophe, soulignant comment personne n’est à l’abri des nuisances mortifères résultant de la production industrielle. C’est le cas lors des désastres (nuage toxique, catastrophe nucléaire, marée noire, rupture des bassins de rétention des résidus miniers,…), mais surtout au quotidien, par une pollution omniprésente qui tue à plus ou moins petit feu. Un des derniers exemples en date de cette pollution meurtrière insidieuse est la contamination des humains, des animaux, des sols et des eaux aux PFAS, les dites « polluants éternels, les per- et polyfluoroalkylées [1]. A l’instar du phosgène et de l’isocyanate de méthyle échappés des cuves de l’usine chimique à Bhopal, ces polluants éternels sont des substances chimiques synthétiques. Elles n’existent pas dans la nature, elles ont été manufacturées. Aujourd’hui, 204 millions de substances sont répertoriées [2]. Les industriels de la chimie admettent aujourd’hui l’usage de 150 000 substances chimiques, et c’est ce qui permet une définition approximative de ce secteur de l’industrialisme : l’industrie chimique concerne la fabrication de matières synthétiques, artificielles, non-existantes dans la nature [3]. Comme on le verra au long de cet article, l’industrie chimique est non seulement le modèle par excellence de la domestication industrielle (par son assaut contre le vivant, sa volonté de contrôle, sa pollution, sa mise au service de la conquête et de l’extermination), mais elle en est aussi la pierre angulaire. Et à l’instar de l’ensemble des industries en « transition écologique », elle est en pleine mutation pour préserver sa place centrale au sein de la société techno-industrielle.
L’essor de l’industrie chimique
Jusqu’au XIXe siècle, toutes les molécules manipulées par les humaines étaient d’origine naturelle. Qu’il s’agisse d’alliages, des matériaux de construction comme la chaux ou des explosifs comme la poudre noire, les éléments mélangés, broyés, chauffés ou humidifiés sont trouvables dans la nature. Ce n’est bien sûr par parce que les molécules sont d’origine naturelle qu’elles sont compatibles avec la vie (comme les métaux lourds : cadmium, plomb, mercure, arsenic, …).
En 1828, a lieu ce qui est considéré comme un tournant historique : l’Allemand Friedrich Wöhler parvient, à partir d’urine, à créer une urée de synthèse, utilisée pour les engrais. Cette expérience marque la naissance de la chimie de synthèse. Elle apporte en effet la preuve qu’il est possible de synthétiser un composé organique en dehors d’un organisme vivant. La démarche sera poursuivie par le chimiste français Marcellin Berthelot : de 1850 à 1865, il reconstitue le méthane, le méthanol ou le benzène à partir de leurs éléments, avant de publier en 1860 l’une des bibles de la nouvelle discipline, La chimie organique fondée sur la synthèse. La seconde moitié du siècle voit la floraison des traités de chimie, des chaires d’enseignement et des laboratoires.
La chimie du charbon, moteur de l’essor industriel, a associé la science, les intérêts industriels et commerciaux et les politiques étatiques dans l’avènement d’un secteur stratégique, la carbochimie. Elle est à la base de la plupart des produits de synthèse. La chimie de charbon connaîtra ses premières débouchées industrielles dans la teinturerie. Le premier colorant de synthèse – la mauvéine – est fabriqué dans les années 1850 par l’action de l’acide sulfurique sur l’aniline tirée du goudron de houille. Ce qui entraîne très vite une pollution du Rhin à grande échelle dès 1863, le long duquel la nouvelle et très puissante chimie industrielle allemande (Bayer, Hoechst, BASF) s’est implantée ; en 1875, ses rives accueillent plus de 500 usines, aucun autre fleuve dans le monde n’a jusqu’alors été colonisé à une telle échelle par l’industrie chimique. La gamme des produits synthétiques s’étoffe alors : nitrocellulose (1846), benzène (1868), celluloïd (1870), caoutchouc (1909), ou encore l’azote (procédé Haber-Bosch, 1909-1913), qui ouvre la voie aux engrais chimiques industriels. Dans les années 1900, les États-Unis prennent le leadership de la chimie industrielle de synthèse, avec DuPont de Nemours, fondé en 1802 pour l’industrie des explosifs, qui s’oriente vers la chimie industrielle, Dow Chemical (1889) et Monsanto (1901).
La Première Guerre Mondiale marque un tournant majeur. Financées par les États, toutes les usines chimiques augmentent leurs capacités de production pour répondre aux besoins des armées. A la demande du Ministère de la Guerre allemande, Carl Duisburg, le patron de l’entreprise chimique Bayer, et le célèbre chimiste Fritz Haber, lancent la recherche pour l’emploi et la fabrication de gaz toxiques à des fins militaires. L’usine de Leverkusen démarre la production de gaz au chlore début 1915. Il est expérimenté une première fois contre les soldats russes fin janvier 1915, puis une deuxième fois, le 22 avril 1915, sous la supervision de Haber [4], à Ypres, sur le front belge. Le sulfure d’éthyle dichloré, dispersé par le vent après l’explosion d’obus, attaque les yeux et les poumons et provoque des brûlures chez les combattants britanniques et français, tuant un millier de soldats et déclenchant un mouvement de panique. Tout en dénonçant cette attaque chimique, les industries chimiques des Alliés mettront les bouchées doubles pour produire des gaz de combat. Du côté français, c’est la Compagnie des produits chimiques d’Alais et de la Camargue – le futur Péchiney – qui se lance dans la production de gaz de combat. Du chlore est fabriqué dans les usines chimiques de Saint-Auban (Alpes-Maritimes) et de Pont-de-Claix (Isère), sites qui existent encore [5]. Air Liquide, fondé en 1913, fournira du chlore à la demande de la Défense Nationale. De 1915 à 1918, l’industrie française produit plus de 36 000 tonnes de gaz toxiques [6]. D’importantes secousses révolutionnaires suivirent la fin de la « première guerre industrielle », inédite dans l’histoire par le nombre de morts et de blessés, ainsi que par la quantité des moyens employés, des énergies mobilisés et de destructions occasionnées. Dans le Traité de Paix, une clause fut incluse obligeant les Allemands à détruire les usines d’IG Farben qui avaient produit les gaz de combat et les nitrates synthétisés grâce au procédé Haber-Bosch. Le patron d’IG Farben, Carl Bosch, négocia avec le gouvernement la sauvegarde de ses usines contre la révélation de ce procédé. Aidés par des ingénieurs allemands, des usines de production synthétique de nitrates virent le jour en France et en 1927, les usines toulousaines devinrent le premier producteur et exportateur au monde de nitrate d’ammonium [7].
Dans le secteur de la chimie, la reconstruction des économies et des empires coloniaux après la fin de la Première Guerre Mondiale se traduit par la formation de grands groupes fortement soutenus par les États. En Allemagne, de loin le pays avec le secteur chimique le plus développé, les six grandes entreprises chimiques s’unissent en 1925 dans un seul groupe : IG Farben. En réponse, quatre entreprises chimiques anglaises forment en 1926 l’Imperial Chemical Industries. En France, l’État est à l’origine de la création de l’Office National Industriel de l’Azote (ONIA) et en 1928, une fusion donna naissance au mastodonte de la chimie française Rhône-Poulenc. De l’autre côté de l’océan, le groupe DuPont, qui avait dégagé d’énormes bénéfices grâce à l’entrée en guerre des États-Unis, est le premier concurrent de ces grands groupes. Cette tendance vers de grands conglomérats ne va plus jamais disparaître. Après une première période d’industrialisation relativement expérimentale, la Première Guerre Mondiale avait mis en évidence le caractère stratégique de la filière chimique, ce qui explique la forte présence de l’État dans le secteur (jusqu’aujourd’hui), à l’instar des secteurs énergétiques (pétrole, nucléaire, gaz). De plus, la production chimique nécessite d’énormes investissements, d’importantes infrastructures, une onéreuse recherche et un réseau logistique très développé : de tels « défis » et coûts favorisent bien sûr la concentration des capitaux, et une convergence avec la puissance étatique.
Quatre-vingt ans après le forage du premier puits de pétrole commercial à Bakou (1848), ces conglomérats vont développer la pétrochimie : la chimie de synthèse en partant du pétrole (plutôt que du charbon). Au début des années 1930, alors que les économies plongent dans une récession d’une ampleur inédite qui va paver le chemin pour la Deuxième Guerre Mondiale et grâce à une disponibilité majeure de pétrole, les conglomérats vont s’inspirer des procédés de la carbochimie pour développer des monomères et des polymères à partir de pétrole. En 1932, DuPont lance la production du premier caoutchouc synthétique, le néoprène. Un an plus tard, des chimistes d’Imperial Chemical Industries produisent du polyéthylène, qui deviendra la matière plastique la plus répandue. En Allemagne, c’est IG Farben qui se lance dans la fabrication de polychlorure de vinyle (PVC), un polymère thermoplastique [8] . En 1935, le groupe allemand Henkel lance la production des résines de mélamine qui connaîtra son véritable essor après la guerre. De nombreuses autres substances plastiques sont brevetées dans ces années-là comme le nylon, les polyuréthanes, le polystyrène, le polychlorobiphényle (PCB) ou encore le polytétrafluoroéthylène, ancêtre des PFAS.
L’industrie chimique impose le monde du synthétique
A la veille de la Deuxième Guerre Mondiale, IG Farben dominait de loin la production chimique mondiale (elle représentait 25% de celle-ci) [9] . Toutes les industries chimiques intactes des belligérants vont passer sous un régime de planification pour répondre aux besoins de la guerre [10]. Les procédés pétrochimiques connaîtront un important essor : du caoutchouc synthétique aux Etats-Unis, de l’essence synthétique en Allemagne [11], la fabrication de TNT, de solvants synthétiques. De nombreuses usines chimiques sont construites pour produire massivement de l’ammoniaque. A la fin de la guerre, la plupart des usines chimiques, même celles qui se trouvent en Allemagne [12], sont intactes. IG Farben est découpé en plusieurs entreprises (Bayer, BASF, Hoechst, …), d’un côté pour briser la dominance allemande sur l’industrie chimique, et de l’autre parce qu’un tel conglomérat trop grand ne correspondait pas aux nécessaires transformations technologiques de la filière. Le poids de la pétrochimie, mise au point aux États-Unis, tandis que la majorité de l’industrie chimique reposait encore sur le charbon, allait s’accroître sous les desseins d’hégémonie étasunienne. C’est à partir de 1950 que les procédés pétrochimiques, développés pendant la guerre, vont être largement adoptés au sein des usines chimiques du monde entier.
Les années 1950 marquent l’essor définitif de l’industrie chimique. Plastiques et fibres synthétiques prennent agressivement la place de matériaux naturels sur le marché de la consommation. La capacité de production d’ammoniaque surdimensionnée est reconvertie en production d’engrais agrochimiques qui vont industrialiser toute la filière agricole. La production de pesticides prend son envol, l’usage sur les champs va plus que doubler chaque décennie [13]. Dans la pétrochimie, des procédés plus élaborées de vapocraquage et d’hydrocraquage d’hydrocarbures sont mises en place au sein des usines.
Comme d’autres secteurs économiques qui explosent lors de la croissance économique vertigineuse des « Trente Glorieuses » tels que la métallurgie spécialisée, l’industrie de l’automobile et de l’électroménager, l’industrie aéronautique, la chimie en pleine extension a des besoins énergétiques toujours plus importantes. Les États procèdent alors à la construction de nouvelles centrales électriques, des barrages hydroélectriques, des lignes à haute tension et, à partir de la fin des années 1950, à la construction d’oléoducs et de gazoducs. Partout les grands projets transforment les campagnes en cauchemars industriels. En France, l’État commence à aménager dans la vallée du Rhône, l’infâme « Couloir de la Chimie » autour de parcelles préalablement occupées par des entreprises chimiques au sud de Lyon. La pétrochimie s’y installe aussi : en 1964, Elf s’installe sur le site de Feyzin. L’aménagement industriel de la vallée du Rhône au sud de Lyon est particulièrement brutal. C’est la construction du barrage hydroélectrique de Pierre-Bénite qui va permettre l’extension de la zone industrielle existante, et la construction de l’autoroute A7 a lieu en même temps que l’implantation de la raffinerie d’Elf à Feyzin, une des plus modernes de l’époque. A peine deux ans après son ouverture, la catastrophe s’invite : le 4 janvier 1966, la raffinerie explose, provoquant 18 morts et 84 blessés. Au-delà de la raffinerie, des toitures ont été endommagées jusqu’à plus de deux kilomètres, et des vitres brisées à plus de huit kilomètres [14].
La chimie est devenue un secteur extrêmement compétitif exigeant d’importants investissements dans la recherche et le développement. Et contrairement aux autres branches industrielles, elle nécessite relativement peu de main d’œuvre pour faire tourner ses usines [15]. Mais pour faire face aux coûts très élevés de la construction de laboratoires, de financements de recherche aux débouchés incertains et de la continuelle modernisation des structures de production, la tendance vers la formation de grands groupes aux activités diversifiées – et souvent avec une forte participation de l’État (surtout dans les industries européennes et soviétiques) – marque le panorama du secteur. L’industrie tire une bonne partie de ses bénéfices du développement de nouveaux produits chimiques, ce qui expose le secteur à d’importantes prises de risque financier et l’incite à mener d’importantes campagnes de promotion de ses produits. Si l’acception est très large pour les applications industrielles, les consommateurs restent longtemps assez méfiants face aux fibres synthétiques, au plastique et aux insecticides, avant d’être mis devant le fait accompli, puis d’être complétement acquis. Mais en 1968, la consommation de fibres synthétiques aux États-Unis dépasse celle des fibres naturelles. Et le monde devint plastique.
Le temps des catastrophes
« L’humanité tirera plus de bien que de mal des découvertes nouvelles. » (Pierre Curie)
L’optimisme aveugle régnant dans l’industrie chimique et la pétrochimie fait l’impasse complète sur les conséquences nocives pour le vivant et les dangers liés à la production chimique. Plusieurs accidents et catastrophes, ainsi que les premières mobilisations écologistes, tâcheront pourtant à jamais l’image de cette industrie. En 1963, dans le livre Printemps silencieux, la biologiste Rachel Carlson dénonce l’usage immodéré des pesticides et ses effets néfastes sur la biodiversité, notamment sur les oiseaux. L’extension rapide de l’industrie chimique s’accompagne dans la décennie suivante d’importantes catastrophes : à Bingen, pollution du Rhin en Allemagne par un fût d’insecticide en 1969 (600 km de fleuve contaminé, 20 millions de poissons morts) ; explosion à l’usine chimique Thiokol Chemical aux Etats-Unis en 1971 (29 ouvriers morts, 50 blessés graves) ; explosion de 50 tonnes de cyclohexane à l’usine chimique de Flixborough au Royaume-Uni en 1974 (28 morts, 36 blessés graves) ; fuite de dioxines à l’usine chimique d’ICMESA à Seveso en Italie en 1976 (193 blessés gravés, des milliers de personnes intoxiqués avec séquelles, plus de 80 000 animaux morts ou abattus, mort de la flore et pollution durable des sols [16]) ; contamination du quartier Love Canal aux Etats-Unis par 21 tonnes de déchets chimiques en 1978 (relocalisation des habitants, explosion de cancers et de maladies) ; explosion d’un camion de propylène à Los Alfaques en Espagne en 1978 (217 morts). C’est aussi la décennie des premières marées noires : catastrophe de Seven Rocks en 1967 (123 000 tonnes de pétrole dans la mer, 180 km de côtes anglaises et françaises touchées) ; naufrage du pétrolier Sea Star en 1972 (100 000 tonnes, Golfe d’Oman) ; échouage du pétrolier Showa-Maru dans le détruit de Malacca en 1975 (200 000 tonnes de pétrole) ; explosion du pétrolier Urquiola dans la baie de La Corogne en Espagne en 1976 (100 000 tonnes) ; naufrage de l’Amoco Cadiz devant les côtes bretonnes en 1978 (220 000 tonnes de pétrole) ; explosion du pétrolier français Bételgeuse en Irlande en 1979 (49 morts et marée noire) ; explosion de la plateforme pétrolière Ixtoc-1 dans le Golfe du Mexique (1 million de tonnes de pétrole brut répandu dans la mer).
Toutes ces catastrophes suscitent d’importantes mobilisations. Une autre filière particulièrement nocive, en développement à cette époque, le nucléaire, suscite également de vastes mobilisations et une opposition de plus en plus radicale (et sa chronologie est parsemée de sabotages, attentats à la bombe et attaques armées) [17]. Si une partie du mouvement identifie et attaque le nucléaire non seulement pour ses nuisances, mais aussi parce que le secteur énergétique dont il fait partie constitue la colonne vertébrale de la société techno-industrielle, d’autres se laissent aisément séduire par la proposition d’alternatives moins polluantes pour fournir de l’énergie à cette société. Dans la contestation de l’industrie chimique, la personnification de Frankenstein dans la production industrielle, un écueil similaire laissera à l’industrie et à l’État une porte de sortie pour continuer, mais autrement. Dans les années 1970, les États commencent à imposer d’importantes régulations à la filière chimique en matière de pollution et de sécurité des installations, tout en évitant d’étouffer cette pierre angulaire du progrès industriel. Les industriels de la chimie commencent alors la valse qui se poursuit encore aujourd’hui : ils s’opposent à l’interdiction de molécules considérées trop toxiques ou dangereux, puis remplacent la molécule interdite par une autre. Les longues et onéreuses enquêtes sur la toxicité de la nouvelle molécule [18] reprennent, laissant suffisamment de temps aux industriels pour réaliser leurs bénéfices et garder une longueur d’avance. A la fin des années 1980, en pleine restructuration mondiale et après encore maintes terribles catastrophes [19], l’industrie chimique cherche elle aussi de nouvelles orientations. Elle va se lancer dans la « chimie verte », soucieuse envers l’environnement et durable pour la société. Avec l’industrie pétrolière, c’est la filière qui mène les premières expérimentations d’un greenwashing avant l’heure. Elle doit aussi chercher de nouveaux domaines, car à partir des années 1970, les innovations « de rupture » sont devenues de plus en plus rares. En adoptant une stratégie de diversification, l’industrie va donc se concentrer sur des applications toujours plus spécialisées, en créant une très large panoplie de molécules synthétiques [20].
Dès les années 1980, l’industrie chimique s’implique aussi dans les nouvelles technologies à l’origine de la société techno-industrielle qui règne désormais sur la presqu’entièreté de la planète. Le développement des biotechnologies (avec notamment la transgénèse et la biologie moléculaire) vont transformer les procédés de l’industrie pharmaceutique [21]. Les grands groupes chimiques vont diversifier leurs activités et investir massivement dans le secteur pharmaceutique, tout en conservant leur base historique, dont les procédés sont restés substantiellement les mêmes depuis les années 1950 (plastiques, engrais, pesticides, solvants, gaz industriels et polymères synthétiques). Grâce à l’automatisation électronique et aux technologies de télécommunication, les méthodes de production de l’industrie chimique vont requérir encore moins de main d’œuvre tout en atteignant des niveaux de productivité toujours plus élevés.
Dans les années 1990 et 2000, l’industrie chimique évolue fort peu en comparaison avec d’autres secteurs comme l’électronique, la télécommunication et les biotechnologies. Si elle ne produit pas d’autres molécules toxiques pour suivre sa quête de devenir « verte », la chimie va jouer un rôle toujours plus croissant dans l’essor de l’industrie électronique et technologique qu’elle fournit en gaz industriels, en acides, en solvants, … [22] En même temps, la position mondiale historique de l’industrie chimique européenne et étasunienne est éclipsée par la fulgurante ascension de la filière chimique en Chine, accouplée à la production de biens de consommation, de l’agro-industrie et de l’électronique. Si leurs profits n’ont cessé d’augmenter, les entreprises européennes voient leur part sur le marché mondial se diviser par deux en deux décennies [23]. Secteur énergivore, les prix élevés d’électricité et de gaz influencent négativement la compétitivité de la chimie européenne. Mais en contrepartie d’une régulation accrue, les États français, allemand et anglais stimulent l’augmentation des capacités de production par le biais de réductions d’impôts, de subventions, de plans d’aide. Fortement entremêlé avec l’industrie de défense et considéré comme un secteur stratégique, les États font tout pour éviter un démantèlement ou une délocalisation de leurs fleurons chimiques.
La structure actuelle de l’industrie chimique
Avant de nous pencher sur les restructurations et transformations en cours dans l’industrie chimique dans le cadre de la « transition verte », nous interrompons le récit historique pour rapidement esquisser la structure de la filière. Elle est traditionnellement divisée en trois branches principales.
La première branche, la chimie de base ou la « chimie lourde », concerne la production à partir de matières premières facilement accessibles, de produits de grand volume mais à faible prix de vente (matières plastiques et caoutchouc), en peu d›étapes de réaction, dans des installations de grande capacité mobilisant des capitaux importants. Cette chimie est composée de deux sous-secteurs : la chimie minérale et la chimie organique. La chimie minérale produit, à partir d’eau, d’air, de sel, de soufre et de phosphates, des produits tels que les gaz industriels, les colorants et pigments ou d’autres produits chimiques inorganiques de base tels que le chlore, les produits azotés et l’engrais. Le deuxième sous-secteur, la chimie organique, fabrique essentiellement à partir de pétrole (mais aussi de charbon, de gaz, de colza, de maïs, de graisses animalières), les « grands intermédiaires de la chimie » qui sont ensuite utilisés comme matières premières par de nombreuses industries de la chimie à son aval : cosmétique, électronique, aéronautique, biotechnologique…Outre l’éthylène et le propylène, les « grands intermédiaires » sont notamment le butadiène, le benzène, l’éthanol, l’acétone. Ce secteur comprend aussi la production de matières plastiques (polyéthylène, polypropylène) destinées aux industries.
La deuxième branche, la chimie dite « de spécialité », fabrique à partir des matières premières de la chimie de base des produits possédant des propriétés bien définies pour un usage spécifique : polymères de spécialité, peintures et vernis, explosifs, colles, huiles essentielles, produits phytosanitaires, encres d’imprimerie, additifs pour ciments ou béton, savons et détergents, produits cosmétiques… Le savoir-faire de cette industrie repose notamment sur la maîtrise de la formulation, c’est-à-dire le mélange et le dosage des matières premières de la chimie de base. Ces produits sont destinés à un large éventail de secteurs d’activité : construction automobile ou aéronautique, construction, agriculture, …
Enfin, la troisième branche est celle de la « chimie fine » qui produit à partir des produits de la chimie de base (grands intermédiaires), mais aussi d’extraits animaux ou végétaux, de molécules plus complexes à forte valeur ajoutée pour les industries pharmaceutique ou cosmétique. Les molécules élaborées au terme d›un processus de recherche et développement intense sont complexes et leur production nécessite de nombreuses étapes de réactions chimiques. Les volumes de production sont plus restreints que ceux de la chimie de base et les produits élaborés peuvent être très coûteux comme par exemple les principes actifs des médicaments.
Au cours de son développement, l’industrie chimique en Europe s’est généralement implantée le long de fleuves, près de ports ou avec un accès autoroutier et ferroviaire. Le cœur de la filière est constitué par les plateformes chimiques ou parcs chimiques. Il s’agit de grandes structures de production mutualisées qui peuvent héberger des dizaines, voire de centaines d’entreprises. L’Allemagne, plus grand producteur chimique en Europe en compte 25, suivi de près par la France avec ses 18 plateformes chimiques aux caractéristiques variées, mais toutes situées dans la « chimie lourde ». Suivant la stratégie de structuration économique par « clusters » de l’Union Européenne, en Hexagone, les entreprises chimiques sont presque toutes regroupées au sein de la cinquantaine de « pôles de compétitivité » de la chimie, réunissant grandes, moyennes et petites entreprises [24]. Certains pôles collent plus à la filière chimique, mais l’idée de base des « clusters » est la transversalité entre secteurs. Ainsi, en Auvergne-Rhône-Alpes, le pôle Axelera est dédié à la transition « éco-durable » de la chimie et la fabrication de molécules pour l’industrie technologique. Le pôle Polymeris est dédié aux caoutchoucs, plastiques et composites et fédère des entreprises implantées dans six régions. Euramaterials en Hauts-de-France regroupe 112 entreprises impliquées dans la fabrication de matériaux pour « l’industrie du futur ». Enfin, la filière chimique se structure aussi géographiquement, non seulement avec les plateformes, mais aussi par zones et technopôles comme la Cosmetics Valley (Chartres), le Plastics Vallée (Ain), le MAUD (Hauts-de-France),…
Les plateformes et les technopôles sont reliés à des hubs de transport multimodal. Les produits chimiques sont transportés par la route (camion-citerne), par train de marchandises et par navire (canaux, fleuves et mers). En plus des oléoducs et des gazoducs pour le transport de pétrole et de gaz, il existe également une importante infrastructure de pipelines transportant des matières chimiques tel que le propylène, l’éthylène, le chlore, le chlorure de vinyle, ... [25] A la dangerosité souvent invisible de la contamination des milieux non seulement autour des sites chimiques, mais littéralement partout, s’ajoute donc un vaste panorama de structures visibles, allant des plus évidentes comme les plateformes chimiques avec leurs tuyauteries, leur cheminées menaçantes et leur cuves ; aux convois ferroviaires de produits toxiques ; aux canalisations enterrées ; aux camions circulants sur les routes. Tout cela est réglementé par des plans de sécurité, des plans de prévention du risque, des normes de sécurité pour le stockage, etc. Mais comme le démontrent les nombreux incidents, fuites et contaminations, aucun règlement ne peut éliminer la dangerosité intrinsèque nichée au cœur de la chimie industrielle.
Le règne de l’artificiel
Important moteur du bond en avant industriel impulsé par les deux guerres mondiales, l’industrie chimique, malgré une tendance générale vers des baisses de recette dans la dernière décennie, restera, avec le secteur énergétique, la colonne vertébrale matérielle de la société techno-industrielle. Depuis longtemps, l’industrialisme n’est pas seulement le règne de la machine, augmentant les capacités de transformation des matières premières arrachées à la nature pour produire des marchandises. Très rapidement, la société industrielle ne pouvait plus se satisfaire du pillage sans mesure de la nature et a avancé vers la création de nouveaux matériaux grâce aux procédés chimiques. Son œuvre d’artificialisation ne se limite pas au rasage des forêts, la construction d’autoroutes, l’industrialisation des sols par l’agroindustrie, l’urbanisation : il façonne aussi un monde de plus en plus artificiel. Aujourd’hui, avec le triomphe des technologies numériques, cette artificialisation du monde palpable avance de pair avec la virtualisation. Au fur et à mesure que la dévastation de la nature et la dissémination des molécules artificielles avance, l’éloignement de la terre semble de plus en plus irréversible.
Et cet éloignement a un coût terrible. Les molécules synthétiques sont invariablement toxiques pour les organismes vivants : seules les échelles varient. Chez les humains et les autres animaux, cette toxicité provoque toute une panoplie de « maladies industrielles ». L’explosion des cancers, des maladies neuro-dégénératives, des maladies cardiovasculaires et respiratoires ou encore la chute de la fertilité et de la fécondité est directement proportionnel à la pollution et la dissémination des produits chimiques. Plus spécifiquement liés aux substances chimiques, les effets des perturbateurs endocriniens restent encore largement inconnus. Ces perturbateurs, d’origine « naturelle » mais surtout d’origine synthétique, interfèrent avec le système hormonal des organismes en imitant l’action d’une hormone naturelle, en se fixant sur les récepteurs d’hormones naturelles ou en bloquant le mécanisme de production ou de régulation des hormones et des récepteurs. C’est par exemple le cas pour la famille chimique des phtalates (plastiques), des alkylphénols (détergents, peintures et plastiques), des parabènes (produits cosmétiques), des ignifuges bromés (produits électroniques, matelas), des composés perflurorés (poêles antiadhésives, emballages, batteries), chaque État en reconnaissant certaines et d’autres non en fonction des scandales, des études financés et des intérêts économiques [26].
Mais avec l’accélération et l’approfondissent de la « crise écologique », des approches très sectorielles des nuisances commencent à perdre leur sens. Si tout est lié et que nous n’avons même pas les capacités de comprendre les liens (même pas à coup de Big Data et d’Intelligence Artificielle), détailler les toxicités qui seraient spécifiques à l’industrie chimique perd rapidement son sens. Les interactions sont trop nombreuses : comment en effet analyser les perturbateurs endocriniens sans y inclure la contamination radioactive à laquelle les tissus cellulaires sont exposés depuis l’essor de l’industrie nucléaire ? De plus, beaucoup de phénomènes pourraient être perçu comme des réponses (ou des rétroactions, pour celles et ceux qui préfèrent rester plus proche du langage scientifique) de la nature [27] à la dévastation causée par la société techno-industrielle. La pollution de l’atmosphère et l’émission des gaz à effet de serre est en train de provoquer un rapide changement climatique. La dissémination des molécules synthétiques génère à son tour une réponse sous forme de maladies et d’extinction. Il s’agit de développer une appréhension et une perspective globale qui dépasse les approches trop sectorielles. Si cela constitue un défi relevé depuis longtemps par l’écologie radicale, il s’agit de l’insérer aussi dans les méthodes de lutte et nos conceptions du combat contre la société techno-industrielle. Car nos luttes peinent à s’insérer dans le plus-que-humain et baignent dans la myopie du suprématisme humain. Elles continuent généralement à considérer les phénomènes naturels, les conditions écologiques, les actions d’animaux, comme « extérieurs » aux combats en cours. Comme si les vents ne pouvaient pas abattre des pylônes, des ratons-laveurs ronger des câbles, des sécheresses chasser des agro-industriels, des pluies favoriser des sabotages en cette époque de surveillance par drones… De même, contrairement à une métropole en béton, la forêt favorise les petites communautés non-centralisées, le désert et la steppe favorisent le nomadisme plutôt que la concentration étatique… En gros, il s’agirait de relier nos élans, nos idées et nos désirs avec la nature, d’en faire des présences reliées à la terre. Dans de nombreuses résistances autochtones, le combat est intrinsèquement relié au « territoire », à la nature (au sens le plus ample) dans laquelle elles s’enracinent et qui les inspire.
La chimie au cœur de la transition énergétique et de la réindustrialisation
L’industrie chimique est réputée être devenu un secteur qui réagit aux nouveautés plutôt que de les anticiper et de les produire. La percée des nouvelles technologies et des innovations de « disruption » au tournant du siècle prennent l’industrie de court. Certes, elle va adapter ses capacités de production pour répondre notamment aux besoins de nouveaux matériaux et d’intrants chimiques de l’industrie électronique en pleine expansion. Certes, elle va continuer à diversifier sa production à destination de l’agro-industrie pour contourner la réglementation croissante et se greffer aux développements sur le terrain de la biologie moléculaire et des biotechnologies plus généralement. Certes, elle va s’impliquer dans les nanotechnologies aux potentiels mirifiques. Mais généralement, elle est à la traîne : les chiffres d’affaires sont élevés à cause de la taille du secteur, pas à cause d’une productivité croissante ou d’innovations particulièrement lucratives.
A l’instar d’autres industries lourdes (tel que la sidérurgie, l’exploitation minière et le secteur énergétique) et devant une réalité économique et géopolitique qui s’assombrit par le changement climatique et le pessimisme qu’il engendre, c’est le programme de renouveau industriel connu sous le nom de « transition » (énergétique, technologique, écologique,…) qui va insuffler une nouvelle dynamique. En même temps, les majors de l’exploitation pétrolière et gazière multiplient leurs investissements dans les énergies renouvelables et anticipent la production croissante de polymères et d’engrais pour combler un hypothétique recul des ventes d’hydrocarbures destinés aux moteurs. Partout dans le monde, de nouveaux complexes pétrochimiques sont en construction, comme le pharaonique Amiral (Aramco-TotalEnergies) en Arabie-saoudite.
Du côté de la chimie lourde, le renouveau industriel s’accompagne de subventions et d’interventions massives de l’État pour accompagner l’industrie à se décarboner et davantage s’électrifier. Le secteur est un des plus énergivores de l’économie et fortement émetteur de gaz à effet de serre. La stratégie européenne de décarbonation de la chimie repose sur le nucléaire et l’hydrogène. Cela ouvre une fenêtre pour redorer le blason mortifère de la chimie, faisant l’objet d’un important rejet au sein de la société qui repose pourtant sur sa production, pour la présenter comme clean and green. Les besoins en électricité sont donc prévus d’exploser. Le président du Conseil Européen de l’Industrie Chimique (CEFIC) résume : « Les coûts énergétiques sont le talon d’Achille de l’industrie chimique européenne ». S’il pose le problème comme s’il s’agissait d’une question bêtement commerciale, il s’agit bien sûr d’un problème d’infrastructure et de capacité : toute croissance industrielle dépend de l’énergie. C’est très marqué dans un secteur énergivore comme l’industrie chimique. La feuille de route de la transition de l’industrie chimique [28] prévoit ainsi à l’horizon de 2030 des besoins annuels en « électricité bas-carbone » (lire : nucléaire, éolien ou photovoltaïque) de près de 15 térawattheure supplémentaire [29]. Aujourd’hui sa consommation est estimée à 23. Pour 2050, la feuille de route prévoit même une augmentation de 35 térawattheure supplémentaire par an. Ces chiffres donnent une idée de l’importance de la croissance que les scénaristes économiques et les planificateurs étatiques continuent à prévoir et à projeter dans un monde en plein naufrage. Pourtant, l’« insécurité » et l’« instabilité » ne sont pas absentes dans ces projections et plans : qu’il s’agissent des perturbations de l’approvisionnement à cause de tensions géopolitiques, de guerres et de conditions climatiques radicalement changées (poussant vers la « réindustrialisation » et une « recolonisation » des territoires-ressources) ou des pénuries d’eau (essentielle à la production chimique), l’instabilité est présentée comme une raison supplémentaire pour investir, élargir, accroître, « augmenter la résilience », voire une opportunité pour augmenter les bénéfices.
Le programme ambitieux d’électrification de l’économie dans l’Union Européenne repose notamment sur le développement de la filière de l’hydrogène [30]. L’industrie chimique, qui produit aujourd’hui de l’hydrogène à partir de gaz naturel à destination de la pétrochimie, d’entreprises chimiques et de l’industrie technologique, est appelée à jouer un rôle de premier plan dans la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. Pour développer la filière, non seulement des infrastructures de production et un accès à d’importantes quantités d’électricité sont nécessaires, mais il y a aussi urgence à développer les infrastructures de distribution et de transport (par hydrogénoducs notamment) dont va dépendre la viabilité du programme européenne.
La croissance et le développement de l’industrie technologique, qu’il s’agisse de l’électronique, du numérique, de la mobilité électrique ou des énergies, entraîne les autres secteurs. Pour répondre à ses besoins croissants en métaux, de nouveaux projets miniers sont lancés partout dans le monde et la relance minière en Europe se concrétise de plus en plus [31]. De même, une demande croissante de molécules de synthèse est anticipée au sein de la filière chimique. Pour y répondre, non seulement les capacités de production (la plupart du temps en surcapacité) au sein des plateformes sont maintenues et même augmentées, mais également un nouveau secteur (de nouveau, fortement subventionnée) est en train de voir le jour pour recycler des polymères de plastique ou récupérer par procédé chimique des métaux précieux des déchets.
D’importants projets sont aussi en cours dans la dite « chimie biosourcée », qui prend comme matière de départ des matériaux organiques telles que les résidus agricoles, des algues ou des bactéries. Les partisans du secteur sont si enthousiastes qu’ils n’hésitent pas à lancer des prophéties sur le remplacement pur en simple du pétrole et du gaz dans la production de toutes les substances chimiques. Cependant, le problème reste similaire : la matière végétale, the « feedstock » comme on l’appelle dans le jargon de l’industrie, la matière d’où part la chimie biosourcée pour produire des substances intermédiaires et des produits finis, n’est pas inépuisable. Son exploitation et extraction n’est évidemment pas « verte » et est en train de se traduire par la multiplication de champs industriels pour cultiver des plantes destinées à cette nouvelle branche de la chimie (pour produire des biocarburants et des bioplastiques, par exemple, le préfixe « bio » n’ayant rien à voir avec biologique, mais uniquement avec la matière d’origine : de la flore).
En 2019, les industriels européens lançaient un appel à l’Union Européenne pour replacer l’industrie chimique au cœur de la transition [32]. Ils y vantaient les compétences de l’industrie chimique pour contribuer à l’objectif de la neutralité carbone de l’économie [33], leur rôle incontournable dans l’approvisionnement en matières de base pour l’industrie (des matériaux d’isolation aux composites pour les pales des éoliennes, des batteries électriques au captage de CO²) et son engagement vers une « chimie respectueuse ». Comme dans les autres secteurs industriels qui se vantent tous de leur capacité à devenir « verts » et à créer de la valeur dans un cadre de régulations écologiques [34], les chimères d’une « chimie verte » servent surtout à masquer la pérennité de cette branche mortifère sur laquelle repose le progrès techno-industriel.
Comme fournisseur des briques essentielles de toute industrie, la chimie, avec ses molécules toxiques, ses pollutions et ses plateformes ne disparaîtra pas avec la transition. Bien au contraire, sa place est plus qu’assurée au sein du Titanic techno-industriel.
[1] Cette famille de substances d’origine anthropique comprend plus de 4000 molécules différentes et est originellement issue de la synthèse du polytétrafluoroéthylène (PTFE) en 1938, que l’entreprise chimique étasunienne DuPont a commercialisé en 1945 sous le nom de Téflon. Le polymère trouvera sa première utilisation sur le terrain militaire dans le cadre du projet Manhattan, nom de code du programme de recherche qui déboucha sur la première bombe atomique. Seuls des joints d’étanchéité réalisés dans ce nouveau polymère se montraient en effet capables de résister aux acides très corrosifs qui se formaient lors de la production d’uranium U-235.
[2] Depuis 1907, le Chemical Abstracts Service liste les substances synthétisées, chacune identifiée par un numéro d’enregistrement. Depuis quelques années, l’institution rajoute quotidiennement en moyenne 15 000 substances nouvelles.
[3] C’est une définition approximative qui pourrait induire en erreur. S’il est vrai par exemple qu’on peut observer de la chaux dans la nature – mais dans des conditions rares et exceptionnelles, comme sur les flancs des formations volcaniques – elle est fabriquée par calcination de calcaire pour être employée dans la construction. La plus ancienne utilisation de chaux par l’humain a été découverte dans le désert du Sinaï : elle est datée à 16 000 Av. J-C. Pour garder une définition qui fait sens, mieux vaut garder en tête une des molécules les plus utilisées dans la chimie industrielle : l’acide sulfurique. Elle n’existe pas dans la nature, c’est un pur produit synthétique.
[4] En 1918, Fritz Haber reçoit le prix Nobel pour les travaux sur la synthèse de l’ammoniac, important pour la fabrication d’engrais et d’explosifs.
[5] L’usine de Saint-Auban (Arkema) est un producteur majeur de solvant chloré trichloroéthane en Europe. Ce solvant permet de fabriquer des gaz fluorés, des hydrofluorocarbures et des polymères fluorés. On y retrouve également Kem One spécialisé dans la production d’émulsion PVC et Méta-Régéneration, spécialisé dans le recyclage et le traitement de déchets mercuriels.
[6] Rachel Knaebel, Première Guerre mondiale : va-t-on commémorer les exploits de l’industrie chimique ?, publié sur Basta !, 3 septembre 2014.
[7] Le 21 septembre 2001, ces mêmes usines, connues entre-temps comme AZF et exploitées par le conglomérat TotalFinaElf, furent rasées par l’explosion d’un stock de 300 tonnes de nitrate d’ammonium. La catastrophe fit 31 morts, 2500 blessés et de lourds dégâts matériels dans le quartier voisin. Des milliers de personnes souffrent toujours de séquelles physiques comme de l’hyperacousie. Le Centre de Recherche sur l’Action Sociale (CRAS) à Toulouse dispose d’un vaste archive de documents, tracts, affiches et publications de l’époque concernant cette catastrophe industrielle. On peut consulter les indices du catalogue sur leur site (cras31.info).
[8] Un polymère est une substance composée de molécules caractérisées par la répétition, un grand nombre de fois, d’un ou de plusieurs atomes ou groupes d’atomes (macro-molécules). Quand il s’agit de substances naturelles, on emploie généralement le terme « fibres » (bois, protéines, collagène, latex naturel). Parmi les matières synthétiques, les polymères les plus utilisées dans l’industrie sont les plastiques, les colles et les résines.
[9] Ses concurrents principaux, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, ne comptaient que pour 15% de l’industrie chacun. Voir Raymond G. Stokes, La reconstruction de l’industrie chimique européenne, 1998.
[10] Avec des différences notables, mais une même rigidité étatique dans la gestion économique. On pourrait argumenter que toutes les économies vont connaître une ligne assez similaire à celle corporatiste du Troisième Reich. Pour tenir aussi longtemps, l’économie nazie a aussi fait largement usage d’esclaves, de travail forcé et de pillage.
[11] La production d’essence synthétique aurait satisfait près d’un tiers des besoins nazis.
[12] Dans ses mémoires, Albert Speer, ministre de l’Armement et de la production de guerre de 1942 jusqu’en 1945, s’étonne du fait que les Alliés n’ont pas concentré leur bombardements sur quelques usines précises comme les usines de roulements et les usines chimiques de lubrifiants. Selon lui, la destruction de ces usines aurait considérablement accéléré la chute du Troisième Reich.
[13] Voir Faites vos jeux ! dans Avis de Tempêtes, bulletin anarchiste pour la guerre sociale, n°21, septembre 2019, ainsi que Chimères agrochimiques dans le n°41, 15 mai 2021.
[14] Aujourd’hui, le Couloir de la Chimie s’étend sur 25 km le long du Rhône, du port Edouard-Hérriot à Loire-sur-Rhône. Plus au sud, on retrouve la plate-forme chimique Les-Roches-Roussillon, construite en 1915 pour produire du phénol et des gaz de combat. Elle est aujourd’hui une des plus importantes plateformes chimiques de France.
[15] Depuis les années 1970 jusqu’à aujourd’hui, des usines chimiques aux infrastructures monstrueusement grandes fonctionnent en réalité avec un nombre restreint d’ouvriers, de techniciens et d’ingénieurs, dépassant rarement des effectifs de plus de 100 employés.
[16] 5 février 1980, 8h15 du matin. Paolo Paoletti, dirigeant industriel de l’ICMESA à Seveso, est en train d’ouvrir le portail devant sa maison à Modena quand soudainement une personne armée bondit devant lui. Trois balles, Paoletti s’écroule au trottoir. L’assassinat est revendiqué par l’organisation armée d’extrême gauche Prima Linea comme riposte à la catastrophe de Seveso dans le cadre de sa campagne contre la pollution et pour la santé des prolétaires.
[17] Voir, pour le territoire français, les deux brochures Actions directes contre le nucléaire (1973-1996), en grande partie extraite du livre Golfech Le nucléaire : implantation et résistances, éditions du CRAS (Toulouse), 1999.
[18] Souvent, la molécule est à peine différente de celle interdite. C’est le cas de la plupart des pesticides. D’ailleurs, en cas d’interdiction par un État, les industriels peuvent continuer à le produire pour l’exporter ailleurs. Les industries chimiques (BASF, Corteva, Syngenta) en France ont exporté (notamment vers le Brésil, l’Ukraine, la Russie et l’Inde) en 2023 au moins 7300 tonnes de pesticides interdits en Europe, soit 10% de leur production annuelle. La France est parmi les cinq premiers pays exportateurs de pesticides (au coude-à-coude avec l’Allemagne, l’Inde et les États-Unis, derrière la Chine). Les usines principales en France se situent à Genay (BASF, Rhône), Gravelines (BASF, Hauts-de-France), Saint-Aubin-lès-Elbeuf (BASF, Seine-Maritime), Drusenheim (Corteva, Bas-Rhin) et Aigues-Vivues (Syngenta, Gard).
[19] Dont la catastrophe de Bhopal en Inde (1984), l’incendie de l’usine chimique Sandoz en Suisse (1986) ou l’explosion de l’usine chimique de Pasadena aux États-Unis (1989) sont peut-être les plus marquantes.
[20] En France, pour préserver sa base industrielle face au déclin des profits et éviter un morcellement jugé inopportun, l’État nationalise l’entièreté de l’industrie chimique et pétrochimique dans les années 1980, avant de la privatiser à nouveau aux « débuts » de la mondialisation néolibérale, après l’effondrement du bloc de l’Est.
[21] Bien que le secteur pharmaceutique soit à placer dans la filière de la chimie, nous l’avons volontairement laissé en dehors de l’analyse exposée dans ce texte. Les questions que soulève cette branche de l’industrie sont fortement liées à la conception du vivant, de la maladie, aux structures sociales et au patriarcat, qui méritent un développement approfondi à part entière.
[22] La production de semi-conducteurs nécessite par exemple de très nombreux produits chimiques : le trichloroéthylène, l’acétone, l’isopropanol, l’éthanol dénaturé, l’acide sulfurique, nitrique, orthophosphorique, chlorhydrique, bromhydrique, le peroxyde d’hydrogène, l’hydroxyde d’ammonium, l’hydroxyde de sodium et l’hydroxyde de potassium, le fluorure d’ammonium, l’hexafluorure de tungstène, l’arsine, le trifluorure de nitrogène ou encore des composés métalliques tels que le sulfate de cuivre, l’oxyde d’aluminium, l’oxyde de titane...
[23] En 2011, la part de marché de l’industrie chimique européenne est tombée de 36% (en 1991) à 20%. Ses ventes totalisaient alors 539 milliards d’euros, en deuxième derrière la Chine. Voir le rapport produit par Oxford Economics à la demande du Conseil Européen de l’Industrie Chimique (CEFIC), Evolution of Competitiveness in the European Chemical Industry, octobre 2014 et CEFIC Publications, Facts & Figures 2012 : The European Chemicals Industry, août 2013.
[24] La filière chimique française compte près de 3300 entreprises, employant 219 000 personnes. Elle emploie aussi plus de 20 000 chercheurs. C’est la première industrie exportatrice de France en termes de chiffre d’affaires, devant l’industrie agroalimentaire et l’industrie de l’armement.
[25] Les conduits de ces canalisations ont un diamètre entre 8 et 120 centimètres, fonctionnent à des pressions importantes (jusqu’à 94 bars) et sont, la plupart du temps, enfouies à au moins 80 centimètres de profondeur. Leur présence est indiquée en surface par des bornes spécifiques (rouge pour les hydrocarbures, jaune pour le gaz, blanche ou orange pour les produits chimiques). La France compte 4000 kilomètres de canalisations pour les produits chimiques.
[26] Certaines molécules synthétiques sont fabriquées avec le but explicite de perturber ou influencer le système hormonal, telle que la pilule contraceptive, les bloqueurs de puberté, le traitement hormonal de la ménopause ou de l’infertilité masculine, les hormones de croissance, l’hormonothérapie contre le cancer, la thérapie hormonale substitutive...
[27] En le traduisant dans le jargon scientifique : au sens de l’hypothèse Gaïa, de plus en plus acceptée par les scientifiques, au fur et à mesure que le changement climatique s’accélère, il rend de plus en plus difficile de ne pas considérer tous les phénomènes naturels et toute la vie sur la planète liés comme s’il s’agissait d’un seul organisme vivant.
[28] Feuille de route pour la décarbonation de la chimie en France, éditée par la Direction Générale des Entreprises en juin 2023. Il s’agit d’une déclinaison au niveau national de la stratégie européenne exposée dans le rapport Transition Pathway for the Chemical Industry par la Commission Européenne en janvier 2023.
[29] Pour comparer : en 2018, la consommation d’électricité de la ville de Paris s’élevait à 30,8 térawattheure
[30] Voir Hydrogène : le cheval de Troie de la transition énergétique, dans Takakia n°1, 2024.
[31] Notamment en Scandinavie, mais aussi en Pologne, en France, au Portugal, en Serbie, ...
[32] CEFIC, Molecular Managers : A journey into the future of Europe with the European Chemical Industry, 2019.
[33] Un des objectifs de ce qui commence à être connu comme le Green Deal européen : le vaste renouveau industriel de l’économie européen face au changement climatique, aux tensions géopolitiques et aux innovations technologiques.
[34] Voir la Déclaration d’Anvers, appel lancé lors du European Industry Summit à Anvers (Belgique) en février 2024 et auxquel ont souscrit de nombreux industriels en Europe. La déclaration plaide pour des investissements massifs dans l’infrastructure industrielle (ferroviaire, portuaire et logistique), les productions énergétiques (nucléaires et renouvelables), le lancement de projets miniers en Europe et une stratégie offensive pour assurer l’approvisionnement en matières critiques, ... bref, une déclaration de guerre industrielle.
Texte originellement publié dans la revue Takakia, brame de combat contre le Mordor industriel, #3 (automne-hiver 2024).
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.5 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.5 Mio)