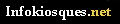Brochures
Abolir la contention
mis en ligne le 1er septembre 2025 - abolirlacontention
Récit d’une journée sur l’entrave en psychiatrie
Le 8 Juin 2024, nous avons organisé à la Friche Lamartine à Lyon une rencontre autour de l’abolition de la contention en milieu psychiatrique et hospitalier. Cette journée a réuni une quarantaine de personnes, venues d’horizons différents : soignant..es, patient..es, pairs aidant..es, militant..es, proches de patient..es, psychothérapeutes, infirmier..es, travailleur..euses sociaux.... La parution du livre Abolir la contention et la présence de son auteur Mathieu Belhassen ont motivé cette rencontre. L’enjeu de cette journée était d’ouvrir un espace de parole public sur ces thématiques souvent tenues à l’écart des débats et des luttes politiques. Sortir du silence contribue à la lutte contre les violences systémiques et institutionnelles, dont la pratique de la contention dans le champs du soin fait partie.
Cette journée a été riche en échanges. La qualité d’écoute et d’accueil y était forte et précieuse. Plusieurs participant..es nous ont fait part de l’importance pour ell..eux de parler publiquement de la contention et de s’inscrire dans la perspective d’une mobilisation contre ces formes de maltraitance. Avec cette brochure nous souhaitons informer, alerter et laisser une trace de ces moments pour, nous l’espérons, en garder la force. Nous avons appris, notamment des luttes anti-carcérales, que de faire sortir l’intolérable hors des murs de l’institution est un geste puissant. Cette brochure espère y contribuer.
Vous ne trouverez pas dans ce texte une retranscription exacte des paroles prononcées. Passer de l’oral à l’écrit, en préservant l’ambiance des rencontres et la puissance des paroles, a impliqué quelques coupes et remaniements. En naviguant entre narration de la journée, présentation du livre par Mathieu Belhasen et témoignages, nous esperons vous transmettre l’essentiel de ces rencontres.
En attendant que cette brochure ne soit plus qu’un souvenir de pratiques psychiatriques disparues, nous vous souhaitons une bonne lecture et des solidarités émancipatrices.
Le collectif d’organisation
Pour planter le décor
L’association La Friche Lamartine est un collectif artistique multidisciplinaire. Elle regroupe trois lieux d’expérimentation et de création artistique autogérés, dont fait partie La Friche du 7. Cet espace situé au sud de Lyon, dans un quartier qu’on nommait autrefois "ouvrier", est un ancien atelier de réparation de péniches et de formation à ce métier. Nous trouvions important d’être dans un lieu qui ne soit pas trop marqué du côté militant et encore moins du côté de l’institution hospitalière. La Friche du 7 nous semblait le bon espace : du fait de son histoire dans le mouvement squat (c’est un des rejetons de la mythique Friche RVI) et de son souci à faire se rencontrer des milieux différents.
En fin de matinée, une amie de la Friche nous a ouvert les portes de ce lieu et nous a fait visiter. Une grande salle nous a accueilli..es durant les temps d’échange et des repas. Un entrelacs de couloirs nous a conduit vers de petites pièces de créations, que nous avons investi..es pour des échanges en petits groupes l’après-midi : une salle de répétition de musique, avec ses murs feutrés et ses instruments brillants, un bureau vitré, une salle avec une ville miniature en train de sortir de terre, une salle de danse avec son parquet et ses miroirs. une grande salle pour les échanges. Plusieurs chemins pour s’orienter dans la parole.
Après nous être perdu·es dans les couloirs et dans les derniers points d’organisation, l’arrivée des premièr..es participant..es nous a rappelé·es que nous avions un peu trop pris notre temps. Ces arrivées ont été de bons coups de main pour finir d’aménager la grande salle, faire couler le café et chauffer l’eau du thé. Pendant que les contours de l’accueil finissaient de se dessiner, dans la salle de danse, les derniers coussins et fauteuils rejoignaient les enceintes audio, qui allaient diffuser l’adaptation radiophonique du livre Barge.
L’écoute de Barge
Nous, Sissi et Pull, avec des ami..es de l’émission de radio Mayday sur Radio Canut, avons réalisé la mise en son du livre Barge d’Héloïse K. Ce livre raconte ses aventures de jeunesse, faites d’études, d’amours, d’abus, de luttes, de voyages et de séjours à l’hôpital psychiatrique, après des épisodes délirants. Son livre résonnait en nous, par la force du témoignage, par la beauté de la langue et, par les appuis que Hélo nous offrait lors de nos propres traversées de doutes, d’errances, de rencontres face à nos folies personnelles ou familiales. Diffuser la grande lumière présente dans ce petit livre est pour nous un événement important de notre vie radiophonique, psychique et politique.
C’est pour prolonger le geste généreux d’Héloïse que nous avons tenu à organiser des écoutes collectives, là où il y avait l’envie ou la place, chez des gens, dans un bar, au sous-sol d’un squat vide, dans la salle d’un lieu d’accueil pour personnes psychatrisées. Au fil des écoutes, nous avons senti la continuité entre l’écoute radiophonique et l’écoute thérapeutique. Car, au début de nos tournées, l’effet thérapeutique de l’écoute radiophonique n’allait pas de soi. S’y jouaient des résistances quant au partage d’expériences douloureuses, à la prise de risque d’être vulnérable aux yeux des autres. Le dispositif d’écoute, composé de deux grosses enceintes entourant des canapés, a permis de soutenir les corps, les pensées et les échanges. La place laissée au silence a aussi permis l’expression de témoignages et d’analyses marquantes.
Avec des inconnu..es, en famille ou entre ami..es, sur un lieu de travail ou de vie, chacune des diffusions a été touchante et marquée d’éclairs de compréhension au sein de la communauté éphémère formée à l’occasion. C’est pour ces raisons que nous vous invitons, si ça vous parle, à mettre en place des séances de diffusion et d’échange.
Les sons s’écoutent et se téléchargent sur l’audioblog de l’émission Mayday, une émission hebdomadaire de documentaire et de création sonore. Et si vous voulez que l’on vienne animer ce moment ou vous aider à penser le cadre d’écoute, contactez-nous sur barge_leson@@@riseup.net
Ce 8 juin, des échanges ont suivi l’écoute des deux premiers épisodes de Barge
– « J’imagine que l’écoute doit être différente d’une personne à l’autre, non ? Entre une personne qui a vécu des délires, une personne qui soutient ou encore un..e soignant..e, on ne place pas l’écoute au même endroit, on n’ouvre pas le même espace dans lequel le récit d’Héloïse peut se loger. » Simon
– « Je suis psychiatre. Je trouve que ce son, c’est une esthétisation de la folie. Ca ne rend pas compte de la souffrance qu’elle provoque. » René
– « Pour ma part je suis membre d’un Groupe d’Entraide Mutuelle et cette adaptation ne me parait pas si artistique. Elle est plutôt proche de mon vécu. Je crois que j’aime bien me reconnaître dans les mots d’Héloïse et que d’autres personnes puissent entendre ce type de témoignage. » Pierrick
Les échanges et rencontres ont pu se poursuivre autour d’un repas dans la grande salle de la Friche. Les petits groupes, se formant et se déformant constituèrent avec les dernier.e.s arrivé.e.s un grand cercle pour ouvrir la première assemblée.
1ère plénière Etat des lieux de la contention
Le collectif d’organisation : Nous qui avons organisé cet évènement, on n’a pas une pratique commune de la psychiatrie ou de la contention. On se connaît par des liens d’amitié et on a des intérêts pour ces questions, que ce soit par des pratiques professionnelles, pour certain..es d’entre nous, par des ancrages militants ou par des vécus de patient..es, ou de proche de patient..es. Ce qui nous a regroupé..es, c’était la mobilisation pour la défense d’un soin humain. Nous pensons que ces questions de psychiatrie et de santé mentale concernent tout le monde, au-delà des professionnel..les et des patient..es.
En préparant cette journée, on a fait le constat d’un paradoxe actuel. D’une part, il y a beaucoup de nouvelles lois, de mesures ou de pratiques qui mettent les patient..es au centre du parcours de soin, comme par exemple les « directives anticipées » (pour prévoir quoi faire en cas de crise), le savoir expérientiel, la pair-aidance, etc. D’autre part, il y a encore beaucoup de pratiques coercitives, beaucoup de mesures contraignantes ou disciplinaires et beaucoup de discours sécuritaires dans le milieu du soin. C’est une situation qui est grave, qui cause des traumatismes chez les patient·es et qui alimente une culture de l’entrave. Alors, à nos yeux, la question de l’abolition des contentions fait penser à celle de l’abolition des prisons ou de la police. En invitant Mathieu Bellahsen, l’auteur d’Abolir la contention, notre idée est de tenter de nous mobiliser sur cette question de la contention, en prenant appui sur ce que dénonce ce médecin psychiatre pour créer un mouvement débordant.
Mathieu Bellahsen prend la parole et lit un témoignage tiré de son bouquin :
« Au milieu de la nuit, le besoin de boire me réveille. Ma bouche est complètement sèche. J’ai une soif immense. "Détachez moi ! J’ai besoin d’eau !" Aucune réponse. "S’il vous plait ... de l’eau...". Je n’ai jamais eu aussi soif. Je vois le robinet, deux mètres plus loin. Je me sens tellement faible, les traits de mon visage se crispent de peur. personne ne m’entend. Je hurle. "Heeeeeelp ! De l’eau ! Pitié". J’ai cru mourir cette nuit-là. Je hurle, je supplie, il n’y a personne. Et si personne ne venait ? Le manque d’eau est un supplice. J’appelle à l’aide à intervalles contrôlés, pour ne pas m’épuiser totalement, mais être entendue. "Ils m’ont oubliée." Quelle ignonimie de faire endurer cela à un être humain... Quelle ignonimie. Je hurle. "Les humains ! Les humaaaaaains ! Qu’est ce que vous êtes en train de faire ?!" [...] Les infirmiers n’entrent dans une chambre que quand le patient est calme. C’est ce que je comprendrais plus tard. Alors surement, ils ont dû m’entendre. Je suis trop faible pour continuer à crier. J’abandonne. M’échappe de mon corps qui meurt de soif. Fixe les yeux au plafond. Et attends. J’ai eu besoin de pleurer, mais le manque d’eau était tel que j’ai pleuré sans larmes. Expérience traumatisante. La torture a duré une heure, deux heures, peut être quatre ou cinq avant que s’ouvre la porte de la chambre [...]. Je ne suis plus qu’un objet à la merci des blouses blanches, un tube digestif. Mon humanité est niée. [...] Des jours qui suivent, pas de souvenir. La contention, la déshumanisation, l’humiliation, la sensation d’être complètement dépossédée de ses moyens, d’être à la merci d’autres être humains ça a de quoi vous rendre fou. On atteint les limites de ce qu’un psychisme peut endurer de supportable. C’était en 2021. Ca a lieu encore. Mon corps s’était rappelé d’une agression sexuelle dans l’enfance. Et le choc du souvenir remontant m’a fait décompenser. Qu’on m’ait mise sous contention, c’était comme empêcher une nouvelle fois mon corps d’exprimer et d’extérioriser le traumatisme subi, et le traumatiser de nouveau ».
Mathieu B. : Il y a tout dans ce témoignage, je pourrais m’arrêter là. Je vais quand même vous dire un petit mot.
En 2017, il y a toute une palanque de psychiatres du lobby FondaMental, qui sont assez actifs à Lyon d’ailleurs, qui disent dans leurs articles que « la littérature internationale dit que la contention est thérapeutique ». Il n’y a pas de sources, mais voilà, c’est la culture de l’entrave, elle peut faire dire n’importe quoi. FondaMental c’est un thinktank néolibéral, associé à l’institut Montaigne, qui a été créé en 2007 sous Sarkozy. Leur enjeu, c’est de faire comme la fondation Alzheimer : une fondation qui organise tous les soins pour les gens qui ont des maladies mentales. C’est l’objectif aussi de remettre les gens psychiatrisés au travail, dans le monde pourri du néolibéralisme actuel et du travail déglingué.
En fait, nulle part dans la littérature scientifique internationale — si on prend ça comme référence d’un cadre pseudo objectif — il n’est dit que la contention est thérapeutique. En 2016, en France, la contrôleuse général des lieux de privation de liberté le rappelle dans un rapport sur l’isolement et la contention. En réalité, non seulement c’est pas dit que la contention soit thérapeutique, mais en plus, ce qui est sûr, c’est que c’est traumatique. Ça retraumatise des gens qui sont déjà traumatisés et qui décompensent du fait de ces traumatismes. Car le champ du traumatisme et le champ des grandes souffrances existentielles sont des champs qui sont très proches.
Ce livre, que je vous présente aujourd’hui, il arrive dans un certain contexte politique. La contention a fait l’objet de plusieurs procédures de constitutionnalité, c’est-à-dire de contestation d’une loi, sous forme d’un procès, car elle ne respecterait pas les droits et libertés inscrits dans la Constitution française. Le 19 juin 2020, le conseil constitutionnel dit que ce n’est pas normal que l’isolement et la contention ne soient pas encadrés légalement. C’est des degrés extrêmement graves de la privation de liberté, puisque c’est même de la privation de mobilité : on ne peut plus bouger le corps quand on est contentionné. Alors, que fait le gouvernement ? Il passe en douce, dans la loi de finances de la sécurité sociale (loi PLFSS de l’automne 2020), un article sur les pratiques pour encadrer l’isolement et la contention. Pour encadrer une pratique, on passe par une loi de finances : c’est ce qu’on appelle un cavalier législatif. Après, pendant le COVID, c’est la concorde nationale, et la loi passe.
Suite au passage de la loi, il y a quand même des associations de psychiatrisé..es et le barreau de Versailles qui engagent une procédure juridique pour contester la constitutionnalité de cette loi. La loi va être cassée et de nouveau le gouvernement va légiférer à ce sujet. Le 1er janvier 2022, de nouveau le gouvernement passe dans la loi de finance de la sécurité sociale, un article encadrant la contention. Là, ce n’est plus la concorde : des député·es et des sénateur..ices dénoncent le cavalier législatif. Patatrac, ça ne passe pas. Ensuite, le 22 janvier 2022, un petit article, pour encadrer l’isolement et la contention, va passer dans la loi sur le passe vaccinal.
Donc entre le 1er janvier 2022 et le 22 janvier 2022, il n’y a aucune loi encadrant l’isolement et la contention en France, alors que c’était une obligation légale imposée par le conseil constitutionnel. Il y a donc eu un vide juridique. S’il y a des gens qui ont été attaché..es, entravé..es à ces dates-là, i..elles peuvent porter plainte et demander un recours indemnitaire à l’état.
Quand la loi passe à l’Assemblée nationale, Caroline Fiat, aide-soignante et députée La France Insoumise, va dire à Olivier Veran, ministre de la santé (et actuel médecin esthéticien), que si il y avait plus de Centre Médico-Psychiatrique, plus d’accueil, alors il y aurait moins de contention, moins d’isolement, moins de mesures de contraintes légales. Et là ce c*****d de ministre va répondre que ça n’a rien à voir avec un manque de moyens, car quand quelqu’un·e est agité·e il faut quatre à cinq personnes pour lui sauter dessus et, de l’avis des psychiatres, dit le ministre, il y a une dimension thérapeutique dans l’isolement et la contention. Mais en fait, la seule question qui n’est jamais posée c’est : « est-ce que c’est thérapeutique la contention ? Est-ce que c’est un soin ? Et comment on fait pour s’en passer ? ». Voilà, ça c’est la question politique !
Dans mon livre, je me suis centré sur la contention. Le seul lieu où elle est encadrée, c’est dans les secteurs de psychiatrie adulte. Elle n’est pas encadrée en réanimation, ni dans les urgences, les EHPAD, les ambulances ou les foyers de vie. Il y a des vides juridiques. Pour les enfants, elle est encadrée de manière bizarre, parce que quand vous êtes un..e gosse et que vous décompensez, vous n’êtes pas hospitalisé..e à la demande d’un tiers, vous l’êtes sous l’autorité parentale. Un..e enfant n’a pas les mêmes droits que les adultes, notamment le droit de faire appel au contre-pouvoir que peut être le juge des libertés.
Si on parle de chiffres : 2021, c’était 10 000 personnes attachées. D’ailleurs, faut arrêter de dire « contentionné..es » de mon point de vue, faut dire « attaché..es » !
Derrière cette histoire de mots, il y a un grand problème au niveau de l’imaginaire collectif : au fond, qu’est-ce qu’on entend par soin ? Petit rappel : dans la loi de 2011 qui encadre les hospitalisations sous contrainte, celles ci sont appelées « soins sans consentement ». On parle de "soin" sans consentement ! Il y a là un point hyper important : ça n’existe pas les soins sans consentement ! Ça existe des injections ou des prises de médicaments sans consentement, ça existe le fait d’être à l’hôpital sans l’accord de la personne elle-même. Par contre, on ne peut pas dire qu’on soigne sans consentement ou que la contention est thérapeutique. Le "soin", c’est tout faire pour créer de la relation avec les gens. Parfois on a besoin d’outils parce que la relation n’est pas possible avec les soignant..es, avec nous, avec le monde de la personne ou ses proches. Mais de dire que le soin c’est équivalent à la contrainte, c’est un problème. C’est un problème d’imaginaire de soin, de la culture de l’entrave, et un problème d’imaginaire politique. Un problème qui donne en 2021 en France : 90 000 personnes en "soin" sous contrainte, 80 000 hospitalisées par an sans consentement, parmi lesquelles 30 000 en isolement et, encore parmi elles, 10 000 en contention !
Dans le livre, j’aborde ce que j’appelle le système contentionnaire. Ça sonne avec L’univers concentrationnaire de l’essayiste David Rousset, qui parlait des camps nazis en 1946. En fait, je veux dire que le système contentionnaire est fait de plusieurs sangles. La première, elle nous concerne tous..tes en tant que citoyen..nes : c’est l’emmurement du monde, le fait qu’il y a de plus en plus de murs dans le monde, entre les états, entre régions, etc. Ça emmure aussi les relations entre nous tous..tes. L’imaginaire sécuritaire dans la société contamine jusqu’aux soignant..es en psychiatrie. Quand il y a un imaginaire un peu plus émancipateur, on est contaminé..es positivement par cet imaginaire émancipateur. Donc ça c’est la première sangle.
La deuxième sangle, c’est ce que je nomme la sangle cérébrologique. Ici, à Lyon, vous avez le psychiatre Nicolas Franck. C’est un professeur universitaire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Lyon, au Vinatier, qui organise la psychiatrie lyonnaise et qui est très lié à FondaMental et compagnie. C’est pas mon pote. En fait, selon moi, ces gens-là ne font pas de la psychiatrie. Ell..eux, i..elles font de la cérébrologie, c’est-à-dire qu’i..elles ont des discours et des pratiques sur le cerveau. Je critique
pas ça en tant que tel. Je le critique en tant que ça se fait passer pour du soin. Nicolas Franck, dans une émission La Série Documentaire de France Culture, il dit qu’un..e patient·e, quand i..elle décompense, alors i..elle reste maximum trois semaines à l’hôpital. Si la..e patient·e a des problèmes sociaux ou qu’i..elle est à la rue, c’est pas le souci de l’hôpital. On l’envoie à l’assistant·e social·e. I..Elles vont mettre les médicaments, dire qu’i..elles vont s’intéresser au·à la patient·e et à ses habilités sociales. Mais en fait, son emmerdement dans le milieu où i..elle vit, on n’en parle pas. Au contraire, je définis la psychiatrie comme le iatros de la psyché, c’est-à-dire, en grec ancien, l’activité de soin de la psyché. C’est prendre soin de nos emmerdes existentielles quoi.
Et on en est encore loin ! Prenez Philippe Pinel : c’est celui qui a, dans le mythe de la psychiatrie française, libéré des chaînes les aliéné·es à l’hôpital de la Salpêtrière et à Bicètre, à Paris. Maintenant, il y a une marque de sangles de contention qui s’appelle Pinel. Il y a du marketing, des communicant·es de m***e qui se disent « tiens on va appeler une marque de sangles Pinel ». Là aussi on voit l’imaginaire. Je vais vous lire la phrase sur leur site internet : « Le concept Pinel permet de satisfaire au besoin de contention de tout niveau avec un seul système. Dans la contention d’urgence, le patient agressif peut être immobilisé en 7 points, en moins de 10 secondes. Les patients plus passifs peuvent être maintenus au lit ou au fauteuil tout en conservant une mobilité et peuvent ne pas se rendre compte qu’ils sont sous contention. Ce système s’adapte à tous les types de besoins de contention des institutions ». La « contention des institutions », voyez comme ces communicant·es ont aboli l’inconscient ! I..Elles ne s’entendent pas parler ! Donc « tout type de besoin de contention des institutions : soin prolongé, urgences, psychiatrie, soins intensifs, etc. ». Il y a une création d’imaginaire, un renversement pervers des mots, des pratiques, de l’histoire.
Dans la seconde partie du bouquin, je témoigne du fait que nous ne sommes jamais seul..e quand on attache un·e patient·e, ça se fait toujours en groupe, en collectif de soin. Je raconte un certain nombre d’histoires très concrètes vécues avec les personnes qui étaient hospitalisées dans le service où je travaillais, sur comment on faisait sans contention. Nous, par exemple, on n’avait pas de sangles, tout comme 15 % des lieux de soin en France d’ailleurs, où il n’y a pas de contention, ou très peu. Pour 85 % des lieux, il y en a beaucoup, voire tout le temps. La culture de l’entrave fait que c’est au 15 % qui n’attachent pas de se légitimer auprès des 85 % qui attachent.
On entend « Vous n’attachez pas parce que vous sélectionnez vos patient..es, parce que vous n’avez pas les même patient..es que les autres, parce qu’i..elles ne sont pas aussi précaires ». Tout ça c’est du blabla. Hier j’étais à Marseille et à l’hôpital de Valvert i..elles n’ont pas de contention, i..elles sont même en train de travailler à ce qu’il n’y ait plus de chambre d’isolement. I..Elles interviennent dans les quartiers nord, on peut pas dire que les quartiers nord de Marseille c’est tranquille ! À la fin des années 1950, dans un hôpital psychiatrique parisien du 13ème arrondissement (ASM13), le médecin Philippe Paumelle a dit qu’il n’y aurait pas de contention, et jusqu’à maintenant ça n’a pas varié. Dans tous les autres secteurs de psychiatrie à Paris on attache, pas à l’ASM13.
Utiliser ou non la contention, c’est pas non plus un problème de moyen financier, comme c’est souvent dit. Les syndicats notamment ont souvent cet argument-là. L’argument financier est réel, mais il ne suffit pas, parce qu’on attache même quand on a pas de problème de fric ou de personnel. C’est un problème d’imaginaire.
Dans la dernière partie du bouquin, je fais des propositions très concrètes en partant d’expériences existantes, dont on entend peu parler en France. Le conseil de l’Europe a fait un tour d’Europe (pas que l’Union Européenne) des pratiques alternatives aux mesures de contrainte. Je rajoute au passage que, dans mon livre, je me suis centré sur la contention, la contrainte physique. Je n’ai pas parlé de la contrainte chimique ou de la contrainte légale. Moi, mon penchant pour les collectifs de soin ça s’appuie sur l’histoire de la psychothérapie institutionnelle, qui cherche à réfléchir à comment on va construire avec les premier..es concerné..es nos dispositifs de soin. On va essayer de diminuer les effets de hiérarchie, de tendre vers une horizontalité, qui n’est jamais possible, mais en tout cas vers une transversalisation des liens.
Et ce que disent tous les programmes internationaux, c’est des trucs que nous on connaît bien. On sait qu’il faut qu’il y ait une volonté à tous les échelons du corps psychiatrique, dans un service, pour que les professionnel..les soient partie prenante, avec les patient·es. Il faut que la..e médecin chef·fe soutienne. Il faut que la hiérarchie infirmière soutienne. Il faut que la direction de l’hôpital soutienne, que les Agences Régionales de Santé soutiennent, que tous les échelons politiques soutiennent et se parlent régulièrement. Mais l’ARS du côté de Marseille ne soutient pas le travail du centre Valvert, qui veut se passer de chambres d’isolement.
Quand il y a des pratiques de contraintes, il faut un retour d’expériences, qu’on se parle, qu’on parle avec les patient..es qui ont vécu ça. Leur demander : qu’est ce que ça vous a fait ? À votre avis, comment on aurait pu faire autrement ? Il faut aussi mettre en place ce qu’on appelle les directives anticipées : quand les gens ont déjà décompensé et qu’i..elles vont mieux, on leur demande comment il faudrait faire la prochaine fois qu’i..elle est pas bien. La psychiatrie, elle doit se faire à partir du vécu, des idées, des gestes, des premier..ères concerné..es, avec et à partir d’elles..eux. C’est aussi un des points hyper importants : comment on fait de l’auto-défense, comment on se défend dans des circuits psychiatriques un peu brutaux en ce moment.
Et puis je vais m’arrêter après avoir dit que, dans les propositions très concrètes, il y a en premier d’arrêter de dire que la contention est un soin. Il faut dire que c’est une mesure de sécurité, une mesure de contrôle. Peut-être que certain·es peuvent pas s’en passer, mais en tout cas arrêtons de dire que c’est un soin.
Deuxième chose, essayons de créer peut être un observatoire, comme David Dufresne l’a fait avec #Allo place Beauvau pour les violences policières pendant le mouvement des Gilets jaunes. Faisons un observatoire qui pourrait recueillir les témoignages. Tout ça crée de la honte. Pendant la présentation du livre, les premier..es concerné..es qui ont vécu la contention disent : « Merci parce que, enfin, on peut faire comprendre ce qu’on a vécu, on peut dire aux proches : "lis ça, tu verras ce que j’ai vécu et ce que je ressens" ». Donc un observatoire sur ces maltraitances institutionnelles ça serait utile. Rappelons-nous que le comité de prévention de la torture, en 1994, disait que la contention était une torture. En 2003, ce comité a révisé son jugement : il dit que c’est du « dernier recours ». Cet observatoire pourrait faire l’état aussi des pratiques alternatives. Il y a quand même plein de lieux — 15 % des lieux en France c’est beaucoup — qui font sans !
Je conclue là-dessus : la contention, ça peut être la pierre d’achoppement de plusieurs mobilisations, comme l’est aujourd’hui le béton ou comme l’a été l’aéroport de Notre-Dame-des-Landes ou comme le sont aussi les reprises de terre. Il faut bien commencer quelque part, et commencer par une lutte concrète contre la contention, ça peut déboucher sur plein de luttes.
Je plaide pour l’abolition parce qu’abolir c’est pas interdire. Dans l’abolition, il y a une dimension imaginaire qui dit quelque chose de la société : l’abolition de l’esclavage, l’abolition de la peine de mort, l’abolition des privilèges. L’interdiction peut-être que ça peut être un pas, mais ça vient d’en haut, c’est très vertical, alors que l’abolition, ce sont les personnes concernées qui la mettent en place.
Encadré I :
Au fil de l’histoire humaine, des lieux comme la prison, l’hôpital, l’asile, le temple, la caserne, ont souvent servi à la fois de lieu de protection et de lieu de punition pour les personnes s’y trouvant logées. Pour en arriver là, il a d’abord fallu que les formes de déviances sociales (maladie, violence, abus, transgression de la norme, etc.) ne soient plus traitées au sein de la communauté de référence, mais externalisées, voire mises au ban ou emmurées. Dès lors que le but de l’État moderne a été de contrôler la reproduction de la population et de défendre les intérêts libéraux des sociétés, les liens d’entrave ont augmenté au détriment des liens d’entraide. À la fin du xviiième siècle en Europe, prison et asile ont alors été fondés sur une même base de fonctionnement : la privation de liberté comme moyen espéré de réparer des torts supposés. Aujourd’hui, les liens entre les deux institutions sont encore plus visibles. L’Observatoire Internationnal des Prisons rappelle qu’un..e détenu..e sur cinq est atteint..e de trouble psychotique (schizophrénie, paranoïa, hallucination, etc.) et que huit sur dix présentent au moins un trouble psychique (anxiété, dépression, bipolarité, etc.). Face à cette situation, les autorités judiciarisent le soin et psychologisent la justice. Les lieux de soins en viennent à reproduire des formes de répression et à en prendre eux-mêmes la responsabilité : par le biais d’expulsions pour non respect des règles (« sortie disciplinaire »), d’hospitalisations préalable à l’incarcération, de dénonciations ou de collaborations avec les services de police. C’est pourquoi les militant..es anti-autoritaires luttent conjointement contre toutes les formes d’enfermement et pour la resocialisation des personnes autrices de violence, qu’elle soit infligée contre soi ou les autres.
Encadré II :
Contention : être attaché..e par un deux trois ou quatre membres du corps, voire par l’abdomen, à un lit. En général, en psychiatrie, ça a lieu dans une chambre d’isolement. Il n’y a que dans cet endroit-là que c’est légal.
Isolement (chambre d’) : maintien d’un·e patient·e dans une chambre isolée des autres, seul..e dans la pièce fermée à clef, calfeutrée et rembourrée. Ces mesures doivent être prescrites par un·e psychiatre pour une durée maximum de 12h. Elles peuvent être renouvelées et ne doivent, selon la Haute Autorité de Santé (HAS), dépasser les 48h qu’à titre exceptionnel. Selon l’HAS, seul..es les patient·es en soins sous contrainte peuvent être isolé·es. Ces mesures doivent être enregistrées dans un registre. Régulièrement, la..e Contrôleur..euse des lieux de privation de libertés fait état d’abus concernant les mesures d’isolement comme de contention.
Chambre d’apaisement : chambre offrant un espace de faible stimulation, qui ne doit pas être fermée à clefs.
Hospitalisation sous contrainte :
→ À la demande d’un tiers (SPDT) (membre de la famille, proche, etc), ou pour « péril imminent » (SPPI) (lorsqu’il n’y a pas de proche suceptible de rédiger la demande de tiers) : lorsque les troubles compromettent la possibilité de la personne de décider pour elle-même de la necessité du soin.
→ À la demande d’un·e représentant·e de l’État (SPDRE) : lorsque les troubles compromettent l’ordre public . Dans tous les cas, le protocole d’hospitalisation sous contrainte fait intervenir un, ou plusieurs certificats médicaux circonstanciés, notifiant la symptomatologie psychiatrique.
Programme de soin en psychiatrie : C’est une obligation de suivre des soins en ambulatoire, c’est-à-dire hors de l’hôpital. Ces programmes de soins peuvent comporter, par exemple, des rendez-vous, des visites à domicile, des soins en structure, des courts séjours à l’hôpital. La..e psychiatre peut décider d’un retour à l’hôpital à tout moment.
Temps d’échange
– François : Est-ce que la contention a déjà été interdite ?
– Mathieu B. : Non, la contention a toujours existé. Le seul pays à l’avoir aboli, c’est l’Islande, dans les années 1930. Et la contention ne faisait plus partie des pratiques dans plein d’endroits, dans l’après-guerre, en France. Par exemple, j’étais invité dans un hôpital du 9-3, à Ville-Évrart, où les infirmièr..es qui ont commencé dans les années 1970 disaient qu’i..elles avaient jamais jamais attaché... jusqu’à 2010-2015. Donc avec Rachel, la journaliste avec qui j’ai écrit le livre La révolte de la psychiatrie (2020), on date aux années 2000 le début du retour de la contention. Mais il n’y a pas de date exacte en fait.
– François : Est-ce qu’on arrive à comprendre pourquoi c’est revenu, les causes ?
– Mathieu B. : L’argument syndical serait le plus simple : c’est parce qu’il y a moins de personnel. Mais, en fait, il y a, avant ça, le tournant sécuritaire de la psychiatrie, avec le « drame de Pau » en 2004. Romain Dupuy, un jeune schizo, dont les parents ont tout fait pour qu’il soit soigné et que la psychiatrie a refusé de soigner, tue une aide-soignante deux mois plus tard. Les pouvoirs publics s’en sont saisi pour faire un premier tour de vis. Le deuxième tour de vis, c’est Sarkozy : 2008, le discours d’Anthony. Après le meurtre d’un étudiant à Grenoble, 70 millions d’euros sont débloqués pour construire des unités pour malades difficiles et des chambres d’isolement, pour de la vidéosurveillance, etc. Ça va diffuser l’idée que « le fou est dangereux ». Et puis il y a l’hôpital-entreprise, la réforme des politiques publiques, la politique du chiffre par le T2A (tarification à l’acte) en psychiatrie. Tout ça fait qu’on peut plus rapidement déshumaniser les patient..es.
– Bonnie : L’hypothèse qu’on peut faire aussi, sur le retour de l’entrave, c’est la fin de l’hôpital sous la forme du village, la fin de la politique de sectorisation, selon laquelle le soin est meilleur quand la..e patient·e peut rester dans son milieu de vie. Dans des entretiens sociologiques que j’ai faits, à l’hôpital du Vinatier de Lyon notamment, des ancien..nes infirmier..es racontent qu’i..elles appelaient les patient..es par leurs surnoms. À partir des années 1990, les patient..es sont revenu·es à l’intérieur des services, i..elles sont caché..es, il ne faut plus qu’i..elles soient trop dans le parc, parce que ce parc est devenu un parc public où on peut promener son chien. Il y a quelque chose d’incompatible avec des personnes qui ont des comportements sortant des normes, pouvant choquer. Alors il faut les entraver, les garder à l’intérieur. Et ça, avec le meilleur moyen possible : des chambres d’isolement, des liens de contention. C’est tout ça qui prépare le grand tournant sécuritaire sous Sarkozy.
En plus de ça, il y a eu des grosses critiques contre la politique de sectorisation, en disant qu’elle ne porte pas assez ses fruits. Mais on oublie de dire qu’il n’y avait pas tous les moyens qu’il fallait pour soutenir cette politique de secteur.
– Jean : Je voulais dire un mot sur le langage, quand on dit : « la contention, c’est en dernier recours ». En Algérie, la torture, c’était le dernier recours ! C’est exactement la même expression. Donc le langage du capitalisme, il faut toujours que vous l’écoutiez dans son double sens, il est toujours pervers.
– Benoît : J’ai une question toute simple : est-ce qu’il y a une durée maximale de pratique de la contention et, si elle est dépassée, est-ce que la..e patient·e a un recours quelconque possible ?
– Mathieu B. : Les médecins doivent évaluer toutes les six heures si la contention est encore nécessaire. Ensuite, selon la loi, la..e juge est saisi..e par l’hôpital, si elle dépasse les 24h. Pour l’isolement, c’est au bout de 48h, systématiquement. Cela dit, on peut être enfermé..e ou attaché..e pendant des semaines et des semaines. Il n’y a rien qui dit qu’il y a une durée maximale après que la..e juge des libertés soit informé..e.
– Benoît : Parce que, moi, je trouve que la contention, ça se conçoit si un..e patient..e arrive, se jette contre les murs, saute partout, menace tout le monde, et qu’on l’attache une heure ou deux, pour qu’i..elle se raisonne. Mais quel est l’objectif plus longtemps ? À part détruire quelqu’un·e ? C’est vrai que vous avez dit que ce n’est pas du soin, mais c’est au-delà de ça : c’est une forme de sadisme affirmé, non ? Une volonté d’aliénation. Qu’est-ce que vous en pensez ?
Moi en 2000, i..elles m’ont fait entrer dans une chambre. C’est vrai, j’y allais à mon insu, mais j’avais pas du tout besoin de ça, réellement ! Quelques années auparavant, j’aurais pu comprendre qu’on me prenne en charge comme ça, car je délirais un peu. Mais là, i..elles m’ont fait entrer dans une chambre, i..elles se sont mis..es à cinq autour de moi, alors j’ai compris. Je leur ai demandé : « vous êtes sûr..es qu’il y a besoin de ça ? ». I..Elles m’ont répondu : « c’est le protocole ». Je me suis allongé, j’ai allongé mes bras, i..elles m’ont attaché, ça a duré cinq jours. J’ai pas levé le petit doigt. Donc j’aimerais comprendre, car ça imprime quelque chose de phénoménal dans la psyché ! On est réduit à rien et on a l’impression d’avoir plus aucune voix citoyenne quand on sort, malgré toute leur bien-pensance et leurs bonnes intentions de soigner les symptômes, comme i..elles disent. J’espère que ça change un peu avec la pair-aidance.
– Claire : Moi j’ai vécu des contentions dans un cadre qui me questionne beaucoup. J’étais mineure, j’avais des troubles du comportement alimentaire, j’étais en manque de soin, j’ai signé un contrat de soin, mes parents étaient consulté..es à ce moment-là. Mais une fois que j’étais dans l’hôpital, il n’y a plus de moyen de contacter l’extérieur. J’ai passé des mois dans une chambre d’isolement fermée à clef. J’étais pas dans le déni du trouble, j’étais même en demande de soin. Et la seule solution qu’on m’a proposée pour arrêter que je fasse du sport, pour éviter que je continue à devenir anorexique, c’est de m’attacher. Sans aucune consultation ! Donc ma question c’est : à partir de quand il a fallu un signalement obligatoire pour rendre légale une contention de longue durée ? Moi ça a duré une semaine, voire deux, même si mon carnet de soin n’est pas clair là-dessus. C’était en 2006. Est-ce que c’était légal ?
– Mathieu B. : c’est le 1er janvier 2021 qu’il y a eu une loi qui encadre la contention et l’isolement. Avant, il y avait une loi qui encadrait l’hospitalisation sans consentement. Pour la première fois, l’isolement-contention apparaît comme devant faire l’objet d’un registre dans les hôpitaux, avec la loi Touraine de 2016. Avant, il y a rien, nada. I..Elles font ce qu’i..elles veulent.
– Léa : on peut aussi se poser la question de la légalité de la contention, du fait de ta minorité et de la non-référence à tes représentant·es légaux..les.
– Claire : Oui, moi je me suis longtemps posée cette question. Je me demande si ce n’est pas de la torture, alors que c’est des établissements qui sont censés être sous le contrôle de l’ARS (Agence Régionale de Santé).
– Bonnie : Il y a une analyse juridique qui dit que, avant la loi de 2021 et avant l’obligation de 2016 de tracer les actes de soin dans le dossier médical, c’est la Constitution française qui interdit tout ce qui est de l’ordre de la contention, « sauf disposition légale » existante. Donc je pense que c’était illégal, dans ton cas, à l’époque. Et les dirigeant·es des hôpitaux, ensuite, ont créé une loi qui rend légal ce genre d’acte d’entrave, puisqu’il existe maintenant une disposition légale à ce propos.
– Ella : J’imagine bien que c’est important, quand on a vécu l’expérience de la contention, de savoir si c’est légal ou pas, mais en même temps, la justice propose une interprétation des règles qui n’est pas fixe, contrairement à ce qu’on pourrait penser. La loi n’explique pas clairement les choses, pas très distinctement. C’est fait pour que les personnes, qui sont en situation de pouvoir intermédiaire obéissent à la loi et en même temps fassent la loi à leur manière. Et le climat général, sécuritaire, forme la loi d’une certaine manière, en pratique. Avec cette idée, on rejoint beaucoup de luttes anti-carcérales : on aimerait bien croire que la justice est impartiale et droite, mais ce n’est pas le cas. D’où l’intérêt aussi de parler des alternatives à la contention et aux stratégies de luttes, pour que l’application des lois penchent dans le bon sens.
– Mathieu B. : Hier, j’étais avec une avocate-sociologue de Marseille, Pauline Renter, qui rappelle qu’avoir les portes d’un service fermées à clef, c’est illégal. C’est déjà une première étape avant d’arriver à la contention : les portes ont été fermées avant que la contention soit de nouveau pratiquée. Plus on ferme, plus on ferme...
– Virginie : Tu dis que c’est illégal de fermer les portes à clef, mais on voit que le CHU de Nantes a décidé d’empêcher tous les patient·es en psychiatrie de la région de sortir en raison du passage de la flamme olympique !
– Bonnie : Je voulais réagir sur l’histoire de la fermeture des services. Là où je pense qu’il y a des leviers d’action, c’est avec des associations de patient·es ou de familles ou de proches. Un exemple concret : je travaille depuis 2021 dans un service de psychiatrie adulte. Quand je suis arrivée, c’était un service fermé, pas officiellement mais quand même. Je suis partie en congé maternité et quand je suis revenue, le service était ouvert pour de vrai. Ma cadre m’a dit : « on garde bien le service ouvert car des familles se sont plaintes, on s’est fait tapé sur les doigts. Donc quand le service est fermé, ça doit être juste une heure ou deux et on doit le justifier ». Donc ça, c’est de l’histoire récente, c’est parce qu’il y a eu des plaintes de familles que ça a bougé. Donc c’est vrai que la loi « Patients, santé,
Territoire », qui amène la T2A, elle amène plein de trucs dégueulasses économiquement, mais elle amène aussi un peu tout ce qui est de l’ordre du droit des patient·es. Avec certes un vocabulaire qui est celui de la « qualité », de l’« évaluation », etc. Mais ça a cet avantage là, quand même, de donner la parole aux patient..es, de donner un peu de pouvoir à cet endroit-là, pour que le pouvoir ne soit pas détenu uniquement par le corps médical et administratif. Donc je pense qu’il y a des leviers à cet endroit-là pour ouvrir des services et abolir la contention.
Encadré III :
Psychiatrie de secteur : à partir des années 1960 la forme asilaire du soin psychiatrique est remis en cause. Le service public en psychiatrie est progressivement structuré suivant un maillage de secteurs géographiques décentralisés. À chaque hôpital correspond un territoire défini dans lequel se trouve des structures de soin dit "ambulatoire" (centre médico-psychologique, hôpital de jour, centre d’accueil thérapeutique à temps partiel, diverses structures spécialisées...). L’idée du secteur était de promouvoir le soin hors du cadre hospitalier, au sein du terroir duquel lae patient..e est issu..e, et de permettre ainsi plus d’accessibilité,de proximité et de continuité entre les espaces de soin.
On clôt les échanges en grands groupes, et on propose de les continuer en petits groupes, pendant 1h30, autour de trois questions.
1. La contention, c’est quoi, ça fait quoi ?
2. Comment s’en passer, comment faire autrement ?
3. Comment lutter contre, comment se mobiliser ?
Après un café et un bol d’air, chacun..e se retrouve dans la grande salle de la Friche pour la seconde assemblée. L’enjeu est de restituer les échanges à l’ensemble des participant..es et de pouvoir échanger tous..tes ensemble.
2ème plénière
1. La contention, c’est quoi, ça fait quoi ?
– Benoît : J’ai été mandaté par mes camarades pour résumer ce que nous avons partagé lors de ce temps d’échanges. On était tous..tes concerné..es, soit pour l’avoir subie, soit pour en avoir été témoins lors de sa pratique professionnelle, soit à travers la camisole chimique. C’est-à-dire : pas de la contention physique mais une forme de contrôle basé sur la surmédication. Ce qui est revenu le plus dans nos discussions, c’est tout ce qui est lié aux émotions ressenties quand on subit cette violence. C’est une violence, une torture. Cela crée de la honte, un traumatisme qui rajoute au traumatisme, une sanction.
Certain..es ont témoigné que ce genre de pratiques n’avait pas lieu d’être, d’autant qu’i..elles ne présentaient aucune menace. Plus largement, on a parlé de traumatisme lié à l’accueil dans l’hôpital. L’un d’entre nous a pu dire s’être fait frapper directement quand il est arrivé à l’hôpital, puis s’est retrouvé directe en contention, avec un parcours de vingt années de psychiatrisation. C’est une perte de dignité absolue, une perte de droit, la perte de tout choix, et notamment des soins qu’on peut se voir prodiguer. On est donc bien loin du soin. Ce n’est pas du tout aller vers le soin.
On a fait un parallèle avec certaines méthodes policières. Personnellement, à l’issue d’un délire dans la rue, où je n’étais pas violent, j’ai été arrêté par la police, menotté. J’ai passé 48h de garde à vue, pendant lesquelles j’ai été frappé. Je me dis que finalement certaines méthodes policières qu’on dénonce, sont les mêmes en hôpital psychiatrique. Il y a un caractère mécanique, une violence systémique qui est appliquée aveuglement. Pour nous, la contention se trouve dans un contexte politique.
On a souligné aussi que ça dépendait des hôpitaux, voire des services, certain..es vont vers moins ou pas du tout de contention. Le problème c’est quand on se retrouve minoritaire.
2. Comment s’en passer, comment faire autrement ?
Premier groupe
Noah : L’entrée de la discussion, c’était de se dire qu’au sein même de la contention il y a différentes pratiques. Il y a des personnes qui l’utilisent de manière automatique et facilement. D’autres l’utilisent en vrai dernier recours. On avait l’exemple d’un service de Paris, où 30 personnes étaient accueillies par jours, certain..es professionnel..les mettaient beaucoup en contention et d’autres n’ont utilisé que deux contentions dans leur carrière. Cela dit, ces deux recours peuvent quand même poser question.
Ensuite on a souligné qu’aujourd’hui la contention est présentée comme une option, une possibilité, et donc que les professionnel..les l’utilisent. C’est l’offre qui entraîne la demande : si on n’a pas de sangles, on ne les utilise pas. La contention est aussi une culture apprise, transmise. Si la contention est une option, quelles autres options sont possibles ? Les médicaments peuvent mettre du temps à agir et parfois la contention se double de traitements qui ne fonctionnent pas. Il ne faut pas non plus évacuer ce qui questionne quand on administre des médicaments.
Après, on a soulevé la place dans le soin de la parole et du non verbal. Il existe tout ce qui, dans le comportement et dans l’interaction, soutient. Quand on voit quelqu’un..e dans un cadre délirant, on peut avoir l’impression qu’i..elle n’est pas du tout accessible par la parole. Mais la parole peut permettre de revenir et il ne faut pas croire qu’un..e psychotique n’entend pas ce qui est dit ou ne se souvient pas.
On a pris deux types de situation concernant une contention. La première, dans laquelle la personne qui est contenue entend la parole des soignant..es, qui lui expliquent ce qui se passe, que les soignant..es vont revenir, comment faire pour demander à boire. La seconde situation de contention c’est celle où rien n’est dit. Pire, j’ai entendu une collègue paire-aidante sur le territoire du Rhône, qui, au moment de la contention, a entendu : « on va te rappeler que tu es un..e patient..e ».
Derrière la contention il y a la question de la sanction. De quoi ? Et pourquoi ? Par qui ?
La parole est un outil et les professionnel..les n’ont pas eu dans leur formation de transmission de cette technicité de parole. La contention va intervenir en intrahospitalier, sans consentement, dans une temporalité psychique où c’est déjà trop tard. C’est trop tard : pas d’une heure, pas d’un jour mais de plusieurs mois. Les alternatives c’est d’organiser les soins différemment, avec plus de prévention. Il faut des lieux de soins qui ne sont pas enfermés ni enfermants, qui réduisent les risques de décompensation amenant à une contention. Si on soigne avec une nouvelle définition du mot soigner, on réduit les états psychiques pouvant amener à des contentions.
Pour finir rapidement on a aussi évoqué les points suivants :
– la question de l’honnêteté, de la manipulation. Certain..es soignant..es peuvent te dire : « attends, tiens viens » et derrière la porte y’a cinq personnes qui vont t’isoler.
– la question du manque de moyens humains : est-ce que la contention est liée au manque de moyens ? En écho on se souvient qu’il y a 15 % des établissements qui n’utilisent pas la contention.
– le un..e pour un..e : une personne soigné..e, implique un..e soignant..e.
– la question des chambres d’apaisement, mais ça on pourra en reparler autour d’un verre !
Deuxième groupe
Ella : On a évoqué beaucoup de choses en commun avec le précédent groupe. On s’est aussi posé la question du manque de personnel. On pourrait penser que ça joue, qu’on aurait besoin de plus de temps pour être auprès des personnes. Mais si on regarde les chiffres, il n’y a pas de corrélation entre le nombre de professionnel..les par patient..e et l’usage de la contention.
Dans notre groupe, il y avait des vécus très différents : des personnes qui avaient vécu la contention dans leurs parcours en psychiatrie, des personnes qui avaient contentionné en tant que professionnel..les et des gens qui étaient professionnel..les du soin sans avoir participé à ces situations-là.
Christine : On s’est aussi dit qu’au-delà du nombre de soignant·e, c’était la question de la qualité de relation, de la parole et de la pair-aidance qui pouvait désamorcer les crises en amont. Les choses sont à prendre en amont !
Ella : Souvent dans les services, on sait à l’avance que ça va mal se passer, on voit les choses monter. Contenir, c’est penser que les soignant..es sont essentiel..les pour que ça se passe mieux, qu’il faut casser la crise, stabiliser. Peut-être que de laisser la personne en crise partir faire autre chose, trouver d’autres ressources, y compris hors de la psychiatrie, peut être la solution.
On a aussi beaucoup parlé de hiérarchie et d’institution. Cell..eux qui prescrivent la contention ne sont pas cell..eux qui l’appliquent. Cell..eux qui l’appliquent ont des protocoles. On a fait le parallèle avec la police, où cell..eux qui décident disent qu’i..elles obéissent à des ordres, que cell..eux qui décident ne sont pas cell..eux qui appliquent. On a aussi fait le parallèle avec la prison. On s’imagine que les personnes qui sont en prison sont hyper dangereuses et qu’il n’y a pas d’autres solutions, mais en fait non. Je fais le pari que la plupart des gens qu’on attache en psychiatrie, autour de cette table aujourd’hui i..elles feraient peur à personne.
Enfin, il y a la question des soignant..es qui ont été déshabitué..es à gérer des crises. On a rapidement peur de la situation. On s’imagine à tort qu’on ne peut pas gérer ça autrement que par la contention.
3. Comment lutter contre ? Comment se mobiliser ?
Cassandre : Dans nos échanges, plusieurs niveaux de luttes ont été évoqués.
Le niveau micro : comment on fait pour défendre les droits des patient..es et comment on fait pour que les patient..es puissent défendre leurs droits dans les institutions. On a évoqué plusieurs figures juridiques potentiellement utiles : la..e Contrôleur..euse des lieux de privation de liberté, la..e Défenseur..euse des droits et la personne qualifiée. Pour les patient..es, quand i..elles sont en institution, c’est compliqué de défendre leur droit par ell..eux-mêmes. On a donc parlé des familles, des personnes à l’extérieur. Le droit est assez obscur et compliqué à mobiliser. Il y aurait intérêt à réaliser des brochures explicatives sur le droit pour les patient..es et leur entourage.
On a rebondi aussi sur l’idée des témoignages comme outil de lutte. On s’est questionné..es sur la protection des personnes qui témoigneraient. On évoquait l’effet de retour de bâton : parler en son nom, qu’on soit professionnel..le ou personne psychiatrisée, c’est s’exposer à des conséquences. On a parlé aussi de l’importance de compiler les témoignages pour les rendre visibles : soit du côté "observatoire", soit du côté réseaux sociaux. Il pourrait aussi y avoir un enjeux à compiler des récits de lieux qui savent faire sans la contention.
À la différence de ça, le niveau de lutte macro, serait la question du plaidoyer, de comment faire changer les choses du côté législatif. On a évoqué le rôle des député..es, des juristes, des avocat..es. On s’est aussi posé la question de se rapprocher d’autres collectifs, soit au niveau international (un collectif travaille sur cela en Suisse), soit au niveau national avec des collectifs qui s’organisent dans des luttes anti-carcérales ou contre le mitard (les cellules d’isolement en prison). Est-ce qu’il y a des choses à faire en commun ou des formes de luttes qui pourraient être reprises ?
Il nous semblait aussi que les syndicats professionnels étaient peu enclins à défendre l’abolition de la contention. Il y aurait un intérêt à construire des ponts avec les syndicats, d’autant plus qu’ils peuvent mobiliser des moyens pour la formation, le travail de défense, la diffusion et la visibilisation des témoignages ou des luttes.
Dernier temps d’échanges avant la clôture de la journée
Pascal : je propose une solution que j’ai rédigée depuis 44 ans, une solution au problème des fondements des sciences, qui permettent de justifier des fondements du droit. En effet, les droits de la démocratie sont affirmés dogmatiquement et il en manque les fondements. Je propose une solution au problème de la norme juridique fondamentale. L’existence de cette norme juridique fondamentale est théorisée depuis peu de temps, depuis le début du xxème siècle, grâce à Hans Kelsen. Le fait de résoudre intellectuellement ce problème permettrait une solution systémique de toutes les questions démocratiques, écologiques, etc. à l’échelle mondiale. Du coup, c’est un outil extrêmement important, même s’il n’est pas visible pour la convergence des luttes et pour une efficacité de résoudre tous ces problèmes. L’échec des Conférences pour le climat est lié au fait que les procédures de dialogue ne sont pas rationnelles dans la société, ni ici, ni dans un parlement, ou un syndicat. Il faut donc que l’humanité fournisse cette conception de la technique du dialogue. C’est un problème intellectuel oublié par le capitalisme, qui oriente la recherche et occulte des recherches en sciences humaines. Je propose une solution à ce problème et j’ai été stigmatisé depuis 1979. J’ai les bases de cette théorie et j’ai été ostracisé par la psychiatrie dans ce travail de recherche. Je propose une solution et je propose à quiconque de s’en emparer, de la vérifier.
Jean : Il y a quand même un autre sujet. On dit qu’on s’occupe des fous et folles mais ça fait peur, ou des malades mentaux, qui est une expression moche comme tout. Il faut repopulariser la folie en ayant à l’esprit les travaux de François Tosquelles. Et cette phrase « n’oubliez pas l’humanité de la folie ». Cela fait partie de l’humain. Il faudrait cogiter là-dessus.
Claire : ça rejoint la question du témoignage, de la stigmatisation, de la déstigmatisation. Si on veut lutter et arriver à une abolition de la contention, il faudrait que le grand public soit au courant de ce qui se passe. Par exemple, moi, dans mon histoire personnelle, mes proches n’étaient pas au courant de ce que j’ai vécu. Il se passe des choses obscures en psychiatrie. Il y a cette stigmatisation des fous et folles de manière générale. On a besoin d’une déstigmatisation globale pour pouvoir agir sur les soins en psychiatrie. On a besoin de gens dans différents domaines qui puissent porter ce discours-là. Dans notre groupe, on a abordé la question des juristes, des avocat..es, mais aussi des politicien..nes. Tout..e seul..e, et on le voit en pair-aidance, tout..e seul..e, on y arrivera pas.
Mathieu B. : Dans notre atelier, il y a Raymonde qui est là et qui est parlementaire sénatrice. Peut être qu’il pourrait y avoir une mission sur la contention ou une journée nationale ? Dans la région du Rhône, il y a eu l’étude Plaid-Cair, qui étudie le fonctionnement des établissements psychiatriques n’ayant pas ou peu recours à des mesures de contrainte. Hier, j’étais à Marseille pour une discussion sur la contention, y’avait plus de soixante-dix personnes. On est de plus en plus nombreux..ses !
Raymonde : je ne le dis pas du tout par opportunisme, mais j’ai organisé un colloque au Sénat sur la Palestine. À l’issue, j’ai dit à mon équipe, « le prochain, ce sera sur la psychiatrie ». Bon, ça ne sera pas tout de suite, mais c’est prévu. Je dois proposer un thème dans le cadre de ce qu’on appelle « la mission d’évaluation et de contrôle des politiques des santé », dont je suis vice-présidente. Pourquoi pas le resserrer sur les pratiques d’isolement et de contention.
Ella : En arrivant ici, on a vu plein de grands murs blanc. C’est plus terre à terre et local que le Sénat, mais ça serait bien si on pouvait taguer des choses comme « on pense qu’attacher c’est un soin ? ». Ça fait écho aux collages féministes.
Claire : on parlait de l’aspect communicatif, on parlait de l’idée de lancer un #MeTooContention, de faire apparaître, de montrer qu’on est beaucoup plus nombreux..ses que ça, comme ce qui a été fait par les combats féministes.
Emilie : La difficulté c’est que les personnes qui pourraient témoigner ce sont des personnes qui sont déjà invisibilisées, silenciées. Il peut y avoir une fatigue de ces personnes qui vont se retrouver face à un mur, parce qu’il y a pas les bonnes personnes pour porter ce truc-là. Peut-être qu’il y en a, des artistes, des personnes connues qui ont vécu de la contention, mais risqueront-i..elles de témoigner ?
Vanessa : oui, il y en a déjà qui ont parlé de leur parcours psy. Et j’ai envie de faire le lien entre la maladie psy, l’hypersensibilité et la créativité. Il y a déjà beaucoup d’artistes qui ont porté au jour leurs problèmes psy. Si ça démarre, je pense que ces gens là appuieront la démarche des invisibles.
Loîc : Tout ce qu’on s’est dit sur les questions de témoignages, ça me fait beaucoup penser aux luttes contres les violences policières et dans le prolongement des techniques de visibilisation. Dans l’appel à témoignage, faut assumer, faut réfléchir à l’accueil de ces paroles, à les protéger, à les anonymiser, etc. C’est quelque chose qui peut simplement être mis en place par des réseaux, sur internet, mais il faut un groupe qui se forme pour les recueillir, les collecter, les diffuser, etc.
Pierre : J’ai cru comprendre dans les échanges que la contention faisait partie de la formation de soignant..es. C’est toujours le cas ?
Clara : J’ai eu un séminaire en tant qu’interne en psychiatrie sur la « désescalade de la violence », qui finissait sur un cours sur comment contenir. Il y avait un jeu de rôle, on devait désescalader une situation de crise, mais ça marchait pas, la..e patient·e essayait de partir, on lui sautait dessus et on le contenait... Oui, c’est dans la formation initiale des internes.
Mathieu B. : Ce n’était pas le cas il y a vingt ans. On avait refusé dans notre cursus, on s’était battu contre.
Christine : Je suis infirmière, j’ai été formée de 2004 à 2007, et en formation initiale ; on nous apprenait que la contention était un soin.
Jeanne : Je suis paire-aidante et je me demandais quel argument est donné quand on enseigne la contention. Est-ce qu’il y a un lien qui est fait avec les langes dans lesquels on mettait les enfants pour pas qu’i..elles bougent ?
Mathieu B. : Oui, dans les échanges aujourd’hui, on a fait le mélange plusieurs fois entre contention et contenance. La contention, ça veut dire attacher des personnes. Il faudrait arrêter de dire contention car ça fait penser à contenir. Or les termes contenir-contenance ont été développés par la psychanalyse, notamment pour décrire comment le bébé, l’enfant, se développe dans la relation avec autrui. Les gens disent la contention c’est contenant. Plutôt, moi je dis que la contention ça décontenance le soin.
Clara : Actuellement, en faculté de médecine, la question sémantique est très importante. Le même prof qui nous a formé à la contention m’a engueulée car j’avais dit « contentionné ». I..elles interdisent de le nommer comme ça. Parce que, quand on le fait, on sent un peu trop qu’on parle de contention, d’attacher.
Elise : Je suis formatrice de pair..e-aidant..e et aussi juriste. Je rappelle aux infirmier..es ce qui se passe, par exemple, à Madagascar. Les personnes y sont attachées, on les enchaîne, c’est affreux. Mais n’empêche que la chaîne elle fait deux mètres... Le gars attaché, il peut pisser debout. Il y a des trucs à un moment, il faut percuter que, dans des endroits où il n’y a pas de moyens financiers, humains ou d’accès au savoir, on n’hospitalise pas s’il n’y pas quelqu’un..e de la famille qui veille avec la..le malade tout le temps. De fait, les montées de crises sont moindres car il y a ce lien de la parole, ce lien de la proximité. Il y a plein de pistes en fait, notamment dans l’ethnopsychiatrie (l’étude des désordres psychiques en lien avec leur contexte culturel, principalement hors de l’Occident). Qu’est-ce que veut dire "délirer" dans d’autres cultures et comment on apprend à gérer ça ? Si dans d’autres cultures, on considère ça comme quelque chose qui s’apprend, à un moment il faudrait un peu se réveiller chez nous.
Ella : Il est 18h50, je propose qu’on s’arrête là et qu’on continue à discuter autour d’un verre. La synthèse des discussions en assemblée sera donnée par mail, grâce à la liste mail qu’on a créé avec vous aujourd’hui. Et on espère que ça permettra de s’organiser pour d’autres rencontres ou événements.
Merci ! A toutes les personnes qui ont participé à cette journée, qui l’ont enrichie de leurs expériences et de leurs réflexions et qui en ont fait, paradoxalement malgré le poids du sujet, un agréable moment. A Najeh, Anne-Sophie, Tyb, Manon, Gagz, qui nous ont aidé dans son organisation. A Pull et Elie, pour les dessins, la mise en page, et les longues réunions qu’ont nécessité la réalisation de cette brochure. A l’atelier Fluo de Grenoble, et à RogAteliers à Annonay de nous avoir accueilli..es À toutes les personnes qui luttent pour un soin humain et pour abolir la contention !
Pour tout contact, retour, remarque, etc., ou pour recevoir la brochure, vous pouvez nous écrire à : abolirlacontention@proton.me
Pour continuer la réflexion
Auto support
– L’Abolition carcérale doit inclure la psychiatrie, 2021, écrite par Stella Akua Mensah
Les Ami..es sont le meilleur des remèdes, 2006, "guide pour créer des réseaux de soutien en santé mentale"
– Guide de navigation en eaux troubles, Les Faillantes, 2020, "pour se fabriquer des ressources pour se faire du bien quand on vit une crise ou un moment pas cool"
Communauté numérique (site, revue, liste mail)
– Commedesfous, site pour "changer les regards sur la folie"
Désaliéner, liste mail de discussion pour "une critique active de la psychiatrie, des normes sociales et de l’enfermement" par et pour les premièr·es concerné·es : desaliener@poivron.org
– Icarius, "réseau de soutien et de partage par et pour les personnes dont les manières d’expérimenter le monde sont souvent diagnostiquées comme des maladies mentales"
"Isolement et contention : faire autrement ?", revue Santé Mentale, n° 260, septembre 2021
– Soinsoin, "Journal de réflexion sur le soin psychiatrique"
Collectif, association, réseau d’entraide et d’activisme
– Advocacy France, association d’usager..es et ex-usager..es de la psychiatrie
Fédération nationale des usager·es en psychiatrie (FNAPSY)
– Humapsy, collectif "d’humains impatients pour une psychiatrie humaniste", Reims
– REV, réseau français sur l’entente de voix
– Tout..es concerné..es 69
– UNAFAM, association de famille et d’aidant..es
– Psycom, site qui répertorie plein d’associations et de groupes d’entraide mutuelle
Ressource juridique
– Cercle de réflexion sur et de proposition d’action sur la psychiatrie (CRPA)
– Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGPL)
– Défenseur des droits, "autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des libertés et des droits des citoyen..nes"
– Haute Autorité de Santé, indique le cadre légal des pratiques et donne des recommandations de "bonnes pratiques"
– Personne qualifiée, « a pour mission d’aider à faire valoir les droits de l’usage [...] pour la résolution d’un conflit [...] rencontré dans le cadre d’une prise en charge sociale ou médico-sociale »
– Psycom, site d’information sur la santé mentale. Propose notamment des annuaires et des brochures synthétiques. Certaines concernent les droits en psychiatrie
Radio
– Madness radio, pour dépasser la santé mentale (en anglais)
– "Vincent, entendeur de voix", Les Pieds sur Terre, France Culture
– "Handicap : la hiérarchie des vies", La Série Documentaire, France Culture
– Psylence, Radio Panik (Belgique)
– Microsillons - plusieurs émissions (Au coin du micro, Emi-Sillons...) créées par un Gem à Toulouse
– Radio pirates et kawa, émissions du Gem Envol & Cie à Villeurbanne + autres podcasts :
– Malheur niveau 2 un documentaire de Violette Gitton, Arte Radio "
– A la folie", Passages, Louie media "
– Autour des parcours de psychatrisées et autres folies interieures..", Le gang des gazières, Radio Galère "
– Folie, psychiatrie, lutte des psychiatrisé-e-s", Le feu, la rage et l’orage, Radio Pikez
Livre
– À quelle heure passe le train... Conversations sur la folie, Marie Depussé et Jean Oury, Calmann-Lévy, 2003
– Barge. Trois bouffées délirantes, dix ans de vie, trente carnets, Héloïse Koenig, éditions du Chien Rouge, 2016
– Brique par brique, mur par mur. Une histoire de l’abolitionnisme pénal, Gwenola Ricordeau, Joël Charbit, Shaïn Morisse, Lux Éditeur, 2024
– Charges. J’ouvre le huit clos psychiatrique, Treize, La Découverte, 2023
– Demain j’étais folle. Un voyage en schizophrénie, Arnhild Lauveng, Autrement, 2019
– Dieu gît dans les détails, Marie Depussé, chronique de jours ordinaires passés à la clinique psychiatrique de La Borde, P.O.L., 1993
– Le Château des insensés, Paola Pigani, roman à partir des archives de l’hôpital de Saint-Alban-sur-Limagnole, éditions Liana Lévi, 2024
– OPEN ))res((SOURCE, abécédaire des équipements en période de crise, L’Autre "lieu", 2024
– Soigner les institutions, François Tosquelles, textes choisis et présentés par Joana Masó, coédition L’Arachnéen-Arcàdia, 2021
Ce texte est composé en BBB Baskervvol [1] pour la transcription des propos oraux tenus pendant la journée du 8 juin 2024 et en Adelphe-Floreal [2] pour la narration et les textes écrits pour cette brochure. Ces deux typo, qui proposent des solutions graphiques à l’écriture inclusive nées du projet de typothèque Bye Bye Binary sont téléchargeables sur leur site.
[1] - (John Baskerville, Birmingham, c. 1750.)
– Claude Jacob, Strasbourg, 1784.
– ANRT (Alexis Faudot, Rémi Forte, Morgane Pierson, Rafael Ribas, Tanguy Vanlaeys, Rosalie Wagner), Nancy, 2017-2018.
– Baskervvol BBB (Julie Colas, Camille Circlude, Louis Garrido, Enzo Le Garrec, Ludi Loiseau, Édouar Nazé, Marouchka Payen, Mathilde Quentin), Bruxelles 2018-2022. Ajout de glyphes non-binaires.
[2] Eugénie Bidaut
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.1 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.4 Mio)