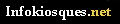Brochures
Technologie et prison
mis en ligne le 19 avril 2025 - carapatage
Emission audio disponible ici.
Introduction
Une des caractéristiques des prisons modernes c’est d’être équipées de toujours plus de technologies. Ces avancées technologiques sont présentées comme des améliorations pour les prisonnier·es et, par opposition aux vieux cachots vétustes, ce serait carrément humanisant. En réalité les technologies servent globalement à augmenter la sécurité de la prison, synonyme de plus d’isolement pour les prisonnier·es, en limitant les contacts humains et en tentant de ne laisser plus aucun angle mort, en mettant chaque endroit et chaque interaction sous contrôle.
Que ce soit la protection des murs d’enceinte, le contrôle des visiteur·euses, le contrôle des mouvements dans la détention et des communications des détenu·es entre elleux et avec l’extérieur, les outils technologiques visent à restreindre au max le peu de marge de manoeuvre qui existent dans les prisons et empêcher la débrouille. Pour cela on va voir que les dispositifs de brouillage d’ondes et les caméras se multiplient, les détecteurs d’objets sur les personnes se perfectionnent, l’utilisation de la biométrie se banalise, le traitement des données se numérise, se centralise, s’automatise. On parlera aussi de l’accès des détenu·es aux technologies, car comme à l’extérieur la soi-disant émancipation par la technologie aide à faire passer la pillule de la société sécuritaire que nous promet le tout numérique.
Après cet état des lieux de l’usage de la technologie dans les prisons françaises on ira voir ce qui se passe du côté des entreprises privées et de certaines prisons étrangères, car les deux ont une influence sur le futur d’ici. Pour finir on parlera de luttes et résistances à l’intérieur des prisons contre les avancées technologiques.
Panorama de l’usage de la technologie dans les taules françaises
La détection des téléphones
À partir des années 2000, la présence de portables dans les taules s’est multipliée et jusqu’à aujourd’hui l’administration pénitentaire (AP) tente au maximum de limiter leur nombre. En 2023, par exemple, c’est 53 000 portables qui ont été saisis dans les taules en France. Mais les portables introduits étant pour certains très petits, il est difficile d’empêcher leur entrée, les détecteurs de masse métallique ne détectant les métaux qu’à partir d’un certain poids. Il est donc facile de trouver des portables miniatures dans le commerce et de les faire entrer.
Une nouvelle génération de portiques plus efficaces, similaires à ceux des aéroports, a été mise en place depuis 2011 dans les maisons centrales, à Lannemezan, Saint Maur, Moulins, Clairvaux, Condé-sur-Sarthe, Arles, Réau, Vendin-le-Vieil, Lille-Annoeullin, Valence et Fresnes. Ces POM, portiques à ondes millimétriques, détectent les surfaces et permettent de voir à l’écran la présence d’objets métalliques, plastiques, liquides, semi-liquides, et en papier, y compris lorsqu’ils sont dissimulés entre les vêtements et la peau de la personne contrôlée. Ils valent entre 100 000 à 150 000 euros pièce.
C’est l’attaque en 2019 de deux matons par un prisonnier et sa compagne au parloir de Condé-sur-Sarthe, grâce à un couteau en céramique non détecté à la fouille, qui a relancé le débat sur le déploiement des POM dans les taules.
Les brouilleurs d’ondes téléphoniques
Pour tenter d’endiguer l’usage de téléphones dans les cellules l’AP se concentre plutôt sur le brouillage des ondes. Le principe d’un brouilleur est d’émettre un signal plus puissant sur la fréquence ciblée, créant ainsi de multiples interférences. Pour brouiller les ondes téléphoniques dans les prisons, ces machines doivent émettre de puissants signaux sur les fréquences des réseaux GSM, entre 900 MHz et 1800 MHz.
Les premiers brouilleurs sont installés à partir de 2013 par le ministère de la justice, suite à une loi de 2012. En 2015 de nouveaux brouilleurs plus performants, fabriqués par Thalès, sont installés et, à partir de 2018, plus de 100 millions d’euros sont dépensés pour en déployer d’autres. En 2024, sur les 187 établissements pénitentiaires de France, 18 disposent d’un brouillage sur tout l’établissement et 90 d’un brouillage partiel sur le quartier d’isolement.
La question des brouilleurs revient sur le devant de la scène en mai 2024 après l’évasion de Mohamed Amra, suite à l’attaque du fourgon pénitentiaire dans lequel il était transféré et pendant laquelle deux matons ont été tués. En effet, il utilisait plusieurs téléphones dans sa cellule à la Santé, grâce auxquels il aurait continué le trafic de stup’ et probablement organisé son évasion. Cela relance la question du déploiement des brouilleurs d’ondes. Un accord est alors signé entre le ministère de la justice et les syndicats pénitentiaires pour renforcer la sécurité des prisons, prévoyant de faire passer de 18 à 38 le nombre de prisons dotées de brouilleurs.
Aujourd’hui, même si des matons et directeurs de taule affirment que les brouilleurs ont fait chuter l’utilisation de portables, ces dispositifs présentent plusieurs limites :
– ils coûtent très cher (125 millions d’euros pour installer 500 brouilleurs entre 2018 et 2021)
– brouiller des ondes dans une prison est techniquement très compliqué car il faut émettre des ondes suffisament puissantes pour franchir quantité d’obstacles : murs en béton armé, grilles, barreaudages, etc.
– à partir du déploiement de la 4G une partie des brouilleurs sont devenus obsolètes car ils ne la filtrent que partiellement, et ne parlons pas de la 5G
– dans les prisons proches d’habitations ça brouille aussi les ondes des voisins
– dans certaines taules les détenu·es utilisent des petits routeurs qui permettent de contourner les brouilleurs
Par exemple à la prison de la Santé (Paris), réouverte en grande pompe en 2019 avec notamment ses fameux brouilleurs d’onde dernier cri, les brouilleurs ne fonctionnent vraiment que pour la 2G et la 3G et seulement au rez-de-chaussé mais pas aux étages ! Et ça coûte à l’AP 7 millions d’euros par an.
Les brouilleurs de drones
Un autre type d’ondes que les matons cherchent à maitriser sont les ondes radio servant à télécommander des drones. Pour faire entrer dans la taule des téléphones ou de la drogue, on peut lancer des colis par-dessus les murs d’enceinte, mais ces dernières années de plus en plus de gens, notamment des dealers, utilisent des drones en les faisant voler jusqu’aux cours de promenade voire jusqu’aux fenêtres des cellules.
Avec un drone dans les premiers prix ( 100 euros), on peut déjà transporter un colis d’environ 500 grammes et le faire voler à plusieurs centaines de mètres de distance. Pour celui ou celle qui le commande, ça limite les risques de se faire arrêter en étant plus loin du mur d’enceinte
Les drones peuvent aussi servir à préparer voire provoquer une évasion. Par exemple en faisant entrer des outils, des armes, ou en filmant la prison depuis les airs. En septembre dernier dans la prison de haute sécurité de Guayaquil en Équateur, un drone a fait exploser un toit et permis une évasion.
Les matons n’arrêtent pas de se plaindre des vols de drones qui se multiplient dans certaines prisons, parfois tous les jours. Donc, à partir de 2019, l’AP commence à équiper les prisons de brouilleurs antidrones, c’est à dire des dispositifs qui permettent de brouiller les ondes radio qui relient le drone à sa télécommande. Une fois les ondes interceptées le drone revient là d’où il a décollé. Ce sont les entreprises Cerbair et Keas qui ont équipé les prisons, avec une antenne capable de détecter les drones à 360 degrés dans un rayon de 2 km et d’un brouilleur qui neutralise les drones dans les gammes de radiofréquences 2,4 et 5,58 Ghz et la bande de fréquence L/433. On ne sait pas s’il existe des drones pouvant voler sur d’autres gammes de fréquences, ce qui permettrait de contourner le problème.
49 prisons sont équipées de brouilleurs en novembre 2024. Selon l’accord signé en mai 2024 entre le ministère de la justice et les syndicats de matons, 90 taules devraient être équipées d’ici à 2025.
La vidéosurveillance
Les images filmées en prison sont conservées un mois au maximum et, à ce jour, la vidéosurveillance algorithmique n’y est pas légalement autorisée.
• Caméras en cellule :
Suite à l’arrestation de Salah Abdeslam, impliqué dans les attentats du 13 novembre, l’usage de la vidéosurveillance en cellule (auparavant réservée aux cellules de protection d’urgence, dites « cellules anti-suicides ») a été étendu par un arrêté de juin 2016, validé par la CNIL.
Salah Abdeslam a contesté la vidéosurveillance en cellule via un référé‑liberté au tribunal administratif mais elle a été validée par le Conseil d’état. À notre connaissance, ce serait le seul prisonnier concerné par cette mesure (sous vidéosurveillance dans sa cellule, 24h/24 et 7j/7) même si la loi la permet pour les prisonnier·es à l’isolement, en attente de procès pour crime, « dont l’évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l’ordre public eu égard aux circonstances particulières à l’origine de leur détention et à l’impact de celles-ci sur l’opinion publique. »
Cette mesure est mise en place suite à un débat contradictoire où le·a déténu·e peut être assisté·e par un avocat, mais le garde des sceaux peut décider d’un placement provisoire sous caméra de 5 jours sans ce débat.
Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l’objet d’une décision du garde des sceaux pour une durée de trois mois, renouvelable à l’infini. Cette décision est notifiée à la personne détenue.
Les images peuvent être regardées en direct et le chef de l’établissement pénitentiaire peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l’enregistrement. Au-delà de ce délai, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d’une enquête judiciaire ou administrative.
• Caméras piéton :
L’apparition des caméras piéton en prison date de 2020 dans le cadre d’une expérimentation et se généralise à partir de 2023. Auparavant elles étaient réservées à certaines interventions des ERIS (équipe régionale d’intervention et de sécurité, les matons anti-émeute). Elles fonctionnement selon le même modèle que celles qui équipent les flics et les contrôleurs : elles n’enregistrent pas en permanence, indiquent par un signal qu’elles filment, et elles enregistrent aussi le son. Les données sont conservées trois mois, les agents ont interdiction de les déclencher pendant les fouilles. Seulement certains agents en sont équipés sur décision de la direction. C’est l’entreprise Axon qui les fabrique suite à un appel à projet remporté en 2023.
L’identification des prisonnier·es par la biométrie
Un des autres objectifs de la technologie carcérale est de ficher le plus possible les prisonnier·es. En 2003, un arrêté du ministère de la justice autorise l’installation de systèmes de reconnaissance de la morphologie de la main dans les prisons. L’objectif est de lutter contre les évasions par substitution, c’est à dire lorsqu’un·e détenu·e échange sa place avec une personne lui ressemblant venue au parloir, comme l’avait fait un membre de l’ETA en 2002 en s’échangeant avec son frère.
La reconnaissance de la main s’est depuis généralisée. En 2010,un décret autorise la création d’un fichier d’identification dans chaque taule avec l’enregistrement du contour de la main de chaque prisonnier·e, en plus de leur nom de famille, nom d’usage, alias et prénoms ; numéro d’écrou et une photographie d’identité numérisée. Le contrôle biométrique est effectué pour toutes les entrées et sorties de l’établissement, les entrées et sorties de parloirs et l’accès à certaines zones comme les établissements de santé. Le fichier biométrique est couplé à des cartes de circulation, ou cartes d’identité de détenu·e, contenant une photo et le numéro d’écrou encodé dans une piste magnétique.
Informatisation des données
Un autre fichier, le logiciel Genesis, regroupe l’intégralité des informations produites par l’AP concernant les personnes sous main de justice, telles que leur identité, l’identité de leurs proches (parents, enfants, conjoint.e.s, etc), leur temps de peine, leurs rapports d’incident durant l’incarcération, les mouvements au sein du système carcéral, etc. Il fusionne et remplace depuis 2014 le GIDE (Gestion Informatisée des Détenus en Établissements pénitentiaires) et le CEL (Cahier Électronique de Liaison).
Ces informations sont transférées avec le·a prisonnier·e dans le cas d’un transfert d’établissement pénitentiaire.
Ce fichier a été critiqué par les médecins en détention par rapport au secret médical et à l’indépendance des personnels de santé dont certain·es ont tenté de résister en boycottant son utilisation, mais il a été validé par le Conseil d’état. Les critiques portaient d’un côté sur le fait que pour pouvoir utiliser le logiciel les soignant·es doivent se faire remettre des cartes à puce d’« agents extérieurs justice » comme s’iels étaient des collaborateur·ices de l’AP. De l’autre, Genesis bafoue le secret médical car il inclut une application qui invite par des items « oui, non, ne se prononce pas » à donner des indications sur les antécédents de suivi psychiatrique des personnes, à révéler si elles ont des problématiques d’addiction ou si elles ont eu des antécédents familiaux de suicide. Le logiciel comprend aussi un « agenda partagé » qui permet que tou·tes les utilisateur·ices, quels qu’iels soient, personnels pénitentiaires ou intervenant·es, peuvent non seulement savoir quand les personnes se rendent en consultation mais aussi avec qui. Le logiciel intègre aussi un volet « gestion des requêtes » dans lequel tout le monde pourrait voir les lettres dédiées aux soignants.
L’informatisation des données entraîne un besoin de sécurité informatique. L’AP s’est ainsi dotée en 2006 d’un pôle dont la mission est de développer et de professionnaliser le réseau des acteurs de la sécurité des systèmes d’information.
Un poste de correspondant local des systèmes informatiques (CLSI) a été créé pour « prévenir les risques, de protéger notre réseau et de sensibiliser les utilisateurs ».
Technologies pour le « bien-être » et la réinsertion
Si le premier argument pour vendre des technologies carcérales est la sécurité des établissements et la garantie de leur imperméabilité, très vite après vient celui du bien-être des détenu·es. Les technologies leur permettraient de mieux vivre leur détention, mais aussi leur réinsertion.
En France le numérique en détention, généralisé depuis 2024, est un exemple de ce type de rhétorique. Ce sont des tablettes avec lesquelles les détenu·es peuvent consulter leur compte nominatif, cantiner ou encore saisir des requêtes vis-à-vis de l’administration.
Techniquement, les personnes détenues accèdent à l’intranet par le biais de tablettes partagées – à raison d’une par cellule – fixées au mur et câblées au réseau téléphonique déployé en détention. Des terminaux sont également accessibles depuis les salles d’activités. Les détenu·es peuvent consulter elleux-mêmes leur solde cantinable, mais aussi directement passer commande par le biais du nouveau système de cantine numérique, c’est à dire un catalogue de produits en ligne avec photos, de quoi « faciliter la tâche aux personnes non francophones ou qui ont des difficultés avec l’écrit » selon l’AP. D’autres usages sont prévus : la possibilité de choisir son type de repas pour « lutter contre le gaspillage alimentaire », l’espace numérique de travail pour poursuivre les études en prison.
Mais internet reste interdit en prison. Une exception existe néanmoins depuis 2009 avec les salles de Cyber base Justice. Leur objectif est de rendre les détenu·es autonomes dans l’utilisation de l’outil internet et ainsi de favoriser leur réinsertion. Seuls quelques établissements pénitentiaires en sont dotés à titre d’expérimentation. Quatre profils ou clés de connexion sont possibles : le profil internet, le profil bureautique, le profil exercice en ligne et le profil internet accompagné.
Dans l’univers carcéral et judiciaire la technologie est aussi souvent promue comme un moyen de lutter contre la récidive. Parmi les récentes expérimentations on trouve des casques de réalité virtuelle destinés à des auteurs de violences conjugales. Pendant douze minutes, le spectateur se retrouve plongé en immersion dans la salle à manger d’un couple, qu’il voit évoluer sur plusieurs années : l’attente du premier enfant, un dîner ordinaire, un repas avec des amis… Au fil des sept séquences, la violence s’installe. La réalité virtuelle permet au spectateur de se mettre tour à tour dans la peau du conjoint violent, de sa compagne et de leur petit garçon. L’objectif serait de susciter de l’empathie pour la victime et une prise de conscience chez les auteurs. Une phase test, pendant un an, débutée en octobre dernier avec une trentaine de détenus à Lyon, Meaux (avec des personnes condamnées et suivies en milieu ouvert) et Villepinte (en milieu fermé).
Mais contrairement aux bracelets électroniques qui ne constituent pas une alternative à la prison mais viennent plutôt en général s’y ajouter, les technologies soi-disant humanistes, elles, viennent souvent remplacer les quelques miettes de liberté... Aux Etats-Unis des casques de réalité virtuelle sont utilisés pour donner à des longues peine un avant goût de l’extérieur pour anticiper leur sortie, au lieu de leur octroyer des permissions de sortie. Plus proche de nous, internet ou plus précisément la visioconférence a été permise à des détenu·es pour remplacer les parloirs qui avaient été supprimés lors de l’épidémie de Covid.
Influence des entreprises privées et des expérimentations à l’étranger
Des entreprises font du lobbying pour promouvoir des solutions technologiques en milieu carcéral dont certaines anticipent clairement sur les possibilités légales. Une liste non exhaustive de ces entreprises est dans les ressources de cette brochure. De plus certaines choses qui ne sont pas encore légales ici le sont dans d’autres pays, ce qui représente aussi une source d’inspiration pour les législateur·ices français·es.
Voici des exemples des innovations qu’on peut trouver sur les sites des entreprises et à l’étranger :
• En ce qui concerne la vidéosurveillance, des entreprises proposent aux prisons des caméras résistantes aux chocs et à l’eau, des qualités d’image haute résolution permettant par exemple de voir les couleurs en faible luminosité, des caméras à 360°, des câbles protégés avec une gaine acier pour éviter que les détenu·es puissent les couper...
Beaucoup de propositions concernent des logiciels de vidéosurveillance algorithmique (VSA) pour détecter automatiquement différents types de situations qui donnent lieu à une alarme au poste de surveillance : bruits suspects, rassemblements de personnes, mouvements brusques, franchissements de lignes, détection de mouvement associée à des horaires, détection de feu ou fumée, de vandalisme, de mouvements de panique, de présence d’armes, de violence, comptage des détenu·es et du personnel dans des zones précises, inventaire automatique de matériel, audétection de l’état des caméras (pannes ou tentatives de sabotages), suivi automatique d’une personne...
Une partie de ces solutions de VSA concerne la détection de problèmes de santé, tels que les crises d’épilepsie, l’automutilation ou les épidémies : détection d’effondrement, d’agenouillement, de recroquevillement, mesures de température, analyse de l’état émotionnel.
Un système de VSA va être mis en place dans la prison de Csenger en Hongrie, actuellement en construction : une technologie permettant un contrôle complet des mouvements des détenus, et une intelligence artificielle pour analyser leur comportement et leurs expressions faciales. Si leur comportement s’écarte de leur routine habituelle, le système enverra un signal aux matons.
En Allemagne dans les lands de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Basse-Saxe la VSA est expérimentée « afin de prévenir le suicide et d’améliorer la sécurité dans les prisons ». En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, c’est la société FusionSystems qui a décroché le contrat pour développer le logiciel.
Depuis octobre dernier des robots sentinelles fabriqués par l’entreprise DEKA sont testés dans la prison de Cobb dans l’État de Géorgie aux états-Unis. Ils sont dotés d’intelligence artificielle, de caméras à 360°, d’une vision nocturne et de détecteurs de chaleur. Ils peuvent se déplacer de façon autonome dans les couloirs. « Pour l’instant, comme leur nom de sentinelle l’indique, ils servent à surveiller. Ils patrouillent dans la prison, offrant une surveillance continue, toujours à une distance de plusieurs mètres des détenus. Si l’intelligence artificielle des Jail Bots détecte quelque chose d’anormal, le problème de santé d’un prisonnier par exemple, elle en informe les gardiens humains. »
En Norvège, en 2019, il a été décidé d’installer des capteurs de respiration (détecteurs de souffle et de mouvement) dans les cellules de prison pour éviter les suicides.
• D’autres offres de ces entreprises concernent la protection périmétrique de l’enceinte des prisons : détection des intrusions, déclenchement d’alarme, de lumière, de messages automatiques. Elles vendent pour cela des capteurs radio-fréquence enterrés, des capteurs à micro-ondes ou des systèmes avancés d’analyse vidéo extérieure, ou encore des caméras thermiques à technologie radar, le tout agrémenté d’algorithmes sensés permettre de rejeter les alarmes intempestives générées par les conditions extérieures type intempéries.
Pour rêver un peu plus, voici ce qu’on peut lire sur le site de l’entreprise Senstar : « Le remplacement de certaines mesures de sécurité périmétrique visuellement intimidantes, telles que les barbelés et les tours de garde, par des mesures de sécurité cachées ou déguisées, telles que la détection périmétrique par fibre optique ou l’éclairage intelligent, peut avoir un effet positif sur le comportement des détenus. »
• Certaines entreprises perfectionnent des systèmes de détection et de brouillage des drones, par exemple qui permettent d’avoir les coordonnées exactes du drone et de son pilote.
• L’entreprise suisse Johnsoncontrols propose un système de localisation des détenu·es : « Un système de suivi et de comptage des personnes vous permet d’établir l’identité, la localisation et le statut des détenus et du personnel en temps réel, à l’intérieur comme à l’extérieur. » ça a l’air de ressembler grosso modo à un sytème de bracelets électroniques équipés de GPS, mais pour l’intérieur des prisons.
Honkgong a investi en 2019 dans des outils de haute technologie pour équiper les prisons : VSA, bracelets électroniques pour contrôler les mouvements, le pouls et d’autres données corporelles, systèmes de fermeture des portes basés sur la reconnaissance faciale, et un robot qui manipule les excréments des détenu·es pour détecter les drogues.
• Des solutions concernent les interphones à l’intérieur des cellules, permettant la communication vocale et vidéo entre les cellules, couloirs, portes, portails, sas et barrières d’une part, et le PC de sécurité et les postes de surveillance d’autre part, avec des systèmes d’autotest pour checker l’état de l’interphone. La société française Commend se vante que ses interphones permettent d’écouter discrètement et d’enregistrer les conversations des détenu·es, en plus d’être équipés d’un module de détection de téléphones portables.
Dans une prison pour mineurs aux Etats-Unis, dans l’État de l’Idaho, l’entreprise Axis a installé un système d’interphone vidéo sur IP, notamment dans les unités de vie, des cellules, la salle de classe, la salle polyvalente. Depuis la salle de contrôle, les matons peuvent regarder n’importe quelle caméra, écouter une pièce, parler à quelqu’un dans une pièce et déverrouiller des portes à distance. En plus les caméras des interphones sont équipées d’une vision nocturne. Sur le site d’Axis on peut lire des horreurs du genre : « Avec ces caméras d’interphone — en plus des 37 caméras qui font partie du système précédemment installé — nous avons littéralement des yeux partout déclare Scott, un maton. Il aime pouvoir zoomer numériquement sur une personne ou un détail dans une scène, puis faire un panoramique pour en voir davantage. » Cette surveillance permanente est justifiée par la nécessité d’« assurer la sécurité » des mineurs enfermés, pour éviter qu’ils s’automutilent, prennent de la drogue, se fassent agressés...
• Des entreprises proposent des solutions pour le contrôle des accès de la prison : reconnaissance faciale pour l’accès des employé·es, reconnaissance des plaques d’immatriculation, détection de « post-marche » (c’est-à-dire se faufiler derrière une autre personne), systèmes d’enregistrement/départ des visiteur·euses pour les parloirs.
Depuis 2019 une expérimentation est menée dans trois prisons au Royaume-Uni pour soumettre les visiteur·euses de détenu·es à un système de reconnaissance faciale par le scanner de l’iris et du visage, pour vérifier s’iels utilisent des faux papiers et mieux connaître la fréquence à laquelle iels viennent à la prison.
• Une IA développée par l’entreprise LEO Technologies en Californie permet de surveiller les communications téléphoniques dans les prisons : « La technologie peut transcrire automatiquement les appels téléphoniques des détenus, analyser leurs modes de communication et signaler certains mots ou expressions, y compris l’argot, que les autorités préprogramment dans le système. » L’IA utilise les outils de traitement du langage naturel et de transcription d’Amazon Web Services (AWS). Pour vendre sa technologie l’entreprise affirme que cet outil va permettre d’éviter des suicides de détenu·es…
• D’autres équipements sont proposés pour augmenter l’efficacité des fouilles, comme au Canada où des fauteuils-scanners appelés BOSS (Body Orifice Security Scanner) permettent de détecter les métaux dans les cavités corporelles, soi-disant pour remplacer les fouilles au corps par les matons.
Aux états-Unis, depuis 2019, le ministère de la défense finance la mise en place d’une base de données contenant les empreintes vocales des prisonnier·es après que des matons aient enregistré leur voix à leur insu, dans l’État de New-York, en Floride, au Texas et en Arizona.
• Certains logiciels concernent plutôt le volet justice, comme aux états-Unis où le système judiciaire pénal utilise des logiciels prédictifs depuis presque 10 ans pour évaluer le risque de récidive de prévenu·es. à partir du résultat de ces algorithmes, qui comportent évidemment tout plein de biais racistes, les juges décident d’une mise en liberté sous caution ou d’une condamnation.
En Chine des chercheurs relevant du parquet de Shangaï ont annoncé en 2023 avoir mis au point une IA capable de remplacer un procureur. Cette IA permettrait de prendre la décision de poursuivre ou non la personne après une analyse du procès-verbal d’accusation la concernant. Elle serait carrément capable de décider de la peine à appliquer relativement aux huit chefs d’accusation les plus fréquemment prononcés.
Résistances
Régulièrement des caméras sont détruites pendant des mutineries, comme lors de celle de la prison d’Uzerche en 2020 pendant le confinement.
Des blocages de promenade ont eu lieu dans plusieurs prisons contre la mise en place des brouilleurs d’ondes : à Seysses (maison d’arrêt de Toulouse) en 2021 et 2023, à Bourg en Bresse en 2022 ou encore à Lille-Sequedin.
Une prison a été hackée aux Etats-Unis dans l’état du Nouveau Mexique en 2022, même si le hacking ne ciblait pas spécifiquement la prison on peut noter que le système informatique a été attaqué par un « rançongiciel » qui a chiffré tous les ordinateurs, ce qui a désactivé toutes les caméras, bloqué le verrouillage automatique des portes. Malheureusement il semblerait que personne n’ait pu saisir l’occasion pour s’évader.
Une lutte de prisonnières de la maison d’arrêt pour femmes de Fleury-Mérogis (91) a eu lieu en 2016 contre la mise en place du logiciel Genesis, qui dégradait par la même occasion les conditions de détention en diminuant les promenades à une par jour, supprimant des jours de parloir, restreignant les horaires de sport.
Le mouvement collectif a pris la forme de blocages des promenade à l’intérieur avec une pétition remise à la direction, de protestations sonores en tapant sur les portes, de refus de plateau, d’affichages dans les cours de promenade. Il a été relayé dans des lettres des prisonnières basques envoyées à l’Envolée (émission de radio et journal anticarcéral), ce qui a donné lieu à deux rassemblements de solidarité à l’extérieur et à des envois massifs de fax à la direction.
Malheureusement peu des revendications des prisonnières ont été prises en compte et la répression elle ne s’est pas fait attendre : intimidations, chantages, fouilles de cellules, permissions de sorties et remises de peine refusées, et quatre prisonnières sont passées au prétoir (le tribunal interne) avec des peines de 14 jours de mitard (quartier disciplinaire) et de confinement pour une faute de place au mitard.
Dans les ressources vous trouverez plus de détails sur cette lutte, avec notamment les lettres de l’intérieur.
Ressources
Liste non exhaustive d’entreprises qui proposent des solutions technologiques pour les taules
• Axis communications (groupe Canon), Suède
• Axon enterprise france, 38 rue de Berri, 75008 Paris, France
• HGH Infrared Systems, 10 rue Maryse Bastié, 91430 Igny, France
• Senstar, Canada
• Dignia Systems Ltd., Israel
• Johnson controls, Suisse
• Netline Communications Technologies, Israel
• SNS groupe, 11 Avenue du Val de Fontenay, 94120 Fontenay-sous-Bois, France
• Castel, 10 route du Bois de la Casse, 49680 Neuille, France
• VIDEOSAFE,55 rue Louis Rouquier, 92300 Levallois-Perret, France
• Synaedge, Suisse
• Reveal, Royaume-Uni
• Zepcam, Pays-Bas
• Securiton (groupe Swiss Securitas), Suisse
• Commend France S.A.S., 155 Rue Dr Bauer 93400 Saint-Ouen France
• IPS Innovative Prison Systems, Portugal
• Intelligent video solution, Etats Unis
• Smiths detection, 36 rue Charles Heller 94405 Vitry-sur-Seine France
• Motorola solutions, Etats-Unis
• LEO Technologies, Etats-Unis
• DEKA, Etats-Unis
• Fusion systems, Japon
• Westminster group PLC, Royaume-Uni
• Sagi France (Telio), 29 Bd Anatole France, 69006 Lyon, France
• Cerbair, 47 rue de la Vanne 92120 Montrouge, France
• Thalès group, 4 rue de la Verrerie 92190 Meudon, France
émissions Carapatage
à retrouver sur carapatage.noblogs.org
• Carapatage #80 Technologie et prison
• Carapatage #79 Enfance sous surveillance dans laquelle il y a une chronique sur la réalité virtuelle dans les prisons aux USA
• Carapatage #43 Emission spéciale #4 dans laquelle il y a une partie sur internet et la communication vers l’extérieur en prison
• Carapatage #27 La vidéosurveillance
La réalité virtuelle dans les prisons aux USA
Chronique tirée de l’épisode #79 de Carapatage
Une personne, quand elle est incarcérée dans les années 80’, à ce moment là on est encore à la fin de la guerre froide. L’URSS existe toujours. Les téléphones sont fixes. Les ordis quasi inexistants. Internet n’existe pas. Il y a une vague d’installation des premières centrales nucléaires donc l’électricité n’est pas du tout aussi abondante qu’aujourd’hui.
Aujourd’hui, où, tout est électrique, tout est numérique, tout passe par internet. Le réseau de caméras se fait toujours plus dense et intelligent dans les villes et les campagnes. Les réseaux sociaux prennent une place énorme. Les caisses de supermarché sont en partie automatisées. Le travail aussi est beaucoup informatisé. Dans le même temps les lois ont bien changé, tout un tas de nouveaux délits sont nés. Les contrôleurs sont accompagnés d’une armée d’agents de sécu dans les transports. Les vigiles sont partout, et les militaires de sentinelle aussi. Etc, etc, etc.
Sortir de prison quand on y a passé tant d’années, surtout alors que la société suit les évolutions toujours plus rapides des nouvelles technologies, c’est faire face à un monde très différent de celui qu’on avait quitté. Un monde face auquel on est perdu-e, et dont on ne sait pas utiliser les outils que tout le monde maîtrise. On est « boomer » malgré nous et bien obligé-e de constater à quel point la prison vole des années de vie. Comme s’il ne suffisait pas déjà de réadapter nos sens abîmés par l’enfermement entre quatre murs et de tenter de rafistoler les liens amicaux souvent brisés par la taule, il faut en plus réapprendre tout les aspects techniques de sa vie.
Mais les enfermeurs adorent se creuser le ciboulot pour chercher à « réinsérer » les personnes qu’ils isolent pendant des années.
Aux États-Unis, la dernière trouvaille pour que ces prisonniers puissent, malgré les murs, arpenter les rues, ce sont les casques de réalité virtuelle. Ces petits bijoux de technologie ultra modernes, ce sont des masques équipés de deux écrans à l’intérieur, qui permettent de simuler un écran en 3D à 360° tout autour de soit.
Au Colorado, depuis 2012, il est devenu inconstitutionnel de condamner des mineur-es à la perpétuité sans leur offrir de conditionnelle.
C’est dans ce contexte là que six personnes, qui ont été enfermées mineures dans les années 80-90, ont passé 3 ans à porter régulièrement des casques de réalité virtuelle pour découvrir une version numérique du monde qui les attend dehors. On simule d’abord des décors, des rues, des intérieurs, pour qu’elles puissent constater à quel point le monde a changé (monde qu’en fait elles ne voient toujours pas, la taule leur montre ce qu’elle veut leur montrer de manière assez grossière et rien de plus). Puis on leur fait apprendre à utiliser les outils informatiques, internet ou le téléphone. Non pas en leur filant un ordi ou un téléphone, ce serait trop simple, mais plutôt en simulant dans le casque de réalité virtuelle un ordi et un téléphone. Faudrait quand même pas leur offrir des sensations tactiles, quoi, faut pas déconner. On leur apprend à gérer leur budget ou encore on les met dans un bar où un type menace de se bagarrer avec elles et on leur demande comment réagir.
Ces personnes là, en fait, le truc le plus proche de l’expérience qu’elles ont quand elles enfilent ces casques, c’est pas le monde hors des murs de la prison, c’est plutôt un film qui est sorti après leur incarcération, c’est Matrix. Pour les préparer à la sortie de la taule, la direction de la taule les met littéralement dans la matrice. Une vision bien dystopique de la réinsertion comme seul les autorités savent le faire.
Ce casque, il est aussi utilisé dans la prison de Jemappe dans le nord de l’État de Washington pour faire suivre à moindre coût aux prisonnières des atelier virtuel de formation à la mécanique auto.
Le géant de la sous traitance carcérale, Global Tel Link (GTL), veut étendre le concept, notamment pour organiser des visites virtuelles dont on imagine facilement qu’elles pourraient remplacer des visites réelles.
Au-delà des murs... (qui s’enrichit sur la machine à enfermer ?)
- tiré de anarchie ! n°6, septembre 2020 –
Lors du mouvement des gilets jaunes de l’année dernière, des dizaines et dizaines de personnes différentes ont soudain été confrontées à ces lieux où l’État pratique loin des regards une torture institutionnelle de masse : la prison. Comme dans n’importe quel mouvement social où des manifestants rompent avec la passivité – qu’il soit ouvrier, lycéen ou de lutte sur un territoire contre un projet nuisible de la domination –, plane en effet très vite le spectre de l’enfermement. Enfermement comme menace qui vise à nous paralyser, bien sûr, mais aussi comme réalité qui peut frapper large, qu’on brise une vitrine ou crame une poubelle, qu’on lance une pierre en direction des flics ou qu’on tente de libérer un autre manifestant de leurs mains, qu’on réplique lors d’une charge ou qu’on sabote une infrastructure du pouvoir.
Face à l’ombre de la prison où croupissent déjà quotidiennement trop d’autres pauvres, réfractaires à l’ordre ou à la propriété, on est ainsi souvent démunis quand on veut apporter notre solidarité enragée à celles et ceux qui sont tombés, un sentiment d’impuissance qui peut aussi se produire lorsqu’un complice ou un ami est envoyé derrière les barreaux pour avoir refusé d’être exploité et a pris l’argent là où il se trouve concentré en abondance, ou pour avoir soustrait de la marchandise sans passer à la caisse. Afin d’alimenter un peu l’imaginaire offensif contre le monstre carcéral et d’offrir quelques pistes à tout individu suffisamment mal intentionné et déterminé à rendre des coups, cette petite rubrique va tenter d’explorer d’autres chemins que de simplement se rendre sous ses murs barbelés.
Tout d’abord, et cela pourrait sembler trivial comme remarque, mais les premiers concernés auxquels on peut s’adresser, à savoir ceux qui portent les clés, appuient sur les boutons d’ouverture des portes, matent derrière l’œilleton ou la caméra, fouillent à corps et en cellule, tirent à vue du haut des miradors et tabassent en groupe – les matons –, ne restent pas toute la journée en prison. Que ce soit sur leur trajet domicile-travail ou au supermarché par exemple, il reste possible de les croiser furtivement pour leur exprimer tout ce qu’on pense de leur tâche de geôlier. Et en parlant de domicile justement, quelques inconnus nous ont également rappelé cet été en Corse que les porte-clés ont autre chose que leur dignité (à laquelle ils ont renoncé en s’engageant dans l’administration pénitentiaire) à perdre : trois véhicules de gardiens ont ainsi été incendiés devant chez eux à Lucciana le 26 juillet, et deux autres sont partis en fumée chez un de leur collègue à Vescovato le 28 juillet.
Mais si les matons (ou les juges) ont des noms et des adresses, ils ne sont pas pour autant les seuls, puisque c’est également le cas des entreprises de BTP qui construisent ces fortifications de béton et d’acier, comme Eiffage, Vinci, Spie Batignolles, Léon-Grosse et Bouygues, dont les bureaux, les utilitaires et les pelleteuses sont disséminés à travers tout le territoire. A la portée de chacun, en somme. En cherchant un peu, dans le même ordre d’idées, il est également possible de dénicher les cabinets d’architectes qui imaginent et planifient les chantiers de prison avec un paquet de fric à la clé. De plus, comme l’État a lancé fin 2018 un vaste plan pour construire rien moins que 15 000 nouvelles places de détention d’ici à 2027, ce ne sont pas non plus les occasions d’attaquer à la source qui risquent de manquer, pour qui entend non seulement s’y opposer en regardant au-delà des murs, mais aussi exprimer sa haine de tout enfermement.
Ensuite, une autre façon d’agir un peu plus loin des barbelés et des miradors est également de se tourner vers toutes les entreprises qui participent à la machine à enfermer en collaborant avec les autorités. Parmi elles se détachent souvent deux multinationales bien frrrançaises, qui sont Sodexo pour la bouffe (en contrat avec 34 prisons françaises plus 70 autres dans le monde) et Gepsa pour un tas d’autres services (filiale du groupe Engie, elle est présente dans 30 prisons et bon nombre de centres de rétention pour sans-papiers). Loin de leur siège social blindé et disposant de véhicules et d’entrepôts un peu partout, ces deux-là offrent une autre piste encore pour rendre un peu de la monnaie de leur pièce à ceux qui s’enrichissent directement sur la peau des reclus. Mais tout ne finit pas là, même si ce tableau est déjà bien écœurant, puisque la gestion du covid-19 en prison nous a révélé une nouvelle piste à explorer en matière de vautours carcéraux.
Au prétexte de l’épidémie, on a ainsi vu non seulement se multiplier les jugements en visioconférence depuis la taule, mais aussi la suppression de la plupart des activités et des limitations de parloirs, laissant pour principal lien un peu fluide avec l’extérieur ce satané téléphone. Depuis mai 2007 (et 2002 en Belgique), avec prolongation par simple avenant de contrat avec l’administration pénitentiaire en 2009, 2015 et 2017, c’était l’entreprise Sagi qui détenait le monopole des appels de prisonniers via les cabines téléphoniques. Sauf qu’au cours de cette période, avec l’arrivée en masse des téléphones portables sur le marché, et notamment leur miniaturisation, ce monopole a été brisé de fait. Mieux encore, l’équilibre entre les impératifs sécuritaires (comme les écoutes) d’un côté, et la course de vitesse technologique entre portables et équipement des taules en brouilleurs, a tourné en faveur de l’auto-organisation des prisonniers. Rien qu’en 2017, plus de 40.000 téléphones et accessoires avaient été saisis à l’intérieur contre un peu moins de 5000 dix ans plus tôt, et les 60% de prisons disposant de brouilleurs en étaient restées à la 2 ou 3G.
C’est d’ailleurs cette année-là que l’État a décidé de mettre le paquet, en alignant les billets, pour tenter de briser toute possibilité autonome des prisonniers de parler avec leurs proches. Il a donc lancé un appel d’offres sur six années à 125 millions d’euros (14,7 pour 2018, 19,9 en 2019, 24,8 pour 2020, 30,6 pour 2021 et 35,5 pour 2022), afin d’acquérir de nouveaux brouilleurs incluant non seulement de larges gammes d’ondes (du wifi jusqu’à la future 5G) mais aussi accroître leur présence. Et devinez qui s’est attribué ce juteux marché en décembre 2017 ? Sagi, bien sûr, en association avec la PME grenobloise Keas, qui équipait déjà en transpondeurs depuis 2016 l’ensemble des bâtiments de la Marine Nationale. Mais ce n’est pas tout, puisque l’État a décidé d’un autre côté d’installer au fur et à mesure des téléphones fixes dans chaque cellule, avec d’onéreuses cartes rechargeables et un nombre limité de numéros appelables et sur écoute, ça va de soi. L’opération est simple, et c’est la même en Belgique et en France : un nouveau contractant va remplacer la Sagi sous forme de concession de service public (CSP) pour installer le nouveau système à ses frais puis se rémunérer sur les forfaits vendus aux taulards. Voici la valeur respective de ces contrats décrochés par l’entreprise allemande Telio pour les prochaines dix années, telle que parue en juin 2018 au journal officiel de chacun de ces deux pays : 78,5 et 23,4 millions d’euros !
Et quand on sait que Telio a racheté en juin 2015 la branche française de Sagi et en 2018 sa branche belge, puis en avril 2019 le roi des (em)brouilleurs Keas, on comprend vite que cette entreprise de Hambourg qui ne compte qu’un peu plus d’une centaine d’employés est devenue en vingt ans « le second plus grand fournisseur de systèmes de communication pour prisonniers en Europe » (soit 600 prisons dans le monde, dont les 250 françaises, 35 en Belgique, 12 en Allemagne,..) Dit autrement, Telio se fait des centaines de millions d’euros en rackettant les conversations téléphoniques des prisonniers tout en les écoutant pour le compte de la police, mais aussi en brouillant pour le compte des matons celles qui leur échappent, tout en profitant du covid-19 pour renforcer un peu plus la déshumanisation avec ses dispositifs de vidéoconférence (pour les parloirs comme pour les comparutions au tribunal ou devant les juges).
Si les rassemblements devant les taules pour des parloirs sauvages ou les feux d’artifice solidaires sont certainement toujours bienvenus pour les prisonniers, on ne peut que constater qu’entre les entreprises de BTP et les architectes qui les construisent, les partis politiques et les journalistes qui les justifient chaque jour, les fournisseurs comme Sodexo et Engie qui s’engraissent dessus, ou Telio et ses branches qu’on a listées ci-dessous parce qu’un peu plus difficiles à dégoter, ce ne sont pas les cibles de notre haine des chaînes qui manquent. Et comme la seule réforme des prisons qui nous va est de les raser au sol avec le monde qui en a besoin et s’en nourrit, allez, à chacun le sien !
Un mutiné de la prison sociale
Sagi France (Telio)
Siège : 29 Bd Anatole France, 69006 Lyon
Entrepôt : 49 cours Vitton, 69006 Lyon
Sagi Belgique (Telio)
Avenue d’Esneux 72, 4130 Tilff
Keas (Telio)
Siège : Parc Scientifique ZA La Bâtie – 175 allée de Champrond, 38330 St-Ismier
Unité de fabrication : Electronic F6 – 163 impasse du Teura, 38190 Bernin
Dirigeant : David Morio
Ingénieur en chef : Laurent Damon
Pour les voyageurs :
Telio Management GmbH – Holstenstrasse 205 – 22765 Hambourg
Président : Oliver Guido DREWS demeurant
Rissener Ufer 16, 22559 Hambourg, Allemagne
Directeur Général : Kai THIEL de meurant
Hammer Dorfstrasse 147/b, 4022 Düsseldorf, Allemagne
Lutte à la MAF de Fleury
Lettre des prisonnières basques sur la lutte en cours à Fleury
- publié le 10 avril 2016 sur paris-luttes.info -
Nous les prisonnières politiques basques incarcérées à la MAF de fleury-mérogis, nous adressons à vous pour vous informer des changements effectués à la MAF avec l’excuse de la mise en route d’un nouveau logiciel qui vise à égaliser les conditions de vie dans l’ensemble de la prison. Ce nouveau fonctionnement touche les jours de parloir, l’accès à la salle de sport, et surtout, à la promenade.
En ce qui concerne les parloirs nous constatons qu’une fois de plus, comme cela avait été fait il y a 8 mois, il y a eu un changement des horaires et une suppression de jours en nous prévenant seulement 15 jours à l’avance, en sachant que nos proches viennent de loin et que l’achat des billets des transports publiques et les réservations d’hébergement pour le mois d’avril ont déjà été faits. La suppression des parloirs des mardis et des vendredis a un grand impact sur nos visites puisque cela empêche nos proches de profiter le long voyage pour faire deux, voire trois, parloirs d’affilé. Une fois de plus nos proches ont dû annuler les billets d’avion et la réservation d’hôtel avec les pertes économiques que cela suppose, lesquelles viennent s’ajouter au grand coût, autant économique que personnel, que la politique de dispersion a pour nos proches et pour nous mêmes depuis des années et des années.
En ce qui concerne la promenade à la MAF il a été mis en fonctionnement un système similaire à celui qui est en vigueur à la MAH, c’est à dire une seule promenade par jour avec alternance matin et après-midi selon le jour soit pair ou impair. En fait depuis quelques années nous assistons à une brutale restriction du temps des promenades. En effet, en 2009 (et nous étions déjà la !) nous avions en horaire d’été 1 heure de promenade le matin et 3 heures les après-midi. Maintenant nous passons de même pas 3 heures de promenade par jour à … 2 heures par jour !! 2 heures qui ne sont même pas réelles puisqu’il faut compter le temps des mouvements dans ces horaires et maintenant il va falloir sortir non 2 ailes mais 3 (parce que toutes les condamnées sortiront en même temps), ce qui peut prolonger les mouvements de plus de 20 minutes pour les dernières.
Tout cela suppose pour nous, les prisonnières, d’être enfermées dès 11 heures du matin en plein été, dans une cellule où la fenêtre ne s’ouvre que de 10 centimètres, sans douche ni frigo, à attendre la promenade de l’après-midi du lendemain (prévue à 13h15). Ce régime est comparable à un régime disciplinaire. Ces mesures sont inhumaines et le fait de vouloir nous enfermer 26 heures d’affilé, sans prendre l’air, sans communication entre nous, sans marcher ou discuter, et surtout le week-end que nous n’avons ni sport ni activité, nous le percevons comme un fait très grave. Ces mesures vont à l’encontre de la dignité humaine et à notre avis représentent une atteinte aux droits de l’homme.
A toutes ces restrictions il faut ajouter les changements à la salle de sport car la direction veut séparer les prévenues et condamnées. En fait maintenant nous ne pouvons plus choisir d’aller au sport soit le matin soit l’après-midi, maintenant nous avons droit à un seul créneau par jour en fonction de la promenade, et évidemment l’accès à la salle est limité à une trentaine de personnes, celle qui n’est pas sur la liste restera enfermée en cellule...
En plus si nous avons d’autres occupations comme les études, les activités, ou les parloirs qui nous empêchent d’aller à la salle, et même en promenade, nous sommes obligées de renoncer à l’activité physique ou à prendre l’air. Franchement, la mise en fonctionnement d’un nouveau logiciel nous semble un argument très faible pour justifier une telle dégradation de nos conditions de vie, surtout quand la séparation entre condamnées et prévenues et pratiquement impossible dans une prison de ces caractéristiques : la séparation ne va pas s’effectuer pour l’école, ni les parloirs, ni les ateliers ni les activités. L’argument de la direction est de vouloir empêcher le « trafic » et pour cela la solution c’est l’enfermement en cellule et l’isolement entre nous.
Depuis des mois nos conditions matérielles se sont dégradées, nous n’avons même plus la trousse mensuelle, plus de service de lingerie, plus de coiffure, la télé a presque doublé son prix en 3 ans, pas de frigo, pas de douche en cellule... et maintenant ce sont les conditions de vie qui touchent notre santé autant physique que psychique. Ici la direction continue à serrer l’étau afin de limiter les mouvements et les échanges entre nous, et de contenter les surveillantes lesquelles, tout soit dit en passant, auront maintenant tout leur temps pour rester assises à rien faire.
Face à tous ces changements nous ne sommes pas restées les bras croisés. Nous avons participé d’un mouvement collectif réalisé le dimanche 3 avril, le jour avant de la mise en route de ce nouveau système. Ainsi, dimanche après-midi plusieurs tours de promenade ont été bloqués, autant côté prévenue que condamnée.
Côté condamnée (au premier tour) 26 femmes sommes restées à la fin de la promenade. Même si nous avons annoncé que le blocage serait de 10 minutes finalement nous sommes restées une bonne vingtaine de minutes entourées de filles qui criaient par la fenêtre et tapaient sur les portes. Bien sûr, des chef et gradées (et même le directeur adjoint) sont venus à la porte nous menacer « qu’ils prendraient des dispositions ». Rien de nouveau, c’est la seule chose qu’ils savent faire : nous menacer avec des représailles. Nous leur avons donné la feuille de revendications signée par plus de 45 personnes (d’autres feuilles tournent encore). Pendant que nous bloquions, les filles du côté prévenue bloquaient aussi, et nous avons regardé amusées les chefs qui surveillaient le mouvement clairement dépassées par la situation.
Les mineures, qui sont en ce moment une bonne douzaine, ont spontanément décidé de bloquer la promenade aussi. Elles sont restées pendant 10 minutes à chanter et danser pendant que les chefs (qui ne sont pas sortis en promenade avec les majeures), sortaient pour les faire rentrer. Simultanément, le deuxième tour de promenade du côté prévenue a bloqué aussi. Nous ne savons pas encore combien de femmes ont participé de ce blocage, nous savons que minimum 4 tours de promenade ont suivi.
Une fois toutes enfermées en cellule un grand tapage de portes a commencé et toute la prison s’est convertie en une grande protestation sonore. Cela a tapé partout pendant presque une heure sans interruption. Les chefs et gradées sont venues ouvrir quelques portes pour nous menacer à nouveau : « Si vous continuez à taper vous finirez au mitard ». On tremble. Finalement, nous avons réalisé un refus de plateau collectif.
Nos demandes sont de maintenir les deux tours de promenade matin et après-midi, surtout pour le week-end. Nous vous informerons de la suite du mouvement. Pour l’instant nous faisons un appel à la solidarité de l’extérieur avec l’envoi du texte qui suit par courrier, e-mail ou fax au directeur adjoint de la MAF :
« M. Parscau,
Les conditions de vie que vous voulez imposer à la MAF de Fleury-Mérogis constituent une atteinte à la dignité humaine. Le système de promenade unique et alternée suppose un enfermement (dans une cellule sans aération, sans douche et sans frigo) qui peut se prolonger pendant 26 heures les jours où il n’y a pas d’activité ni sport (ce qui arrive souvent), et surtout le week-end. Je réclame des condition dignes et que les demandes des prisonnières soient prises en compte. »
Adresse :
M.Parscau – Directeur adjoint à la MAF
MAF de Fleury-Mérogis
9, Avenue des Peupliers
91 705 Saint-Geneviève-des-bois Cedex
Fax : 0033-169460336
E-mail : ce n’est pas posible
Note
Les blocages ont continué le lundi mais le lendemain, de nombreuses femmes ont été convoquées par la direction pour être intimidées : menaces de transfert disciplinaire, de suppression des remises de peines, etc. Bref les chantages habituels. Mais ça continue ce week-end ! Samedi une cinquantaine de femmes bloquaient la cour de promenade !
A l’intérieur comme à l’extérieur c’est les mêmes logiques répressives qui nous sont destinées : il s’agit de tuer ce qu’il reste de lien et de solidarité entre nous, nous isoler davantage... Combattons les !
Suite de la lutte à la MAF de Fleury-Mérogis
- publié le 12 avril 2016 sur paris-luttes.info -
À Fleury-mérogis, le 11 avril 2016
Bonjour,
Une grosse salutation de la MAF de Fleury-mérogis à toute l’équipe de l’envolée avant de commencer. Aujourd’hui nous vous écrivons pour vous informer de la suite du mouvement contre l’implantation du système de promenade unique qui a démarré le dimanche 3 avril.
Ce dimanche-là, comme nous vous l’avions déjà raconté, 4 tours de promenade ont été bloqués pendant plus de 10 minutes. En tout, plus de 80 personnes ont participé à ces blocages. Au tapage de portes a suivi un refus de plateau et à peu près 100 signatures ont été envoyées aux chefs.
Lundi et mardi les blocages ont continués avec des affiches en promenade en mobilisant une cinquantaine de personnes. Et pendant ces jours l’administration pénitentiaire a fait, bien sûr, son boulot de flic. Toutes les femmes qui avons participé aux blocages nous sommes faites appeler par le chef et chacune d’entre nous a eu droit à sa menace personnalisée. La menace principale concerne les RPS, après le changement d’affectation et les transferts disciplinaires, et finalement la commission disciplinaire et le mitard.
Le directeur adjoint et le chef de détention nous ont reçu pour nous dire qu’ils n’ont pas l’intention de revenir sur le système de 2 promenades par jour et qu’ils sont en train d’analyser si c’est possible de le faire pour le week-end, mais ils voulaient absolument qu’on arrête le mouvement avec la menace de représailles dans le cas contraire. A leurs dires, ils vont faire quelques « ajustements » pour les personnes qui vont à l’école (ce qui n’arrange rien et concerne très peu de femmes). Mais pour le reste ça se maintient comme ça. Comme ils ont vu que le mouvement continuait ils n’ont pas appliqué, pour l’instant, la séparation entre prévenues et condamnées pour la salle de sport.
De notre part nous avons fait des nouvelles propositions (accompagnées des signatures) qui peuvent bien se mettre en place en gardant le système actuel :
Nous nous sommes montrées prêtes à accepter la promenade unique mais à condition que pour les jours où nous sortons l’après-midi nous enchaînions notre tour de promenade avec celui des travailleuses, c’est à dire, de 13h15 à 17h30, et surtout de garder les deux tours de promenade pour le week-end. Ce qui pour l’instant a été refusé en disant que 4 heures de promenade leur semblait beaucoup, que dans la loi c’est marqué une heure et comme ils sont si généreux ils nous en « donnent » deux. Après avoir passé toute la semaine avec ce nouveau système nous avons constaté qu’en comptant les mouvements ces deux heures deviennent en pratique 1h30-1h40.
Mais ce changement touche plus d’aspects que nous le pensions auparavant. Maintenant nous sommes 3 ailes à sortir ensemble ou à rester enfermées en même temps ce qui veut dire que du côté condamnée nous sommes à peu près 80 personnes pour 2 seules cabines téléphoniques. Résultat : appeler devient une chimère.
Pour limiter encore plus les mouvements des prisonnières, maintenant il n’y a plus de premier appel, c’est à dire, impossible de sortir prendre l’air une petite heure et enchaîner avec une activité ou le sport qui pourrait prolonger un peu le temps qu’on reste hors de la cellule. Résultat : il n’y a presque plus personne aux activités, ce qui, bien sûr, les arrange bien. En plus, maintenant le médical fonctionne par rendez-vous et si celui-ci coïncide avec la promenade on reste bloquée en cellule sans pouvoir sortir en promenade ni aller au sport.
Dans un courrier antérieur nous vous disions que maintenant les surveillantes auraient tout leur temps pour rester assises à rien faire, excusez-nous de notre naïveté, La nouvelle occupation des surveillantes c’est les fouilles de cellule. Depuis la mise en place de ce nouveau logiciel tous les jours il y a des fouilles dans toutes les ailes. Les premières à y avoir droit avons été celles qui avons participé aux blocages.
Le mouvement de protestation continu malgré les menaces. Ainsi le samedi 9 avril nous avons mis une grande pancarte en promenade et nous avons bloqué à nouveau pendant 10 minutes. Côté condamnées nous étions 23, avec quelques désertions de dernière minute quand les gradés sont sortis faire la pression. Côté prévenue 35 femmes sont restées. Dimanche nous étions 15 personnes du côté prévenue.
Nous savons qu’il y a eu plein de lettres de solidarité qui ont été envoyées et nous espérons que cela continuera jusqu’à l’obtention de nos demandes. Ici, nous continuerons à nous battre contre ce système assassin qui nous étouffe de plus en plus. Les menaces font leur effet sur quelques unes, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu’ils peuvent s’acharner sur des personnes isolées, mais ils ne peuvent pas déplier leur machinerie répressive quand nous restons ensemble et soudées. Merci de votre soutien et attention. À bientôt.
Prisonnières politiques basques incarcérées à la MAF de Fleury-mérogis
Compte-rendu du rassemblement à la MAF de Fleury-Mérogis
- publié le 18 avril 2016 sur paris-luttes.info -
Samedi nous nous sommes retrouvé-es à 13h devant la Maison d’Arrêt des Femmes de Fleury-Mérogis. Le centre pénitentiaire de Fleury c’est un complexe énorme qui s’étale le long de l’avenue des peupliers, les femmes sont tout au bout de cette voie sans issue.
Nous étions 60 ! La plupart des gens s’y sont rendus par leurs propres moyens, toutefois un départ groupé était prévu à 11h place de la République. Nous étions une douzaine dans une place vidée et massivement occupée par les flics...
Devant la MAF les premières familles et ami-es de détenues attendent le tour de parloir. Le temps que tout le monde arrive, on tracte, on discute avec les proches qui sont surpris et contents de voir un rassemblement en solidarité avec les femmes incarcérées devant les portes de la prison. C’est assez rare...
On sort des banderoles, on commence à faire du bruit, à crier des slogans sur le rythme d’une percussion et de quelques pétards « des parloirs tout le temps, des promenades tout le temps, téléphone tout le temps, liberté tout de suite », « de l’air pour les prisonnières », « vos logiciels on s’en fout on veut plus de prisons du tout ! » (etc), et en basque aussi « presoak kalera, amnistia osoa » ! Certaines entonnent l’hymne du Mouvement de Libération des Femmes !
La voiture de ronde de la prison nous observe de loin mais finit par repartir. Pas de flics, pas de matons.
Une brève averse nous replie sous le auvent de l’accueil des familles, certain-es se payent un café à la machine. Et puis c’est reparti de plus belle ! D’autres personnes arrivent au fur et à mesure pour le 2e et dernier tour de parloir. C’est l’occasion de discuter encore.
A l’approche de 15h le premier tour de parloir sort, on les accueille avec énergie, certain-es nous saluent et reprennent nos slogans. On attend que le dernier tour de parloir rentre à son tour pour lancer un dernier pétard et partir en manif jusqu’à la maison d’arrêt pour hommes. Là-bas il y a beaucoup plus de monde à l’entrée des parloirs, les gens sont curieux et enthousiastes. Un fourgon cellulaire de la pénitentiaire est hué. Il est 15h30, avant de partir on raconte un peu pourquoi on est là et les gens écoutent avec beaucoup de sympathie !
On attend des nouvelles, mais déjà on sait que notre solidarité a été entendue de l’intérieur !
Lettre du 04 mai 2016 depuis la prison pour femmes de Fleury-Mérogis
- publié le 5 mai 2016 sur paris-luttes.info -
Bonjour,
Nous vous écrivons de la MAF de Fleury-Mérogis pour vous informer des changements effectués par la direction concernant les horaires de promenade après le passage au système de promenade unique et de la suite des mouvements que nous, les prisonnières, avons réalisés.
Nous constatons que le but de l’Administration Pénitentiaire est de restreindre les mouvements des prisonnières au minimum. Le système mis en place nous oblige à choisir entre prendre l’air 2 petites heures ou réaliser une autre activité que ce soit sportive ou culturelle. Si notre activité, et même notre parloir, coïncide avec la promenade ce jour-là nous ne sortons pas. Le week-end, comme nous vous l’avions déjà communiqué, il n’y a pas d’activités et, par contre, il y a souvent des parloirs, alors nous restons enfermées en cellule pendant des heures et des heures à attendre la promenade du lendemain. Alors nos demandes sont soit de remettre en place les deux promenades par jour, soit de prolonger le temps de la promenade de l’après-midi.
Après les protestations que nous avons réalisées ces dernières semaines le directeur adjoint, M. Parscau, nous avait demandé du temps pour faire quelques « ajustements » et pour réfléchir sur nos demandes concernant le week-end. Pendant ce temps quelques blocages ont été réalisés. Le week-end du 16 avril nous étions 6 personnes du côté condamné et 34 du côté prévenu encouragées par le soutien reçu de l’extérieur. Ce samedi-là nous avons entendu les cris des manifestant-es au loin et de l’intérieur nous avons essayé de nous faire entendre, ce qui nous a valu d’être escortées jusqu’aux parloirs sous la menace d’interrompre nos parloirs si nous persistions à crier. Nos proches nous ont transmis avec joie l’ambiance de l’extérieur, pour eux aussi c’est important de sentir que nous ne sommes pas seules dans notre lutte.
Et pendant ce temps la répression a continué. La Commission d’Aménagement des Peines (CAP) du mois d’avril est passée. Des permissions de sortie et l’octroi de remise de peines ont été refusés pour plusieurs femmes ayant participé aux blocages. Après il s’est avéré qu’il y avait des documents manquants ou d’autres raisons pour ces refus, mais ils se sont bien chargés de noter les blocages comme en étant la cause. De notre côté nous avons décidé de rester systématiquement les deux heures en promenade, pas une minute de moins, ce qui nous coûte des tensions et des rapports au quotidien, mais au moins nous avons constaté que les matonnes ne se permettent pas de raccourcir autant le temps de la promenade.
Finalement, le résultat des profondes réflexions de la direction est arrivé et les « ajustements » se sont traduits par la mise en place d’un premier appel et la possibilité de réintégrer la promenade si on se trouvait ailleurs à condition qu’il reste au moins 20 minutes avant la fin. Concernant le week-end... maintenant les samedi et dimanche nous sortirons les après-midi de 15h00 à 17h00 !! C’est à dire que maintenant nous passerons toute la matinée enfermées. Ce changement n’arrange en rien notre situation, et pire, nous montre que la direction reste fixée sur le système de promenade unique de deux heures.
Pas étonnant, avec ces gens c’est impossible de raisonner. Nous parlons de conditions de vie dignes, ils parlent de règlement. Nous parlons d’entraide, de partage, eux parlent de « trafic ». Nous parlons d’humanité, ils parlent de textes de loi. Nous parlons de besoin de communiquer, de discuter, de se rencontrer, eux parlent de sécurité et d’isolement. Ils font leur loi, ils créent des systèmes de contrôle qui naissent des besoins de réprimer les problèmes qu’ils ont eux-mêmes créé, c’est la machine qui s’alimente elle-même. C’est en nous menant à bout et en créant des tensions qu’ils justifient leur dérive sécuritaire et répressive.
Nous continuerons à nous battre pour des conditions dignes à l’intérieur comme vous le faites à l’extérieur. En espérant vous entendre à nouveau le samedi prochain nous envoyons une forte accolade enragée et solidaire à toutes celles et ceux qui luttent et résistent.
Répression à la MAF de Fleury-Mérogis et Compte-rendu du deuxième rassemblement
- publié le 13 mai 2016 sur paris-luttes.info -
Nous nous sommes retrouvé-es à 13h devant la Maison d’Arrêt des Femmes, arrivé-es par nos propres moyens, ou au départ du rendez-vous de co-voiturage.
Nous étions 30, deux fois moins que la première fois mais tout autant d’énergie ! Avec quelques instruments de musique, une sono, des tracts, des banderoles... et du soleil !
On reconnaît quelques familles qui attendent le premier tour de parloir à 13h30, toujours aussi contentes de nous voir ! Il n’y a pas beaucoup de monde pour les visites, mais chacun, indigné, écœuré, ou révolté partage le même sentiment d’injustice et d’impuissance face à la prison. Alors on échange quelques mots pour se donner de la force.
Un petit discours pour contextualiser notre présence, la lecture de la dernière lettre reçue, et c’est parti pour faire du bruit ! « solidarité avec les prisonnières, et leur famille, et leurs amie-es », « pas d’régime disciplinaire, de l’air pour les prisonnières », « tout le monde déteste la justice et la prison », des chants (dont un en polyphonie !), des cris, tout fuse !
Entre les deux tours de parloir on décide de partir en cortège jusqu’à la maison d’arrêt des hommes. Là-bas il y a beaucoup plus de monde qui attend le parloir, c’est très dynamisant, les gens se joignent à nous pour taper dans les mains, reprendre les slogans !
On prend la parole pour expliquer notre présence, lire la lettre des prisonnières, ça fait écho à tout le monde et d’ailleurs, quelques personnes s’expriment spontanément pour dénoncer l’humiliation et la violence que les prisonniers et leurs proches subissent, pour dénoncer aussi les peines de prison systématiques pour les petits délits, le manque de moyens et l’absence de réinsertion.
On repart vers la MAF plein d’entrain, c’est le dernier tour de parloir, et à 15h c’est le début des promenades pour les détenues. Alors on décide de mettre le paquet avant de repartir vers 15h30 !
On fait du bruit, du bruit, du bruit !
...
Malheureusement le vent et contre nous et à l’intérieur on ne nous a pas entendu (c’est pour ça que nos voix portaient si bien du côté contraire !)... Il n’y a que les retours de parloir, et le téléphone qui donneront le récit de notre présence.
A l’intérieur plusieurs femmes ont prévu de bloquer la fin de la promenade à 17h, autant côté prévenu que condamné. Mais l’heure arrive, les prévenues résistent jusqu’aux deux heures puis abandonnent, peut-être suite à la pression d’un gradé particulièrement zélé. Du côté des condamnées elles sont 9 à bloquer. Elles bloquent 15 minutes, et comme les chefs arrivent pour leur dire c’est fini, elles restent 15 minutes de plus.
Le lendemain, 4 femmes sont convoquées par les chefs pour un rapport d’enquête.
Lundi, ces 4 femmes reçoivent une convocation au prétoire (commission disciplinaire) pour le mercredi 14h (un délai de 48h est obligatoire).
Mercredi, 3 femmes sont condamnées au mitard, la 4e au confinement, pour une durée de 14 jours.
A priori d’autres commissions disciplinaires pourraient avoir lieu la semaine prochaine...
Face à la répression de l’administration pénitentiaire qui commence à se déployer, soyons solidaires des prisonnières et de leur lutte, continuons d’envoyer/faxer des courriers de protestation à la direction de la maison d’arrêt pour mettre fin à la dégradation des conditions de détention et aux mesures disciplinaires.
Soyons nombreux à écrire aux 4 femmes qui sont actuellement au cachot ou en confinement. En attendant de pouvoir transmettre leurs coordonnées, vous pouvez nous adresser vos lettres par mail à commissionprisonnuitdebout@riseup.net,
Force, Courage et Détermination !
D’après l’épisode #80 de l’émission de radio Carapatage de décembre 2024
ce texte est aussi consultable en :
- MP3 par téléchargement, en cliquant ici (95.3 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (9.4 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (9.4 Mio)