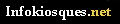Brochures
Comment la police interroge et comment s’en défendre
mis en ligne le 9 avril 2025 - projet-evasions
Privilégier le texte en format pdf à lire sur l’écran :
Un interrogatoire n’est pas un échange harmonieux et égalitaire entre deux individus. C’est un conflit.
Introduction
Comprendre pour se défendre
Notre ignorance fait leur force.
Cette phrase résume parfaitement ce sur quoi se base un interrogatoire de police : sur notre ignorance. Ignorance sur le sens du travail de la police, ignorance sur les techniques de manipulation utilisées, ignorance sur le cadre juridique et enfin ignorance sur nos moyens de défense. Un interrogatoire n’est pas un échange harmonieux entre deux individus se plaçant dans un rapport d’égalité. C’est un conflit. Contrairement à un conflit physique où une personne utilise sa force pour attaquer l’autre, dans un interrogatoire la police exploite tes propres faiblesses pour les retourner contre toi et t’attaquer avec. Ce sont les informations livrées par la personne elle-même qui permettront à la police et à la Justice de la frapper – en aiguisant leurs stratégies et manipulations pour des futurs interrogatoires ou sous forme de preuves et d’indices devant un tribunal. On touche ici à un point central pour comprendre comment se défendre : pour mener à bien son travail, la police a besoin de la participation de la personne interrogée. Avec le temps, j’ai fait un constat ; la majorité des personnes qui livrent des informations permettant à la police de faire son travail ne se considèrent pas elles-mêmes comme des « balances ». Bien plus, ils·elles pensent n’avoir rien dit d’important, avoir parlé uniquement d’elles·eux-mêmes, n’avoir eu rien à se reprocher ou même avoir réussi à berner la police en mentant. C’est là tout le propos de cet ouvrage : la meilleure défense lors d’un interrogatoire de police est de refuser d’y participer en gardant le silence.
C’est un propos que je vais répéter souvent dans les pages qui suivent, mais c’est un propos qui a besoin d’être répété encore et encore. Car en face, la police dispose de tout un arsenal de techniques et de stratégies de manipulation pour exploiter tes faiblesses, de possibilités d’enfermement à travers les gardes à vue et détentions provisoires pour t’épuiser et te fragiliser. À cela s’ajoute une culture populaire où l’on intériorise que l’on DOIT répondre quand la police, figure d’autorité, pose des questions.
« Pour mener à bien son travail lors de l’interrogatoire, la police a besoin de la participation de la personne interrogée. »
Avant de continuer, un avertissement
Ce livre n’est pas pensé pour être un guide juridique.
Il s’adresse à un public de différents pays où les législations ne sont pas toujours les mêmes. Toutefois, ces différences juridiques n’affectent que très peu le contenu que je transmets et n’influencent en rien son propos. Les mécanismes et stratégies d’interrogatoire développés par les différents services de police se sont unifiés au fil des années et des échanges entre services et pays. Aujourd’hui inspecteurs et inspectrices de police du monde entier débattent et affinent ensemble leurs méthodes de manipulation lors de congrès et colloques de police ou dans des revues spécialisées. Néanmoins, les stratégies et pratiques analysées et présentées dans les pages qui suivent ont été développées essentiellement par des policiers·policières travaillant dans des pays occidentaux et ce livre reflète donc plutôt une réalité occidentale d’une démocratie capitaliste.
Deuxième avertissement
Ce livre décrit une pratique générale et non la manière exacte dont va se dérouler ton expérience si tu es confronté·e à la police.
Ce livre montre ce que la police apprend et développe comme stratégie d’interrogatoire. Ce qu’apprennent les inspecteurs·inspectrices ne sera pas toujours exactement ce qu’ils·elles vont mettre en pratique. Néanmoins, dans les grandes lignes, ça devrait rester très proche de ce qui va être décrit ici.
Le contenu de ce livre est issu de plusieurs sources
• La littérature policière et forensique, notamment des supports de cours d’académies de police, des revues spécialisées ou des livres de vulgarisation écrits par des inspecteurs (tous les ouvrages que j’ai eu entre les mains ont été écrits par des hommes).
• L’étude et l’analyse de cas de répression concrets, de dossiers d’enquête en cours ou déclassés.
• Mon expérience personnelle ainsi que celle de mon entourage proche à travers les interrogatoires que nous avons subis.
À propos du langage utilisé
Le fait que la police reste une institution reposant sur des schémas profondément virilistes (punition, contrainte, contrôle et surveillance) et défendant un système patriarcal n’empêche pas la majorité des unités de police de recruter des femmes. Ainsi, pour ne pas reproduire la domination du masculin sur les autres identités de genre, j’ai écrit mon texte en langage épicène. En plus de poser le masculin au-dessus du féminin, le langage français impose une binarité violente du monde : rien n’existe en dehors des genres masculins et féminins. Pour ma part, je conçois le terrain de nos identités comme bien plus vaste, même si je n’ai pas trouvé de manière entièrement satisfaisante de le transposer par écrit.
À la fin de l’ouvrage se trouve un lexique regroupant les termes techniques. Ceux-ci sont surlignés dans le texte lors de leur première apparition.
À propos de la police
Ce livre est pensé comme un outil d’auto-défense contre la pratique policière de l’interrogatoire. Il est écrit dans une perspective anarchiste. Je défends l’idée que toute autorité est illégitime et représente une entrave à une vie libre, définie selon les propres besoins et envies de chaque individu.
Ainsi en va-t-il de la police, qui est une structure essentielle sur laquelle s’appuient tous les systèmes autoritaires. À chaque époque où elle a existé, la police fut l’institution réprimant avec violence les tentatives de changements radicaux et émancipateurs. La police et la Justice sont dans leurs fondements les plus profonds des institutions réactionnaires et anti-émancipatrices. Lorsque des personnes cherchent à pratiquer l’autodéfense face aux menaces les concernant, l’État les désarme et s’impose comme protecteur, le plus souvent inefficace [1]. Là où des personnes concernées par un conflit ou une oppression cherchent des résolutions réparatrices, la Justice s’impose comme arbitre et s’accapare le droit de décider seule de la solution à adopter. À travers la fonction sociale de la police, l’État mise sur le contrôle, la dépendance à ses institutions et la punition tout en empêchant la création de dynamiques basées sur la confiance, l’autonomie et la transformation. Non seulement la police et la Justice sont une réponse insuffisante aux agressions et oppressions interhumaines mais elles les reproduisent et les alimentent. Il ne s’agit pourtant pas de lutter contre la police en faveur d’autres formes d’autorité (leader maffieux, gouru, agresseurs·agresseuses), mais de lutter contre le concept même d’autorité sous toutes ses formes.
I) Avant l’interrogatoire
Ce chapitre explique quelle place l’interrogatoire occupe dans l’ensemble du processus de la Justice et quels en sont les enjeux.
1. Les contextes d’un interrogatoire
Plusieurs critères influencent le déroulement d’un interrogatoire. Premièrement, le pays dans lequel tu te trouves. Toutes les polices n’ont pas le même cadre légal ni la même marge de manœuvre. Ensuite la gravité posée sur l’affaire en question. Est-ce qu’il s’agit d’une « banale » affaire de stupéfiants ou est-ce que l’enquête est placée sous le coup de lois antiterroristes ? Peut-être les enquêteurs·enquêtrices vont bâcler l’affaire ou au contraire la prendre très au sérieux suite à la mise sous pression de leur hiérarchie. Il va sans dire que si tu es interrogé·e dans le cadre de violences contre les forces de l’ordre à la suite d’une manifestation par exemple, il y a des chances pour que les inspecteurs·inspectrices le prennent plus personnellement que s’il s’agit d’un vol dans la caisse de ton entreprise. Tous ces critères, ainsi que l’humeur du jour des policiers·policières qui vont t’interroger, ou leur expérience, vont influencer la suite du déroulement. Ainsi, un interrogatoire peut tout autant être un ennuyant moment administratif qu’un instant de tension énorme.
De manière générale, les hiérarchisations habituelles de nos sociétés sont, sans surprise, reproduites dans le comportement de la police et de la Justice. Spoiler alerte : les institutions policières reproduisent les violences structurelles et systémiques que sont par exemple le racisme, le sexisme et l’homophobie. Il y a de fortes chances pour que les agent·es de police que tu rencontres aient des comportements racistes, antisémites, sexistes et homophobes. Pourquoi ? Parce que les sociétés qu’ils·elles défendent sont structurellement racistes, antisémites, sexistes et homophobes et que, par conséquent, cela attire des personnes aux idées racistes, sexistes, antisémites et homophobes [2].
À travers les oppressions systémiques, les structures de pouvoir rendent certains corps plus vulnérables que d’autres. Ces vulnérabilités peuvent également jouer un rôle dans la confrontation que représente un interrogatoire. C’est le privilège de la personne qui s’inscrit dans les normes de la société : ne pas porter le poids mental quotidien de la discrimination.
Faire face au racisme, à l’islamophobie, la transphobie ou d’autres formes de discrimination alourdit la charge mentale liée à une telle épreuve.
Enfin, les circonstances de l’arrestation peuvent affecter ta capacité à faire face à l’interrogatoire. Ton état émotionnel ne sera pas le même s’il s’agit d’une arrestation en pleine rue, sous adrénaline ou d’une convocation reçue par courrier plusieurs jours à l’avance. Se faire réveiller de manière soudaine lors d’une perquisition et se faire interroger peut engendrer une sensation de grand désarroi, surtout si le réveil a eu lieu durant le nadir, le moment le plus profond du cycle du sommeil.
De façon similaire, être enfermé·e dans une cellule de garde à vue pendant plusieurs heures ou jours peut considérablement affaiblir ta capacité de résistance. À l’inverse, une connaissance des procédures de police et des interrogatoires peut t’aider à te défendre.
Tous ces facteurs déterminent les grandes lignes du contexte dans lequel ton interrogatoire va être mené.
2. Le fonctionnement de la Justice
Pour bien comprendre le rôle de l’interrogatoire dans une procédure juridique, il est nécessaire d’examiner la place de la police dans le processus de Justice. Dans la plupart des pays, le processus judiciaire est composé de trois acteurs : la police, les procureurs [3] et les juges. Chacune de ces institutions a une fonctionnalité différente et se place dans un rapport hiérarchique par rapport aux autres.
La police
La police est l’acteur principal de l’action de sécurité [4]. En plus de maintenir l’ordre et de surveiller de potentiels criminels, la police récolte des informations pour les tribunaux. Ces informations permettent ensuite aux tribunaux de juger si une personne a enfreint une loi et de décider de la punition qu’elle subira. Dans ce processus, l’institution policière se trouve en bas de l’échelle hiérarchique, reléguée à la tâche de terrain de collecter des informations. Les policiers·policières constituent un dossier d’enquête composé du maximum d’éléments, afin de donner l’image la plus large et précise sur des faits, leurs déroulements, le contexte, les personnes impliquées ainsi que leurs motivations, rôles et intentions. Lorsque la police estime ne plus être en mesure de récolter de matériel supplémentaire, le dossier d’enquête est bouclé et transmis au·à la procureur. Un dossier d’enquête qui n’est pas assez fourni est synonyme de mauvais travail de la part de la police. Cela montre que l’enquête n’a pas été menée de manière assez efficace pour permettre à un·e juge de se prononcer. Ce qui est positif pour la personne qui se retrouve sur le banc des accusé·es.
Procureur / ministère public / juge d’instruction
Une fois bouclé, le dossier d’enquête est transmis au·à la procureur. Son travail est d’évaluer si le dossier comporte, ou non, assez d’éléments pour un jugement/condamnation. Suivant les pays, pour certaines affaires légères, le·la procureur peut directement proposer une condamnation sans passer par la case tribunal. En se basant sur le dossier, une peine va être proposée à la personne inculpée qui pourra l’accepter ou y faire opposition et ainsi renvoyer l’affaire devant un·e juge. Cette pratique est appelée ordonnance pénale et a surtout été mise en place pour décharger les tribunaux d’une partie de leur travail.
Le·la procureur peut décider de mener lui·elle aussi des interrogatoires, pour se faire une idée plus précise et directe qu’au travers de l’unique lecture du rapport d’enquête. Il·elle pourra chercher à acquérir de nouvelles informations et anticiper les axes de défenses que tu vas choisir en cas de procès.
Si le·la procureur estime que le dossier d’enquête ne donne pas assez d’éléments pour permettre une condamnation, il·elle peut soit classer l’affaire, soit renvoyer le dossier à la police avec des demandes de compléments d’informations. Cela peut être perçu comme un blâme pour la police. Souvent, le·la procureur collabore déjà durant l’enquête avec les enquêteurs·enquêtrices en redirigeant l’enquête dans telle ou telle direction, ou en ordonnant des mesures précises (mise sous écoute, perquisition, élargissement du cas à d’autres affaires en cour, etc.)
Juge
À partir du moment où le·la procureur estime à son tour que le dossier est complet, il·elle le transmet au tribunal, où un·e juge se saisit de l’affaire et prépare un procès.
C’est seulement à partir de cette étape que tu peux consulter ton dossier d’enquête pour connaître les informations utilisables contre toi lors du procès.
Lors du procès, le·la juge (ou le jury selon les pays) va rendre son jugement en se basant sur le dossier d’enquête et en t’interrogeant à nouveau ainsi que d’éventuel·les co-accusé·es et/ou témoins. Le verdict sera choisi en fonction de ce qui est prescrit dans les lois et les jurisprudences ainsi que du contexte de l’affaire (et l’humeur du jour du·de la juge). Selon les pays, il est possible de faire opposition à une condamnation et ainsi faire rejuger l’affaire. Cela revient à renvoyer le dossier devant un autre tribunal pour y être rejugé. Durant ce temps, de nouveaux éléments peuvent être ajoutés au dossier d’instruction, par la défense comme par l’accusation.
Le travail de la police est de remplir un dossier d’enquête te concernant avec le maximum d’éléments à l’intérieur. Ces éléments seront notamment récoltés grâce aux interrogatoires.
Les policiers·policières ne vont pas poser de verdict par rapport à ta culpabilité ou à ton innocence. Cela n’est ni dans leur cahier des charges, ni de leur ressort.
Une erreur dont j’ai souvent été témoin est que des personnes interrogées tentent de convaincre les policiers·policières qu’ils·elles sont innocent·es en espérant ainsi se tirer d’affaire. Et c’est exactement le piège qui leur est tendu. Leur besoin de s’expliquer, de se trouver des excuses, des mensonges, bref leur besoin de convaincre les enquêteurs·enquêtrices d’une certaine version des faits les poussent à collaborer avec la police. Des réponses (mensongères ou non) sont données, des explications (vraies ou fausses) sont livrées, des demi-vérités sont fournies. Autant d’éléments qui vont permettre à la police de faire son travail : enquêter, vérifier, valider les explications de la personne interrogée, corréler, analyser et construire des hypothèses permettant de rediriger les futures recherches.
Il n’est pas dans le cahier des charges de la police de statuer sur ton innocence ou sur ta culpabilité. À partir du moment où un dossier d’enquête est ouvert, il sera soit transféré à l’échelon hiérarchique supérieur, soit le dossier sera classé sans suite si l’enquête n’a pas fourni assez d’éléments pour poursuivre l’instruction et appeler à un procès. Si tu souhaites convaincre l’un des acteurs du processus de justice de ton innocence, réserves cela uniquement pour le·la juge lors du procès en présence de ton avocat·e. Toute autre démarche te met en danger.
« En général, si tu procèdes à une arrestation c’est que tu as un minimum de preuves. Toutefois, ces preuves ne sont pas toujours suffisantes pour mettre en examen l’individu. De plus, la mise en examen requiert a minima d’avoir entendu le suspect sur les faits lorsque cela est possible » [5]
Présomption d’innocence
La présomption d’innocence est un principe général selon lequel toute personne suspectée d’avoir commis une infraction à une loi est considérée comme innocente tant que sa culpabilité n’a pas été juridiquement établie. Puisque dans la majorité des pays, le·la juge est la seule autorité à pouvoir se prononcer sur la culpabilité d’un individu, cela signifie que tu seras juridiquement uniquement coupable à partir du moment où un·e juge pose ce verdict lors d’un procès. Avant ce moment, tu es prévenu·e, donc soupçonné·e d’avoir commis une infraction.
Ce concept juridique se fonde sur l’article 11 de la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 de l’ONU qui le formule de cette façon :
« Article 11. Toute personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d’un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. [...] »
Aujourd’hui, de la Russie à l’Iran en passant par les USA et la France, presque tous les pays l’ont intégré d’une manière ou d’une autre à leurs codes pénaux et constitutions. La manière dont ils s’y tiennent reste sujet à interprétation. Concrètement, cela implique que c’est à l’état (procureur, police) que réside la charge de rassembler les preuves de ta culpabilité et non à toi de prouver ton innocence. Le travail de la police est de prouver ta culpabilité (ou celle d’autrui). Et chaque élément, chaque information que tu leur donnes les aide à avancer dans ce travail.
« Avant de commencer l’audition, on a généralement déjà un contenu, qui oriente très nettement la suspicion, et donc quelque part vous démarrez une audition en vous disant “il est le coupable”. Mais on va respecter quand même le principe de la présomption d’innocence, car on lui accorde le droit de n’être que suspect, mais dans notre mentalité on est déjà loin dans la suspicion et les indices au moment où on parle avec »
« C’est de la vérité judiciaire la présomption d’innocence, c’est pas de la réalité de terrain. Dès lors que je suis en possession d’indices si importants, j’agis comme s’il était déjà coupable, je dois l’admettre oui. Ça n’empêche pas d’être respectueux et correct, mais bien sûr qu’il est présumé coupable. Mais si on a le moindre doute, on va travailler aussi dans l’autre sens. On peut enquêter dans les deux sens hein, on le fait : 95% à charge et 5% à décharge. La présomption d’innocence n’a pas d’intérêt dans le travail policier. D’autres en ont : le respect des droits, de l’intégrité de la personne, mais la présomption d’innocence n’a aucun intérêt pragmatique. Un intérêt légal mais rien de plus »
Construction parallèle
Imagine qu’un informateur recruté par la police avertit cette dernière avoir connaissance du fait que deux personnes ont commis un crime. Suite à cette information, la police procède à des perquisitions au domicile de ces deux personnes, y trouve des indices de leur culpabilité et place le duo en garde à vue. Des écoutes téléphoniques sont faites dans leur entourage, suite auxquelles les policiers·policières apprennent qu’une troisième personne a également participé au délit en question. Toutefois, dans l’urgence, aucune demande d’autorisation de mise sous écoute n’a été faite au juge (ou procureur ou ministère public selon la juridiction du pays en question). Lors des interrogatoires, les enquêteurs·enquêtrices amènent le duo à trahir l’identité de leur complice sans leur révéler être déjà au courant de son existence.
Une fois l’enquête terminée, la police ne souhaite pas révéler qu’elle a fait usage d’écoutes illégales, ni révéler l’existence de leur informateur, ce dernier pouvant encore leur être utile dans le futur. Ils·elles vont modifier le dossier d’enquête afin de dissimuler ces deux informations. Deux dossiers parallèles sont alors constitués. Le premier, avec le déroulement entier et réel de l’enquête, restera dans les bureaux de la police. Dans le deuxième dossier, spécialement conçu pour être rendu visible lors du procès, les informations sensibles seront remplacées par des informations « tout public ». L’existence de l’informateur sera passée sous silence, un autre motif sera trouvé pour justifier les perquisitions et la connaissance de la troisième personne accusée sera expliquée à travers les réponses fournies durant les interrogatoires et non grâce aux écoutes téléphoniques illégales.
Cette pratique s’appelle la construction parallèle (du terme anglais Parallel Construction). C’est une méthode qui repose sur une grande opacité et sur laquelle, en tout bon sens, aucune police ne communique officiellement. Néanmoins, plusieurs cas de constructions parallèles ont été rendus publics à travers le monde par des journalistes d’investigation [6]. La majorité des (ex-)policiers interviewés déclarait que cette pratique était couramment utilisée et la défendait comme étant une nécessité pour un travail efficace des institutions de police. La plupart des cas connus et médiatisés ont eu lieu aux USA. De mon point de vue néanmoins, on peut partir du principe que l’utilisation de cette méthode de travail est répandue dans toutes les polices, soit à l’échelle de l’initiative personnelle d’un·e enquêteur·enquêtrice, soit de manière systématique et établie par tout le service en question.
Quoi qu’il en soit, l’interrogatoire est un outil pratique pour combler les trous dans un dossier d’enquête ou cacher des sources. Des informations déjà connues par la police peuvent être « blanchies » en amenant les personnes interrogées à redonner la même information et permettre ainsi de dissimuler les véritables sources.
3. Le déroulement d’une enquête
Toute enquête part d’une infraction supposée à la loi, sur laquelle la police va collecter des informations. Dès l’ouverture d’une enquête, des infractions y sont attribuées (par exemple violation de domicile, dommage à la propriété, recel, etc.). La police va ensuite chercher à attribuer la responsabilité de ces infractions à des individus. Au fil de l’enquête, les infractions peuvent être ajustées (ce qui a commencé comme une enquête sur une violation de domicile peut se transformer en une effraction ou un cambriolage). Il arrive régulièrement que de nouveaux délits soient détectés lors d’une enquête et que de nouvelles enquêtes soient ainsi ouvertes. Lorsqu’elles ont des choses en commun (par exemple plusieurs cambriolages imputés au même groupe), ces différentes enquêtes peuvent être traitées en « réseaux d’enquêtes » ou en « enquêtes parallèles ». Les différent·es policiers·policières impliqué·es auront un échange régulier sur les affaires respectives. De plus, beaucoup de services policiers possèdent des bases de données interconnectées : si un·e enquêteur·enquêtrice souhaite être tenu·e au courant de chaque nouvelle mention concernant un individu, un objet, une arme ou un véhicule, il·elle peut s’abonner à une alerte et recevoir l’info par mail en temps réel.
Durant l’enquête, les inspecteurs·inspectrices rassemblent dans le dossier d’enquête les différents éléments récoltés. L’objectif de ce dossier est de donner une vision claire du contexte de l’affaire, des personnes impliquées, du déroulement des faits, des intentions, etc. Lorsque les policiers·policières pensent avoir récolté tous les éléments possibles ou utilisé toutes leurs ressources (temps et budget), le dossier est bouclé et transmis à l’échelon supérieur où sera décidé s’il y a matière à ouvrir une procédure judiciaire.
Tout comme les services de renseignements, la police mène également un travail de surveillance hors-enquête : collecte, traitement et analyse de données sur des individus, groupes, réseaux et contextes sociaux. Ces données seront utiles pour détecter des infractions et pour « nourrir » de futures enquêtes.
Le dossier d’enquête
Le dossier d’enquête comprend la totalité du déroulement de l’enquête, les pièces à conviction, les traces et preuves matérielles trouvées et analysées (empreintes, vidéo-surveillance, ADN, traces de pas, etc.), les auditions des témoins et bien sûr, les procès-verbaux des interrogatoires. Ces dossiers sont souvent construits de manière chronologique, démontrant le chemin d’enquête suivi par les inspecteurs·inspectrices, les hypothèses envisagées, les thèses validées et invalidées. La conclusion finale est toutefois laissée à l’évaluation du·de la procureur/juge. La qualité du travail de la police sera évaluée sur la base de ce rapport d’enquête. L’objectif visé à travers l’élaboration de ce dossier est de brosser un tableau large et précis du contexte de l’infraction, des personnes impliquées, des liens (contextes interindividuels), des intentions, des implications et du déroulement des faits.
Au tout début de la procédure judiciaire, lorsque tu es interrogé·e par la police, en garde à vue ou en détention préventive, tu n’as pas la possibilité de consulter le dossier d’enquête. Cela signifie que tu n’as qu’une connaissance minime du contexte de l’enquête, de ce qui intéresse la police, des éléments et indices qu’ils·elles ont déjà récoltés, des déclarations qu’ont fait ou non les potentiel·les co-inculpé·es. C’est dans ce déséquilibre que se situe le plus grand danger de faire des déclarations. Tu n’as pas la possibilité de savoir si tu livres des informations que la police possède déjà ou non, si tu contredis ce qu’une autre personne a déclaré, si la police possède des éléments lui permettant de déterminer si tu mens, etc. Dans ces conditions, il n’est tout simplement pas possible de décider d’une stratégie de défense efficace et solide autre que de garder le silence.
Ce n’est que lorsque l’affaire est envoyée devant un·e juge que toi et tes avocat·es avez la possibilité de consulter le dossier d’enquête. À partir de ce moment-là, tout nouvel élément ajouté doit t’être notifié, souvent par le biais de tes avocat·es [7]. Une fois que tu as pris connaissance du dossier d’enquête, tu sauras à partir de quelles informations le·la juge va établir son verdict. Tu pourras ainsi préparer en connaissance de cause un axe de défense qui te nuira le moins possible. Si le dossier d’enquête a très peu d’éléments, peutêtre même qu’il fera sens de continuer à garder le silence plutôt que de prendre le risque de se faire piéger par une question habilement posée par un juge ou les procureurs.
Preuves et indices
Les indices sont des informations récoltées par la police lors d’une enquête. Par exemple :
• Indice 1 : Monsieur X possède une Honda rouge
• Indice 2 : Des traces de pneus retrouvées sur les lieux du crime, correspondant à la voiture de Monsieur X
• Indice 3 : Une témoin affirme avoir vu une Honda rouge sur les lieux du crime
• Indice 4 : Un second témoin affirme avoir passé la soirée du vendredi avec Monsieur X dans un bar
• Indice 5 : Les déclarations de Monsieur X lors de son interrogatoire disant que sa fille sait conduire bien qu’elle n’a pas encore passé son permis.
Ces éléments vont être mis en lien et présentés par la police comme des hypothèses. En regroupant les indices 1, 2 et 3, l’hypothèse pourra être émise que Monsieur X était présent sur le lieu du crime avec sa voiture. Une autre hypothèse prenant également en compte l’indice 4 proposera la thèse selon laquelle la voiture de Monsieur X était présente sur les lieux du crime mais pas Monsieur X, celui-ci ayant été vu dans un bar au même moment. L’indice 5 pourrait finalement amener la nouvelle hypothèse que c’est la fille de Monsieur X qui s’est rendue avec la voiture de son père sur les lieux du crime.
À partir des éléments récoltés, la police va donc tenter d’établir des faits, en proposant différentes hypothèses constituées en faisceau d’indices et d’éléments convergents. Certains éléments peuvent par la suite venir invalider des hypothèses, ce qui permettra à la police de travailler par élimination.
Dans tous les cas, la police travaille uniquement avec des indices. C’est le·la juge qui décidera quel élément pourra être utilisé comme preuve, en fonction du cadre légal et de son interprétation. Est-ce que ce témoignage peut être à lui seul utilisé comme preuve ? Est-ce que cette image de caméra de surveillance a plus de poids juridique que les déclarations du suspect ? Ces questions et bien d’autres vont être de l’ordre du champ de bataille entre juge, avocat·es et procureur. Au final c’est le·la juge qui va choisir, en fonction des lois, des jurisprudences mais également de son humeur et de ses convictions. Si les avocat·es de la défense ne sont pas d’accord avec son évaluation, ils·elles pourront introduire un recours et faire rejuger l’affaire par une instance supérieure.
Ce chapitre met en évidence deux points importants.
Premièrement, la question réellement débattue lors d’un procès n’est pas de savoir si tu es coupable ou innocent·e, mais de savoir s’il y a assez d’éléments ou non pour te condamner pour ce dont tu es accusé·e. Une nouvelle fois, cela montre l’importance de cette équation : moins ton dossier d’enquête est rempli d’éléments (y compris tes propres déclarations), mieux tu te porteras lors du procès.
Secondement, le travail de la police se limite à récolter les informations et à les présenter sous forme d’hypothèses. Ce point est important car il met en lumière la fausse croyance selon laquelle les policiers·policières jugent de ta culpabilité ou de ton innocence et qu’il peut être bénéfique d’essayer de les convaincre de ton innocence. Ce besoin de s’expliquer et de se justifier face à la police est habilement exploité pour te soutirer des informations finalement utilisables contre toi ou d’autres personnes.
La place de l’interrogatoire dans l’enquête
L’importance que prend l’interrogatoire dans une enquête évolue en fonction de l’enquête en question. Dans certaines investigations, les policiers·policières récoltent rapidement une grande quantité de traces matérielles et d’indices (empreintes, surveillances, témoignages) ou procèdent à une arrestation en flagrant délit. Dans ces cas-là, les informations fournies par les interrogatoires ne sont pas primordiales à la résolution de l’enquête. Dans certaines enquêtes, les déclarations de la personne soupçonnée ne font plus qu’une différence minime dans l’appréciation qu’aura le·la juge de l’affaire. La personne interrogée subira sans doute moins de pression, vu que l’avancement des investigations ne dépendra pas de ses déclarations.
À l’inverse, certaines enquêtes ne reposent que sur des soupçons minimes, sans aucun élément matériel pour les étayer. Il peut s’agir d’un seul indice qui a amené un soupçon sur la personne interrogée, la menant à une audition devant la police. Ici l’importance d’extorquer des informations à travers l’interrogatoire est cruciale. Sans réponse de ta part, l’enquête n’avancera pas et sera finalement classée sans suite. Sachant cela, il y a fort à parier que la pression perçue lors de l’interrogatoire sera intense.
«
Les enquêteurs·enquêtrices ne vont jamais communiquer
sur l’absence d’éléments dans leur enquête. »
Par contre, ils·elles peuvent te faire croire qu’ils·elles ont connaissance de beaucoup d’éléments te concernant pour te donner une impression de supériorité, alors qu’en réalité leur dossier est quasiment vide. Il n’y a rien de plus frustrant que de voir des juges condamner des personnes sur l’unique base de leurs propres déclarations. Cela arrive pourtant fréquemment.
L’interrogatoire sert aussi à diriger l’enquête dans une direction précise ; il peut donner des indications sur des personnes à mettre sous surveillance (écoute, filature, perquisition) ou sur des traces à rechercher dans des endroits spécifiques. Par exemple, si à travers ton interrogatoire les inspecteurs·inspectrices apprennent l’identité de tes complices, il est fort probable que ces personnes voient leur domicile perquisitionné. Des outils seront peut-être trouvés, correspondant à des traces sur les lieux du crime. Ainsi, l’enquête peut avancer.
L’aveu
L’aveu est la reine des preuves (proverbe policier)
L’aveu est le moment où une personne donne sa version des faits sans répondre uniquement à une question ciblée. C’est ce moment particulier où une personne reconnaît et/ou avoue des faits. Un aveu peut être total (la personne interrogée donne toutes les informations qui intéressent la police) ou partiel (la personne interrogée reconnaît une partie des faits tout en dissimulant ou niant une autre partie).
Pourtant, les aveux ne sont pas pour autant recueillis sans une certaine forme de méfiance, que cela soit chez la police ou chez le·la juge. Une personne peut mentir pour protéger quelqu’un, ou avouer une partie de la vérité pour en cacher une autre. L’aveu n’a donc pas un poids juridique différent de réponses concises à des questions précises.
En parcourant la littérature policière, deux courants ressortent en ce qui concerne l’importance de l’aveu dans la mise en place des stratégies d’interrogatoire. Le courant le plus classique et le plus ancien place l’aveu au centre de l’interrogatoire. L’interrogatoire est construit dans le but d’amener la personne interrogée vers une confession sous forme d’aveu final, le plus proche possible de la vérité des faits. Les enquêteurs·enquêtrices vérifient les déclarations et contrôlent les alibis pour pouvoir distinguer l’aveu du mensonge.
« Toutes les déclarations de la personne interrogée sont réparties
entre ces deux catégories : aveu ou mensonge. »
L’aveu implique que la personne interrogée reconnaisse sa culpabilité, au moins de manière partielle. Une théorie de ce courant encourage à partir du principe que lorsque une personne suspectée passe aux aveux, il·elle commencera dans la majorité des cas à minimiser les faits et son implication en fournissant des aveux partiels. Les enquêteurs·enquêtrices vont donc vérifier les faits, élément après élément. Pour ce faire, ils·elles vont pousser la personne interrogée à approfondir chaque détail de l’affaire jusqu’à avoir assez de matière pour vérifier la cohérence des déclarations ou trouver d’éventuelles contradictions indiquant un mensonge. Pour amener une personne vers une posture d’aveu, une stratégie consiste à la pousser vers une anxiété intérieure sous la forme de culpabilité ou de honte. L’anxiété dirigée vers l’extérieur telle la colère, la méfiance ou le mépris limitera par contre le passage à l’aveu. Des stratégies comme la contagion émotionnelle ou l’humanisation du lien seront privilégiées.
Les policiers·policières partent du principe que le·la suspecte va employer un mécanisme de défense pour justifier ses actes et maintenir sa confiance en soi. L’axe d’attaque des interrogateurs·interrogatrices est de briser sa résistance en identifiant et exploitant les vulnérabilités psychologiques du suspect·es (sentiment de culpabilité, deuil, fierté, naïveté, etc.). Des facteurs logistiques peuvent également être utilisés, comme la maladie, la fatigue, le stress, l’isolement social ou la privation de nourriture.
Le deuxième courant se préoccupe moins de l’aveu pour se focaliser sur la recherche d’éléments précis nécessaires au dossier d’enquête. L’interrogatoire n’est plus placé au centre de l’enquête mais est relégué au même niveau que les autres moyens d’enquête (preuve matérielle, collecte de trace, témoignage). Les stratégies misent en place visent à amener la personne interrogée à parler des thématiques précises où les policiers·policières ont besoin d’éléments pour avancer dans leur enquête. Il peut s’agir de récolter des mensonges ou contradictions qui seront retenus à charge contre le·la suspect·e ou des déclarations livrant des indications techniques à la police (nombre de personnes impliquées, connexion interindividuelle, mode opératoire). Les stratégies du sable mouvant, bon flic, méchant flic et rejeter la faute sur autrui seront utilisées.
L’enquête se construit ici en premier lieu sur les preuves matérielles et ensuite seulement sur les déclarations ou aveux de la personne interrogée. Les stratégies vont de préférence viser à affaiblir les capacités de raisonnement et de prise de décision en augmentant la peur, l’incertitude et l’anxiété de l’individu, notamment à travers l’enfermement et/ou l’isolement.
« On sent dès le départ si c’est possible ou pas de l’amener à des aveux, ou à faire évoluer le dossier en tout cas, mais sans avoir une idée préconçue, selon les éléments qu’on a et la sensibilité qu’on a. Ce n’est pas de la manipulation hein, mais on va essayer de l’amener vers une direction qu’on voudrait »
II) Pendant l’interrogatoire
Ce chapitre examine la pratique spécifique de l’interrogatoire : la préparation, les techniques et les stratégies.
4. Préparation
Profilage
Avant tout interrogatoire, les inspecteurs·inspectrices en charge du dossier vont dresser un profil de la personne auditionnée. En fonction de l’importance de l’enquête, ce profil pourra être très détaillé et précis ou au contraire constitué uniquement de quelques traits de caractère grossiers.
Pour se faire une idée du comportement que tu pourrais avoir lors de l’interrogatoire, toute information disponible sur toi est bonne à prendre : situation financière, parcours scolaire, environnement social, relations familiales et professionnelles, passions, sensibilités et valeurs morales. Si tu as déjà eu affaire à la police, les procès-verbaux de tes précédents interrogatoires vont être parcourus afin d’anticiper tes réactions. Si tu as été arrêté·e et placé·e en garde à vue avant ton interrogatoire, les agent·es seront attentifs·attentives à ton attitude à leur égard, au niveau de stress et d’anxiété que te provoque la privation de liberté, à la facilité que tu as de t’exprimer, au choix des mots que tu utilises. Les informations disponibles sur ton état médical (alcoolisme, toxicomanie, maladie chronique, etc.) sont également des informations utiles, pour l’enquête autant que pour l’interrogatoire. Certains corps de police reçoivent des formations basiques de psychiatrie afin que les enquêteurs·enquêtrices soient capable de créer un profil psychologique de la personne interrogée en exploitant ses troubles psychologiques tels que la dépression, la bipolarité ou encore la schizophrénie.
Tu ne connais rien des policiers·policières en face de toi, eux·elles par contre, auront une idée assez précise de qui tu es.
C’est le propre du renseignement : cumuler des informations afin de gagner un avantage stratégique et une emprise sur son adversaire.
Classification des informations
Je sais que tu sais ce que je sais que tu sais (pensée policière)
Contrairement à toi, les inspecteurs·inspectrices ont connaissance du dossier d’enquête. Cela leur procure un avantage non négligeable. Lors de la mise en place de leur stratégie d’interrogatoire, les enquêteurs·enquêtrices vont répartir leurs connaissances en trois niveaux.
• Informations qui peuvent/doivent t’être transmises.
• Informations qui peuvent t’être transmises si cela peut te pousser à donner des informations en retour.
• Informations qui ne doivent en aucun cas t’être transmises.
Les informations de la deuxième catégorie te seront données si les policiers·policières estiment que cela leur donnera de nouvelles informations en retour. En clair, s’ils pensent que cela va aider à te faire parler. J’ai souvent entendu des personnes affirmer répondre aux questions de la police avec l’intention de pouvoir soutirer des informations sur l’état de l’enquête sans en donner eux·elles-même. C’est une vision qui me paraît dangereusement optimiste. Surtout lorsque l’on sait que les inspecteurs·inspectrices font l’effort de lister les informations à ne pas donner aux suspect·es. D’autant plus que l’une de leur stratégie consiste à exploiter une trop grande confiance en soi.
« Les éléments que tu as, tu n’es pas obligé de tout dévoiler d’un coup. Tu te sers de ce que tu as, tu as une boîte à outils si tu veux, alors des fois tu n’as rien dans ta boîte à outils, c’est une partie de poker, des fois tu as des éléments, mais ces éléments-là tu n’es pas obligé de les lâcher d’un coup, il faut les sortir au bon moment. Le travail consiste en ça, l’expérience c’est ça, c’est d’arriver à sortir les outils au bon moment, et de t’en servir avec adresse »
Exemples :
• Informations qui peuvent/doivent t’être transmises.
Tu es inculpé·e pour émeute, manifestation non autorisée et dommage à la propriété
• Informations qui peuvent t’être transmises si cela peut te pousser à donner des informations en retour.
Tu es spécifiquement suspecté·e d’avoir participé au pillage d’un magasin lors de la manifestation en question
• Informations qui ne doivent en aucun cas t’être transmises.
Ton téléphone est mis sous écoute ce qui a permis à la police de savoir avec qui tu étais à la manifestation. Des perquisitions et arrestations sont dès lors prévues.
Anticiper les stratégies de défense
Dernier élément de préparation à un interrogatoire : suite à l’étude de ton profil, anticiper tes stratégies de défense. Est-ce que tu risques de présenter un alibi qu’il s’agira de vérifier avant de continuer la procédure ? Vas-tu t’engager dans la voie du mensonge ? Essaieras-tu de couvrir des ami·es ou vas-tu au contraire accuser un·e complice ? Vas-tu partiellement avouer les faits dans l’espoir de dissimuler une partie de la vérité ? Auras-tu la bonne idée de te protéger par le silence et le refus de répondre à leurs questions ? Comment vas-tu réagir lorsque tu seras confronté·e à tes mensonges, aux éléments de preuves, aux déclarations de co-accusé·es ou de témoins ?
En fonction de tous ces éléments, les inspecteurs·inspectrices vont choisir quelles stratégies et techniques d’interrogatoire utiliser contre toi et lesquelles laisser de côté.
5. Techniques générales de manipulation
« La manipulation consiste à construire une image
du réel qui a l’air d’être le réel. » Philippe Breton
Je définis le terme de manipulation comme une intention d’influencer et de contrôler les impressions, les pensées et les choix d’une personne pour son propre bénéfice. Manipuler une personne, c’est lui refuser la liberté d’un choix libre et en conscience. Un antagonisme donc avec l’idée anarchiste que tout individu est légitime de mener une vie libre par et pour lui-même.
Depuis plusieurs années, la psychologie sociale nomme et pointe des schémas récurrents de manipulation qui, selon le contexte, prennent un nom différent : « harcèlement » dans un contexte d’oppression patriarcale, « mobbing » lorsque la manipulation se fait dans un cadre professionnel, « abus » et « relation toxique » si l’on parle de relation affective.
La pratique de l’interrogatoire policier s’inscrit parfaitement dans ce panel des différents contextes de manipulation. Un interrogatoire est une interaction vécue dans la contrainte et basée sur un rapport de pouvoir inégal. La police se sert des techniques de manipulation couramment utilisées dans l’ensemble des autres contextes précédemment cités. Il existe cependant une nuance entre les techniques et les stratégies de manipulation.
• Les techniques sont des éléments de manipulation concrets et courts (la construction d’une phrase, une intonation).
• Les stratégies sont pensées sur une temporalité plus longue, pouvant englober l’ensemble de l’interrogatoire voire même plusieurs interrogatoires.
Voici une série de techniques de manipulation utilisées notamment lors d’interrogatoires.
Engendrer de la sympathie
Une partie des stratégies policières nécessite un sentiment de sympathie de la personne interrogée envers les policiers·policières. Cela demande un virage à 180° par rapport à la réalité. Malgré le fait qu’ils·elles enquêtent sur toi, te surveillent, t’enferment et cherchent activement des éléments de preuve permettant ensuite à la Justice de te punir, ils·elles tentent de te convaincre qu’en réalité ils·elles te veulent du bien et te respectent. L’objectif étant de baisser ton niveau de méfiance afin de te rendre plus perméable aux stratégies basées sur le lien interhumain entre policier·policière et suspect·e.
Comment se rend-on sympathique ? Les sociologues qui se sont penché·es sur cette question ont noté plusieurs facteurs ayant une influence certaine et cependant inconsciente chez la plupart d’entre nous : l’apparence physique, la présence de points communs (ce policier a un fils comme moi, cette policière supporte le même club de hockey que moi), une certaine familiarité, des associations positives à leur contact (le policier qui te fait la « faveur » de te donner à manger alors que tu as très faim sera associé au plaisir de pouvoir enfin manger). La flatterie fait aussi partie de l’arsenal de manipulation des enquêteurs·enquêtrices. Contrairement au compliment, la flatterie a pour but de te séduire pour t’inciter à une chose spécifique. Cela te met en confiance, te fait baisser la garde et te place dans des dispositions positives pour la suite.
Principe de réciprocité
« Lorsqu’on t’offre quelque chose,
il est normal de rendre en retour » Norme sociale
Le principe de réciprocité se construit sur la norme sociale stipulant que lorsque tu reçois quelque chose, tu as une obligation de donner en retour. Nous apprenons tous et toutes cette norme au travers de notre éducation. Si tu acceptes de prendre, tu dois donner en retour. Si tu déroges à cette injonction, tu t’exposes à une pression sociale négative, ainsi qu’à un fort jugement. Tu pourras par exemple être qualifié·e d’égoïste, profiteur·profiteuse, parasite, malpoli·e, ingrat·e. Dans cette technique de manipulation, c’est le sentiment de dette qui est exploité, créé par le fait d’avoir reçu quelque chose, alors même que cela n’a pas été demandé.
Lors de l’interrogatoire, cette technique est utilisée dans un rapport de force particulièrement inégal. Les faveurs que « t’offrent » certain·es inspecteurs·inspectrices compensent en réalité des manques créés par ces mêmes inspecteurs·inspectrices au travers de ta détention. T’amener un verre d’eau, te permettre de faire un appel, de recevoir de la visite ou un livre. Autant de « faveurs » utilisées pour créer en toi un sentiment de redevance. Dès la première hésitation à répondre à leurs questions, ces « faveurs » te seront rappelées avec l’attente que tu rendes à présent la politesse.
Écoute aversive
L’écoute aversive, c’est quand le·la policier·policière qui t’interroge regarde ailleurs ou fait autre chose pendant que tu lui parles. C’est ne pas lever la tête vers toi lorsque tu arrives dans la salle d’interrogatoire. L’idée derrière cette attitude est simple : déstabiliser, créer une sensation de gêne et te donner l’impression que ce que tu dis n’a aucun intérêt et que cet interrogatoire ne représente rien d’important, uniquement un ennuyeux protocole de routine à accomplir. Mais aussi que leurs idées sur toi sont déjà toutes faites. En réaction à cette attitude, tu peux vouloir à tout prix attirer leur attention et te justifier sur ce qui s’est passé. Ce faisant, tu livres peut-être bien plus d’information que ce que la police aurait pu tirer de toi avec une attitude confrontative.
Prêcher le faux pour connaître le vrai
Cette technique consiste à poser une question en y incluant sciemment un élément erroné. L’objectif est que ta volonté de rétablir la vérité te pousse à donner plus d’informations que si on t’avait posé la question de manière plus neutre.
Examinons ces deux questions.
1. Qu’est-ce que vous êtes allé·e faire à Paris ?
2. Vous êtes-vous rendu·e à Paris pour voir un·e amant·e ? La première question ne semble pas poser d’enjeu émotionnel particulier, ni dans la question, ni dans la réponse. C’est une question ouverte et plutôt neutre. Visiblement, la police cherche à savoir ce que tu es allé·e faire à Paris.
Lors de la deuxième question, la police suggère déjà savoir ce que tu es allé·e faire à Paris. Cela crée donc l’insinuation que tu as bel et bien un·e amant·e. Les policiers·policières qui te posent cette question savent pourtant pertinemment que tu ne t’es pas rendu·e à Paris pour cette raison. Toutefois, ils·elles ignorent la vraie raison de ta visite et espèrent que, poussé·e par la volonté de te justifier, de rectifier un élément erroné, ta réponse soit plus complète que si la question avait été formulée de manière neutre.
« [l’interrogatoire est comme] une partie d’échecs, ou une partie de poker, comme tu veux, donc tu as le droit de bluffer. En face de toi tu as des joueurs, tu as des gens qui ne te disent pas forcément la vérité, toute la vérité, ou qui l’arrangent à leur façon. Toi tu as des cartes en main, le mec ne sait pas forcément quelles cartes tu as en main, donc tu peux bluffer, tu peux prêcher le faux pour savoir le vrai ».
« Tout dépend de l’inspecteur, il y en a qui vont jouer la menace, d’autres qui vont prêcher le faux pour savoir le vrai. Moi je suis dans la réalité, je suis honnête »
Créer de la suspicion
« Ce n’est pourtant pas ce que nous a
raconté votre ami·e » Insinuation policière
Créer de la suspicion au sein d’un groupe est une bonne méthode pour le fragiliser, créer des dissensions, amener les un·es à se désolidariser des autres et empêcher de tirer de la force d’un sentiment collectif. Il existe beaucoup de méthodes de manipulation utilisées pour semer les graines du doute. Cela va du mensonge pur et dur aux insinuations l’air de rien, concernant ce que tes ami·es auraient dit ou fait.
Même si tu ne souhaites pas y porter attention, le message est capté et intercepté par ton cerveau. Comme ce message est généralement chargé d’affects émotionnels, il ne sera pas simple de l’oublier totalement, et cela même si tu n’y crois pas. Le danger de ces remarques auxquelles tu ne donnes sur le moment aucun crédit repose sur le fait qu’elles peuvent refaire surface au premier signal semblant corroborer ces dires ou dans des moments de faiblesse et d’épuisement émotionnel. Le message a été entendu et enregistré.
Un élément de défense face à cette technique est de rejeter en bloc toute accusation amenée directement ou indirectement par la police sur un ou une de tes proches. Si tu te trouves dans l’impossibilité de vérifier par toi-même une déclaration que te rapportent les enquêteurs·enquêtrices, pars du principe que c’est faux. Il sera toujours temps de revenir là-dessus plus tard, lorsque le danger de l’interrogatoire sera derrière toi. N’oublies pas que contrairement à tes proches ou coaccusé·es, les policiers·policières en face de toi ne sont pas tes ami·es et ne te veulent pas du bien. Leur travail est de t’affaiblir émotionnellement afin de te pousser à faire des déclarations qui leur serviront à remplir leur dossier d’enquête.
− Grand amour n’est-ce pas ? le lieutenant fit une grimace moqueuse.
Lenz haussa les épaules.
− Paraît que ça arrive oui.
Le lieutenant le regarda à nouveau, puis secoua la tête.
− Quand j’étudie votre parcours et que je considère l’importante énergie criminelle que vous avez dépensée pour nous échapper, votre fuite semble carrément ridicule. Que dit le dicton ? Quand l’éléphant se porte trop bien, il danse sur la glace.
Il aurait mieux fait de lui offrir des cigarettes plutôt que de lui présenter de telles sagesses populaires.
− Vous savez ce que je soupçonne ? Que vous nous quittiez uniquement par amour pour votre femme.
− Votre conclusion n’est pas totalement fausse.
C’est ce qu’ils avaient convenu : s’ils devaient être attrapés dans leur fuite, ils diraient qu’il n’y avait aucun motif politique derrière leur intention de passer la frontière, uniquement le désir de réunir leur famille. Mais est-ce que Hannah s’y tient toujours ? Peut-être avait-elle déjà dit la vérité.
− Le grand amour donc ! Malheureusement, votre femme nous a raconté une tout autre histoire.
L’absence de cigarettes aujourd’hui était probablement intentionnelle, il voulait encore se la jouer offensif, ce Lieutenant.
− Vous vous êtes rendu de nombreuses fois à la foire de Leipzig non ? On sait tous comment ça se passe là-bas entre hommes et femmes.
− Pouvez-vous être plus précis ?
− Bien sûr : votre femme a exprimé quelques doutes sur votre fameux « grand amour ». Et encore plus en ce qui concerne votre fidélité.
Lenz dût sourire.
− C’est cela que vous appelez mener une guerre psychologique ?
− Vous ne me croyez pas ?
− Non, sauf si ma femme répète cette phrase en ma présence.
− Vous croyez qu’on essaie de vous monter l’un contre l’autre, vous et votre femme ?
− Disons que le soupçon n’est pas bien loin
− Vous avez une grande confiance en nous dites donc.
Il fit un visage hautain, le camarade lieutenant ouvrit un tiroir et jeta un paquet de cigarettes ouvert sur la table.
− J’avais oublié que vous étiez fumeur.
C’est ce qu’on leur aura appris, aux camarades interrogateurs : à traiter la personne interrogée tantôt avec gentillesse et générosité, tantôt en s’acharnant sur la moindre bagatelle ; ils sont tantôt le compagnon sympathique, tantôt le juge d’instruction sévère. Ils savent que tu répéteras mille fois dans ta cellule chaque mot prononcé ici, et comptent sur le fait que la moindre remarque, lâchée l’air de rien comme ça en passant, s’incruste dans ta tête jusqu’au moment où le doute s’installe : se peut-il que Hannah pense réellement que tu as joué le Don Juan à Leipzig ?
Extrait librement traduit du livre Krokodil im Nacken, Klaus Kordon 2008
Rabaisser et dévaloriser
Rabaisser une personne afin qu’elle se sente dévalorisée, mette en doute ses capacités, manque de confiance en elle et développe une dépendance émotionnelle est un classique dans toute relation toxique ainsi que dans les interrogatoires. Cette technique se pose toutefois en antagonisme avec les stratégies basées sur l’humanisation de la relation enquêteur·enquêtrice-suspect·e. Elle sera donc utilisée uniquement lorsque les inspecteurs·inspectrices estiment que cette manière offensive aura plus de chance de réussir que la manière conciliante.
Pour t’atteindre, leurs jugements moraux et critiques seront dirigés vers les thématiques qu’ils·elles savent sensibles pour toi. Ils·elles peuvent te mettre face à tes contradictions et tes doutes, reporter sur toi la responsabilité de tes erreurs passées et de la situation difficile que tu vis. Ils·elles vont te pousser systématiquement à penser que tu n’aurais pas dû faire tel ou tel choix et que tu as agi stupidement. Apparaissent alors de puissants sentiments de culpabilisation et de dévalorisation, peut-être déjà présents en toi, mais indéniablement amplifiés par la manipulation policière.
En règle générale, il convient de ne considérer aucune critique de la part d’une personne identifiée comme manipulatrice comme étant digne de réflexion. Je ne parle pas ici de critiques constructives, empathiques et bienveillantes venant de la part de celles et ceux qui te veulent du bien. Et là un scoop : Les flics ne sont pas tes ami·es, ils·elles ne se préoccupent ni de ton bien-être ni de ton développement intellectuel et n’ont aucun intérêt à t’amener des critiques constructives. Ils·elles ne sont pas concerné·es par qui tu es, par ce qui est important pour toi, tes sensibilités etc. Ils·elles ont leurs propres intérêts qui n’ont pas de lien avec ta personne mais uniquement avec leur travail quotidien et le dossier d’enquête. Et lorsqu’ils·elles te disent le contraire, rappelle-toi qui t’a enfermé dans cette pièce et t’y retient contre ton gré.
Exploiter les croyances et sensibilités
Nous avons tous et toutes un système de croyances, de valeurs et de sensibilités propres à notre parcours et notre éducation, à nos croyances religieuses et spirituelles, de schémas appris et reproduits depuis l’enfance et de modèles que nous montre la société dans laquelle nous vivons. Certaines sensibilités proviennent de nos expériences et/ou du travail de déconstruction que nous entreprenons pour nous réapproprier nos vies selon nos propres envies, en rupture avec les normes sociales nous entourant. À l’exception de ce travail de déconstruction, nos croyances s’ancrent tôt dans nos vies et sont rarement remises en question.
Lors d’un interrogatoire, identifier tes sensibilités et ton système de valeurs représente un enjeu majeur pour la police. Cela va leur permettre de les utiliser comme levier pour influencer tes émotions et tes sentiments.
Par exemple, pour faire naître en toi un sentiment de culpabilité ou de manque de confiance, ils·elles vont essayer de te convaincre que tes actes ont été en contradiction avec tes propres valeurs.
Voici quelques croyances classiques de nos sociétés occidentales, inconsciemment intégrées et rarement remises en question. Ce sont des vérités absolues, qui ne prennent pas en compte les nuances, contextes et circonstances dans lesquelles elles sont prononcées.
• Il faut tout savoir sinon on est ignorant·e et stupide.
• Il ne faut pas se tromper. Faire des erreurs n’est pas une pratique normale d’une dynamique d’apprentissage mais est synonyme de stupidité.
• Il faut montrer aux autres que l’on est cultivé·e, intelligent·e, intéressant·e sinon l’on n’a pas de valeur.
• Pour être valorisé·e, il faut être compétent·e en toute circonstance.
• Il ne faut pas changer d’avis sinon on est instable et non crédible.
• Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis (inverse de la norme précédente).
• Quand on s’engage, on doit absolument tenir parole et aller au bout, même si l’on change d’avis.
• Il ne faut jamais être ingrat·e et toujours se sentir reconnaissant·e de ce que l’on reçoit même si l’on n’a rien demandé.
• Si l’on te donne, tu dois automatiquement donner en retour sinon tu es ingrat·e.
• Il faut être généreux·généreuse.
• Il faut être gentil·le et aimable, sinon on est méchant·e, insensible et agressif·agressive, peu importe les circonstances.
• Les gens doivent être punis pour leur méchanceté ou s’ils·elles ne respectent pas les règles.
• Il faut toujours prendre les bonnes décisions, sinon on est stupide.
Ces valeurs sociales peuvent facilement se retourner contre toi. Par exemple, en montrant que tu es ignorant·e sur tel ou tel sujet, les enquêteurs·enquêtrices peuvent faire naître en toi le sentiment que tu n’es pas intelligent·e et ainsi faire baisser la confiance que tu as en toi.
Effet de récence
La technique de l’effet de récence cherche à conditionner inconsciemment une personne grâce à la manière dont est construite une phrase. Notre mémoire retient plus facilement les mots placés en début et en fin des phrases que l’on entend. Surtout lorsque ces phrases sont volontairement longues et compliquées. Surtout lorsque l’on est épuisé·e par une session d’interrogatoire qui dure depuis plusieurs heures. Surtout lorsque les inspecteurs·inspectrices tentent de nous déconcentrer juste avant de poser la question à travers une attitude subitement agressive, ou en lâchant une information jusqu’alors inconnue.
Exemple d’un conditionnement positif
C‘est bien sûr votre libre choix, même si cela vous donnera un air suspect devant le juge et que c‘est connu que seul les criminels se taisent, de faire usage de votre droit au silence.
Exemple d’un conditionnement négatif
Bien que cela vous donnera un air suspect devant le juge, c‘est votre libre choix de faire usage de droit au silence, même si c‘est connu que seul les criminels se taisent.
Harponnage
Imagine que tu retires de l’argent en dollars à la banque et que l’employé·e te dises « Ce n’est pas souvent que des gens viennent retirer des dollars en ce moment ». Ce à quoi, sans y faire attention, tu réponds « oui je pars deux semaines en Floride visiter ma famille ».
Sans même que l’on te pose une question, tu transmets deux informations sur toi : tu pars deux semaines en Floride et tu y as de la famille. Cette situation anodine peut être bien plus problématique dans un contexte d’interrogatoire. La formulation d’une simple affirmation plutôt que d’une question dirigée donne l’impression qu’il s’agit d’une discussion sans enjeu voire même que la police ne cherche pas nécessairement à avoir des informations à ce sujet. L’affirmation peut aussi être dite avec suspicion pour pousser à se justifier.
Créer de l’espoir et de la déception
Faire miroiter une promesse va déclencher chez une personne un processus d’imagination et de projection positif lié à l’espoir de la réalisation de cette promesse. Lorsque cette dernière n’est finalement pas tenue, cela crée une désillusion et une déception. En faisant sciemment des fausses promesses, l’objectif est de pousser à un épuisement émotionnel. La détention en garde à vue ou en préventive est un terrain particulièrement propice à cette technique. Comme tu subis un grand nombre de privations, la police peut de te faire miroiter plein de faveurs (coup de téléphone, droit d’avoir un livre en cellule, droit de recevoir des visites, etc.) pour finalement créer de la déception en te les refusant. Le processus est encore plus vicieux lorsque les policiers·policières t’accusent d’être responsable de leur refus (et donc de ta déception). « Si vous vous étiez montré·e plus coopérative, nous aurions pu faire un geste pour vous ».
Le maton conduisit Lenz dans le couloir, au premier étage [...] Il dut attendre deux ou trois minutes, avant de monter une autre volée d’escaliers pour se retrouver dans la zone de réception recouverte d’un tapis rouge. Il pouvait imaginer qu’à ce moment-là, derrière les portes à sa droite et sa gauche, on interrogeait, on entendait, on niait, on admettait, on confessait ses remords ou on rassemblait son courage. Et lui ? Comment allait-il se comporter ?
Le maton le conduisit vers une porte, devant laquelle il s’était déjà tenu par le passé. L’interrogateur qui l’attendait était lui aussi déjà connu. Seulement cette fois, il portait un uniforme de lieutenant. En souriant, il attendit que Lenz ait pris place sur le tabouret, avant de demander, comme s’ils ne s’étaient plus vus depuis seulement un peu plus de deux jours .
− Alors ? comment ça va ?
− Vu le contexte, bien.
− Heureux de l’entendre !
Ce qui devait sûrement vouloir dire « Je ne te crois pas, je sais à quel point tu te sens mal et que tu es heureux qu’on reprenne de tes nouvelles ». Lenz détourna les yeux. Mentir avec des mots était facile, mentir avec les yeux beaucoup plus difficile.
Sur la table devant le bureau se trouvait un paquet de cigarettes de la marque Kabinett, déjà ouvert mais encore plein. L’inspecteur fumait-il ? Ou avait-il déposé les cigarettes à son intention ?
− Avez-vous des plaintes à formuler ? Le flic à Sofia lui avait posé la même question. Est-ce lors de leur formation qu’ils apprennent ces questions de réceptionniste d’hôtel ?
− Oui
− Lesquelles ?
− J’aimerais avoir quelque chose à lire. Vous avez sûrement une bibliothèque dans la maison, n’est-ce pas ? La réponse fut un rire amusé.
− Eh bien ça alors ! Vous ne coopérez pas avec nous et êtes si arrogant qu’en guise de récompense vous demandez à recevoir de la lecture ?
Extrait traduit librement du livre Krokodil im Nacken,
Klaus Kordon 2008
La porte-au-nez
− Alors je t’écoute ! Moi j’attends pas hein, si tu me fais attendre je te colle au trou […]
− Je suis prêt à m’expliquer mais je citerai pas de nom.
− Alors on va jouer aux X. Chaque fois que tu parles de quelqu’un tu vas le nommer X1 puis X2, X3 et ainsi de suite. »
− A l’été 97, j’ai rencontré un ancien camarade nationaliste, X1...
Cité du film Les Anonymes, Pierre Schoeller, 2014
La technique de la porte-au-nez consiste à formuler une requête exorbitante par rapport aux possibilités et envies de la cible, qui la refusera systématiquement. Cependant, cette première formulation augmente les chances d’acceptation d’une seconde requête, comparativement beaucoup moins grave, mais suffisamment problématique pour qu’elle ne soit pas été acceptée spontanément. Dans l’exemple donné plus haut, l’inspecteur demande à la personne auditionnée de lui livrer les noms de ses complices, ce que ce dernier refuse catégoriquement. Pourtant lorsqu’on lui demande ensuite de raconter les évènements en masquant les noms par des surnoms (X1, X2, etc.), la même personne répond par la positive. Ce sont là pratiquement les mêmes informations qui sont données, sachant qu’avec les recoupements que pourra faire la police il est fort probable qu’ils·elles arrivent à en déduire des identités réelles.
Amorçage et faux marchandage
Comme technique pour extorquer des informations, le faux marchandage est couramment utilisé par la police. Faux, car les termes sont mensongers et car les promesses dépassent souvent les possibilités même des enquêteurs·enquêtrices. Lorsque les policiers·policières promettent qu’en échange d’informations, ils·elles vont toucher un mot au juge sur ton honnêteté, que la garde de ton enfant ne te sera pas retirée, que tes affaires séquestrées lors de l’enquête te seront rendues, que un·e tel·le ne sera pas informé·e de ce que tu as fait, tout cela est mensonger. La police ne dispose pas de pouvoir d’action et de décision dans ces domaines-là ni sur ce qui va t’arriver dans la suite de la procédure judiciaire. Ces prérogatives relèvent du ministère public, voire des juges.
Il n’est pas rare qu’après t’avoir soutiré une information à coup de fausses promesses, les inspecteurs·inspectrices modifient les termes de votre accord et te reposent d’autres questions en te menaçant de rompre le marché si tu n’y réponds pas. Cela s’appelle la stratégie de l’amorçage et est terriblement efficace. Tu acceptes un marché, car certaines conditions te paraissent acceptables. Au dernier moment, les conditions se modifient, mais tu continues d’accepter cette situation car tu es pris·e par un sentiment d’engagement. Puisque tu as déjà parcouru un bout du chemin, il vaut mieux continuer que de faire marche arrière. Or tu n’aurais pas accepté ce marché s’il t’avait été présenté d’emblée sous sa forme finale. Il s’avère malheureusement qu’une personne informée de la réalité des faits après avoir pris une décision sur de fausses bases risque fort malgré tout de maintenir cette décision.
Passer un contrat avec la police est une démarche très précaire car tu ne contrôles rien des éléments extérieurs et tu ne possèdes aucun moyen de pression pour qu’ils·elles maintiennent leurs promesses.
Proposition d’esquive
Cette technique sert à comprendre si un sujet est sensible pour toi ou non. Les enquêteurs·enquêtrices t’interrogent sur un terrain où iles·elles imaginent que tu as quelque chose à cacher. Après plusieurs questions accusatrices sur ce sujet, ils·elles partent tout d’un coup sur un autre thème, totalement hors sujet pour tester ta réaction. Si tu réagis avec soulagement et que tu t’engages à ton tour dans le thème qui vient de surgir, cela sera interprété comme le signe que tu cherches à esquiver le premier sujet et que tu as potentiellement quelque chose à cacher.
Exemple
− Tu était à Paris lundi dernier ?
− Non
− Allez, arrête de mentir, on le sait que tu y étais.
− Mais non, pas du tout.
− Pourquoi mentir ? On sait que tu t’y rends pour voir Louis. D’ailleurs attend c’est quoi déjà l’équipe de foot de Paris ? StGervains ? St-Germain ?
Esquive
− Ha non c’est le Paris-St-Germain, le PSG.
− Ha oui juste, ils sont plutôt bien dans le classement non ?
− oui oui c’est vrai.
Non-esquive
− Hein ? Mais on s’en fout là non ? Je vous dis que j’étais pas à Paris ce jour-là.
6. Stratégies d’interrogatoire
À l’inverse des techniques de manipulation citées plus haut, les stratégies qui suivent prennent place dans une plus longue temporalité. Elles vont se développer sur la totalité de l’interrogatoire, voire même sur plusieurs interrogatoires d’affilée. Alors que les techniques de manipulation seront utilisées d’emblée en fonction de l’interaction police-suspect·e, les stratégies d’interrogatoire sont choisies et préparées à l’avance selon le profil de la personne interrogée.
Bon flic, méchant flic
Assise dans un petit bureau tout bétonné, tu as devant toi un inspecteur particulièrement agressif qui gesticule, hausse la voix, t’injurie et te menace. Tout d’un coup, la policière derrière lui l’interrompt, s’assoit en face de toi et te regarde calmement. Elle déclare d’une voix rassurante que tout est moins grave que ce qu’il n’y paraît, que c’est bientôt fini, que tu dois juste répondre à ces quelques petites questions et qu’ensuite, promis, tu pourras partir. Tu cèdes ? Non ? Alors le premier flic tape sur la table, te foudroie du regard, menace de te ramener en cellule et de t’y garder pour la semaine, et puis te pose des questions très précises auxquelles tu n’as aucune envie de répondre. Quand la flic « sympa » voit que le thème abordé t’est désagréable, elle coupe son collègue et te lance sur un autre sujet, qui paraît inoffensif et sur lequel tu t’engages volontiers ne serait-ce que pour que le flic « méchant » reste à l’écart et éviter les sujets sensibles. Sauf que petit à petit les questions te ramènent vers le sujet indésirable et que le flic « méchant » n’attend qu’une occasion pour te ressauter dessus. Tiendras-tu le coup ? Bienvenue dans la stratégie du bon flic / méchant flic, grand classique des séries policières.
Dans cette stratégie d’interrogatoire, l’un·e des policiers·policières aura une attitude agressive et menaçante, attaquant frontalement sur des sujets désagréables et inconfortables. À l’inverse, l’autre prendra une attitude rassurante, calme, presque bienveillante. Entre eux, tu es comme une balle de ping-pong, envoyée de l’un·e à l’autre jusqu’à ce que tu craques. Le rôle du flic « méchant » est de te mettre la pression, de te pousser dans tes retranchements, de t’épuiser et de t’effrayer. Lorsque le·la deuxième inspecteur·inspectrice juge que tu es prêt·e à craquer, ou lorsqu’un sujet particulièrement sensible est abordé, il·elle prend le relais, te rassure, t’offre un verre d’eau, te propose une pause, et d’une voix calme te fait des promesses avant de reprendre les questions ; « on veut juste une réponse à cette question ensuite vous pourrez rentrer chez vous ».
Pour se concerter et savoir quand passer la main à l’autre, les policiers·policières utilisent des signaux spécifiques, comme un mot, un signe corporel, ou même une intonation. Les deux rôles ne sont pas nécessairement présents en même temps. Plusieurs entretiens peuvent d’abord avoir lieu avec des flics au rôle de « méchant » uniquement. Puis, arrivent deux inspecteurs·inspectrices, calmes et rassurant·es. Et tu te doutes bien que si tu ne coopères pas, les flics agressifs·agressives reviendront.
Passer rapidement d’une émotion à une autre entraîne un épuisement émotionnel. Cette tentative d’influencer tes émotions par un comportement spécifique s’appelle la contagion émotionnelle. En effet, l’état émotionnel d’une personne en face de nous influence notre propre émotion. Rencontrer une personne agressive pourra nous mettre dans un état de colère, de peur ou de stress alors que rencontrer une personne calme et douce créera de la tranquillité mais peut-être aussi de la méfiance. Avec ce mécanisme, on peut influencer un état émotionnel qui change au rythme des interlocuteurs·interlocutrices et de leurs comportements. Cela provoque un grand épuisement mental. Lié au stress de l’interrogatoire et à la peur d’être à nouveau confronté·e au flic « méchant », le risque de céder plus facilement au flic « gentil » est grand. En fonction de l’ambiance que la police souhaite créer, la disposition des chaises sera différente : face à face pour créer une ambiance de confrontation, et chaise sur le côté de la table s’ils·elles souhaitent t’amener dans une position réconfortante et collaborative.
Pour se protéger, rien de mieux que le silence, ou de répéter en boucle « je n’ai rien à déclarer ». Plus vite les policiers·policières comprendront que tu ne vas pas t’engager émotionnellement dans leur stratégie, plus vite ils·elles te laisseront tranquille.
Sable mouvant
Toujours assise dans le même petit bureau au mur en béton, tu fais face à deux inspectrices qui te posent une question à laquelle tu ne souhaites pas répondre par la vérité. Tu mens sans savoir qu’elles connaissent déjà la vérité. Cette question n’est en fait qu’un test pour voir si tu vas t’engager dans un mensonge ou non. À présent, elles savent que oui. Alors elles te poussent à mentir encore et encore. Chaque mensonge attire une nouvelle question pour laquelle tu vas devoir rapidement inventer une réponse, cohérente avec le reste de ton histoire. Pas facile pourtant de te souvenir de ce que tu leur as exactement dit par le passé. Tout d’un coup, l’air triomphant, une des policières explique qu’elles savent que tu mens, qu’elles ont un élément qui démontre que ce que tu racontes est faux, que tu t’es contredit. Tu ressens que tu n’es plus crédible, que le juge va savoir que tu as essayé de mentir, que ce comportement te rend suspecte. Que tu avoues avec l’espoir de sauver ce qui peut encore l’être ou que tu persistes à nier, la démonstration de tes mensonges est établie et elle sera retenue contre toi lors du procès. La tentation de craquer et de leur donner des aveux complets est alors très grande.
La stratégie du « sable mouvant » vise à te laisser mentir, voire à t’encourager sur cette voie. Cela commence toujours par une question test dont la police connaît déjà la réponse afin d’évaluer si tu vas essayer de leur mentir dans la suite de la discussion. Si c’est le cas, tu vas être poussé·e à fournir de plus en plus de réponses mensongères. Et à chaque fois que tu inventes un nouvel élément, les interrogateurs·interrogatrices rebondissent et te posent de nouvelles questions. En clair, tu t’enfonces dans tes propres mensonges. Et plus tu leur livres d’éléments mensongers, plus le risque devient grand que tu te contredises ou que tes mensonges s’opposent à des éléments déjà récoltés lors de l’enquête (témoignages, traces, indices, etc.).
Mentir à l’improviste demande une grande capacité de concentration, beaucoup d’imagination et une très bonne mémoire.
La police note l’entier de l’interrogatoire, alors que toi tu n’as que rarement la possibilité de prendre des notes. Et quand deux ou trois semaines plus tard les mêmes questions te sont posées à nouveau, tu dois répondre de manière similaire jusque dans les moindres détails. Si tu te contredis, tu perds en cohérence et en crédibilité, jusqu’à ce que finalement ton mensonge tombe en morceaux. Puisque tu ne connais pas les éléments de preuves que les policiers·policières ont récoltés contre toi, comment savoir si en mentant tu es en train de te sauver ou de te nuire ? L’objectif pour la police est de te pousser à mentir puis de faire voler ton mensonge en éclat. Alors les policiers·policères vont te montrer qu’ils·elles savent que tu mens, que tu n’es plus crédible.
Le silence est une meilleure forme d’autodéfense que le mensonge. Tenter de dissimuler la vérité par le mensonge c’est prendre le risque de révéler bien plus d’informations qu’en restant protégé par le silence.
Stratégie de l’entonnoir & phénomène de l’engagement
Assis dans cette même pièce aux murs bétonnés, les deux inspecteurs du jour ont une attitude sympathique, ouverte et légère. Ils commencent par te poser des questions ouvertes, très éloignées du sujet qui te retient enfermé dans leurs locaux. Ça ressemble à une discussion amicale menée dans un café et non à un interrogatoire sous la contrainte. Leurs questions semblent n’engager à rien, ne sont pas menaçantes, tu peux y répondre par la vérité sans crainte que cela soit retenu contre toi. Et tu as peur que si tu refuses de répondre, leur attitude amicale disparaisse et que les choses se compliquent. Sauf que petit à petit, le sujet est habilement amené vers des points sensibles. L’alarme sonne en toi et tu hésites à répondre, tu deviens évasif. Rapidement, on te fait sentir que ton changement de comportement a été détecté et te rend suspect. Lorsque tu refuses de répondre, les inspecteurs se montrent étonnés de ton silence, te font remarquer que jusque-là tu as répondu et que si tu te tais maintenant, cela signifie forcément que tu as quelque chose à cacher, que tu es coupable. Le piège se referme.
Poser des questions ouvertes et sans enjeux particuliers en début d’interrogatoire est une pratique tout à fait banale, peu importe quel profil de suspect·e tu as. Si tu y réponds, les inspecteurs·inspectrices tiennent déjà un élément de pression contre toi si par la suite tu refuses de répondre. « Pourquoi avoir répondu à nos questions jusqu’ici mais refuser de le faire maintenant ? Vous avez quelque chose à nous cacher sur ce sujet ? »
Avec cette stratégie la police cherche à créer ce qui est appelé le phénomène de l’engagement : établir une attitude participative, un engagement émotionnel de ta part dans le processus d’interrogatoire. Plus tu réponds à des questions et donnes des informations, plus c’est ardu de t’arrêter, de déclarer ne plus vouloir poursuivre la discussion. Changer d’attitude nécessite de remettre en question les choix que tu as fait précédemment et de rebrousser chemin, ce qui, inconsciemment, peut s’avérer difficile. C’est à nouveau le silence qui t’aidera le plus face à cette situation. Refuser d’entrée de jeu de répondre aux questions de la police, même si elles paraissent inoffensives, coupe l’herbe sous les pieds des inspecteurs·inspectrices souhaitant te piéger avec la stratégie de l’entonnoir. Sans réponse de ta part, pas de piège à tisser.
Le camarade Knut continua de prendre quelques notes jusqu’à ce qu’il se penche en arrière en poussant un gros soupir et jouant à nouveau le rôle de l’homme étonné : quoi qu’il en soit, dit-il, il ne pouvait pas comprendre pourquoi quelqu’un voudrait couper tous les ponts derrière soi, juste pour une femme. Certes, la République Démocratique d’Allemagne n’était pas un pays de cocagne, il fallait travailler dur si l’on voulait se créer une certaine prospérité, mais c’était le cas partout. D’autre part, il n’y avait pas d’exploitation en RDA et pas d’avenir incertain pour ceux qui voulaient travailler. Dans la société compétitive capitaliste, et cela même leurs propres critiques sociaux occidentaux le confirmaient, tout le monde essayait d’écraser tout le monde simplement pour avancer un peu plus soi-même. C’était une véritable guerre de tous contre tous qui se déroulait dans la République fédérale. Est-ce que lui, Lenz, voulait d’une telle vie, est-ce qu’il voulait que le monde reste bloqué dans cet état-là ?
− N’avez-vous pas appris dans vos études que dans le capitalisme, l’homme n’est qu’un outil entre les mains des propriétaires des moyens de production et qu’il n’est nourri que pour pouvoir être exploité davantage ? Nous voulons créer un monde dans lequel l’homme est la force créatrice, nous voulons construire une Allemagne véritablement démocratique et socialiste. Cela ne vaut-il pas la peine de travailler pour l’obtenir ?
Attention, Lenz ! C’est encore une de ces situations pièges. Ils ne sont pas encore satisfaits de ce qu’ils ont découvert sur toi jusqu’à présent.
− Vous ne dites rien ?
Lenz se tut. Il y avait une frontière pour tout ; la Stasi ne le laissait pas traverser librement leur frontière, il ne laisserait pas la Stasi traverser la sienne. Après tout, il n’était pas un distributeur automatique ; insérez quelques cigarettes et récoltez des réponses en échange.
− Alors vous pensez que tout est merveilleux ici ? Si c’est le cas pourquoi avez-vous voulu partir ?
Lenz voulait continuer à rester silencieux, mais finalement l’envie de parler fut plus forte.
− Je suis peut-être comme le kangourou stupide qui saute hors du zoo et abandonne tout son confort − nourriture, tranquillité, sécurité − juste parce qu’il a une idée floue de la lointaine Australie.
− un Zoo ! Aha !
Le lieutenant nota le mot.
− Vous vous êtes donc senti « emprisoné » avec nous ? Tu vois, Lenz, c’est si facile de se trahir soi-même
− Disons que je m’y sens à l’étroit
− Et qu’est-ce qui vous a fait vous sentir emprisoné ?
Extrait librement traduit du livre,
Krokodil im Nacken, Klaus Kordon 2008
Mécanisme d’acceptation inconscient
− Vous vous appelez bien Georges Jackson [8] ?
− Oui
− Vous avez déjà eu affaire aux services de police par le passé ?
− Oui
− En consultant votre dossier, je constate que vous êtes marié et que vous avez deux enfants, est-ce bien exact ?
− Tout à fait
Posées comme une introduction protocolaire à l’interrogatoire, ces questions ont l’air totalement inoffensives voire même inutiles. Pourtant elles sont le cœur d’une stratégie de manipulation provenant du domaine du marketing : le mécanisme d’acceptation inconscient. Cette technique est utilisée en tout début d’interrogatoire pour amorcer le dialogue avec la personne interrogée. Les inspecteurs·inspectrices connaissent déjà les réponses et n’ont aucun intérêt à ce que tu les confirmes. L’utilité de cette stratégie repose dans le fait de t’amener à dire « oui » à une question à laquelle en tout bon sens c’est l’unique réponse possible. En répondant par la positive à des choses apparemment insignifiantes, tu te mets en position inconsciente de dire « oui » à des faits bien plus conséquents.
Dans le domaine de la vente, cette technique est couramment utilisée, par exemple lors de ventes par téléphone ou dans la rue. La théorie du marketing veut qu’une vendeur·vendeuse arrive plus facilement à vendre son produit après avoir fait dire trois « oui » à sa « victime commerciale ». L’objectif est d’encourager la personne auditionnée à une attitude de collaboration positive pour la suite des événements.
Pour éviter de se faire influencer par cette stratégie, le meilleur moyen est d’aborder d’entrée de jeu une attitude de non-collaboration avec les policiers·policières qui mènent l’interrogatoire. Le plus simple est de répondre dès la toute première question avec la phrase « je fais usage de mon droit au silence » et de la répéter à chaque question.
Humaniser la relation & bouée de sauvetage
Enfermée depuis des heures voire des jours dans une inconfortable et froide cellule de garde à vue, tu es stressée, mise sous pression, dans le doute quant à ton avenir et soucieuse de comment se portent tes proches. Les policiers et policières avec qui tu as eu contact ont eu une attitude froide, agressive et hostile. La solitude et le manque de contact social te pèsent. Soudain une policière te sourit, te parle avec gentillesse et bienveillance, se montre compréhensive et rassurante quant à ta situation et te propose même des « faveurs » jusqu’alors refusées (verre d’eau, nourriture, appel téléphonique, lecture). Pourtant, bien vite, cette même policière te pose des questions dérangeantes et lorsque tu refuses d’y répondre elle se montre personnellement déçue et te culpabilise « après tout ce que j’ai fait pour vous − moi qui croyais en votre sincérité ». Si tu maintiens ton attitude non-coopérative, les faveurs et la gentillesse vont disparaître aussi vite qu’elles sont apparues.
Placé·e en garde à vue ou en détention préventive, ton seul contact social est avec les inspecteurs·inspectrices qui t’interrogent et les policiers·policières qui te gardent en cellule. Cette situation est exploitée avec la stratégie cyniquement appelée le phénomène de « bouée de sauvetage ». Lorsqu’au milieu d’un environnement hostile, une personne nous tend soudainement la main et fait preuve de gentillesse, il est dur de ne pas se sentir redevable envers elle. Ce sentiment va être utilisé pour te faire du chantage affectif. Le·la policier·policière en question fera part d’une profonde déception, surtout après s’être investi·e personnellement et émotionnellement, en espérant ainsi accentuer le sentiment de culpabilité chez la personne qui refuse de collaborer.
Suivant ton profil émotionnel et social, cette stratégie peut être extrêmement déroutante et déstabilisante. La peur de décevoir la seule personne ayant fait preuve d’un peu d’humanité depuis plusieurs jours et le sentiment de lui être redevable de ses « faveurs » poussent à aller dans le sens voulu par cette stratégie : l’aveu et la collaboration à l’interrogatoire. Dans un tel moment, garde en tête l’asymétrie totale de cette situation. Après t’avoir arraché·e à la liberté et enfermé·e dans une pièce bétonnée, isolé·e de l’extérieur, la police tente un chantage émotionnel en te faisant dmiroiter un verre d’eau ou une cigarette. N’oublies pas que l’enquêteur·enquêtrice qui se montre « gentil·le » avec toi ne le fait pas par hasard ou par humanité mais parce que c’est un élément d’une stratégie de manipulation dont tu es la cible.
Syndrome de Stockholm
Le terme « Syndrome de Stockholm » s’est développé en psychologie en référence à un braquage de banque avec prise d’otage à Stockholm en 1973. Après avoir pourtant passé six jours sous la détention des braqueurs, les otages ont montré une forte solidarité avec ces derniers. Ils·elles protégèrent les bandits de leurs corps lors de l’assaut de la police, refusèrent de témoigner lors du procès, prirent leur défense, se cotisèrent pour payer leurs frais d’avocats et allèrent leur rendre visite en prison [9].
En psychologie, le « Syndrome de Stockholm » désigne depuis lors un phénomène d’attachement paradoxal des victimes de séquestration envers leurs agresseurs·agresseuses. C’est le fait de perdre de vue l’objectivité de la situation et de s’identifier à la personne qui pourtant t’oppresse. Le sentiment de reconnaissance pour ne pas être plus maltraitée surpasse le ressenti négatif de l’oppression vécue. Le syndrome de Stockholm peut être vu comme une manifestation inconsciente de survie : le sujet concerné, en s’attirant la sympathie de l’agresseur·agresseuse, peut se croire partiellement hors de danger, voire susceptible d’influencer les émotions de l’agresseur·agresseuse.
Les stratégies et techniques de manipulation qui se construisent sur l’humanisation de la relation police-prévenu·e et la contagion émotionnelle cherchent à créer ce phénomène. Lorsque tu ressens de la gratitude envers un·e policier·policière pour t’avoir amené de l’eau alors même qu’il·elle t’enferme (et te prive d’eau), il s’agit d’une forme du syndrome de Stockholm.
Contagion émotionnelle
Assis sur ta chaise inconfortable, tu écoutes le policier te parler des dommages collatéraux que tes actes ont provoqué, du désarroi et de la détresse des personnes qui ont retrouvé leurs vitrines brisées. Tu sens monter en toi la culpabilité, la honte et le doute. Et s’il disait vrai ? Ton intention n’était pas de faire souffrir des gens lorsque tu as lancé cette pierre dans une vitrine de boucherie mais de protester contre la souffrance animale. L’inspecteur change de ton et devient énervé. À présent, il t’accuse d’être un lâche, de ne pas assumer tes convictions, d’être un suiveur de groupe. C’est la colère et l’indignation qui montent maintenant en toi. Tu ressens l’envie de te justifier, de t’expliquer et de te défendre. Mais tu te retiens de justesse. Alors l’autre policier présent prend une voix dure et te menace : « tu vas prendre cher, ta famille ne te comprendra pas, tu risques même de perdre ton emploi. Et si tu continues à t’enfermer dans le silence, tu resteras enfermé ici une semaine de plus ». Ses paroles attisent des craintes déjà bien présentes en toi. Tu prends peur, l’émotion jaillit et les larmes coulent en même temps que tu te mets à répondre à leurs questions.
Passer d’une émotion à une autre entraîne un épuisement émotionnel. Cette stratégie policière consiste à influencer ton émotion par le comportement des enquêteurs·enquêtrices. En psychologie, cela s’appelle la contagion émotionnelle. L’état émotionnel des personnes en face de nous influence notre propre état émotionnel. Rencontrer une personne agressive par exemple, pourra te mettre dans un état de colère, de peur ou de stress alors que rencontrer une personne calme et douce créera de la tranquillité mais peutêtre aussi de la méfiance. Avec ce mécanisme, il devient possible d’influencer ton état émotionnel qui changera au rythme de tes interlocuteurs·interlocutrices et de leurs comportements.
Les policiers·policières vont chercher quel état émotionnel représente pour toi la plus grande vulnérabilité et va te faire perdre tes moyens. Est-ce la honte et la culpabilité éveillant l’envie de te racheter et de te confesser à travers l’aveu ? La colère dans laquelle tu n’arriveras plus à garder ton sang-froid ? Ou encore la peur qui te poussera à faire des déclarations ? L’étude de ton comportement durant la garde à vue / détention provisoire, les interactions que tu auras tout du long de ton arrestation et de ta détention pourront donner de précieux éléments à la police pour répondre à cette question. La contagion émotionnelle se transmet par la communication verbale et non-verbale. Une attitude ouverte, souriante et presque joyeuse d’un·e inspecteur·inspectrice (sourire, bras ouverts) t’influencera différemment qu’un comportement distant et hostile (bras croisés, regard en coin).
« Alors il y a le vrai énervement, mais c’est assez rare, et il y a le faux énervement. Donc c’est du cinéma, il y a des moments où ça va être du show. C’est du bluff. C’est-à-dire que tu vas t’énerver, tu te mets à hausser le ton, tu gueules, tu leur rentres dedans si tu veux »
Flic naïf·naïve
Lorsque l’inspecteur commence l’interrogatoire, tu te dis très vite qu’il ne doit pas encore avoir beaucoup d’expérience en la matière. Il pose des questions qui te paraissent peu pertinentes, voire même carrément hors-sujet. Visiblement, il fait fausse route sur toute la ligne et n’est pas juste novice mais carrément incompétent. Cela te rassure et te donne confiance dans le fait que tu vas t’en sortir. Tu tentes un mensonge, puis un autre et pris dans ton optimisme tu lâches une information de trop. L’attitude de l’inspecteur change ; il te montre une contradiction dans tes mensonges, te fait comprendre qu’il sait que tu mens et qu’il peut le démontrer. Les questions deviennent très précises en touchant des sujets sensibles. À son expression changée, tu comprends qu’il s’est joué de toi et t’as laissé gagner en confiance pour que tu fasses des erreurs.
La stratégie du flic naïf·naive est utilisée en début d’interrogatoire, lors de ton premier contact avec les policiers·policières. Dans cette stratégie, c’est souvent un·e policier·policière jeune qui va se présenter à toi comme le·la flic peu dégourdi·e, à côté de la plaque, voire carrément idiot·e. L’objectif est de te mettre en confiance et de te faire baisser la garde afin que tu fasses des erreurs. Tu pourrais par exemple lâcher une information importante en sous-estimant le fait que les inspecteurs·inspectrices puissent l’utiliser contre toi. Ou mentir avec confiance en pensant que ton mensonge ne sera pas percé à jour par ces enquêteurs·enquêtrices novices.
Cette stratégie crée non seulement chez toi un manque de méfiance et de défense mais elle peut te déstabiliser lorsque tu remarques que les policiers·policières se sont joué·es de toi, que la situation telle que tu l’avais évaluée ne correspond pas à la réalité et que tu t’es mis·e en danger. Cela peut soudainement inverser ta vision. Après avoir pensé être dans une position supérieure à l’inspecteur·inspectrice à cause de sa naïveté visible, tu te sens mis·e en infériorité puisque tu as pu être berné·e.
« C’est très bien d’être policier avec ce caractère d’autorité à partir du moment où on peut jouer dessus, y compris avec son paradoxe. C’est-à-dire que vous êtes autoritaire et débile, et puis tout à coup quand vous discutez avec les gens vous avez l’air ouvert et sympa. Bah c’est déstabilisant, et ça ouvre des possibilités. »
Entretien synchronisé
Toi et tes amies avez toutes été arrêtées simultanément, trois jours après être allées déboulonner ensemble la statue d’un ancien esclavagiste, pourtant célébré par la société. Visiblement, la police vous soupçonne. Heureusement, vous vous étiez mises d’accord sur une version commune à raconter en cas d’arrestation. Pendant l’interrogatoire, tu réponds aux questions en narrant l’histoire que vous aviez préparée. Peu de temps après, les policiers reviennent et te font part de quelques légères divergences dans ton histoire par rapport à celles qu’ont racontées tes amies. Tu réponds en essayant de recoller les morceaux tant bien que mal. Mais une tension s’installe en toi. Comment être sûre que tu restes cohérent·e avec ce que disent les autres ? Encore plus tard, lors du troisième interrogatoire, tu comprends à travers les questions des policiers que ce ne sont plus de simples divergences qui sont présentes entre vos versions, mais de réelles contradictions laissant supposer un mensonge. Tu réalises, trop tard, que tes amies ont subi exactement le même interrogatoire que toi, dans le même ordre et que les inspecteurs ont ainsi réussi à transformer ce qui était d’abord une légère différence dans la même histoire, en deux versions opposées.
Les entretiens synchronisés sont une stratégie spécifiquement utilisée lorsque la police auditionne plus d’une personne à propos d’un même événement. Elle permet de vérifier si les différent·es suspect·es ont préalablement convenu d’une fausse histoire commune afin de dissimuler la vérité. Dans un tel cas, toi et tes ami·es seront interrogé·es séparément mais suivant un schéma d’interrogatoire exactement similaire. Les questions seront posées de la même manière et dans le même ordre afin d’amener la même interprétation. Il sera facile de remarquer où se trouvent les divergences, quels sont les petits détails auxquels vous n’avez pas pensé, les questions qui n’avaient pas été anticipées et qui vous ont pris de court.
Après comparaison entre les différentes versions, un deuxième interrogatoire est à nouveau mené simultanément et de manière identique chez toutes les personnes interrogées sans que vous n’ayez pu vous concerter entre vous. De cette manière, il devient aisé pour la police de creuser les écarts entre vos déclarations, jusqu’à faire perdre la crédibilité à votre histoire et à démontrer, par comparaison, qu’il s’agit d’une version préparée à l’avance.
Une trop grande similarité dans une même histoire racontée par plusieurs personnes peut être tout aussi suspecte que de trop grandes lacunes. Deux personnes qui ont vécu un instant commun le raconteront chacune selon leur propre mémoire, construite à travers les propres ressentis et sensibilités. Le rendu sera sensiblement moins identique que si les deux personnes racontent la même histoire apprise par cœur.
Mettre le doigt sur les changements de comportement
L’interrogatoire a commencé par des questions ouvertes sur des sujets sans trop d’enjeux. Pour te donner une image innocente tu as décidé d’y répondre. Tout d’un coup, une enquêtrice te pose une question sur un sujet qui te met clairement mal à l’aise. Tout en dissimulant ta gêne, tu tentes de répondre en esquivant le sujet. Les questions deviennent moins menaçantes jusqu’au moment où l’inspectrice te pose une série de questions précises, toujours à propos de la thématique qui t’a déjà mis dans l’embarras et sur laquelle tu ne souhaites pas t’aventurer. Tu essaies d’esquiver à nouveau mais cette fois les policières te font clairement comprendre qu’elles ont remarqué ton changement de comportement chaque fois qu’elles abordent ce sujet et qu’elles savent que tu souhaites dissimuler quelque chose. Tu te sens rougir. Tu hésites, tu bafouilles et finalement tu leur dis que tu ne souhaites pas répondre à cette question. « Fort bien, c’est votre droit en effet, te répondent t-elles, mais vous devez savoir que devant un tribunal, cela sera perçu comme un indice de culpabilité. Sinon, pourquoi avoir été d’accord de répondre aux premières questions et subitement plus à cellesci ? Vous avez quelque chose à cacher et nous le savons. Avouer vous soulagera et fera gagner du temps à tout le monde ».
Lors d’un interrogatoire, les inspecteurs·inspectrices étudient autant ton langage corporel que tes réponses verbales. Cela leur fournit beaucoup d’indications pour connaître les thèmes qui te sont sensibles, où tu deviens nerveux.nerveuse ou stressé·e. En te montrant tes changements de comportement, par exemple lorsqu’ils·elles évoquent des personnes soupçonnées d’être tes complices, les policiers·policières tentent de te donner l’impression que tu te fais trahir par ton corps et que tu n’es plus crédible. Pourquoi deviens-tu agité·e lorsque tu réponds à cette question-ci alors que juste avant tu paraissais calme et détendu·e ? L’objectif visé est de te déstabiliser, de te faire douter de toimême, de tes capacités à dissimuler des choses à la police et de te donner une impression que « tout est déjà joué ». Le fait de ne répondre à aucune de leurs questions te protège fortement contre cette stratégie. Sans comparaison possible entre tes différentes réponses et réactions aux questions, il n’est pas possible d’utiliser contre toi ton potentiel changement de comportement.
Minimiser / maximiser
Depuis le début de ta garde à vue, tu te prends la tête à réfléchir aux conséquences que pourraient avoir une condamnation. Est-ce que tu risques une grosse amende ? Une peine de prison ? Si oui de quelle durée et dans quelles conditions ? Est-ce que tes proches vont se montrer compréhensifs ? Et ton employeur ? De manière inconsciente, ton cerveau se concentre sur la pire des possibilités et tu imagines comment tu vivras une condamnation de plusieurs mois de prison accompagnée du rejet de ton environnement social. Ton stress et ton anxiété montent. Pourtant, lors de l’interrogatoire, tu entends avec soulagement les inspecteurs évoquer que tu ne risques qu’une amende, qu’à ton âge eux-mêmes ont fait bien pire, que ce dont tu es accusée est illégal mais somme toute assez banal et que « les dealers voilà les vrais criminels » toi ce que tu as fait en comparaison « c’est pas bien grave ». Entendre cela te détend, la pression en toi redescend. Après avoir imaginé le pire, la perspective d’une simple amende à payer te paraît moins dangereuse, presque salvatrice.
Tu ressens moins d’enjeu à te protéger, tu baisses la garde et tu réponds à leurs questions jusqu’à être ramenée en cellule. Un doute apparaît alors dans ton esprit. Et s’ils avaient menti ?
La police liste trois peurs pouvant empêcher les personnes interrogées de passer aux aveux :
• la peur de la répression juridique, de la peine encourue
• la peur de la répression sociale, du rejet de la famille, des proches, de la perte de travail
• la peur de son propre sentiment de culpabilité, d’avoir enfreint sa propre morale et d’avoir honte de soi. Cela peut empêcher de s’avouer sa faute et par conséquent de l’avouer à autrui
En minimisant les faits, la réaction de l’entourage et la gravité des faits, les inspecteurs·inspectrices cherchent à atténuer les peurs que tu pourrais avoir, à te rassurer afin que tu aies moins de réticence à avouer tes actes. À toi-même d’abord, mais bien sûr aussi aux policiers·policières qui t’interrogent. Ils·elles peuvent donc te raconter que tu ne risques pas grand-chose juridiquement, faire preuve de compréhension pour ce dont tu es accusé·e d’avoir fait et surtout sur le pourquoi tu l’as fait. Ils·elles vont également t’assurer que tes proches comprendront ce que tu as fait et te pardonneront. Ils·elles compareront ce que tu as fait avec des crimes « vraiment » graves en te disant que « tu aurais pu faire bien pire ».
Il est normal et légitime de ressentir des peurs
et de leur offrir de la place.
Néanmoins, c’est particulièrement dangereux (et inutile) de se confronter à ses démons dans le cadre de l’interrogatoire en présence de policiers·policières qui cherchent à exploiter ces faiblesses pour te manipuler.
Pour te confronter aux conséquences juridiques, ton avocat·e ou un groupe de soutien juridique auront de bien meilleurs conseils. N’oublie pas qu’entre ton passage chez la police et le procès où tu seras jugé·e, tu auras le temps nécessaire pour te renseigner sur ce que tu risques en cas de condamnation. Tout cela en connaissant du contenu du dossier d’enquête. En ce qui concerne la réaction de tes proches, qui est mieux placé·e que toi pour anticiper leurs réactions face à ta condamnation ? Sûrement pas des policiers·policières doté·es des œillères d’une institution garante de l’ordre moral. Discuter et débattre en amont avec ses proches, du sens que l’on voit dans des concepts tels que « coupable et innocent », « légal et illégal » ainsi que du fonctionnement des institutions de justice et du sens que l’on voit dans nos choix de vie, même lorsqu’ils sont illégaux, aident à créer un terrain de compréhension mutuelle.
Peut-être que tu ressens un sentiment de culpabilité, que tu regrettes les actes que tu as commis et pour lesquels la police enquête à présent sur toi. Nous faisons tous·toutes des erreurs ou des actes que nous regrettons par la suite. L’enjeu se trouve dans la transformation qui pourra être permise à travers la responsabilisation de ces actes, d’un sentiment d’empathie et d’honnêteté.
La justice institutionnelle n’a pas pour but de réparer les dommages causés ou de transformer la souffrance vécues en un changement émancipateur. Elle vise en première ligne à punir les personnes coupables d’avoir enfreint les lois. Une institution autoritaire et bureaucratique n’est pas une base propice à une démarche réparatrice. La réparation d’un préjudice ou d’une souffrance a bien plus de chance d’aboutir lorsque la démarche se fait avec les personnes concernées et touchées par les actes produits, en interaction individuelle ou au sein d’une même communauté.
Cette stratégie s’emploie aussi dans le sens inverse. En exagérant la gravité des faits afin de jouer sur la tendance naturelle à accepter une infraction d’une gravité moindre que celle présentée initialement.
« Tu lui expliques qu’il s’est retrouvé dans une affaire qui le dépasse. [À ce moment, le suspect] croit qu’il est dans une affaire de droit commun, mais les téléphones qu’il a volés ils ont servi pour du terrorisme, et ça il savait pas. [je lui dis alors] soit tu m’expliques pourquoi tu as volé, comment, avec qui et voilà, soit tu vas être impliqué dans une affaire de terrorisme, c’est toi qui vois. Tu te sers de ça pour appuyer là où ça fait mal et pour avoir des infos, et là tu lui mets une pression psychologique ».
Rejeter la faute sur autrui
Lorsque, inquiète, tu arrives dans la salle d’interrogatoire, les enquêtrices font preuve d’une forte compréhension envers ta situation. Elles évoquent tes complices qui t’auraient mis la pression pour que tu acceptes de les aider à cultiver du chanvre et qui porteraient une plus grande part de responsabilité que toi. Elles parlent des lois qui sont mal faites puisque dans d’autres pays la culture de chanvre est déjà dépénalisée, elle parle de la société qui a besoin de temps pour comprendre que le cannabis n’est finalement pas plus dangereux que l’alcool. Elles aussi fumaient de l’herbe en étant ados. Elles te disent que toi au moins tu ne deales pas d’héroïne, que « ça c’est de la vraie saleté ». Ces déclarations confortent des pensées déjà présentes en toi. L’environnement de cette salle d’interrogatoire dans laquelle tu es enfermée devient moins hostile, tu te sens comprise et entendue dans le fait que tu ne portes pas réellement une grande responsabilité morale dans ce dont tu es accusée. Un sentiment inconscient de reconnaissance naît en toi, envers ces policières qui ont contribué à t’enlever la culpabilité que tu pouvais porter. Te sentant en terrain favorable, tu t’ouvres et reconnais ce que l’on te reproche.
Rejeter la faute sur autrui (les lois, la société, les complices voire, pour les policiers·policières les plus cyniques, sur les victimes) vise à amener la personne entendue dans une posture de déresponsabilisation face à ses actes. Et si tu n’es pas vraiment responsable, nier ce qui t’es reproché devient tout d’un coup moins important. Les enquêteurs·enquêtrices te font croire que puisque tu ne portes pas toute la responsabilité morale de tes actes, tu vas bénéficier de circonstances atténuantes lors de ta condamnation. C’est l’occasion pour moi de rappeler que le travail de la police consiste uniquement à composer un dossier avec des éléments pouvant servir à te condamner lors d’un procès. Tout ce qui relève de la condamnation (type de peine, longueur, clémence, circonstances atténuantes) dépasse totalement leur fonction. Pour ces décisions, c’est l’appréciation d’un·e juge qui entre en compte.
Dans une enquête visant plusieurs personnes, une stratégie récurrente est de te faire croire que c’est de la faute de tes complices si la police s’est retrouvée à enquêter sur toi. L’un·e d’entre eux·elles n’aura pas fait assez attention et aura laissé fuiter une information ou t’aura balancé lors de son interrogatoire. L’accent est mis sur le fait que ce n’est pas à toi de payer pour une erreur commise par quelqu’un d’autre. Cela te pousse à te désolidariser de tes complices en donnant des informations à la police.
Une stratégie parallèle consiste à te présenter une version des faits où tu t’es fait entraîner par tes complices plus ou moins contre ton gré et où tu porterai donc moins de responsabilités que les autres (ce qui induit à penser que tu auras une peine moins lourde). La contrepartie de ce « deal » est que tu vas devoir répondre aux questions. Car si tu as participé à l’action illégale uniquement sous pression, pourquoi vouloir ensuite protéger ceux.celles qui t’ont forcé la main ?
Encourager à l’aveu
Depuis ton arrestation, tu es pris d’un sentiment de doute et de culpabilité par rapport aux actes que tu as commis. Tu as peut-être agi un peu trop vite, de manière un peu trop irréfléchie. À présent tu regrettes. Dans l’idéal tu te rendrais auprès des personnes touchées par tes actes pour leurs présenter tes excuses et réfléchir ensemble à comment réparer ce qui a été fait. Mais la Justice s’est déjà immiscée dans l’histoire et plutôt que la réparation, c’est de punition qu’il va être question. Et que va penser ton entourage de tout cela, quelle image de toi auront les gens ? Tu ressens le besoin de te justifier, d’expliquer ton acte et tes intentions. Malheureusement tu es isolé. En face de toi ne se trouvent que les habituels inspecteurs. Ces derniers s’efforcent d’attiser ton sentiment de culpabilité tout en se montrant compréhensifs de ta situation. Ils se disent conscients que tu vis une mauvaise passe et t’assurent que tout cela ne sera bientôt qu’un mauvais souvenir. En avouant, tu feras preuve de repentance, ton entourage comprendra que tu regrettes ce qui s’est passé et tu te sentiras soulagé d’avoir entamé le chemin de la rédemption. Pour cela rien de mieux que de passer aux aveux.
La plus banale des stratégies d’interrogatoire. Après avoir attisé en toi la culpabilité et le remords, les inspecteurs·inspectrices te présentent l’aveu comme un premier pas vers la rédemption. Ils évoquent le soulagement que va te produire le passage aux aveux, en prenant appui sur le modèle religieux de la confession. Tes croyances religieuses, principes moraux et la notion du Bien et du Mal sont alors exploités afin d’y chercher des contradictions avec les actes que tu as pu commettre, et te pousser dans une position de fautif·fautive cherchant le pardon. C’est ici que l’on va entendre des expressions du type « ça va te libérer », ou « vas-y sors-le, ça va te faire du bien ».
Un autre argument mis en avant, est que « plus vite tu reconnais et plus vite tout cela sera derrière toi ». En réalité, c’est plutôt l’inverse qui est vrai. Combien de conflits interhumains auraient été résolus depuis longtemps si la Justice n’était pas entrée en jeu, avec toute sa lourdeur et sa lenteur ?
Flatterie – moquerie
« Normal qu’un nul comme toi se fasse pincer aussi vite. »
« Décidément vous deviez être totalement inconsciente et naïve pour croire qu’un plan pareil avait des chances. »
« En quinze ans de carrière je n’ai encore jamais vu ça. »
« Une idée pareille est vraiment audacieuse. »
« Vous avez préparé votre plan de manière très astucieuse et clairvoyante, c’est rare que l’on voie ça. »
La flatterie tout comme la moquerie sont de puissants leviers émotionnels, agissant sur la fierté, l’ego ou encore la vanité. Les inspecteurs·inspectrices peuvent ainsi se moquer de l’incapacité de la personne interrogée et des erreurs commises afin de la pousser à se justifier et à rectifier l’image négative qu’ils·elles ont d’elle. À l’inverse, la flatterie sera utilisée avec l’objectif que la personne interrogée reconnaisse ou s’attribue des faits présentés comme particulièrement osés ou astucieux. Ce travail de valorisation/dévalorisation peut se faire sur une longue durée au travers d’insinuations subtiles réparties entre les interactions avec la police dans et hors interrogatoire. Cette stratégie est très utilisée chez les personnes jugées narcissiques, ayant trop ou trop peu de confiance en elles ou habitées par un sentiment de supériorité.
Pour se protéger, une piste est de ne pas se laisser aller à une bataille émotionnelle avec les policiers·policières qui te provoquent. Peu importe ce qu’ils·elles pensent de toi ou leur avis sur la situation, tu n’as rien à leur prouver. Ce sont des inconnu·e.s, ils·elles apparaissant dans ta vie uniquement pour un très court instant, avec des intentions hostiles à ton égard. Être intègre avec ses idées et au clair avec ses choix de vie, légaux ou non, évite de se laisser provoquer sur le terrain de l’ego.
Spéculer sur les moyens d’enquêtes
Tu arrives à l’interrogatoire assez sûre de toi. Tu en as vu d’autres. Les policiers qui t’ont arrêtée n’ont sûrement rien en leur possession qui pourraient prouver ta culpabilité. Ils te soupçonnent, c’est sûr, mais heureusement un soupçon n’est pas suffisant pour condamner une personne. Il te suffit de ne rien dire et tu devrais t’en tirer. Les policiers remarquent très vite ta grande confiance en toi et le fait que tu ne sembles pas très inquiétée par les risques que tu encours. Pourtant, eux aussi prennent un air confiant. Ils te disent que ça n’a pas d’importance que tu parles ou non, n’es-tu pas au courant qu’ils ont en leur possession des enregistrements vidéos provenant de caméras de surveillance où l’on te voit ? Il te semblait pourtant ne pas avoir aperçu de caméra mais peut-être que tu t’es trompée, que tu n’as pas regardé assez précisément ? Sous peu, te disent les policiers, ils auront les résultats des relevés d’empreintes digitales, des traces de chaussures et de l’ADN prélevé sur place. Tu sens la chaleur te monter au visage et ta confiance faire place au doute : tu avais des gants et tu as jeté tes chaussures mais l’ADN ? Comment est-ce que ça se relève déjà ces traces-là ? Est-ce que tu t’es assez protégée ? Les policiers continuent, ils évoquent que plusieurs personnes ont déjà répondu à leur appel à témoin passé à la radio et que les relevés de ton téléphone semblent également assez prometteurs. Mince ton téléphone ! Tu n’y avais plus pensé à celui-là. Est-ce que tu as bien tout effacé ? Et est-ce qu’on ne t’avait pas une fois raconté qu’il existait des possibilités de retrouver des fichiers anciennement supprimés ? À ce stade-là, ta confiance en toi est clairement entamée. Et si de toute façon ils trouvent toute la vérité ? La tentation se fait forte de tout avouer, de te montrer coopérative pour faire preuve de repentance et espérer ainsi gagner un petit peu de clémence lors du procès.
Je l’ai déjà évoqué, en tant que personne interrogée, tu n’as pas accès au dossier d’enquête et tu ne connais donc pas les éléments qui s’y trouvent. D’autre part, à moins de t’y être sérieusement confronté·e, tu n’as probablement pas une connaissance très claire des moyens que la police possède ni du cadre légal dans lequel elle évolue. En résumé, tu ne sais ni ce que les policiers·policières savent ni les capacités qu’ils·elles ont pour faire leur travail. C’est cette ignorance qui est exploitée. Les inspecteurs·inspectrices cherchent à te faire croire que tout leur est possible, qu’ils·elles ont des moyens, des ressources et du temps illimités, qu’ils·elles possèdent déjà toute une série d’indices matériels ou qu’ils·elles vont les trouver avec certitude. L’objectif de cette stratégie est de t’amener dans une des deux postures suivantes :
• La résignation : « tout est perdu, les flics savent déjà tout, ça ne fait plus de différence si je leur parle à présent, alors à quoi bon résister ».
• La justification : l’impression que veulent donner les policiers·policières c’est que ce que tu vas dire (ou ne pas dire) n’a pas vraiment d’importance, qu’ils·elles t’interrogent uniquement par routine mais que leur version est déjà faite. Ce sentiment peut engendrer une forte motivation à te justifier, à rétablir les faits en leur fournissant des explications. Et à travers cela, leur donner plus d’informations que ce dont ils·elles disposent réellement.
7. Types de questions
Il existe plusieurs manières de formuler une même question. En fonction de la stratégie visée ou de ce que l’inspecteur·inspectrice veut te transmettre comme information, la manière de formuler la question sera adaptée. Cette liste aborde les principaux types de formulation de questions.
Ouvertes / directes
Les questions ouvertes abordent un thème de manière particulièrement large. Elles visent à récolter une information fluide, non cadrée. Elles incitent à l’expression libre, à la discussion plutôt qu’à une réponse précise et limitée. Les inspecteurs·inspectrices les utilisent pour donner l’image qu’ils·elles s’intéressent réellement au sujet abordé et pour sortir d’un schéma de confrontation. Les questions ouvertes encouragent à une attitude de collaboration active de ta part.
Lors d’un interrogatoire, ce type de question est privilégié au début et permet de se faire une image de la personne que l’on a en face et de son schéma de pensées. De plus, les questions ouvertes permettent de dessiner les contours de futures questions, qui seront, elles, bien plus précises. Ce type de question est notamment utilisé pour la stratégie de l’entonnoir.
Exemples :
− Que pensez-vous de cette situation ?
− Que pouvez-vous me dire sur ce sujet ?
− Est-ce que vous aimez votre travail ? Le cinéma ? Le sport ?
− Comment se déroule habituellement votre journée ?
Fermées ou indirectes
Il s’agit de questions qui visent une information précise et spécifique. Elles orientent l’interrogatoire vers un point précis. Elles entraînent souvent des réponses courtes comme oui ou non. Lorsqu’elles sont glissées brusquement au milieu de questions ouvertes, les questions fermées créent un effet de surprise qui peut te déstabiliser et te pousser dans tes retranchements. Lors de la stratégie bon flic, méchant flic, c’est le genre de question utilisé par le méchant flic. C’est aussi ce type de question qui est utilisé pour te faire répondre oui et activer la stratégie du mécanisme d’acceptation inconsciente.
Exemples :
− Qui vous a donné cet argent ?
− Avez-vous vu X hier ?
− Vous êtes-vous rendu à Paris dans la semaine ?
Spéculatives
Ces questions sont utilisées pour te donner l’impression que les policiers·policières connaissent déjà en partie la réponse ou en tout cas te faire spéculer sur leur niveau de connaissance. Ce sont des questions qui t’offrent souvent deux choix de réponses grâce à l’article "ou". Elles orientent clairement la réponse attendue, ce qui en fait de bons outils pour recadrer la conversation.
Exemples :
− Vous avez vu Monsieur Bertrand avant ou après son départ ?
− Y a-t-il une raison pour laquelle un voisin a déclaré que votre voiture était parquée près du lieu des faits ?
Tests
Lorsque, pour orienter leurs futures stratégies, les enquêteurs·enquêtrices ont besoin de savoir si tu vas t’engager dans un axe de défense reposant sur le mensonge, ils·elles vont commencer par te poser une question test. C’est une question à laquelle ils·elles connaissent déjà la réponse mais partent du principe que toi tu ignores qu’ils·elles en ont connaissance. Il est très difficile de reconnaître lorsque tu te trouves face à une question test. La stratégie du sable mouvant commence fréquemment par une question test.
Exemples :
− Où étiez-vous hier soir ?
− À quelle date avez-vous emménagé dans votre appartement ?
− Pourquoi n’êtes-vous pas allé travailler hier ?
Suggestives
Les questions suggestives sont clairement orientées. Elles visent à te pousser dans tes retranchements, à te mettre mal à l’aise. Comme si les policiers·policières savaient déjà très bien ce qui s’était passé mais voulaient encore te le faire dire avec tes propres mots. L’effet souhaité peut être de te pousser à l’aveu, de renforcer la stratégie de l’engagement ou encore que tu leur donnes plus d’informations en ressentant le besoin de te justifier et de te défendre contre les insinuations portées contre toi. Pour ce faire, les questions peuvent être ponctuées d’avertissements comme « Réfléchissez bien avant de répondre ! », ou « Êtes-vous sûr de cela ? »
Exemples :
− Pourquoi nous avoir menti en affirmant que vous êtes sorti de chez vous hier soir ?
− C’est vous qui avez envoyé cette lettre ?
− C’est votre complice qui vous a fait ça ?
Projection
Lorsque la police cherche à humaniser le lien entre eux·elles et toi, à te projeter dans des émotions comme la culpabilité et la honte, ou à t’amener à prendre du recul par rapport à la situation présente, des questions de projection peuvent être utilisées. C’est aussi un type de question particulièrement efficace pour amener la personne interrogée sur le terrain neutre du conditionnel. À la question « Si vous étiez dans le besoin, est-ce que vous iriez prendre de l’argent dans la caisse de votre employeur ? » il est moins risqué de répondre oui que si la question était formulée ainsi : « Est-ce que vous avez volé dans la caisse de votre employeur ? ».
Exemples :
− Si vous étiez à notre place, que penseriez-vous ?
− Pourquoi pensez-vous que le coupable ait agi de la sorte ?
− Que ressentiriez-vous si des gens pénétraient illégalement chez vous ?
Rebond
Ce sont des questions courtes permettant aux inspecteurs·inspectrices de rebondir sur une information qui leur paraît importante afin de rediriger la discussion dans la direction souhaitée. Elles sont aussi utilisées pour donner une impression de compréhension, d’empathie et d’intérêt des inspecteurs·inspectrices envers toi.
Exemples :
− De quelle couleur était cette voiture ? (lorsque tu viens d’évoquer une voiture)
− Et quel sport aimez-vous ? (après que vous ayez déclaré ne pas aimer le tennis)
− En quoi ? Dites m’en plus.
Miroir
Les questions miroir sont beaucoup utilisées lors des thérapies psychologiques. Elles visent à pousser la personne entendue à approfondir ses propres déclarations. La question est construite sur une reformulation de la dernière réponse entendue. Elles sont utilisées pour la stratégie de l’engagement ainsi que pour humaniser la relation enquêteur·enquêtrice-suspect·e.
Exemples :
− Vous dites que vous ne vous sentiez pas respecté·e par votre employeur ?
– Vous vous sentiez mal à l’aise en présence de votre ami·e ? (après que la personne interrogée a déclaré se sentir mal à l’aise en présence de son ami·e)
Techniques de manipulation, stratégies d’interrogatoire, types de questions : ce sont autant de pièces d’un puzzle que la police combine de mille manières pour pour arriver à ses fins en s’adaptant à la situation et à la personne devant elle.
III) Autour de l’interrogatoire
Ce chapitre examine différents éléments ayant une influence directe sur l’interrogatoire.
8. Le procès-verbal
Lors de chaque interrogatoire, un procès-verbal est rédigé par la police. C’est le document qui va être ajouté dans le dossier d’enquête et à travers lequel est transmis le contenu de l’interrogatoire. Les interactions entre la personne interrogée et les inspecteurs·inspectrices seront synthétisées en temps réel au fur et à mesure de l’interrogatoire et retranscrites par écrit. Lorsque les interrogatoires sont menés par deux enquêteurs·enquêtrices, le procès-verbal est pris par l’un·e pendant que l’autre pose la grande majorité des questions.
Le procès-verbal transcrit la durée de l’interrogatoire, les questions/réponses, les interventions de l’avocat·e, la communication non-verbale (bégaiement, crispation, mutisme, hochement de la tête) et l’attitude de la personne interrogée (énervement, pleurs, phases émotionnelles).
À la fin de l’interrogatoire, le procès-verbal imprimé est soumis à la personne interrogée pour d’éventuelles corrections. Si un·e interprète est présent·e, le procès-verbal est traduit oralement. Les policiers·policières font ensuite signer le document (page par page ou uniquement une fois à la fin du document, cela dépend des pays) à toutes les personnes présentes (inspecteurs·inspectrices, avocat·e, suspect·e, traducteurs·traductrices).
Signer le procès-verbal revient à valider l’interrogatoire
et TOUT son contenu.
Personnellement, je ne vois aucun intérêt à signer ce document et déconseille de le faire. Dans le cas où tu n’as fait aucune déclaration, tu n’as rien à gagner en le signant et de plus tu restes cohérent·e avec la stratégie du refus de collaborer. Si procès il y a, cela ne fait aucune différence d’avoir refusé de signer un procès-verbal vide.
Si tu t’es fait piégé·e par l’une ou l’autre des stratégies d’interrogation de la police et que tu as fait des déclarations, tu t’enfonces encore un peu plus en signant le procès-verbal. Cela revient à valider tes déclarations et rend encore plus difficile toute rétractation future. Ne pas avoir signé un procès-verbal est une condition nécessaire pour pouvoir contester plus tard ce qui y est écrit.
Le fait de ne pas collaborer avec la police (pas de déclarations, pas de signature) t’offre toutes les chances de pouvoir réfléchir à la meilleure stratégie de défense pour le procès à venir, sans t’être pénalisé·e toi-même au préalable. C’est une règle générale, à appliquer à tout échange avec les forces de l’ordre : la prise de risque la plus minime se trouve dans le fait de ne pas collaborer, de ne pas aller dans le sens voulu par les policiers·policières. Chaque pas que tu fais en direction de la police augmente la mise en danger à laquelle tu t’exposes sans te donner aucun avantage en contrepartie.
« La manière dont on prend une audition c’est déjà faire pression. Si on ne respecte pas la parole de la personne quand on écrit, on fait pression parce que : est-ce que cette personne aura les couilles de s’en plaindre au policier devant elle, de dire “eh ce que vous écrivez-là c’est pas ce que j’ai dit”. Il faut les épaules hein pour oser affronter un policier ; l’autorité là devant vous qui sait ce qu’il fait »
9. Communication non-verbale
Lorsque nous communiquons de manière verbale, notre corps réagit aux émotions activées en fonction des thématiques abordées. Cela se traduit notamment à travers les mimiques, l’attitude, les gestes, le regard, le ton et le rythme de la voix. C’est ce que l’on appelle la communication non-verbale. Le fait que tu tripotes nerveusement ton stylo ou que tu croises les bras ne sera pas nécessairement interprété comme un signe de mensonge mais pourra indiquer une thématique sensible.
Dans un interrogatoire, une forte asymétrie émotionnelle est présente entre toi et les inspecteurs·inspectrices. Pour eux·elles, il s’agit d’un moment banal de leur travail quotidien, c’est de l’ordre de la routine. Ils·elles ont une grande expérience de ce genre de situation, basée sur les formations reçues et sur une pratique courante. Même si tu as déjà vécu quelques expériences d’interrogatoires, ton état émotionnel sera toujours plus intense que celui des policiers·policières en face de toi. Ton cœur battra plus vite, ta respiration sera plus rapide, ta concentration plus haute et tes sens plus vifs. Les enjeux ne sont simplement pas les mêmes pour des personnes qui font leur travail quotidien et pour toi qui risques de voir ton avenir impacté par la manière dont se déroule ce moment.
Il est possible d’apprendre à maîtriser en partie la manière dont notre corps transmet notre état émotionnel. C’est néanmoins un exercice très ardu qui demande une extrême concentration et une maîtrise de soi difficile à maintenir dans des conditions d’interrogatoire. À travers notre détention, la police dispose d’un large panel de moyens pour nous affaiblir psychiquement et physiquement : perturbation de notre cycle de sommeil, intimidation, isolement, manque de nourriture, etc.
Les policiers·policières portent leur attention sur ton langage non-verbal mais aussi sur sa potentielle dissimulation. Lorsqu’une idée et un ressenti se forment dans notre cerveau, le corps communique plus rapidement l’émotion liée que la formulation des phrases.
Si une personne montre de la tristesse mais que l’expression corporelle de tristesse survient après la phrase en rapport, il y a fort à parier que cette émotion est jouée.
Certain·es inspecteurs·inspectrices peuvent essayer de t’influencer avec leur propre langage corporel. Par exemple, lors de la stratégie de la contagion émotionnelle où les policiers·policières tentent de te pousser dans une émotion précise grâce à leur propre émotion affichée. Dans ce cadre, un·e inspecteur·inspectrice voulant avoir l’air en colère jouera aussi sur le comportement non-verbal adapté pour que tu croies que son émotion est authentique (volume de la voix et rythme de parole élevés, mains crispées, rougeur au visage, etc.).
Ci-dessous sont listés les principaux signes corporels auxquels la police porte attention afin d’y chercher des indications sur ton état émotionnel [10].
• Main : crispée, grattement, dissimulée, micro-geste, tremblement
• Parole : ton de la voix, volume, rythme, intonation, bégayer, tousser, se racler la gorge, déglutir, gorge sèche, rire
• Corps : tonicité musculaire, tremblement, rougeur, sueur
• Respiration : soupir, rythme, saccade, profondeur
• Regard : présence ou absence du regard, nuance, larmes, direction du regard
• Rythme cardiaque
10. Les interprètes
Lorsque la personne interrogée ne parle pas la ou les langues officielles du pays où elle se trouve, les policiers·policières font appel à un·e interprète. Dans les pays comme la Suisse ou la Belgique qui ont plusieurs langues officielles, tu peux exiger que l’interrogatoire soit mené dans ta langue maternelle (si elle fait partie des langues officielles) même si tu te trouves dans une autre partie linguistique du pays.
Bien que ne faisant pas partie des services de police, les interprètes ne sont pas pour autant tes ami·es ou allié·es. Ils·elles sont ce que la police nomme « des collaborateurs·collaboratrices externes ». Dans un environnement hostile, une personne qui n’est pas de la police et qui parle ta langue maternelle peut donner une impression de proximité. Pourtant, les interprètes à qui tu as affaire sont choisi·es et vérifié·es par la police et sont amené·es à collaborer régulièrement avec eux·elles. Attention à ne pas reproduire le phénomène de bouée de sauvetage avec l’interprète présent·e. Si tu partages les mêmes origines sociales que l’interprète, il est possible que les inspecteurs·inspectrices lui demandent des informations d’arrière-fond culturel et politique sur tes origines.
Beaucoup des stratégies d’interrogatoire nécessitent que les policiers·policières aient un contact direct avec toi.
L’avantage de la présence d’un·e interprète est son effet tampon entre la personne interrogée et les inspecteurs·inspectrices. Afin de minimiser cet effet, l’interprète est souvent assis·e derrière les enquêteurs·enquêtrices qui te parlent alors directement en te regardant toi plutôt que l’interprète. Néanmoins, dans leurs propres écrits, les policiers·policières sont conscient·es que des stratégies telles que l’effet de récence ou humaniser la relation police-suspect·e seront plus difficile à mettre en place.
Avec ou sans interprète, le silence reste la meilleure stratégie de défense face à la police. La présence d’un·e interprète peut néanmoins être plutôt positive pour toi. Elle permet de comprendre les questions de la police ainsi que le contexte dans lequel tu te trouves et elle pénalise les policiers·policières dans l’utilisation d’effets de manipulation liés au sens exact des mots, de la construction des phrases et des intonations qui ne seront pas retransmis de manière identique lors de la traduction.
11. Les avocat·es
Le moment à partir duquel tu pourras être mis·e en contact avec un·e avocat·e change selon le pays où tu te trouves et selon la pratique policière. Dans certains endroits comme en Suisse, tu peux demander un·e avocat·e dès le premier contact avec la police, dans d’autres seulement lorsque tu es placé·e en détention préventive et qu’une instruction est officiellement ouverte contre toi.
Parfois, lorsque tu demandes à voir un·e avocat·e, les policiers·policières tentent de t’en dissuader en t’expliquant que cela peut prendre du temps et que jusque là tu resteras enfermé·e dans leur locaux alors que sans avocat·e, l’affaire serait rapidement réglée.
L’idéal est que tu sois déjà en contact avec des avocat·es que tu connais et qui sont prêt·es à te défendre. Si ce n’est pas le cas, tu seras mis·e en contact avec un·e avocat·e commis d’office. Il est aussi possible que tu ne ressentes pas le besoin de te faire accompagner par un·e avocat·e lors des interrogatoires de police et que tu réserves cela pour le procès.
Quoi qu’il en soit, la présence d’un·e avocat·e représente souvent un agréable tampon face à la police et à leurs stratégies les plus agressives. La pratique du bon flic, méchant flic n’aura pas le même impact émotionnel avec la présence rassurante de ton·ta avocat·e. Pour atténuer cet effet de protection, l’avocat·e est d’ailleurs souvent placé·e derrière toi. De même, les policiers·policières seront beaucoup plus réticent·es à spéculer sur les moyens de preuves ou les peines que tu encours si l’avocat·e pourra, en connaissance de cause, les contredire et ainsi les décrédibiliser.
La présence d’un·e avocat·e peut aussi amener certains dangers. Il existe autant de bon·nes que de mauvais·es avocat·es. Il·elle est pourtant la seule personne à être tes côtés lors de toute la procédure judiciaire. C’est une personne qui est censée te représenter et te défendre, prendre ton parti. Cette attente peut créer un effet de bouée de sauvetage qui peut se retourner contre toi lorsque ton·ta avocat·e est de mauvais conseil. Il arrive en effet que l’avocat·e te conseille de répondre à certaines questions de la police ou de faire des déclarations sur tes complices pour te décharger. L’avocat·e n’a aucune autorité lors d’un interrogatoire et n’est pas un rempart face aux inspecteurs·inspectrices. Il n’est pas possible de se dérober aux pièges tendus en se cachant derrière lui·elle. Si tu fais des erreurs en entrant dans la dynamique des questions-réponses, ton avocat·e n’a pas la possibilité de t’en extraire. Ses interventions, tout comme vos échanges, sont enregistré·es dans le procès-verbal.
A contrario, avoir un·e bon·ne avocat·e à tes côtés peut amener beaucoup de positif dans une procédure judiciaire :
• une présence humaine non hostile
• un potentiel lien avec tes proches à l’extérieur
• une influence sur les conditions de détention (pouvoir faire des appels, recevoir et envoyer du courrier, etc.)
• une aide dans la paperasse administrative propre à la détention (faire de demandes de libération avant le procès, des recours contre des décisions de détention, des réquisitions de preuves, des demandes de témoin, demander accès au dossier d’enquête, etc.)
• une aide pour se préparer au procès et élaborer des stratégies de défense
« dans la majorité des cas, le pire ennemi de l’avocat c’est son client. Donc souvent l’avocat, il va un peu dans notre sens, ou s’il conseille bien son client, il lui dit qu’à ce stade il vaut mieux dire des choses plutôt que de raconter des salades ».
12. Auditions de témoins
Les auditions de témoins ont ceci de particulier qu’elles s’inscrivent dans un autre cadre juridique. Lors d’un interrogatoire, c’est en tant que prévenu·e que tu es appelé·e à te prononcer, sur une affaire qui te concerne. En plus d’être légitime à te taire, tu en as le droit juridique.
En tant que témoin, tu es uniquement appelé·e pour faire des déclarations sur autrui et sur une affaire pour laquelle tu n’es pas directement concerné·e, ou en tout cas pas suspecté·e. Par contre, dans la majorité des pays, tu as l’obligation légale de t’exprimer. Si tu refuses ou s’il peut être prouvé que tu mens, tu t’exposes dans la majorité des cas à une amende. Dans certains cas graves, tu peux être inculpé·e de complicité. Il arrive que des enquêtes soient ouvertes sur des témoins après leurs déclarations devant la police/ le tribunal, suite à des informations données qui se sont retournées contre eux·elles.
Ici aussi, il est dangereux d’essayer de mentir et cela peut se retourner contre toi. Et si la loi t’interdit de refuser de répondre, aucune juridiction ne t’oblige à te souvenir et personne n’a d’emprise sur ta mémoire. La réponse « je ne me souviens plus » est une bonne esquive, permettant de ne pas te mettre en danger ni de révéler des informations qui pourront servir à condamner autrui.
13. Garde à vue et détention préventive
« Après, un mec qui est casse-couilles, qui te fait chier, qui est con, c’est clair qu’il va pas fumer. Mais je suis pas obligé de le faire fumer, la différence elle est là. Après à l’inverse un mec qui est coopératif il va fumer. »
Un interrogatoire peut se faire sur convocation écrite de la police. Il est également possible que tu sois déjà en détention au moment d’être interrogé·e.
Il existe deux types de situation de détention :
La garde à vue : Il s’agit d’une détention dans les locaux de la police, de quelques heures voire quelques jours (les lois varient entre les pays). C’est le cas lorsque tu es arrêté·e en flagrant délit ou lors de manifestations.
En règle générale, la police te garde le temps de faire un ou plusieurs interrogatoires, de clarifier un peu la situation et la direction que prendra l’enquête.
La détention peut se prolonger lorsqu’elle est utilisée comme moyen de pression ou de déstabilisation, pour te rendre plus vulnérable aux interrogatoires. Elle se termine soit lorsque les policiers·policières te rendent la liberté, soit lorsque un·e procureur (ou juge selon le cadre légal du pays où tu te trouves) prononce ton maintien en détention préventive jusqu’à la tenue du procès. Après ta garde à vue, l’enquête se poursuit et il est possible que tu reçoives une convocation pour un nouvel interrogatoire.
La détention préventive : Lorsque un·e procureur ou juge décide que tu ne peux pas être relâché·e avant ton procès, tu es placé·e en détention préventive. Les justifications pour une telle prolongation sont d’éviter le risque que tu disparaisses dans la nature pour échapper à ta condamnation, d’empêcher un contact entre co-accusé·es, de t’empêcher de faire disparaître des preuves ou de nuire à l’enquête en cours. La détention préventive ne se fait normalement pas dans les locaux de police mais dans une prison. Le temps que tu vas passer en détention va être sensiblement plus long qu’en garde à vue. Là aussi, la durée et les conditions de détention sont utilisées comme moyen de pression et d’affaiblissement de ta résistance aux interrogatoires. Pendant ta détention, l’enquête se poursuit et tu peux être interrogé·e de nombreuses fois avant ton procès. Une fois l’enquête terminée, tu peux avoir accès à ton dossier d’enquête en vue de te préparer au procès, depuis la prison, accompagné·e d’un·e avocat·e ou non. La détention provisoire prend fin soit directement lors du procès, soit avant, auquel cas tu seras remis en liberté jusqu’à ton procès. En cas de condamnation, le temps que tu as déjà passé en détention provisoire te sera compté, et en cas d’acquittement, il est parfois possible de se faire indemniser.
Plusieurs stratégies d’interrogatoire se construisent sur la fragilisation qu’entraîne la privation de liberté.
Dans ces deux situations, tu es enfermé·e dans une cellule avant et après les interrogatoires. Des inconnu·es en uniforme viennent te chercher pour t’amener dans le bureau où a lieu l’interrogatoire. Il est important de comprendre ce processus d’enfermement comme accompagnant les interrogatoires et l’enquête en cours. Plusieurs stratégies d’interrogatoire se construisent sur la fragilisation qu’entraîne la privation de liberté. Un des objectifs de l’enfermement est de t’affaiblir physiquement et psychiquement afin de nuire à tes capacités mentales et réduire tes chances de te défendre face à un interrogatoire. Je présente ici un aperçu assez bref des différents mécanismes à l’œuvre.
Perte de contrôle sur son emploi du temps : Dès le tout premier instant où tu te trouves entre les mains de la police, tu ne disposes plus librement de ton temps. On te porte tes repas, on t’amène dans la salle d’interrogatoire, on te sort pour la « promenade », peu importe que cela te convienne ou non. Certaines cellules, surtout en garde à vue, ne possèdent pas de toilettes et la lumière s’allume et s’éteint depuis l’extérieur, ce qui réduit encore un peu plus ton pouvoir de décision et ton emprise sur ce qui t’entoure. Que tu sois en train de dormir, de lire, d’écrire ou de faire du sport, à tout moment ton programme peut être interrompu. Cela peut faire naître un sentiment de dépossession de ta capacité de détermination. Si ce sentiment s’installe en toi et persiste lors des interrogatoires, il va nettement entamer ta capacité à résister face aux inspecteurs·inspectrices.
Isolement : La solitude et l’isolement social qui résultent d’une période d’emprisonnement peuvent également être très déroutants. Lorsque, après une période sans réel contact humain, ton seul contact se trouve être les inspecteurs·inspectrices faisant mine de s’intéresser à toi, la tentation de maintenir un dialogue avec eux·elles est grande, ne serait-ce que pour enfin parler à quelqu’un. Si les policiers·policières remarquent que la solitude a un effet sur toi, des stratégies comme la bouée de sauvetage ou humaniser ta relation avec la police seront privilégiées.
Intimidation : Attitudes hostiles voir agressives et violentes des gardiens·gardiennes, chicanerie autour des besoins de première nécessité (nourriture, serviettes hygiéniques, médicaments), blocage « administratif » de ton courrier, et ainsi de suite. Ce sont là autant de possibilités que possèdent des agent·es de police pour instaurer un rapport de force et lancer de menaçantes injonctions à la coopération. Un tel climat de tension est un terrain favorable à des stratégies comme bon flic, méchant flic ou la contagion émotionnelle.
Dans la majorité des cas, une arrestation est une surprise pour la personne arrêtée. Se faire extraire brusquement de son quotidien pour une période indéfinie crée souvent une grande dose de stress et d’anxiété. Tu auras sûrement des rendez-vous auxquels tu ne pourras pas te rendre, des personnes que tu ne pourras pas avertir et qui vont s’inquiéter, un employeur qui se retrouvera dans l’embarras suite à ton absence, une personne dont tu ne pourras plus prendre soin et ainsi de suite. Une arrestation est toujours une coupure brutale avec ton quotidien.
L’anxiété et la charge mentale produits prennent alors beaucoup d’espace mental et empêchent de se concentrer sur l’interrogatoire et ses dangers. De plus, la possibilité d’être libéré·e est souvent utilisée comme appât pour te soutirer des informations. Plus le stress et l’inconfort sont grands et plus cet argument aura du poids.
La violence qui réside dans le fait d’être privé·e de liberté est un facteur non négligeable. Par contre, le danger que représente la détention comme moyen de pression dans l’enquête qui te vise est beaucoup plus élevé. Tu risques de leur donner les informations nécessaires pour te condamner, ce qui peut potentiellement grandement rallonger la durée d’emprisonnement.
Ma cellule ?
« Réintégrez votre cellule » sonne un peu comme « va ranger ta chambre ». Pourtant cette cellule n’est pas la mienne. Comment pourrait-elle l’être ? Jamais je ne mettrai de l’énergie à m’approprier un espace destiné à enfermer autrui. Si d’autres conceptualisent, construisent et entretiennent de tels endroits, qu’ils ou elles en gardent la responsabilité. Une cellule, un uniforme ou un numéro de détenu·e restera toujours la propriété de l’administration carcérale. Cette stratégie du langage est censée me faire approprier et accepter la froide logique pénitentiaire. Dans la même logique, il ne s’agit pas de mon interrogatoire ou de ma peine pénale mais de l’interrogatoire que je subis et de la peine pénale que l’on m’impose. Je ne fais pas partie du processus de justice institutionnelle. Je le subis et m’en défends. Les outils que j’invente et que je développe avec les gens qui m’entourent pour gérer des conflits et accompagner la souffrance qu’ils engendrent n’ont pas de comparaison possible avec l’autorité qu’exerce l’État.
14. Quelques mots sur la violence
Attention ce chapitre contient des descriptions de pratiques s’apparentant à de la torture physique.
Chaque interrogatoire de police contient à minima une forme de violence psychologique. Les techniques de manipulation et de mise sous pression des interrogatoires sur lesquelles est basée le travail de la police sont indissociables d’une certaine forme de violence psychique.
Dans de nombreux pays, l’usage de la violence physique a été retiré de la liste des moyens de pression légalement utilisables lors d’un interrogatoire de police. Dans d’autres néanmoins, l’utilisation de cette forme de violence est toujours légale.
Après le 11 septembre 2001, la CIA a mandaté deux psychologues afin d’élaborer des techniques d’interrogatoire liant violence psychique et physique. Loin d’être innovant en la matière, ce manuel a néanmoins convaincu pour son côté « moderne » et a rapidement circulé entre différents services de police à travers le monde.
Voici quelques extraits de ces techniques [11] :
• Empoignade : L’interrogateur·interrogatrice empoigne subitement la personne interrogée par le col et la tire vers soi pour créer un effet de surprise, choquer, intimider et/ou humilier.
• Walling : Le·la prévenu·e est d’abord rapidement tiré·e vers l’avant puis propulsé·e vers l’arrière de manière à ce qu’il·elle se heurte contre un mur au niveau des omoplates.
• Gifle au visage : Donnée dans l’objectif d’humilier, d’empêcher la personne interrogée de se concentrer, de transmettre une impression d’infériorité au travers de l’entrée
• Immobilisation de la tête : Positionné·e derrière la personne interrogée, l’inspecteur·inspectrice lui immobilise la tête grâce à la pression de ses mains, tout en lui posant des questions.
• Waterboarding − Simulation de noyade : La personne interrogée est attachée sur le dos, inclinée la tête en bas. De l’eau est versée sur un linge couvrant son nez et sa bouche ce qui va provoquer une très forte sensation de noyade.
• Privation de sommeil : La personne interrogée est privée de sommeil pendant plusieurs jours afin de créer un état d’épuisement et de déconcentration.
• Confinement : La personne interrogée est enfermée dans un espace confiné limitant sa capacité à se mouvoir. En fonction des phobies de la personne, les psychologues de la CIA conseillent le placement d’insectes dans l’espace. Le temps d’immobilisation va de 2 à 18 heures en fonction du type de confinement.
• Positions douloureuses : La personne interrogée est forcée à rester sur une longue durée dans une position inconfortable (assise au sol bras et jambes tendu·es, à genoux par terre, appuyée contre un mur avec uniquement les doigts qui retiennent le poids du corps, etc.). En parallèle, des questions lui sont posées.
• Faim/température : Utilisation d’éléments comme la faim et la température (la personne est enfermée dans une pièce très chaude ou très froide) pour affaiblir la personne interrogée.
• Nudité : La personne interrogée est forcée à se dénuder dans l’objectif de l’humilier.
Ces techniques se situent loin du cliché cinématographique de l’inspecteur·inspectrice colérique frappant le·la suspect·e ou du nazi psychopathe accompagné de sa mallette de scalpel. Ici, la violence physique est utilisée comme un élément précis dans la stratégie d’interrogatoire, au même titre que les manipulations verbales présentées plus haut. Son usage vise la même finalité : destabiliser, affaiblir, épuiser, intimider et briser la résistance de la personne interrogée afin qu’elle aille dans le sens voulu des inspecteurs·inspectrices (aveux, déclarations, dénonciation, collaboration). Il s’agit de stratégies étudiées, calculées et préparées à l’avance en fonction du profil de la personne.
Le fait que les policiers·policières n’aient légalement pas le droit de recourir à de la violence physique ne signifie pas que dans les faits ils·elles n’y recourent pas.
À côté de l’usage précisément étudié de la violence, cette dernière surgit parfois aussi de manière beaucoup moins subtile. Dans les rares cas où cela est reconnu et thématisé de manière publique, le discours dominant nomme cela une « bavure ». Ce terme, « bavure », est pourtant totalement inadéquat pour décrire le recours à une violence, illégale, mais encouragée par une culture de métier et protégée par une Justice qui ne la condamne qu’extrêmement rarement. En interrogatoire, cette violence-ci va être beaucoup plus émotionnelle. Des policiers·policières qui tabassent un·e détenu·e pour venger un·e des leurs ou lui faire « payer » un comportement insolent agissent plus par élan émotionnel que par tactique en vue de résultats concrets pour leur dossier d’enquête. Pourtant, ici aussi l’objectif est d’intimider et de briser les résistances.
Violence physique, psychique ou les deux à la fois, l’enjeu du rapport de force d’une telle situation reste similaire : contraindre la personne interrogée à aller dans le sens propre aux intérêts de la police.
J’ai eu un aperçu de l’impact que représente l’usage de la violence physique dans un cadre d’interrogatoire/détention à travers deux expériences personnelles. Toutefois, je ne me sens ni la légitimité ni les connaissances pour développer ici des conseils de protection et de résistance face à ces pratiques. Plutôt que de remplir ce vide d’informations hasardeuses, je préfère laisser à d’autres le soin d’écrire ces pages [12].
Pour approfondir un aspect de cette thématique je renvoie aux livres :
• Coco Fusco, Petit manuel de torture à l’usage des femmes-soldats, Éditions Lux, 2010.
• Kubark, Le manuel secret de manipulation mentale et de torture psychologique de la CIA, Éditions Zones, 2012. (disponible en libre accès sur le site des éditions Zones)
« Dans des situations où des personnes pourraient être en danger et qu’on a absolument besoin d’avoir des informations de la part d’un gars, j’imagine que des techniques qui sont à la limite mais qui restent légales pourraient être utilisées, besoin de nécessité »
Se défendre
Après avoir examiné les différents angles d’attaque que la police utilise pour mener des interrogatoires, ce chapitre s’intéresse aux pistes et outils pour se défendre.
15. Le piège du mensonge
Face à une accusation, trois types de réaction sont possibles :
• Reconnaître et accepter l’accusation. Soit en partie, soit dans sa totalité.
• Nier, soit en mentant si l’on est accusé·e à raison, soit en se justifiant si l’on est accusé·e à tort.
• Refuser de se prononcer et garder le silence.
Le mensonge peut être vu comme un mécanisme de défense instinctif face à une accusation. Il est en tout cas perçu par la police comme le mécanisme de défense le plus répandu. Mentir c’est pourtant se mesurer aux inspecteurs·inspectrices sur leur propre terrain, puisque l’on accepte la discussion. C’est être d’accord, avec tous les risques que cela comprend, de se battre selon des règles que l’on n’a pas définies soi-même.
Apprendre à mentir demande beaucoup d’effort. Surtout lorsque tu es mis·e sous pression et pas préparé·e à ce qui t’arrive. Mentir c’est inventer une histoire cohérente en accord avec les éléments déjà trouvés par la police, et dont tu ignores l’existence. Cela nécessite une grande imagination, une forte maîtrise de soi et une très bonne mémoire – surtout lorsqu’il s’agit de ré-expliquer exactement la même histoire une journée ou un mois plus tard sans commettre d’erreur et sans avoir pu prendre de notes.
Dans les académies de police, les futurs enquêteurs·enquêtrices s’entraînent à contrer le mensonge mais également à l’exploiter contre la personne qui l’utilise. À travers le langage non-verbal, ils·elles apprennent à reconnaître les signaux corporels d’une personne qui ment. Dans la stratégie du sable mouvant, ils·elles vont jusqu’à pousser la personne interrogée à mentir pour ensuite la déstabiliser en lui faisant comprendre qu’ils·elles ont détecté les mensonges et que la personne ne sera plus crédible pour la suite.
Lors de leurs formations, différents jeux sont utilisés par les policiers·policières pour s’entraîner à détecter le mensonge. En voici deux exemples :
• Deux personnes mènent une discussion. Chaque personne a une thématique qu’il·elle ne doit pas aborder. Durant la discussion, elle doit trouver le thème que l’autre veut dissimuler et empêcher que son propre thème sensible ne soit découvert. Ce jeu permet de s’entraîner à détecter à quel moment une personne essaie de dissimuler une partie de la vérité ou à esquiver une thématique précise.
• Plusieurs personnes sont assises autour d’un tas de cartes. Certaines cartes ont une image, d’autres uniquement un point d’interrogation. À tour de rôle, chaque personne tire une carte sans la montrer aux autres. Si la carte possède une image, elle devra être décrite, si la carte comporte un point d’interrogation, l’objectif est de décrire une image tout en dissimulant qu’elle est inventée à l’instant même. Les autres personnes doivent deviner si la personne décrit une image existante ou non [13].
Face à l’entraînement des inspecteurs·inspectrices et au contexte difficile dans lequel se place un interrogatoire, je ne recommande pas le mensonge comme stratégie de défense. Cela me paraît être une prise de risque inutile pour soi et pour les autres, ainsi qu’une stratégie inefficace.
16. Les fausses croyances qui poussent à la collaboration
Lors des ateliers d’autodéfense face à la police que je donne, j’ai rencontré toute sorte de fausses croyances sur le fait de refuser de faire des déclarations dans un interrogatoire. Dans ce chapitre, j’explique pourquoi je considère ces avis comme de faux amis.
Je suis obligé·e de répondre aux questions de la police.
J’ai souvent entendu cette phrase, qui semble être une croyance profondément ancrée dans l’imaginaire collectif. Je m’explique cela de trois façons : la position d’autorité dont bénéficie la police dans nos sociétés, la pensée qu’il existe une obligation légale de répondre aux questions de la police, et l’imaginaire véhiculé par la culture fictionnelle occidentale. Voyons cela dans le détail.
Autorité policière : Dans nos démocraties autoritaires, nous sommes habitué·es depuis notre plus jeune âge aux figures d’autorité et à leur montrer du respect et de l’obéissance : nos parents, les professeurs, les médecins et les « spécialistes » en tout genre [14]. La notion d’autorité est rendue totalement banale et on nous inculque plus profondément l’obéissance à l’autorité que la remise en question et la pensée critique. La police (et les uniformes en général) procure un sentiment d’autorité morale, de supériorité légitime. Cette construction culturelle et sociale donne l’impression inconsciente que lorsqu’un·e policier·policière te pose une question, tu dois y répondre, et que sinon tu te feras gronder, tout comme quand tu refusais de répondre à tes parents ou à tes professeur·es.
Considérons cela avec un peu de recul. Selon moi, nous sommes tous et toutes légitimes de vivre nos vies comme nous l’entendons, en pleine liberté de nos choix. Cependant, nous sommes soumis·e à toute une série de constructions sociales, de contraintes et de normes. Reconnaître ces figures d’autorité et les normes sociales qui y sont liées ainsi que se reconnaître la légitimité d’être maître·maîtresse de sa vie sont des premiers pas utiles pour leur transgression. Une transgression souvent difficile, inégale selon notre statut dans la société et non sans conséquences mais néanmoins porteuse d’émancipation. Et en ce qui concerne la figure d’autorité policière, la transgression de cette dernière est un outil de défense des plus nécessaire lors d’un interrogatoire.
Reconnaître les figures d’autorité et les normes sociales sont des premiers pas utiles pour leur transgression.
Obligation légale : Dans la majorité des juridictions, refuser de répondre aux questions de la police en tant que prévenu·e n’est pas punissable légalement. Refuser de s’exprimer est un droit donné par le cadre légal et ne peut juridiquement être retenu contre toi. Selon les pays, tu as néanmoins l’obligation légale de donner certaines informations spécifiques permettant un contrôle d’identité : nom complet, adresse, date de naissance, nationalité, profession, etc.
Si, lors d’un procès, tu décides de maintenir la stratégie du silence, un·e juge peut bien sûr t’en vouloir de ne répondre à aucune de ses questions et ce sentiment risque d’influencer sa sentence. Là-dessus tu n’as aucune emprise. Mais dès le moment où cet élément est présenté comme un fait incriminant et justifiant la condamnation, cela sort du cadre légal et tes avocat·es auront une très bonne base pour faire appel au jugement.
Imaginaire fictionnel : Les enquêtes policières [15] inspirent de nombreux films, séries, bandes dessinées, pièces de théâtre, etc.
Nous sommes grandement divertis par le travail d’enquête des inspecteurs·inspectrices. Même si la plupart d’entre nous n’a jamais vécu d’interrogatoire, tout le monde a une idée et une image mentale de ce à quoi cela ressemble.
Depuis que je m’intéresse au sujet des techniques d’interrogatoire, je regarde les fictions policières d’un autre œil. Une chose me frappe : c’est de remarquer à quel point c’est rare qu’on nous présente des suspect·es qui refusent de collaborer avec la police. Jamais encore je n’ai vu ou lu un « je n’ai rien à déclarer » comme posture principale de défense face à un interrogatoire dans un roman policier ou une série policière. Quand une personne exprime son refus de répondre, soit elle attend son avocat·e pour le faire, soit elle finit par répondre suite à la pression des inspecteurs·inspectrices. Et ça se comprend très bien. Pour produire une fiction policière un tant soit peu intéressante, il faut que l’enquête avance, qu’il y ait un dénouement dans l’histoire à travers l’arrivée de nouveaux éléments. En tant que spectateur.spectatrice, nous avons des intérêts convergents avec les enquêteurs·enquêtrices : on veut que l’enquête avance. Il faut donc que les éléments fictionnels arrivent les uns après les autres, en grande partie au travers des auditions et interrogatoires menés par les inspecteurs·inspectrices Derrick et Julie Lescaut.
Voilà l’image que nous renvoient les fictions policières : un interrogatoire se compose d’un·e flic qui pose des questions et d’un·e prévenu·e qui y répond. Un acte de résistance sera peut-être représenté par la tentative d’un mensonge, mais en tout cas pas par un silence obstiné.
Dans le cadre des fictions, plusieurs ouvrages sont à mes yeux intéressants à analyser autant pour la manière de présenter des interrogatoires que pour les réactions des personnes interrogées. Bien sûr cela reste fictionnel. Mais en gardant un esprit critique, la lecture de ces fictions peut aider à visualiser d’une manière plus ou moins réaliste différentes techniques d’interrogatoires spécifiques :
• Krokodil im Nacken, Klaus Kordon, Beltz & Gelberg, 2008 (livre disponible uniquement en allemand)
• Les Anonymes (Un Pienghjite Micca), Pierre Schoeller, 2014 (film) sous l’angle d’un ·e policier·policière, journaliste, détective ou de toute autre personne en charge de l’investigation.
• Impossible, Erri de Luca, Babelio, 2020 (livre)
• L’interrogatoire, Vladimir Volkoff, Babelio, 1988 (livre)
Exercice pratique
Les prochaines fois que tu regardes ou que tu lis une fiction policière, un exercice intéressant est de se poser les trois questions suivantes :
1. Est-ce que des réponses ont été fournies aux questions des inspecteurs·inspectrices lors des interrogatoires ?
2. Est-ce que ces réponses ont permis à la police d’avancer dans l’enquête, de découvrir de nouveaux éléments ou de formuler de nouvelles hypothèses ?
3.Est-ce que l’enquête aurait évolué si cette information n’avait pas été relevée ?
« Mais il s’agit d’un vrai problème, pas d’un simple jeu intellectuel. Parce que nous vivons aujourd’hui dans une société où les médias, les gouvernements, les grandes compagnies, les groupements religieux et les partis politiques fabriquent de pseudo-réalités et qu’il existe de l’équipement électronique pour faire rentrer ces univers illusoires dans la tête du spectateur, de l’auditeur, et du lecteur. Les policiers sont toujours bons, ils gagnent toujours. Ne négligez pas ça, quelle leçon : on ne doit pas combattre les autorités et si on le fait on est sûr de perdre. Ici le message est : restez passifs et coopérez. Si le Sergent Baretta vous demande une information, donnez-la lui parce que le sergent Baretta est un brave homme digne de confiance, il vous aime et vous devriez l’aimer aussi » [16]
Si je ne parle pas, j’aurai l’air louche
« Si vous ne voulez pas répondre à nos questions, c’est que vous avez quelque chose à cacher. Seuls les criminels endurcis refusent de répondre à nos questions. » C’est ce genre d’argument que les policiers·policières apprennent à présenter aux personnes qui refusent de faire des déclarations. Personne ne veut avoir l’air suspect. En avoir l’air c’est déjà quasiment être coupable, non ? Non, c’est sensiblement différent. Et puis avoir l’air suspect aux yeux de qui ? C’est souvent face aux inspecteurs·inspectrices que l’on souhaite avoir l’air innoncent. Pourtant ce ne sont pas eux·elles qui posent un jugement mais les juges. Avoir l’air suspect n’est pas une preuve légale, ni même un élément de preuve.
Le paradoxe, en ne voulant pas avoir l’air suspect, c’est de se justifier et donc fournir des informations qui serviront à nous condamner. Mettre l’accent sur le besoin de justification que tu peux ressentir est une stratégie policière courante.
Plutôt que le silence, c’est mentir qui va me tirer d’affaire
Les policiers·policières sont entraîné·es à détecter les mensonges ou les questions qui mettent dans l’embarras. Rester crédible tout en mentant demande une grande capacité de concentration, une très bonne mémoire, beaucoup d’imagination et une forte vivacité d’esprit. Tu dois pouvoir redire exactement le même mensonge au détail près plusieurs heures/jours/mois plus tard. De plus, tant que tu es dans les locaux de la police, tu ne sais pas quels éléments te concernant se trouvent dans le dossier d’enquête, quels indices ils·elles ont recueillis sur le terrain.
Une des stratégies des flics consiste justement à te pousser sciemment à dire le plus d’affirmations mensongères et à te couler par la suite en te confrontant à la preuve de ton mensonge.
Une réponse entraîne toujours une nouvelle question.
Je n’ai rien à me reprocher
Et les autres ? Tes ami·es ? Peut-être que la raison pour laquelle tu as été convoqué·e est que la police cherche des informations sur une de tes connaissances plutôt que sur toi. Certaines personnes disent vouloir faire des déclarations uniquement sur elles-mêmes et ne rien dire qui impliquerait autrui. Or, dans une investigation judiciaire, il n’y a pas de place pour différentes histoires personnelles ou pour « mon histoire à moi ». Il n’y a que des éléments séparés mais reliés entre eux, qui donnent une image globale. Par addition ou par élimination, chaque information que reçoivent les inspecteurs·inspectrices est une pièce du puzzle leur permettant d’avoir une image plus complète et claire des faits. En tant que personne auditionnée, tu n’es pas en mesure de savoir ce qui intéresse la police, ce qu’ils·elles pourront utiliser, comment (et contre qui). Même si tu ne souhaites compromettre personne d’autre à travers tes déclarations, ce n’est pas quelque chose que tu peux contrôler.
Finalement, même si tu n’as rien à te reprocher, ton procès-verbal sera enregistré et permettra aux agent·es de police de mieux te connaître la prochaine fois que tu passeras dans leur bureau.
Les flics arrêteront de me mettre la pression si je parle au moins un peu
Cette pensée est compréhensible. On l’a vu plus haut, la liste des moyens de pression qu’ont les policiers·policières est longue, surtout en situation de détention. Et le chantage fait partie de leur arsenal de manipulation : « Plus vite tu nous diras tout, et plus vite tu pourras rentrer chez toi. » Dans les faits c’est pourtant souvent l’inverse qui est vrai.
Si tu commences à parler, tu donnes le signal d’une ouverture dans laquelle les inspecteurs·inspectrices vont se jeter à corps perdu, jusqu’à ce qu’ils·elles soient satisfait·es du résultat. C’est aussi leur montrer que les moyens de pression dont ils·elles disposent fonctionnent sur toi. Pourquoi alors arrêter si cela montre des résultats positifs ? Plutôt que de subir moins de pression, tu vas être pressé·e comme un citron.
17. Se protéger par le silence
Rappelons le contexte dans lequel tu es placé·e lorsque tu vis une situation d’interrogatoire :
Tu ne possèdes que des informations lacunaires sur l’enquête qui te concerne et sur les éléments que la police détient. Tu vis un moment inhabituel et stressant. Tu es dans l’incertitude de ce qui va t’arriver. Si tu es mis·e en détention, tu subis toute une série de pressions supplémentaires dues à tes conditions d’emprisonnement et à la privation de liberté. En face de toi, tu as des personnes entraînées à des techniques de manipulation poussées, fortes d’une expérience professionnelle en la matière et d’une connaissance plus ou moins large de ton profil.
L’ensemble des stratégies et techniques de la police ont un point commun : pour atteindre leurs objectifs, la participation de la personne interrogée est nécessaire, voire essentielle. Cet élément constitue la meilleure défense que tu possèdes. Si tu refuses cette collaboration, tu détruis les armes que la police pourrait utiliser contre toi. Ne leur offrir rien d’autre qu’un impassible « Je ne souhaite pas faire de déclaration » signifie ne pas leur offrir d’emprise sur toi. D’autre part, garder le silence évite de nourrir le dossier d’enquête avec tes déclarations, vraies ou fausses. On ne met personne en danger, ni autrui, ni soi-même.
Pour tenir au mieux cet axe de défense, le plus simple est d’utiliser la stratégie du disque rayé. Cela consiste à répéter avec un volume toujours identique (non croissant) ta décision de ne pas faire de déclaration, sans te justifier davantage, avec à chaque fois pratiquement les mêmes termes. Cela permet de marquer ta fermeté en restant toujours dans le même état émotionnel.
« Je ne souhaite pas faire de déclaration »,
« Je ne souhaite pas faire de déclaration »,
« Je ne souhaite pas faire de déclaration ».
Plus tôt tu exprimes pour la première fois ta volonté de garder le silence, plus il sera facile de s’y tenir. Les inspecteurs·inspectrices vont essayer de te pousser à changer de stratégie de défense, notamment en te culpabilisant de ne pas répondre, ou en essayant de te faire croire que ton silence donne une image suspecte de toi et que cela jouera en ta défaveur.
Après l’interrogatoire, si l’affaire est transmise à un·e juge, tu auras l’occasion de prendre connaissance du dossier d’enquête et ainsi des éléments que la police a rassemblés contre toi. Tu pourras aussi t’entretenir avec un·e avocat·e et te faire conseiller sur la meilleure manière de te protéger. Si tu choisis de faire des déclarations lors du procès, tu pourras les faire en connaissance de cause, avec un risque nettement plus petit de te mettre dans l’embarras.
Le silence est de loin la stratégie de défense
la plus efficace et la moins dangereuse.
Un peu d’histoire
Karl Victor Hase est né le 23 novembre 1834 à Jena en Allemagne. À 19 ans, il commence des études de droit à Heidelberg, où il est condamné à 6 jours de prison pour avoir contredit un religieux. Plus tard, l’un de ses amis étudiant tue un autre étudiant lors d’un duel qui tourne mal. Karl Victor Hase lui donne son passeport pour lui permettre de passer en France. Après le passage de la frontière, son ami jette le passeport qui finit par être retrouvé et renvoyé aux autorités locales de Heidelberg. Karl Victor, désormais juriste, est soupçonné de complicité de fuite et interrogé. Lors de son audition, il répète en boucle « Mein Name ist Hase, ich verneine alle Generalfragen, ich weiß von nichts » − mon nom est Hase, je refuse de répondre aux questions, je ne suis au courant de rien. Cela ne permit pas aux enquêteurs de distinguer la vérité parmi les différentes hypothèse : Hase est complice et a donné volontairement son passeport ; Hase a perdu son passeport que son ami a trouvé et utilisé pour fuir ; Hase s’est fait voler son passeport par son ami duelliste.
Une fois Hase acquitté, faute de preuves, la phrase « Mein Name ist Hase, ich verneine alle Generalfragen, ich weiß von nichts » fait rapidement le tour des universités en droit d’Allemagne et des PaysBas. Raccourcie en « Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts » − mon nom est Hase, je ne suis au courant de rien – elle conceptualise la défense juridique que représente le fait de garder le silence face à l’accusation. Jusqu’à aujourd’hui cette phrase est restée célèbre dans la culture générale germanophone, reprise notamment comme expression populaire ainsi que dans des chansons. Karl Victor Hase, quant à lui, devint finalement docteur en Droit à l’université de Jena.
Il fallut attendre 1966 pour que le droit au silence soit ancré par l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. « Toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : [...] à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable ». Plus tard la Cour européenne des droits de l’homme reprend ce droit comme fondamental et le place au cœur de la notion de procès équitable. Selon la cour en question, accorder un droit au silence « permet d’éviter l’obtention d’éléments de preuve sous la contrainte ou la pression et permet ainsi l’évitement d’erreurs judiciaires ». L’histoire nous montre que l’évitement d’erreurs judiciaires n’a pas été atteint.
Contre-technique policière
Alors que les techniques d’interrogatoire sont décrites en long et en large dans les manuels policiers, je n’ai eu l’occasion de parcourir qu’un très faible nombre de conseils à utiliser face à des personnes refusant la discussion. J’interprète cela de manière très positive ; j’en déduis que les moyens leur manquent pour contrer la stratégie du silence de manière efficace. Voyons tout de même les maigres pistes qu’ils·elles mettent en avant :
• Les policiers·policières vont argumenter avec la personne interrogée sur les raisons qui la poussent à ne pas vouloir répondre. Ils·elles vont lui certifier que c’est tout à fait son bon droit de refuser de faire des déclarations, mais que par curiosité ou afin de le poser dans le procès-verbal, ils·elles aimeraient savoir pourquoi. Si la personne répond, la discussion va continuer et petit à petit conduire vers les questions. C’est un mix entre la stratégie de l’entonnoir et celle de l’engagement. Ce qu’il faut retenir ici, c’est de ne pas se justifier sur les raisons qui te poussent à refuser de leur répondre, puisque cela représente déjà une forme de réponse et contient le risque de te faire glisser dans la discussion.
• Socialement, le silence met mal à l’aise, surtout dans une discussion à plusieurs. Les enquêteurs·enquêtrices peuvent jouer là-dessus en laissant un vide et en te fixant après que tu aies déclaré ne pas vouloir répondre à leurs questions. L’idée est de te mettre mal à l’aise pour te pousser à répondre. Si cela te déstabilise, rien ne t’empêche de laisser vagabonder ton imagination pour t’extraire de cet instant en pensant à des beaux moments que tu as vécus ou que tu aimerais vivre.
• Une stratégie très répandue est que les policiers·policières « acceptent » ton refus de répondre à leurs questions, mais vont néanmoins te lire toutes leurs questions en te demandant de répéter à chaque question que tu ne souhaites pas y répondre. L’idée ici est de créer une envie de justification en te lisant des questions très dirigées et suggestives. Ne te laisse pas faire. Déclarer une seule fois « je ne souhaite pas répondre à vos questions » est totalement suffisant. Reste stoïque et silencieux·silencieuse jusqu’à ce qu’ils·elles se lassent d’attendre et te laissent tranquille.
• La police tente également souvent d’intimider la personne interrogée en lui faisant croire que le fait de refuser de s’exprimer sera retenu contre elle lors d’un éventuel procès. Dans ce cas souviens-toi que le refus de s’exprimer est un droit juridique.
• Évidemment l’utilisation de la violence physique à ton encontre est en principe bannie dans le cadre des manuels auxquels je fais référence. C’est pourquoi il n’en est pas fait mention ici. Ceci dit, on sait tous·tes que cela arrive fréquemment et que même au cœur du cadre « légal » qui devrait être le leur, les policier·policières vont parfois se lâcher.
L’exception qui confirme la règle
Comme toute règle, celle du silence comporte une exception qui la confirme. Il s’agit du cas spécifique des contrôles de routine. Prenons l’exemple d’un contrôle de routine par des douaniers.douanières dans un train traversant une frontière. Les douaniers·douanières passent à travers le train pour faire leur contrôle. Leur objectif est d’interpeller les personnes sans titre de séjour valable ou transportant des marchandises illégales. Les garde-frontières n’ont ni le temps ni les ressources de s’arrêter à chaque personne pour faire un contrôle d’identité, et encore moins pour vérifier les bagages. Pour travailler, ils·elles utilisent des filtres pour faire un tri. Le premier filtre est le tristement connu contrôle au faciès, aussi appelé racial profiling [17] : vont être ciblé·e·s, les jeunes, les personnes non-blanches, pauvres, seules. Bref tout ce qui s’éloigne de la norme blanche et bourgeoise. Pourtant, même avec ce premier filtre il reste toujours trop de personnes pour un contrôle approfondi. Le deuxième filtre est justement ce qui est appelé contrôle de routine. Les douaniers·douanières s’arrêtent quelques instants et te posent 3-4 questions à l’aspect totalement banal. D’où venez-vous ? Vous étiez en voyage professionnel ou de tourisme ? Vous allez où ? Et ainsi de suite. À moins que tu ne te contredises toi-même, les réponses ne sont pas réellement importantes. C’est la manière dont tu réponds qui est observée. Est-ce que tu sembles nerveux·nerveuse ? Quel est ton langage corporel ? Est-ce que tu hésites avant de répondre ? Est-ce que tes mains tremblent ? Tout comme ils·elles le font lors d’un interrogatoire, les policiers·policières essaient de détecter si tu leur mens, si tu leur caches quelque chose ou si des sujets sensibles sont abordés. Si c’est le cas, le contrôle va s’approfondir, tes papiers et bagages vont être vérifiés et tu vas être interrogé·e avec plus de précision. Ces pratiques ont aussi lieu lors de contrôles routiers ou aux abords de manifestation. Si dans une telle situation tu réponds « je n’ai rien à déclarer et je fais usage de mon droit au silence » à la première question qui t’est posée, il y a de fortes chances que tu finisses au poste de police pour un contrôle approfondi. Cette forme de contact avec les forces de l’ordre est un moment très particulier. Tu n’es déjà plus totalement libre et tu réponds sous contrainte, mais tu n’es pas non plus arrêté·e ou prévenu·e dans une enquête. L’enjeu est de rester calme et de répondre le strict minimum : "Dans ma valise ? Oh, des vêtements sales et des livres, oui je suis allé·e rendre visite à des ami·es, là je rentre chez moi". Si tu te sens acculé·e et que les questions deviennent trop précises, endosse ta carapace de protection : je ne souhaite pas faire d’autre déclaration.
« La police est omniprésente là où habitent les ouvriers. ouvrières et les personnes de couleurs. Les tribunaux valident à répétition les interprétations policières racistes. Arrêter quelqu’un parce qu’il marche dans une « zone à forte criminalité » ? Parfaitement légal. Fouiller une voiture pour y chercher de la drogue parce que le conducteur noir s’est arrêté trop longtemps à un panneau stop ? Totalement acceptable. Comme la police le dit souvent en plaisantant sur les contrôles aux faciès : « ça n’arrive jamais mais ça marche »
Naomi Murakawa, Police reform works... for the police, 2020
18. Défense mentale
Atténuer les sources de stress
Être confronté·e à une procédure judiciaire, un interrogatoire et/ ou une garde à vue peut causer un stress qui va fragiliser ta capacité d’autodéfense mentale. Les inspecteurs·inspectrices en sont tout à fait conscient·es et vont chercher à accentuer ce phénomène. Heureusement, certaines sources de stress peuvent être anticipées.
Je distingue deux sources de stress :
Stress provenant de l’intérieur. Il s’agit de la pression provoquée par les conditions du moment même de la procédure judiciaire, en première ligne dû à l’impact de la logistique de l’enfermement. Ai-je la possibilité d’aller aux toilettes librement si j’en ai besoin, est-ce que je m’ennuie, ai-je froid ou chaud, ai-je accès à mes médicaments ou à mes protections hygiéniques ? Suis-je confronté·e à des oppressions systémiques comme le racisme, l’antisémitisme ou la transphobie ? Les menaces et l’hostilité des policiers·policières présent·es peuvent également être des sources de stress. Stress provenant de l’extérieur. Ces sources de stress font partie du monde extérieur au moment présent de la détention/interrogatoire. Tu penses au fait que tes proches au dehors s’inquiètent pour toi, de ce que la police possède déjà comme information ou risque de trouver dans l’enquête à venir et de comment se portent les ami·e·s dont tu n’as plus de nouvelles. Tu te fais du souci à propos de la peine pénale encourue, de l’opinion que les gens se feront de toi si tu es condamné·e. Les inspecteurs·inspectrices savent alimenter cette source de stress. En glissant des insinuations, ils·elles créent le doute en toi.
Ils·elles savent que, lorsque tu seras à nouveau en cellule, tu repasseras tout l’interrogatoire dans ta tête, phrase par phrase, et espèrent ainsi influencer tes réflexions et prises de décision.
D’un côté, il y a donc tout ce à quoi tu es directement confronté·e et qui te cause de l’embarras, du stress et de l’anxiété. Il s’agit de faits que tu vis dans l’instant présent. De l’autre côté, les sources de stress extérieur à la situation présente sont hors de ton emprise. Ce qui te stresse, c’est un cercle vicieux de prises de tête, d’anticipations, d’hypothèses et de projections de ce qui se passe dehors et de ce qui va se passer dans ton avenir proche.
Mon conseil est de dissocier ces deux stress. Prends le temps de réfléchir aux sources de stress auxquelles tu es directement confronté·e et essaie d’y chercher des réponses à ta portée. La solitude te pèse ? Peut-être qu’écrire des lettres à tes proches peut t’aider à te sentir moins seul·e [18]. L’attitude menaçante des policiers·policières t’angoisse ? Rappelle-toi que leur pouvoir est limité et qu’ils·elles essaient sciemment de t’intimider. La situation de l’interrogatoire t’angoisse ? Invente-toi une histoire ou rappelle-toi un souvenir positif pour distraire ton cerveau et te permettre de penser à autre chose. Prends le temps de comprendre ce qui est une source de stress et comment la minimiser. Peut-être qu’il te faudra essayer plusieurs stratégies avant de trouver la bonne.
Quant aux éléments sur lesquels tu n’as pas d’emprise, laisse-les glisser sur toi comme des gouttes d’eau. Lorsque tu es en détention ou en interrogatoire, ce n’est clairement pas le moment adéquat pour t’y confronter. Économise ton énergie pour ce qui touche ton présent et laisse le futur à plus tard. Tu auras le temps pour te préparer à ton procès et aux conséquences juridiques, pour affronter le regard des autres, pour réparer ce qui doit l’être, pour prendre soin de toi, de tes proches, des victimes de l’affaire et pour faire ton autocritique. En ce moment, ce qui compte c’est de faire face aux policiers·policières qui cherchent les failles dans tes axes de défense.
Pour ne pas se laisser envahir par des pensées anxiogènes, il est bon de ne leur accorder qu’une place restreinte. Par exemple, fixe une heure par jour que tu dédies à te confronter et à réfléchir à tous les éléments extérieurs qui te pèsent et te mettent la pression. Ouvre la boîte et observe ce qu’il y a dedans, réfléchis à ce que tu risques sur le plan légal, social, à comment se portent tes proches, aux conséquences qu’aura ton absence à l’extérieur, à comment réparer la souffrance que tu as peut-être engendrée chez d’autres. Accueille les émotions que ces questions provoquent en toi, autorise-toi à les ressentir. Ça fera peut-être mal et ce sera difficile, tu pourras te sentir perdu·e. Néanmoins les sentiments aiment être entendus et c’est la meilleure voie pour apprendre à les gérer d’une manière constructive et de réduire l’emprise négative qu’ils peuvent avoir sur toi. Pour te confronter à toutes ces thématiques anxiogènes, tu peux noter les hypothèses de ce qui pourrait t’arriver, de ce qui pourrait se passer dehors. Certaines hypothèses très optimistes, certaines très pessimistes. Ensuite compare-les et écoute les émotions qui en ressortent. Est-ce que tu trouves ces scénarios réalistes ? Qu’est-ce que tu peux faire pour les influencer ?
À la fin du temps imparti, referme la boîte, fais le vide dans ta tête et pense à autre chose. Un petit rituel peut t’aider à repasser dans le moment présent. Par exemple faire une session de sport, lire un chapitre d’un livre ou écrire tes réflexions. Puis, ferme ton esprit le plus hermétiquement possible à toute insinuation provenant des inspecteurs·inspectrices. Lorsqu’ils·elles évoquent un sujet qui angoisse, laisse-le glisser sur toi et concentre-toi sur autre chose. Tu y réfléchiras lors du prochain moment de temps dédié à ces questions. De cette manière, tu réduis considérablement l’emprise que peuvent avoir les enquêteurs·enquêtrices sur toi, lorsqu’ils·elles essaient de te mettre la pression au travers de sujets qui t’angoissent.
Si tu nies ta peur ou toute autre émotion difficile, tu refuses l’occasion de faire preuve de bienveillance envers toi-même et de t’offrir le soutien et le réconfort dont tu as besoin. Dans l’imaginaire patriarcal, la force nous est présentée comme une valeur virile qui exclurait la faiblesse. Serait forte la personne qui ne ressent aucune peur et ne possède aucune vulnérabilité. L’intériorisation de ce système de valeurs amène beaucoup de gens à cacher leurs peurs, à eux-mêmes ainsi qu’aux autres, et par conséquent à en empêcher une gestion efficace. Les courants féministes, entre autres, nous proposent une autre grille de lecture. Nous sommes toutes et tous vulnérables et tout le monde possède des fragilités. La force réside dans le fait de les accueillir et de vivre avec sans les laisser nous dominer.
Si tu refuses d’entendre tes peurs et tes craintes, tes émotions prendront un chemin détourné pour se manifester et surgir sous la forme d’une colère intense, d’un comportement irrationnel, de terribles angoisses ou de crises de larmes.
Ne reste pas seul·e et isolé·e face à la menace d’une arrestation. Sans entrer dans des détails compromettants, tu peux thématiser ce risque avec tes proches. Se préparer en amont, collectivement, à une éventuelle arrestation ou à une garde à vue aide à vivre ce moment plus sereinement. Plus tu en auras discuté, plus tu auras réfléchi à quoi faire en cas de pépin, moins tu auras à t’inquiéter pour ce qui se passe dehors. Laisse des indications concrètes à tes ami·es sur comment réagir, qui avertir (famille, employeur) et quoi communiquer, où aller arroser des plantes ou nourrir un chat, quel·le avocat·e contacter et ainsi de suite. Une manière sécurisée et efficace pour transmettre ces informations est de les transmettre à la personne de confiance sur une clé USB cryptée [19].
Distanciation avec la police
On l’a vu, plusieurs stratégies de manipulation se construisent sur un lien émotionnel et humain entre les policiers·policières et toi. Plus ce lien est fort, plus il est possible de l’utiliser comme levier pour te culpabiliser, te rassurer, t’inquiéter, te critiquer, te faire espérer, accaparer ton attention, donc influencer tes émotions, en bref.
Pour contrer cela, rappelle-toi l’asymétrie de la situation. D’un côté, toi, prévenu·e dans une procédure où l’État enquête sur toi pour décider de ta culpabilité, enfermé·e et mis·e sous pression par la police. De l’autre côté, les policiers·policières qui font leur travail routinier de fonctionnaire. Des personnes dans ta situation, ils·elles en voient passer des centaines, à qui ils·elles essayent de montrer une attitude compréhensive et attentionnée pour créer un phénomène d’attachement. S’ils·elles te font des faveurs, c’est qu’ils·elles ont d’abord ruiné ta journée, à tel point que recevoir une bouteille d’eau ou un café engendre chez toi de la reconnaissance. Pourtant c’est bien leur responsabilité si tu n’as pas la possibilité d’être tranquillement chez toi en train de boire ton café en lisant un livre. Refuser de se laisser engager dans une discussion avec eux·elles est un moyen très efficace de maintenir une distanciation émotionnelle entre toi et les inspecteurs·inspectrices.
Une règle d’or pour se protéger de tout type de manipulation consiste à ne considérer aucune critique de la part d’un·e manipulateur·manipulatrice comme digne de réflexion. Si ton comportement ou tes actes dérangent ton entourage, écoute les critiques de ceux·celles qui te veulent du bien. Les critiques et auto-critiques, lorsqu’elles sont constructives et honnêtes, nous font grandir et évoluer. Cela nécessite néanmoins un cadre non-coercitif où les personnes critiquées et celles qui font la critique sont sur un pied d’égalité. Les policiers·policières ne sont pas concerné·es par qui tu es, ce que tu souhaites, ce qui est important pour toi et tes sensibilités. Ils·elles ont leur propre agenda et intérêt qui n’ont pas de lien avec ta personne. Les inspecteurs·inspectrices peuvent te dire qu’ils·elles te veulent du bien, qu’ils·elles font ça pour toi, mais qui t’a enfermé·e dans cette pièce, qui te menace et te met la pression
« Ça m’est arrivé de repartir à 22 heures parce que je sentais que la personne avait envie de se confier. La journée beaucoup d’animation, beaucoup de monde, beaucoup de bruit etc. À 22h je sors de la garde-à-vue, je lui offre un café et on discute. Je suis son psy. Et j’obtiens des aveux où on discute enfin pour de bon »
Garder le pouvoir de décision
Un effet direct de la garde à vue ou de la détention préventive est d’être dépossédé·e de son pouvoir de décision. Tu ne décides plus quand tu manges, quand tu as des interactions sociales, quand la lumière dans la cellule est allumée ou éteinte, qui tu vois ou si tu auras de quoi lire. Ce sentiment est difficile à gérer. Il est particulièrement dangereux lorsqu’il se reporte dans l’interrogatoire et donne l’impression inconsciente que puisque tu n’as plus de pouvoir de décision dans ton quotidien, il ne t’est pas non plus possible de refuser de collaborer avec la police.
Une manière de résister à cet effet est de se créer, tant bien que mal, une structure journalière. Décide en début de journée comment tu vas occuper ton temps. Par exemple, décider que tu feras deux heures de sport, une heure d’écriture et deux heures à te confronter à des sujets angoissants. Bien sûr, il est tout à fait possible que tu te fasses interrompre en plein milieu de ta session de sport par les policiers·policières qui viennent te chercher pour t’emmener en interrogatoire ou en promenade. Qu’à cela ne tienne, retiens combien de temps il te reste à faire et dès que tu reviens, termine ta session et fais les deux heures de sport prévues. L’idée est de se fixer des objectifs que tu pourras accomplir et profiter du sentiment de valorisation que te donne le fait de les avoir atteints. D’ailleurs, le sport accélère la fréquence cardiaque et favorise la circulation, les hormones et les neuromédiateurs dans l’ensemble de l’organisme. À certains égards, le sport a des effets chimiques comparables à ceux des antidépresseurs à travers la création de la sérotonine. Et c’est une très bonne manière de se distraire.
Une autre stratégie est de valoriser les endroits où tu résistes avec succès plutôt que de te concentrer sur ceux où tu subis la pression. Tu ne peux pas te déplacer, tu es emprisonné·e, la police farfouille dans ta vie et dans celle de tes proches. Soit, tu n’y peux rien. Il y a pourtant des choses que tu es en mesure de leur refuser. Ta collaboration à leur travail par exemple. Refuser de leur livrer les informations qu’ils·elles exigent, refuser d’accepter leurs chantages, leurs marchandages. Rester intègre à tes principes est un acte de résistance à valoriser et duquel tu peux tirer beaucoup de force.
Lenz a regardé ses deux interlocuteurs et s’est réjoui : ils pouvaient l’enfermer, le laisser croupir à l’isolement pendant des jours, des semaines, des mois, lui enlever Hannah et les enfants et déterminer de l’avenir de sa famille, mais il y avait deux choses qu’ils n’étaient pas en mesure de faire : ils ne pouvaient pas faire de lui un idiot et ils ne pouvaient pas faire de lui une balance. Ici se trouvait la fin de leur pouvoir. Combien ce sentiment l’a satisfait, combien cela a renforcé sa confiance en lui !
Extrait librement traduit du livre,
Krokodil im Nacken, Klaus Kordon, 2008
Lâcher prise
En parallèle au travail de réappropriation de ton pouvoir de décision, il fait aussi sens d’apprendre à lâcher prise. À partir de ton arrestation, tu ne contrôles plus ce qui se passe et tu n’as plus le moyen d’influencer les événements : quand va s’arrêter la détention, le nombre d’interrogatoires que tu vas subir, les manipulations des policiers·policières, ce qui se passe dehors. Que tu t’agites ou que tu restes calme, les événements vont suivre leur cours. Toutefois, si tu t’agites, notamment en tentant de te justifier ou de livrer des informations pour t’en sortir, tu risques de commettre des erreurs et d’aggraver la situation. Le mieux est de lâcher prise, de laisser couler le temps, les pressions et le stress sur toi. C’est un sale moment à vivre mais il finira par passer et ce qui importe c’est d’y survivre le mieux possible. Cela signifie ne pas aggraver ton cas en succombant à la pression et en commettant des erreurs.
Voici une technique de lâcher prise, facilement utilisable en détention/interrogatoire [20] :
Si tu remarques que tu n’arrives plus à maintenir tes pensées anxiogènes à distance, arrête ce que tu es en train de faire ! Prends une grande inspiration et bloque ta respiration. Reste en apnée autant que possible en énumérant à voix haute et le plus rapidement possible tous les objets qui t’entourent. Tu verras à quel point c’est efficace pour chasser les idées noires.
Une fois encore, le lieutenant le laissa mijoter pendant un long moment. Mais cela n’inquiète plus Lenz. Il sait maintenant qu’il ne fait que se rendre la vie encore plus difficile en attendant chaque interrogatoire comme un homme mourant de soif attend une goutte d’eau. Il ne peut rien faire, la Stasi dirige tout. Par contre, il peut apprendre à attendre. Il faudra bien qu’ils reviennent le chercher un jour. Il est ici dans la maison d’arrêt, pas dans le pénitencier ; à un moment donné, ils auront besoin de leur salle de détention pour les futurs traîtres à l’État.
Extrait librement traduit du livre,
Krokodil im Nacken, Klaus Kordon 2008
19. Projection et posture héroïque
Un des impacts fort et brutal de la répression est son caractère inattendu, son effet de surprise entraînant un bouleversement du quotidien. La majorité du temps, cela te tombe dessus sans que tu y sois préparé·e. Dans cette thématique, on peut avoir tendance à penser que ça n’arrive qu’aux autres. Malheureusement ce n’est pas le cas, la répression peut toucher n’importe qui, n’importe où et n’importe quand. Se projeter mentalement, seul·e ou avec son entourage, dans une telle situation peut aider à mieux s’y préparer. Projeter ses peurs, ses faiblesses, réfléchir à ses vulnérabilités. Anticipe les réactions que l’isolement va provoquer chez toi. Imagine les émotions qui pourraient te submerger.
Pour se projeter dans une telle situation, tu peux t’inspirer de récits et de témoignages :
• Résignation est complicité, Marco Camenisch, Éditions Entremonde, 2013
• Mémoires de prison d’un anarchiste, Alexandre Berkman, 2020
• Paroles d’enfermés, 2018, infokiosques.net
• Lettre depuis la maison d’arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, 2016, infokiosques.net
• Sur la route de Magadan, Ihar Alinevich, 2014, infokiosques.net
• Femmes trans en prison, 2011, infokiosques.net
• Paroles de Fies, Entretien avec Laudelino Iglesias, 2005, infokiosques.net
• Un an au pénitencier de Blackwell’s Island, Emma Goldman, 1931, infokiosques.net
• Les frères de Soledad, Georges Jackson, Éditions Syllepse, 2014
• Devant mes yeux la mort, Georges Jackson, Gallimard, 1972
• Huye, hombre, huye, Chroniques de l’enfermement, Xosé Tarrio, Gonzalez, Nyctalope Éditions, 2014
• La revue anti-carcérale L’envolée
Face à la répression étatique, il me paraît très important de ne pas endosser une posture viriliste où l’on chercherait à se mesurer à la police sur son propre terrain. La police est une institution brutale et violente qui pose un rapport de force asymétrique pour briser l’individu. Par contagion émotionnelle, l’idée peut apparaître qu’à ton tour, pour résister, tu dois être fort·e et héroïque. C’est l’image du·de la guerrier·guerrière fort·e, dénué·e de toute faiblesse, qui ne se laisse pas atteindre par les attaques de la police. Jusqu’à ce que tout se craquelle et explose en morceaux lorsque tu remarques que cette image de toi n’était qu’un fantasme.
J’aimerais plutôt encourager une posture résiliente. Reconnaître, accepter et accueillir nos vulnérabilités et faiblesses me semble très important. La posture viriliste qui voit dans toute faiblesse quelque chose de dévalorisant et honteux me paraît idiot. Le fait est que vivre une détention ou un interrogatoire est quelque chose de dur, de désagréable (et potentiellement traumatisant). Chaque personne le vivra différemment en fonction de ses sensibilités, mais tout le monde en sera affecté. L’inverse serait très étonnant. À partir de là, plus on connaît ses propres peurs et faiblesses et mieux on peut les affronter. Le « même pas mal je suis trop badass » ne te protégera pas, mais aura comme conséquence que tu seras surpris·e de découvrir tes vulnérabilités au moment même où tu les vis, ce qui n’est vraiment pas une bonne base pour les affronter et les surpasser.
Tu peux aussi thématiser avec tes proches les questions liées à la répression. Comment le vivraient-ils·elles si tu étais mis·e en détention, sans qu’ils·elles aient de possibilité de contact avec toi.
Montrer à soi-même et aux autres qu’on accueille sereinement ses propres vulnérabilités et peurs est le premier pas pour pouvoir les affronter avec confiance et, à terme, les surpasser.
20. Prendre soin de soi et des autres
Take care of each other so we can be dangerous together.
Slogan queer-anarchiste
Vivre un moment de détention ou une confrontation avec la police peut être un moment traumatisant et laisser des séquelles. Une fois dehors, face à la joie d’en avoir fini, on peut facilement sous-estimer les impacts sur le long terme qu’un tel événement.
Il existe quelques indices de la présence d’un traumatisme. Par exemple des crises d’angoisse, un sentiment de culpabilité, de honte, des reproches envers toi-même, la perte de joie de vivre, un sentiment de solitude et d’abandon, d’inutilité, d’incapacité à prendre des décisions, une remise en question de l’engagement politique et inter-humain, une impression que la vie n’a plus de sens, de valeur ou d’intérêt et enfin une réapparition de souvenirs traumatisants. Quelques fois, ces réactions surgissent bien longtemps après les événements – quelques semaines ou même des années plus tard.
Si tu remarques l’apparition de telles indications, je te conseille de ne pas rester seul·e mais de t’entourer d’ami·es compétent·es à qui te confier, et de rechercher un·e thérapeute travaillant sur les traumatismes. Écrire sur les faits et en retracer le déroulement, comment tu l’as ressenti, peut être un bon moyen d’extérioriser les événements. De plus, il peut être utile d’avoir un témoignage complet sous la main pour la suite des événements. Tu pourras par exemple en avoir besoin lors du procès.
Si un·e de tes proches vient de vivre un tel moment, enquière-toi de son état et de ses besoins. Rien de mieux, en sortant d’un environnement hostile et violent, que de remarquer que des gens se soucient de toi, de ton état et sont là pour te soutenir dans cette épreuve.
Cercle de parole
Le cercle de parole [21] est un bon outil pour extérioriser ton expérience et prendre conscience que tu n’es pas seul·e dans ce que tu as vécu. Réunis plusieurs personnes ayant vécu des expériences de détention/interrogatoire et avec qui tu te sens en confiance. À tour de rôle, chacun·e peut raconter ce qu’il·elle désire sur son expérience. Comment cela s’est passé, les peurs et doutes qui sont survenus, les difficultés, le stress ou encore l’impact sur le quotidien à moyen-long terme. Les autres ne posent pas de questions, ne font pas de critique, ne jugent pas, mais écoutent uniquement. Et cela représente déjà beaucoup. Cela permet de se rendre compte que ce que l’on croyait être seul·e à traverser, à ressentir ou à expérimenter, les autres le connaissent aussi. De reconnaître que des sentiments, des expériences qu’on croyait anecdotiques, honteuses ou insignifiantes, résonnent avec celles d’autres personnes. De découvrir qu’en parler, cela peut aider les autres. Dans un cercle, on peut briser les tabous et sortir de la solitude ; on peut apprendre à écouter les autres et à s’exprimer, et surtout à politiser nos expériences.
Écriture de lettres aux prisonniers·prisonnières
Soutenir activement les prisonniers·prisonnières est une vieille tradition dans les différents milieux anarchistes. Une pratique courante est l’écriture de lettres. L’isolement social fait partie de la logique carcérale. De manière consciente, les personnes emprisonnées sont coupées du monde extérieur, de leur environnement social, de mouvements de luttes politiques. Briser une partie de cet isolement à travers un contact épistolaire peut fournir une aide très concrète pour supporter la vie en prison. Cela peut être en format carte postale ou en s’engageant sur une correspondance à long terme, en envoyant des revues, journaux ou articles imprimés depuis Internet ou en explorant ensemble des jeux de rôles épistolaires [22].
Ce n’est pas toujours facile d’entrer en contact avec des prisonniers·prisonnières. Certain·es tiennent à conserver leur anonymat la où d’autres sont si isolés et coupé du monde qu’ils·elles n’ont pas de relai extérieur. Il existe néanmoins plusieurs listes de prisonniers·prisonnières ainsi que des guides sur l’écriture de lettre en prison.
Guides d’écriture :
• Lettres vers la prison, une introduction, projet-evasions.org
• Guide pour écrire aux personnes détenues, infokiosques.net
Listes de détenu·es :
• abc-wien.net
• solidarity.international
• political-prisoners.net
La force d’une communauté peut se mesurer à la manière dont elle prend soin des plus vulnérables. Les personnes privées de liberté font clairement partie de cette catégorie.
21. Et quand ça se passe mal ?
Rappelons ceci : lors d’un interrogatoire, la police met une grande énergie pour te manipuler le plus efficacement possible, notamment en jouant sur tes peurs et les endroits où tu es fragile. Tout est fait pour que ce moment se passe mal pour toi. L’idée de cet ouvrage est de t’apporter des connaissances et des outils pour que tu puisses te protéger le plus efficacement possible de la pression que représente un interrogatoire.
La manipulation fonctionne grâce à des comportements communément acceptés dans notre société. C’est le cas, par exemple, de tous les principes institués par notre code moral (par exemple il faut s’entraider, dire la vérité, obéir à l’autorité, répondre quand on nous parle, etc.). Elle fonctionne aussi en prenant appui sur les fragilités que tu portes suite au parcours qui t’est propre, de tes expériences passées. Des pièges te sont tendus et peut-être que tu vas tomber dans certains d’entre eux. Si cela arrive, tu ne devrais en aucun cas te sentir honteux·honteuse d’avoir été la proie et la victime des stratégies de manipulation policières. Si un interrogatoire se passe mal, ne te laisse pas aller à la honte, aux remords ou à la culpabilité. Il arrive de craquer, de céder à la pression, d’être brisé·e. Quel intérêt dans un environnement déjà hostile de se fragiliser soi-même en s’autoflagellant à coup de culpabilité ? Cela ne t’apportera aucune solution dans l’instant présent mais prendra par contre beaucoup de place mentale et émotionnelle, ce qui aura comme conséquence de t’affaiblir encore plus lors des prochains interrogatoires. Tu pourras ouvrir la porte à ces réflexions avec du recul, lorsque le danger sera écarté. C’est très important de le faire, comme il est important de reconnaître ses erreurs et faiblesses.
À ce moment-là, il sera temps de réparer ce qui peut l’être, de comprendre et d’apprendre. Ici aussi, je ne peux que conseiller d’être empathique envers soi-même. Mais il me paraît aussi très important d’être honnête et transparent·e par rapport à ses faiblesses. Envers soi-même tout comme envers les autres personnes concernées. Si tu es interrogé·e dans une affaire qui concerne autrui, il faut absolument communiquer de manière transparente sur ce qui a été dit ou non, car cela va impacter toutes les personnes concernées. Le pire scénario qui puisse arriver est qu’une personne craque lors d’un interrogatoire, donne des informations à la police mais n’ose pas le communiquer aux autres personnes concernées. De cela découle une perte de temps précieux qui aurait pu servir à se protéger des conséquences de ces informations ainsi qu’une grande rupture de confiance.
Foutu·e pour foutu·e ? La résignation est un sentiment vers lequel la police tente de t’amener, exactement pour l’effet de renoncement qu’il produit. Si tout est perdu, à quoi bon s’épuiser dans une résistance jugée vaine ?
« Le lendemain, on me conduisit à l’étage inférieur pour être entendue. Ce fut un jeune homme d’un peu plus d’une vingtaine d’années qui m’interrogea. Il voulait des renseignements sur notre mission bolchevique secrète en Europe, savoir pourquoi nous avions prolongé notre séjour à Riga, qui nous avions fréquenté et ce qu’étaient devenus les importants documents que nous avions, comme il le savait, introduit illicitement dans le pays. Je l’assurai qu’il lui restait beaucoup à apprendre avant d’acquérir la notoriété et la fortune d’un enquêteur capable d’interroger une délinquante aussi chevronnée que celle qu’il avait devant lui. Je ne lui ferais pas de confidences lui dis-je, même si je possédais des renseignements qui pourraient l’intéresser. Je lui révélai cependant que je n’étais pas une bolchevik mais une anarchiste.
Emma Goldman, Vivre ma vie, Éditions l’envolée
En réalité, rien n’est jamais totalement perdu
et tout peut toujours devenir pire.
Lexique
Abolitionnisme pénal L’abolitionnisme pénal est un courant de pensée et des mobilisations politiques qui visent la suppression de l’ensemble du système pénal (prisons, police, tribunaux). Il puise ses origines dans le mouvement pour l’abolition de l’esclavage.
Alibi Moyen de défense d’une personne prouvant le fait qu’elle s’est trouvée ailleurs que sur le lieu d’un crime ou d’un délit au moment où celui-ci a été commis.
Crime « En Droit, infraction que les lois punissent d’une peine afflictive ou infamante » Petit Robert.
Délit Synonyme de crime. Dans certaines juridictions, une légère nuance peut exister en fonction de la gravité et de la sanction encourue.
Flagrant délit Lorsque tu es pris·e sur le fait par la police, en pleine action illégale, cela s’appelle du flagrant délit. Il faut qu’au minimum un·e policier·policière puisse témoigner t’avoir vu·e durant ton action illégale pour que l’on puisse parler de flagrant délit.
Forensique Le terme forensique regroupe l’ensemble des différentes méthodes d’analyse fondées sur les sciences (chimie, physique, biologie, neurosciences, informatique, mathématiques, imagerie, statistique, psychologie) afin de servir au travail de la police et de l’action de sécurité.
Informateur·informatrice Personne choisie en raison de son appartenance à une communauté ethnique, linguistique ou à un groupe social pour fournir des renseignements à un·e enquêteur·enquêtrice. Les informateurs·informatrices sont donc recruté·es par la police mais ne sont pas pour autant membres des forces de police. Le salaire ou les avantages qu’ils·elles reçoivent pour leur travail de délation dépendent des juridictions, cela peut être de l’argent ou des allégements de peines s’ils·elles sont eux·elles mêmes impliqué·es dans des instructions.
Interrogatoire Pour la police, l’interrogatoire est défini comme l’ensemble des questions posées à un·e suspect ou à un·e prévenu·e et les réponses qu’il·elle y apporte.
Mode opératoire Dans l’environnement policier, le mode opératoire consiste en la description détaillée des actions nécessaires à la commission d’un crime. La comparaison des modes opératoires peut être un élément d’indice pour affirmer que deux crimes ont été commis par la ou les mêmes personnes.
Perquisition Dans le cadre d’une enquête, la perquisition consiste pour les policiers·policières à fouiller un lieu privé pour y trouver des preuves.
Prévenu·e/Suspect·e Personne qui est soupçonnée par la police d’avoir commis un crime.
Système pénal L’ensemble des institutions (forces de police, tribunaux, prisons) chargées de sanctionner ce que le droit pénal qualifie d’infractions (contravention, délits et crimes).
[1] À propos de l’autodéfense comme pratique émancipatrice, voir le livre de Elsa Dorlin, Se défendre. Une philosophie de la violence, Zones 2017.
[2] Un exemple parmi beaucoup qui illustre la présence du racisme, de l’antisémitisme et du sexisme dans les rangs de la police française est à écouter dans le podcast Gardien de la paix produit par Arte Radio. Ce podcast dévoile l’existence d’un chat WhatsApp entre plusieurs policiers y faisant l’apologie de la suprématie blanche. Ces deux dernières années, plusieurs cas similaires de regroupements de policiers et policières d’extrême droite ont été rendus publics. Suite à la découverte qu’une vingtaine de policiers de l’unité d’élite de la police de Francfort était liée à des mouvements néo-nazis, cette même unité a été dissoute. En 2021, des membres des unités d’élite des polices de Zürich et de Bâle, en Suisse, se rendent à un entraînement de tir organisé par des membres de groupes néo-nazis en Allemagne, ce qui donnera lieu à une interpellation parlementaire.
[3] Suivant le pays aussi appelé ministère public ou juge d’instruction.
[4] Ce terme policier définit tout travail professionnel, mené dans le but de défendre, protéger, imposer et maintenir l’état actuel défini par le cadre légal, les constitutions, règlements etc. Au côté de la police on trouve aussi d’autres acteurs de l’action de sécurité, comme les entreprises de sécurité privée, les services de renseignements ou encore les institutions de psychiatrie forensique et les administrations carcérales.
[5] Témoignage d’enquêteurs·enquêtrices recueilli par Diane Boszormenyi, pour son travail « L’influence des techniques policières d’interrogatoire sur la valeur de l’aveu. Étude à la lumière de la théorie des trois dimensions de la force publique de Monjardet » , Faculté de droit et de criminologie, Université catholique de Louvain, 2019. Tous les extraits de parole policière sont tirés de ce livre et ne seront donc plus référencés autrement que par le pictogramme [Parole de flic].
[6] Voir le rapport de Human Rights Watch « US : Secret Evidence Erodes Fair Trial Rights » Janvier 2018
[7] À vérifier selon les procédures juridiques du pays dans lequel tu te trouves.
[8] Hommage à Georges Jackson (1941-1971), afro-américain incarcéré à dix-huit ans pour un délit mineur à un an de prison reconductible. Il ne sortira jamais de prison et y mourra à l’âge de 30 ans, assassiné par un gardien. Georges Jackson est une figure emblématique des luttes de prisonniers·prisonnières contre le système pénitentiaire et le racisme. Pour lire ses textes : Georges Jackson, Les frères de Soledad, Édition Syllepse, et Georges Jackson, Devant mes yeux la mort, Édition Gallimard.
[9] Le fait que les otages n’aient pas seulement agi par attachement et par identification avec leurs ravisseurs mais également par hostilité à l’égard des autorités policières dû à leurs agissements lors des faits, n’est repris et analysé que dans un faible nombre d’études psychologiques mais vaut la peine de s’y intéresser.
[10] Cette liste est tirée du livre de Ekman P., Je sais que vous mentez, Michel Lafont, Paris 2010. Je recommande la lecture de cet ouvrage pour toute personne cherchant à mieux maîtriser son langage non-verbal.
[11] Pour une liste plus complète voir la traduction française de ce rapport : Techniques d’interrogatoire à l’usage de la CIA, Éditions des Équateurs, 2009. agressive dans son espace intime.
[12] J’intégrerai d’ailleurs volontiers ces écrits dans les prochaines éditions de ce livre. N’hésitez pas à prendre contact à travers l’adresse mail à la fin de l’ouvrage.
[13] Une version de ce jeu a été adaptée par nos soins afin de créer un outil ludique et pédagogique pour démontrer la difficulté de mentir dans une situation d’interrogatoire => Taceo #1, Édition Projet Evasions, 2020.
[14] L’expérience la plus frappante sur ce sujet reste celle de Milgram, reprise sous de nombreuses formes. Voir Stanley Milgram, Expérience sur l’obéissance et la désobéissance à l’autorité, La Découverte, Hors Collection ZONES, 2013
[15] On parle d’enquête policière lorsque dans la fiction les spectateurs · spectatrices découvrent l’histoire
[16] Philip K Dick, Comment construire un univers qui ne s’effondre pas deux jours plus tard (1986, How to Build a Universe That Doesn’t Fall Apart Two Days Later)
[17] Le Racial Profiling ou profilage ethnique désigne le comportement discriminatoire de la police à l’égard d’un individu ou d’un groupe d’individus, en fonction de ses origines raciales ou religieuses, réelle ou perçue. C’est un terme synonyme du contrôle au faciès mais qui met en lumière le côté intrinsèquement raciste de cette pratique. Pour de plus amples informations à ce sujet voir le site de l’alliance suisse contre le profilage racial : stop-racial-profiling.ch
[18] Même si tu n’as pas la possibilité d’envoyer des lettres car cela t’est interdit, rien ne t’empêche d’écrire une lettre à l’attention d’une personne de ton choix. C’est un agréable moyen de passer le temps et de créer une connexion mentale avec une personne éloignée.
[19] Un mode d’emploi pour se créer une clé USB cryptée est trouvable sur le très bon guide d’autodéfense numérique. https://guide.boum.org/ ou en version livre aux Éditions Tahin-Party, 2017. Une réactualisation est prévue pour 2022.
[20] De nos jours, il existe de nombreux guides et manuels de lâcher prise de plus ou moins bonne qualité. N’hésite pas à y jeter un œil.
[21] Explication librement reprise et adaptée du livre et podcast Le cœur sur la table, Victoire Tuaillon, Binge Audio, 2021
[22] Pour un guide à sujet, voir l’article « le jeu de rôle à l’assaut de l’enfer carcéral » sur projet-evasions.org
Version mise en brochure en mars 2025. Contact de la mise en brochure : souslaplage@riseup.net
Par rapport à la version livre, la version brochure a été réduite - pour gagner de la place - des chapitres « Dépasser la police, dépasser la justice » qui aborde l’abolition du système policier et pénal et introduit la justice transformatrice. Il manque aussi la liste des ressources ainsi qu’un appel à traduction dans un maximum de langue. N’hésitez pas à vous procurer le livre actuellement publié par les Éditions du Commun, ou à consulter le pdf du livre disponible sur le site projet-evasions.org.
En cas d’intérêt mais aussi de retours et critiques sur le contenu, envoyez un mail à l’adresse suivante : evasions@riseup.net
Version brochure du livre "Petit Manuel d’autodéfense en interrogatoire" édité par les Éditions du Commun, réduite d’un chapitre.
Rédaction : projet Evasions
projet-evasions.org
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (859.6 kio)
- Zip par téléchargement, en cliquant ici (181.8 Mio)