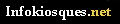Brochures
Le néo-carnisme de Jocelyne Porcher
mis en ligne le 8 février 2025 - Axelle Playoust-Braure , Comme un poisson dans l’eau
Ce texte est une retranscription de l’épisode #24 du podcast "Comme un poisson dans l’eau" réalisé par Victor Duran-Le Peuch.
Victor Duran-Le Peuch : « Salut, moi c’est Victor Durand-Lepeuche et vous écoutez un entretien de Comme un poisson dans l’eau, le podcast contre le spécisme. Aujourd’hui, on s’arrête un peu sur les écrits et les discours d’une des opposantes idéologiques à l’antispécisme, Jocelyne Porcher.
C’est une des personnes qui a par exemple co-écrit une tribune dans Libération en 2018 intitulée « Pourquoi les véganes ont tout faux ? » et qui enchaîne sophisme sur sophisme. Presque tout est faux dans les affirmations de cette tribune, sauf peut-être lorsque les auteur·ices parlent du succès de la propagande végane et écrivent qu’aujourd’hui, les opinions contraires au véganisme, pourtant majoritaires, doivent se justifier par rapport à lui.
Eh bien oui, la domination humaine sur les autres animaux commence à ne plus aller de soi, commence à être fragilisée. Et nos opposants ressentent, face à la montée en force de nos critiques et de nos revendications, le besoin de se justifier, de relégitimer l’ordre spéciste, d’ériger des digues en produisant de nouveaux discours idéologiques. Fondamentalement, c’est ça ce qu’on appelle le néo-carnisme. Le carnisme, c’est l’idéologie qui légitime l’exploitation des autres animaux. Et le néo-carnisme, c’est quand le carnisme a besoin de se réinventer et de produire de nouveaux discours face à l’avancée du mouvement social contre le spécisme.
Le discours de Jocelyne Porcher est une des versions du néo-carnisme contemporain. Et on a pris le temps de le décortiquer en détail avec mon invitée du jour, Axelle Playoust-Braure
Je l’avais déjà reçue dans la première saison, et je vous encourage d’ailleurs à aller réécouter les épisodes 9 et 10, dans lesquels elle nous présentait la pertinence de penser la question du spécisme depuis un cadre matérialiste comme un ordre social.
Je rappelle qu’Axelle Playoust-Braure est journaliste pigiste, et c’est la co-autrice de l’ouvrage Solidarité animale, défaire la société spéciste. Allez, on est parti·es pour un débunkage de Jocelyne Porcher.
V : Bonjour Axelle Playoust-Braure.
Axelle Playoust-Braure : Bonjour.
Introduction
V : « Je vous avais déjà reçue dans le podcast pendant la première saison, et je vous retrouve à nouveau aujourd’hui pour que l’on parle d’un sujet important, d’une personne importante, Jocelyne Porcher. Je dis importante parce qu’elle s’est positionnée dans ses écrits et ses prises de paroles publiques comme une opposante presque acharnée à l’antispécisme et une critique assez féroce du véganisme. Peut-être que je peux commencer par vous demander qui est Jocelyne Porcher ? Et pourquoi mérite-t-elle qu’on lui consacre un épisode entier ?
A : « Jocelyne Porcher est sociologue, directrice de recherche à l’INRAE, et elle est beaucoup discutée dans les milieux antispécistes véganes, parce qu’elle a beaucoup écrit sur l’élevage, sur les relations humains-animaux dans le cadre de l’élevage, et notamment, c’est une défenseuse du modèle paysan de l’élevage. De par ses écrits, de par sa défense de l’élevage, et la façon dont elle le fait, elle se positionne finalement comme une ennemie des animaux. En tout cas, c’est comme ça que le milieu antispéciste l’analyse, et ça a fait l’objet d’écrits divers et variés de la part d’antispécistes, de critiques qu’on va détailler. J’en ai un petit peu parlé dans mon mémoire de sociologie publié en 2018, où je propose une approche différente de Jocelyne Porcher sur la question des rapports humains-animaux dans le cadre de l’élevage. »
V : « Oui, donc elle a là deux casquettes, d’être à la fois ancienne éleveuse et d’avoir travaillé en tant que technicienne agricole, et aussi d’être devenue en fait une des principales sociologues de l’élevage au sein de l’INRAE, c’est ça ? »
A : « Oui, effectivement, elle a cette particularité d’avoir été elle-même éleveuse de brebis, elle est toujours très proche du milieu paysan et dans le cadre de ses recherches, de ses articles scientifiques, elle donne beaucoup la parole aux éleveurs sur comment ils vivent leur travail au contact des animaux, quel sens ils donnent à leur métier, à leur pratique. »
V : « Donc Jocelyne Porcher, avant de devenir, comme vous le dites, une ennemie des animaux, s’est plutôt fait connaître dans sa carrière de chercheuse pour sa critique très vive de l’élevage industriel.
Et alors elle ne l’appelle pas comme ça, ce que tout le monde appelle l’élevage industriel, elle, elle l’appelle les productions animales, dans cette idée que les animaux sont tellement désindividualisés, tellement objectivés dans les systèmes industriels, capitalistes, qu’ils sont finalement réduits à l’état de machines, et même de marchandises produites, et que selon elle, ça n’a plus rien à voir avec l’élevage paysan.
Donc cette critique-là de l’élevage industriel, elle est assez juste, elle est assez intéressante, on est d’accord ? »
A : « Oui, tout à fait. Porcher propose une distinction effectivement terminologique, entre l’élevage paysan d’un côté et de l’autre, les productions animales où c’est vraiment une approche zootechnique de l’élevage industriel, avec le fait de réduire les animaux à des corps marchandises, vraiment de façon très poussée. Mais au-delà de la distinction terminologique, elle pose une distinction morale, entre d’un côté l’élevage, qu’elle présente comme quelque chose de vertueux, qu’il faut sauvegarder absolument, quelque chose de tout à fait positif, un endroit où les liens humains-animaux sont des liens affectifs, sont des liens mutuellement bénéfiques, et de l’autre, le monde des productions animales, qui est ce monde capitaliste où les animaux sont réduits à de simples objets, et qu’elle qualifie de barbares. Donc au-delà de la distinction purement conceptuelle, il y a vraiment une charge morale très forte de la part de Porcher entre élevage paysan et production animale. Donc à la fois, je souscris totalement au fait que dans l’élevage industriel il y a une dimension supplémentaire dans l’ignominie infligée aux animaux, à la fois, je pense qu’il faut être vigilant aux raisons derrière cette volonté de mettre une distinction très forte entre les deux, et je pense que d’un point de vue antispéciste, il n’y a pas forcément de saut qualitatif entre élevage paysan et élevage industriel, parce que dans les deux cas, on a affaire à une situation où les animaux sont appropriés, où les animaux sont réduits à l’objet de biens qu’on peut élever, qu’on peut tuer, etc.
Donc ce que ne rappelle pas Porcher quand elle parle de l’élevage paysan comme quelque chose de vertueux, c’est que dans l’élevage paysan aussi, les animaux sont des propriétés, les veaux sont séparés de leur mère, il y a à la fin, et d’ailleurs c’est une fin anticipée, parce que les animaux ne meurent pas de leur belle mort, les animaux sont mis à mort en élevage paysan, bien sûr, et il y a tout un tas de mutilations, de séparations des groupes sociaux, tout un tas de pratiques qui causent du tort aux animaux qui sont partie intégrante de l’élevage paysan. »
Le discours du don/contre-don
V : « Alors peut-être qu’on peut en venir à une caractérisation un peu plus précise des apports de la recherche de Jocelyne Porcher dans l’analyse de ce qu’elle nomme l’élevage, donc l’élevage paysan. Il y a deux éléments sur lesquels elle insiste particulièrement ; le premier élément c’est le fait que les animaux peuvent travailler presque en collaboration avec leurs éleveurs, éleveuses ; elle parle vraiment du travail animal, et elle applique les grilles de la sociologie du travail, ce qui était assez novateur au moment où elle a commencé à le faire. Deuxième élément elle insiste beaucoup sur le côté relationnel, la relation entre éleveur·euse et animaux. »
A : « Oui, c’est vrai que les éleveurs, du fait qu’ils vivent au contact des animaux connaissent leurs animaux, ils sont au premier plan pour savoir et pour observer que les animaux d’élevage sont doués d’agentivité [1], que c’est pas une relation à sens unique, que les animaux d’élevage peuvent avoir un intérêt à cohabiter avec des humains, du fait qu’ils sont issus de la domestication, qu’ils recherchent le contact avec des humains, donc ça c’est quelque chose qui est commun, d’une certaine façon, entre les thèses de Jocelyne Porcher et la plupart des penseurs et penseuses de l’antispécisme.
En fait, Porcher a une façon assez étonnante de décrire les relations d’élevage, les relations entre humains et animaux dans le cadre de l’élevage. Elle les théorise comme des relations de « dons/contre-dons »
En fait, elle s’inspire d’un anthropologue, Marcel Mauss, qui a étudié ce type de relation sociale entre groupes, entre individus, qui est fondée sur le don qui permettrait le lien social entre groupes, et l’idée de Porcher, en reprenant cette théorie du don, c’est que les animaux nous donneraient leur vie en échange de l’octroi de bons soins de la part des éleveurs pendant leur existence. Le fait qu’ils ont eu une vie bonne, qu’ils ont été protégés des prédateurs, qu’ils ont eu à boire, à manger, qu’ils ont eu des conditions de vie correctes, voire bonnes.
C’est vraiment une approche où l’élevage est défini comme un lieu privilégié de relation de travail, avec une réciprocité, avec le fait que c’est une relation qui est mutuellement bénéfique, chacun y trouve son compte. Les animaux ont une vie bonne, ils sont protégés, et en retour, ils donnent, enfin l’éleveur peut tirer de la viande, des produits qui vont lui permettre de vivre de son travail. Il y a vraiment une idée d’harmonie, de réciprocité, d’échange. Il y a quelque chose de très consensuel dans l’approche de Jocelyne Porcher. Chaque partie trouve son avantage dans la relation d’élevage. C’est un peu ce que Porcher essaye de mettre en avant.
Pour étayer cette position, elle va utiliser des notions comme l’agentivité des animaux, ou le fait qu’il y a une co-construction de normes dans l’élevage. Je sais qu’il y a des articles scientifiques écrits ou co-écrits par Jocelyne Porcher, où il y a vraiment une étude de comment les vaches laitières réagissent aux installations, ou à ce que les éleveurs proposent donc il y a vraiment une attention sur le fait que les animaux ne sont pas seulement des corps-machines, mais qu’ils sont doués d’intentionnalité, de subjectivité, etc. Qu’ils participent activement à la relation d’élevage. Et en fait Il y a des critiques quand même, parce qu’au-delà de cette approche vraiment positive et consensuelle, il y a des critiques qui ont été faites du caractère quand même un peu absurde, en tout cas étonnant à laisser entendre que les animaux donneraient leur vie aux humains en échange d’une vie bonne, parce que ça sonne bien mais en fait, ça paraît quand même un peu fou de se dire que les animaux donnent leur vie, ça paraît vraiment excessif, et je pense notamment à un texte écrit par le philosophe Enrique Utria en 2014, qui s’appelle « La viande heureuse et les cervelles miséricordieuses », qu’on peut trouver sur Internet.
Il y a une formule que j’adore dans ce texte, où il dit que la thèse de Porcher est plus facile à chanter qu’à argumenter et je trouve que ça résume bien tout ça, où Enrique Utria va vraiment reprendre les idées de Porcher, avec des citations, et il va décortiquer à quel point il y a des contresens total.
C’est difficile d’être charitable envers les thèses de Porcher, sauf à interpréter ce qu’elle raconte comme une façon imagée de raconter les choses, comme un peu un récit, une fable idéologique.
Il y a un côté un peu mystique que nous propose Porcher au sujet des relations humains-animaux. Donc il y a ce texte-là d’Enrique Utria qui est très précis et assez jouissif à lire, parce qu’il y va vraiment franco dans la critique des arguments de Porcher. Il y a aussi un texte de Nicolas Delon qui a été publié en 2017 qui s’appelle « L’animal d’élevage, compagnon de travail, l’éthique des fables alimentaires ».
Et puis on peut aussi mentionner un texte publié par Pierre Madelin en 2019 dans la revue Terrestre, là encore qu’on peut lire en ligne, qui s’appelle « Vivre avec les animaux, une proposition politique ». Mais je pense que ça vaut le coup d’essayer quand même de donner du sens au propos de Porcher, parce que ce que raconte Porcher a du sens dans un certain paradigme et je pense que c’est ça qu’il faut aller creuser. Quel est le sens de la théorie de Porcher ? Pourquoi Porcher en vient à postuler l’idée que les animaux d’élevage participent à leur propre assujettissement, finalement ?
Parce que quand même, il faut rappeler que les animaux d’élevage sont mis à mort. Il y a un pouvoir exorbitant des éleveurs, y compris des éleveurs paysans, sur leurs animaux, et les éleveurs sont les propriétaires des animaux. Et pour donner du sens au propos de Porcher, au-delà du caractère absurde de ses arguments pris un par un, je pense qu’il faut opposer à son approche maussienne, son approche issue de Mauss, le don/contre-don, une approche marxienne, c’est-à-dire matérialiste, issue de la philosophie de la lutte des classes, issue de la philosophie non pas marxiste orthodoxe, mais marxienne, c’est-à-dire on reprend les outils théoriques et conceptuels de Marx, le matérialisme historique, pour l’appliquer à d’autres rapports sociaux que simplement les rapports dans le système capitaliste. Donc c’est exactement ce qu’ont fait les féministes matérialistes pour comprendre, pour théoriser, pour qualifier les rapports entre les hommes et les femmes dans une société patriarcale.
Je pense ici à Christine Delphy qui a particulièrement posé les jalons de cette reprise matérialiste des outils de Marx pour l’appliquer à la situation des femmes. Et je pense que ça serait très utile de faire la même chose dans le cadre des rapports humains-animaux, en disant que l’élevage, on peut voir ça comme un rapport don/contre-don, on peut voir ça comme un métier vertueux, on peut voir ça comme une façon de créer du lien avec les animaux issus de la domestication, mais on peut aussi voir ça comme un rapport d’appropriation abominable, comme un rapport social qu’on peut placer dans la continuité d’autres rapports sociaux critiquables, d’autres rapports sociaux de domination, notamment les rapports sociaux de servage, d’esclavage ou de sexage, qui sont des rapports d’appropriation qui ont été étudiés par tout un tas de penseurs, des penseurs critiques de la race, mais aussi Colette Guillaumin, c’est à Colette Guillaumin qu’on doit le concept de sexage, qui est le rapport d’appropriation des femmes en tant que classe par les hommes en tant que classe. »
V : « Et est-ce que dans ce paradigme un peu concurrent pour analyser les relations d’élevage, il y a aussi des critiques qui ont été produites de justement cette idéologie du don, de cette idée que les animaux donnent leur vie et participent activement à leur propre assujettissement, justement pour montrer en quoi c’est une mystification ? »
A : « Tout à fait. Alors les féministes matérialistes se sont démarquées, entre autres par une critique de l’idée de nature, une critique de l’idéologie naturaliste, l’idéologie essentialiste, qui est une sorte de vernis d’idées reçues, qui est au service du statu quo et au service de la légitimation et du verrouillage idéologique des rapports de domination. Et en fait, l’idéologie qui sert à légitimer un rapport de domination prend plein de formes
différentes. Elle va s’incarner dans des idées comme l’idée d’un contrat, comme on l’a déjà dit. De tout temps, les dominants ont essayé d’infuser l’idée que les dominé·es trouvaient un avantage à leur statut de subalterne. Tout ce qui est bon à prendre pour légitimer l’ordre social en place, notamment le fait de postuler l’existence d’un ordre naturel, on va ancrer dans le naturel, dans l’évident, dans l’immuable, quelque chose qui a été institué, qui est arbitraire, qui est violent. Mais le fait de l’inscrire comme ça dans quelque chose non pas de conventionnel et d’institué, mais qui est de tout temps, là, naturel, ça permet justement de couper l’herbe sous le pied aux critiques. Mais du coup, il y a d’énormes problèmes avec cette idée de contrat ; déjà, c’est un contrat implicite, il n’a pas été écrit, on ne le trouve nulle part le contrat qui aurait été écrit et signé, contre-signé par les animaux et les éleveurs. Et surtout, les contractants dans le cadre de ce supposé contrat domestique, ne sont pas égaux. C’est vraiment quelque chose qu’il faut rappeler à chaque occasion, c’est que dans le cadre du supposé contrat domestique, un des contractants est propriétaire de l’autre contractant. Il y a une dissymétrie de pouvoir et de capacité entre les contractants qui est phénoménale. Donc est-ce qu’on peut vraiment postuler l’idée d’un contrat et d’une adhésion à la relation, d’une participation active, d’un accord, d’un consentement à la relation quand il y a une dissymétrie de pouvoir aussi énorme, aussi écrasante ? Et c’est effectivement ce que rappellent les féministes matérialistes. Il y a Colette Guillaumin qui a pu écrire que la condition minimale de n’importe quel contrat, c’est le fait que les contractants soient propriétaires d’eux-mêmes. C’est la qualité de propriétaire chez les contractants qui fait que ensuite on peut éventuellement négocier quelque chose, sa force de travail, sous certaines conditions, etc.
Pareil, il y a Christine Delphy qui a donné un entretien que je trouve vraiment très éclairant pour cette question-là, de l’opposition entre le paradigme de Mauss et le paradigme de Marx pour penser les rapports de domination. C’est un entretien, le titre c’est « La condition de possibilité du don, c’est l’égalité ». Je trouve que tout est dit déjà dans ce titre. »
V : « On dirait presque que c’est une réponse directe à Porcher . »
A : « Exactement, j’étais ravie de tomber dessus dans le cadre de mon travail de mémoir, ça m’a apporté des clés conceptuelles pour critiquer la thèse de Jocelyne Porcher. Delphy, qui s’est intéressée à la question des rapports hommes-femmes mais très peu à la question des animaux dit « Le don et le contre-don ne peuvent se concevoir qu’entre égaux ». Par exemple, entre chefs de famille, entre chefs de village, mais pas entre chefs et subordonnés. Hors les femmes sont des subordonnées dans un certain nombre de situations, notamment vis-à-vis de leur mari pendant très longtemps et encore aujourd’hui, donc il n’y a pas d’égalité de statut, il y a tout un tas de phénomènes qui fait qu’on ne parle pas d’individus ’égaux. Et c’est ce qui fait qu’elle en vient à conclure que le paradigme de Mauss ne peut pas se substituer au concept de classe sociale, au concept d’exploitation et à toute cette compréhension de la société en termes de rapports de force.
Moi je pense que dans tous les cas c’est difficile de faire une interprétation charitable de l’idée d’un contrat entre les humains et les animaux d’élevage, cette idée que les animaux d’élevage nous donnent leur vie etc. sauf dans un sens très abstrait, très imagé, mais qui finalement n’explique plus rien sociologiquement.
Ce discours-là, il joue simplement un rôle de justification d’un rapport de domination. Et c’est ça, ce dévoilement qu’il faut faire circuler au sujet de la théorie de Jocelyne Porcher. Jocelyne Porcher n’est pas là pour expliquer quelque chose, elle est là pour faire le service de com’ de l’élevage paysan, elle est là pour légitimer, pour verrouiller l’idée que l’élevage c’est quelque chose de vertueux. Et c’est dans la continuité de sa distinction terminologique et morale entre élevage paysan et élevage industriel. Pourquoi elle fait cette distinction ?
Parce qu’il est évident que l’élevage industriel est critiquable. Presque tout le monde critique l’élevage industriel, ça serait absurde de défendre l’élevage industriel qui doit de toute façon être critiqué.
Mais du coup, pour sauvegarder quand même l’idée d’élevage, pour sauvegarder l’idée qu’on peut tuer des animaux pour les manger, qu’on peut en faire un métier, une source de revenus économiques, il faut bien trouver un discours idéologique qui sauvegarde l’élevage paysan. Et cette idée de don, de contrat, de réciprocité, d’affectivité, c’est tout ce qui va permettre de sauvegarder l’élevage malgré l’ignominie de l’élevage industriel.
Et le rôle des antispécistes, c’est de rappeler que l’ennemi principal des animaux, c’est pas le capitalisme. L’ennemi principal des animaux, c’est l’humanisme, c’est le spécisme. Et d’un point de vue antispéciste, c’est-à-dire du point de vue des animaux, il y a une continuité fondamentale entre élevage paysan et élevage industriel, ou production animale, qui fait qu’ils restent des subalternes. Ils restent soumis à l’arbitraire des humains, ils restent soumis au fait qu’ils peuvent être envoyés à l’abattoir alors qu’ils n’ont pas envie de mourir, très simplement. »
Critique de l’Idée de nature et du rapport à la mort
V : « Vous parliez de la mobilisation de l’idée de nature, d’un caractère naturel dans le discours de Porcher.
Peut-être qu’on peut s’appuyer sur un point plus précis, qui est ce qu’elle dit par rapport à la mort, et qui s’ancre très bien dans ce que vous disiez, qu’en fait une partie de son discours relève presque d’une mystique.
Et par rapport à la mort, elle écrit par exemple que « la mort est le fondement ontologique des sociétés humaines, et que notre énergie vivante vient de cette incorporation de la vie par la mort donnée », et c’est en continuité directe avec son idée de don/contre-don, parce que on donne la vie aux animaux, et donc ils nous rendent cette vie par leur mort, parce qu’on les consomme, et dans ce que présente Jocelyne Porcher, c’est une nécessité pour qu’on puisse vivre en tant qu’humain, de consommer des animaux. Et donc, il y a une espèce de mystique dans la façon dont elle décrit la nécessité de la mort, de consommer et elle en finit par dire que c’est la mort qui engendre la vie. Et ça, c’est vraiment ancré dans cette idée de nature que mobilisaient notamment les féministes matérialistes. »
A : « Totalement. Le don c’est quand même quelque chose de merveilleux, on ne peut que admirer le don. Donc, toute cette rhétorique, encore une fois vient sauvegarder l’idée que l’élevage c’est quelque chose de vertueux. C’est vraiment de la com’. Et effectivement, dans les écrits de Porcher, on peut trouver des phrases de type « la mort fait partie de la vie ». Littéralement, on peut trouver ce genre de choses. En fait, quand elle dit « la mort fait partie de la vie », ce qu’elle veut vraiment dire, ou ce qu’il faut vraiment lire, c’est plutôt que « la mise à mort fait partie de l’élevage ». C’est ça qu’il faut entendre. C’est que le meurtre des animaux est inhérent à l’activité d’élevage. Et comme Porcher veut à tout prix sauvegarder l’élevage, il faut qu’elle trouve des justifications à la mise à mort des animaux. Et comment on trouve une justification à la mise à mort des animaux, cette chose profondément violente, arbitraire, injuste, et ben on est obligé d’avoir recours à des discours mystiques, idéologiques, de type « la mort fait partie de la vie ». Je trouve ça vraiment odieux. Mais c’est ça qu’il faut entendre chez Porcher…
Ne vous laissez pas berner par les belles phrases, il faut comprendre ce qu’il y a derrière, et c’est une entreprise de justification des rapports de pouvoir des humains sur les animaux. Et évidemment, ce genre de phrase, ça suscite des réactions outrées de la part des antispécistes, quand même, de pouvoir justifier la mort par-dessus la jambe, enfin de façon aussi légère, c’est quand même odieux. Et du coup, Porcher a souvent pu dire que les antispécistes avaient un problème avec la mort, n’acceptaient pas la finitude de la vie… »
V : « Qu’on est dans le déni de sa nécessité, qu’on ne sait pas regarder la mort en face, que de toute façon, tout le monde meurt à un moment, et donc en fait que nous, oui, on aurait un problème avec ça. »
A : « C’est ça. Alors déjà, c’est une hypothèse qui… je veux dire, on peut se dire, bon, peut-être que effectivement, si on faisait des études en psychologie, on verrait que les véganes, les antispécistes, ont un rapport contrarié avec la mise à mort. Peut-être qu’ils ont un traumatisme du fait d’avoir vu trop de vidéos d’abattoirs ou que sais-je. Mais à ma connaissance, non. Je ne pense pas que les antispécistes, en moyenne, aient un problème particulier dans leur rapport à la mort, à la finitude etc. Les antispécistes ont un problème avec la mise à mort, la mise à mort programmée. Les antispécistes ont un problème avec le meurtre alimentaire. Ils ont un problème avec l’arbitraire et la violence du fait de tuer un animal qui ne veut pas mourir. C’est ça. »
V : « Le droit de vie ou de mort que se sont octroyés les humains sur tous les autres animaux, en fait. »
A : « Voilà. Et je pense qu’on a des raisons d’être indignés ou perturbés par ça. Et moi, ce qui me dérange quand Porcher dit que les antispécistes ont un problème avec la mort, c’est qu’il y a une connotation presque psychanalytique là-dedans. Là, on retrouve des trucs un peu mystiques ou je ne sais quoi. C’est que c’est juste un propos pour disqualifier les antispécistes, pour les faire passer pour des personnes naïves, puériles, pour les renvoyer à une position un peu ridicule. Finalement, pour moi, c’est vraiment du même ordre que si on disait, que si des masculinistes disaient les féministes ont vraiment une phobie des pénis. Pour moi, c’est du même ordre. »
V : « Oui, qui va aussi dans un registre de la pathologisation, parfois. Ça peut aller jusque-là de, ah, mais en fait, les antispécistes sont un peu malades ou défaillants dans leur rapport à la mort ou alors ils ont des traumas par rapport à ça. Il y a aussi tout un registre comme ça et qui s’est aussi appliqué aux féministes de pathologisation permanente de ce qui sont des revendications politiques, en fait. »
A : « Tout à fait. Essayer de mettre de côté la charge politique des revendications, des analyses, etc.
Ce qui est fou quand même, c’est que Jocelyne Porcher a écrit un article qui, moi, m’a beaucoup marquée, qui s’appelle « La mort d’Ulysse », dans lequel elle raconte la relation qu’elle a eue avec Ulysse, qui est un bélier qu’elle avait dans son troupeau au moment où elle était éleveuse, et aussi la relation qu’elle a eue avec Sido, qui est une oie avec qui elle a cohabité qui était son amie, peut-être. En tout cas, elle avait un rapport particulier avec elle. Et en fait, dans cet article, elle va raconter la mort de ces deux individus avec qui elle a cohabité, et tout son récit est une façon de rationaliser le fait d’accepter la mise à mort des animaux.
Parce que le bélier, elle l’a fait tuer sur son exploitation parce qu’il était trop violent, parce qu’il ne s’inscrivait pas bien dans la dynamique qu’elle voulait pour son troupeau. Et Sido a été tuée par ses voisins qui lui ont servi à manger sans la prévenir. Et dans cet article elle nous raconte comment elle a vécu ces événements-là.
Elle ne nie pas le fait que c’était difficile, qu’elle a été traversée par des sentiments un peu contradictoires. Mais surtout, à un moment, elle dit, une fois qu’elle a compris qu’elle avait mangé son amie Sido « Je suis sortie de l’innocence et d’une niaiserie confortable. » Elle dit : « Mes voisins éleveurs qui m’ont servi Sido à manger sans me prévenir, finalement ils ont tout compris, ils ont mieux compris et ils m’ont aidé à comprendre, ils m’ont aidé à sortir de mon innocence, de mon rapport nié, de mon rapport naïf à la mort animale. »
Et moi, je trouve ça déchirant parce que j’aurais infiniment préféré qu’elle reste outrée par le fait que ses voisins ont trahi l’amitié qu’elle avait avec cette oie ou le simple fait de reconnaître que c’était une oie individuelle avec un prénom, qui n’avait pas envie de mourir, etc. Et j’aurais infiniment préféré qu’elle garde ses intuitions de solidarité envers les autres animaux plutôt que de se rallier au camp de légitimer, de rationaliser le fait qu’on les met à mort. Donc j’invite vraiment tout le monde à lire ce texte parce que pour moi, c’est un peu une illustration de la dissonance cognitive et de comment elle peut se résoudre dans un sens ou dans un autre en fonction du récit qu’on a envie de se raconter, en fonction des influences de notre entourage social, en fonction d’un tas de choses.
Quand elle explique comment elle en est venue à rationaliser leur mise à mort, elle va avoir des formules qui laissent penser que finalement, ce ne sont plus des individus particuliers avec un prénom, avec une relation d’amitié, etc. ; ce sont des animaux qui rejoignent cette grande catégorie des animaux d’élevage qu’on peut tuer, où il y a un déni de l’individualité des animaux qui permet de faire passer la pilule de leur mise à mort. »
V : « Ils sont renvoyés à nouveau à leur fonction pour nous, humains, et pour servir nos intérêts. »
A : « Tout à fait, oui. »
V : « Ce qui joue aussi dans sa mobilisation de l’idée de nature, elle parle beaucoup du caractère naturel, de la relation de travail et d’élevage avec les autres animaux, et même de son caractère millénaire. Depuis qu’on a domestiqué les animaux, on a cette relation particulière, ce lien important avec les animaux. Ça c’est aussi une mobilisation de l’idée de nature. »
A : « Oui, cette référence au caractère millénaire naturel de la relation éleveur-animaux, c’est un avatar de plus. C’est une façon de nier la dimension sociale arbitraire de cette relation d’élevage. C’est souvent ce qu’on retrouve pour d’autres rapports de domination. Le fait de poser un ordre naturel permet d’asseoir la légitimité d’un ordre social. »
V : « Finalement, pour résumer, j’ai l’impression qu’il y a un contraste assez fort entre une lecture matérialiste des rapports d’élevage qui nous pousse à regarder concrètement quelles sont les conditions d’exploitation, de vie réelle, ce qui se passe et les mauvais traitements et les violences qui sont infligées aux animaux.
Ça contraste complètement avec ce qu’on peut décrire comme un profond idéalisme de la lecture de Jocelyne Porcher sur ces questions. Idéaliste parce que ça passe complètement sous silence, même ça invisibilise ce qui se passe réellement : tout un ensemble d’enjeux de relations de pouvoir, le contrôle total sur la vie et la mort des animaux, le fait qu’il y ait un bénéfice économique qui est en réalité au cœur de la relation et qui rend impossible ou très difficile le fait de développer des amitiés sincères ou que c’est une relation inégalitaire, la vulnérabilité aussi des animaux… en fait ça invisibilise complètement tout ça pour nous en faire une image d’épinal du joli lien d’élevage avec les animaux qui est idéalisé en permanence. »
Élevage paysan et exploitation
A : « Tout à fait. Pour moi, il y a une véritable entreprise d’occultation des rapports de pouvoirs dans ce que propose Jocelyne Porcher. C’est pour ça qu’elle est autant appréciée, qu’elle est autant reprise par certains milieux de gauche ; c’est qu’elle permet de préserver la légitimité du meurtre alimentaire tout en critiquant ce que la gauche critique traditionnellement, à savoir le capitalisme, l’industrialisation, etc.
Pour moi, le paradigme maussien dans le cadre des rapports humains-animaux, il n’explique rien. Il est au service du statu quo, il relaie le sens commun avec des apparats de sophistication. Jocelyne Porcher écrit tout un tas d’articles, de livres où elle va détailler cette théorie du don/contre-don. Ça paraît expliquer des choses, mais encore une fois, il ne faut pas s’y tromper. Pour expliquer la situation des animaux, on ne peut pas laisser de côté le fait qu’ils sont exploités.
V : Justement, en fait Jocelyne Porcher n’ignore pas ce paradigme qui décrit les relations d’élevage comme de l’exploitation. Notamment dans son livre Vivre avec les animaux qui date de 2014, elle adresse finalement une série d’objections anticipant à l’avance l’idée que l’élevage paysan est aussi un rapport d’exploitation.
Peut-être que je peux vous lancer ces objections-là qui viennent de Jocelyne Porcher et vous voyez comment on peut y répondre d’un point de vue matérialiste.
La première objection qu’elle adresse, c’est que la relation d’élevage, dans l’élevage paysan, elle mutuellement bénéfique. Dans son idée, les animaux et les humains travaillent ensemble, les animaux doivent être heureux pour que ce soit vraiment de l’élevage et les éleveurs ont la responsabilité de leur donner une vie bonne dans le cadre d’une relation de soins. »
A : « Oui, alors moi je fais un lien très fort avec le type de rhétorique qu’on trouve dans la publicité pour les produits d’origine animale où bien souvent, on retrouve des représentations de type « suicide food », c’est-à-dire « nourriture suicidaire », où en fait les animaux sont présentés comme consentants à leur exploitation, voire parties prenantes, actifs dans ce processus d’élevage. On peut voir des publicités où c’est la vache qui conduit le camion qui l’emmène à l’abattoir, des cochons qui se découpent eux-mêmes en rondelles de saucisson, ou alors des choses légèrement moins explicites mais qui perpétuent ce mythe de la viande heureuse avec des poulets qui dansent le french cancan, etc. Donc ça, c’est des représentations assez courantes, et d’ailleurs le jury de déontologie publicitaire en mars 2023 a épinglé une publicité KFC qui montrait un poulet, c’était un peu un univers cartoonesque de dessin animé où on voyait un poulet rebondir sur le ventre d’une vache comme si elle était dans un parc d’attractions avec vraiment cette idée que les animaux d’élevage sont bien traités et sont heureux. Et il y a eu une plainte déposée par une association de protection animale au jury de déontologie publicitaire qui a effectivement considéré que c’était de la tromperie aux consommateurs de présenter ces animaux. »
V : « C’est une publicité mensongère en fait, ça a été reconnu comme tel. »
A : « Tout à fait. Et je pense que cette idée que la relation d’élevage est mutuellement bénéfique se rapproche de cette idée de suicide food, de cette idée que les animaux nous donnent leur vie, qu’ils se sacrifient pour nous.
Et c’est ça aussi que fait Porcher, c’est qu’elle inscrit l’institution d’élevage dans le domaine du naturel, du légitime, à travers le thème du consentement, du contrat, du don, de l’affect, de la réciprocité. Ce qui empêche d’envisager l’élevage comme finalement une relation fondée sur l’arnaque.
Moi j’aime beaucoup ce thème de l’arnaque qui a été développé notamment par Paola Tabet, qui est une autre féministe matérialiste qui a beaucoup contribué à la théorisation des rapports hommes-femmes.
Elle a notamment été connue pour un livre qu’elle a écrit qui s’appelle La Grande Arnaque, qui est un livre sur l’échange économico-sexuel entre les hommes et les femmes qui justement prend le contre-pied total des discours sur la complémentarité homme-femme, sur l’amour romantique, sur le couple hétéro, l’harmonie homme-femme, etc. où elle va regarder très concrètement, c’est vraiment de l’approche matérialiste exemplaire, où elle va voir, elle va étudier qu’en fait, dans le cadre des relations hétéro, bien souvent, il y a des logiques d’échanges de type économique par exemple.
Un exemple assez concret qui est très familier pour notre culture occidentale, ça va être le bouquet de fleurs, la bague de fiançailles, ça va être le fait de payer l’addition au restaurant il y a tout un tas de logiques dans lesquelles on est habituées... on justifie ça par l’amour, par la galanterie, etc. alors que derrière, il y a des logiques économico-sexuelles, c’est-à-dire des logiques très matérialistes. »
V : « Et donc de même, l’élevage est une arnaque ? »
A : « Je pense qu’on aurait tout intérêt à voir l’élevage comme une arnaque, plutôt qu’une relation de don contre don, et c’est ce que permet une approche matérialiste, une approche terre-à-terre, une approche qui regarde vraiment les conditions d’existence, les statuts réciproques, le fait qu’il y a des propriétaires, des approprié·es, qui ne va pas se satisfaire de discours issus du sens commun, qui va mettre l’idéologie à distance, qui va prendre l’idéologie pour ce qu’elle est, à savoir un discours de légitimation d’un ordre social.
Ça nous force à voir que le don, il est arraché aux animaux. Il n’y a pas de don. Le don, il est pris de force, enfin, c’est le contraire d’un don.
V : « Oui, Enrique Utria résume ça super bien dans une phrase, il dit « l’animal donne ce qu’il est impuissant à refuser ».
A : « Voilà, c’est super bien dit, effectivement. »
V : « Une deuxième objection qu’elle adresse, ou une idée qu’elle met en avant, c’est l’idée que, puisque les éleveurs, éleveuses, pour la plupart, mais celles et ceux avec qui elle a parlé, aiment leurs animaux, ont vraiment une relation affective avec eux, et bah du coup ça ne peut pas être de l’exploitation. »
A : « Oui, mais ça, pour moi, ça relève d’une naïveté confondante, parce que on sait très bien qu’il peut y avoir une coexistence entre de l’amour et des rapports d’exploitation, c’est d’une banalité totale. Les féministes l’ont bien montré. Il peut y avoir une coexistence dans des rapports homme-femme, entre des sentiments amoureux, et pour autant une structure d’exploitation et d’inégalité. »
V : « Une autre chose, mais je pense que vous me donneriez la même réponse, c’est que les éleveurs, éleveuses, n’ont pas l’intention de faire du mal à leurs animaux, et même c’est une des choses que Jocelyne Porcher a plutôt bien analysé elle parle de contagion de la souffrance, c’est-à-dire cette idée que quand les animaux souffrent, alors on pourrait dire souffrent particulièrement peut-être, ou quand les conditions économiques d’élevage ne permettent pas de leur donner réellement une vie bonne, ou d’éviter les pires maltraitances, du coup il y a une souffrance infligée, entraînée, impliquée chez les éleveurs, éleveuses aussi. Il y a une forme de contagion de la souffrance des autres animaux vers les humains, et elle parle aussi de souffrance morale chez les éleveurs, éleveuses. Avec cette idée quand même que comme les éleveurs, éleveuses ne sont pas indifférentes au sort des animaux, ça montre bien que ce n’est pas de l’exploitation. »
A : « Encore une fois, moi je pense que ça peut être un des apports des études de Porcher, de montrer les affects, les émotions, les sentiments des éleveurs vis-à-vis de la souffrance de leurs animaux, notamment le rapport ambigu à la mise à mort des animaux, ça je pense que c’est tout à fait réel et important de le souligner. »
V : « Oui, le fait que beaucoup d’éleveurs ont beaucoup de mal, c’est vraiment très difficile, qui revient régulièrement de devoir emmener ou laisser partir leurs animaux dans les abattoirs. »
A : « Oui ça, tout à fait. Pour autant, c’est pas parce que les éleveurs souffrent de la souffrance de leurs animaux qu’il n’y a pas exploitation. Encore une fois, il faut distinguer le niveau individuel où il peut y avoir des sentiments contradictoires, il peut y avoir une couche d’interprétation, un récit que les gens se font de leurs pratiques versus une exploitation sociale sociologique, macro, qui donne du sens aux structures sociales. Et c’est deux niveaux d’analyse importants, mais deux niveaux différents. Et en tant que sociologue, Jocelyne Porcher devrait savoir que le discours que les acteurs se font de leurs pratiques peut être différent de ce que la sociologie peut révéler de leurs pratiques. »
V : « Il ne doit pas être pris pour argent comptant en fait, comme constituant l’analyse des relations sociales qui sont décrites par les sociologues. »
A : « Mais ça c’est un problème dans les analyses de Jocelyne Porcher, c’est qu’elle prend pour argent comptant le discours des éleveurs au sujet de leurs animaux. Elle donne une prévalence totale au discours des éleveurs, ça floue une partie de l’explication qu’on pourrait faire de ce que c’est que l’élevage. C’est un parti pris qui permet d’expliquer certaines choses encore une fois, mais qui recouvre, qui met un voile sur tout ce qu’on pourrait aussi expliquer au sujet de l’élevage et qui paraît quand même crucial : le fait que c’est une institution spéciste qui se fait au détriment des intérêts des animaux. »
V : « Oui, en fait, quand elle décrit les affects de cette relation-là, elle les décrit toujours par le prisme des éleveurs-éleveuses. Elle décrit l’affectivité mais du côté humain et très peu ce que vivent concrètement les animaux. Quatrième et dernière objection, une de ses idées, c’est que l’élevage c’est la seule façon, selon elle, de maintenir des relations avec les animaux, de maintenir ce lien enrichissant millénaire qui nourrit les animaux. »
A : « Oui, c’est reprendre cette idée maussienne que le don permet le lien. Le don/contre-don est ce qui permet de faire perdurer une logique de réciprocité, en fait. C’est ce qui permet le contact, le lien... »
V : « ...et à l’inverse, il y a l’idée que les antispécistes, nous, on voudrait abolir toute forme de relation avec les animaux et que sous prétexte de libérer les animaux, en fait, notre projet c’est d’empêcher, in fine, de continuer à vivre avec les animaux, d’avoir des relations avec eux. »
A : « Oui, le fait de refuser ce don prétendument fait par les animaux d’élevage, ça serait rompre tout lien avec les animaux d’élevage, ça serait souhaiter la disparition des animaux d’élevage, c’est ce que dit Porcher, les antispécistes n’aiment pas les animaux, les antispécistes veulent la disparition des animaux.
Sauf que, et c’est fou de devoir le rappeler, mais la fin de l’élevage ne veut pas dire la fin de toute relation avec les animaux. On peut imaginer d’autres formes de relations avec les animaux d’élevage qui passent pas par la mise à mort, encore une fois, les animaux issus de la domestication, on peut les voir comme des amis, on peut les voir comme des voisins, des membres de la communauté, des membres de la famille, mais même, on peut imaginer des formes de travail avec les animaux... Il y a tout un champ en éthique animale sur le travail animal, comment garantir un épanouissement des animaux par le travail qui serait pour autant préservé des logiques de domination et d’exploitation. »
V : « Par un statut particulier en tant que travailleur ou travailleuse pour les animaux, avec des droits associés, avec un droit à la retraite et non à la mort dès qu’on est plus productif... ça vient avec un ensemble de conditions qui rendent possible le fait que c’est effectivement une relation de travail et pas juste le fait de le déclarer comme le fait Porcher. »
A : « Voilà, ça nécessite des garanties, ça nécessite des garde-fous, tout comme dans le cadre du travail humain il y a tout un tas de choses qui sont mises en place pour garantir le droit du travail, il faudrait imaginer ces choses-là adaptées à la situation des animaux issus de la domestication.
Mais ce que je voudrais souligner, c’est que c’est presque étonnant de la part de Jocelyne Porcher, c’est presque insultant pour les animaux d’élevage, de la part de Porcher, de penser que, hors de l’élevage, point de salut pour les animaux d’élevage. C’est réducteur, c’est misérabiliste de penser que les animaux d’élevage n’ont d’avenir que dans l’élevage, c’est un peu horrible de postuler ça, et on a un devoir de réparation morale à l’égard des animaux issus de la domestication. Et vouloir la fin de l’élevage, c’est peut-être vouloir renouveler notre rapport aux autres animaux sur d’autres bases que l’exploitation.
C’est une vision qui s’oppose à un projet extinctionniste des animaux d’élevage, on a une petite fraction du milieu antispéciste qui défend l’idée que les animaux issus de la domestication sont intrinsèquement des êtres diminués, des êtres dociles qui ont été sélectionnés génétiquement pour justement servir les intérêts et les usages des humains et qu’ils sont un peu foutus d’une certaine façon.
Ils sont totalement dépendants et soumis au bon vouloir, au pouvoir arbitraire exorbitant des humains qui les ont domestiqués. Je trouve la position intéressante, en tout cas elle nous met en garde sur le fait qu’effectivement on a sélectionné les animaux sur des millénaires pour répondre à des besoins utilitaires qui nous servent à nous., donc il faut être vigilant sur les traits comportementaux qui ont été sélectionnés, le fait que les animaux peuvent ou pas se défendre, exprimer leurs besoins, leurs préférences authentiques, etc.
Par contre, je pense que sur les questions de dépendance, le fait que les animaux d’élevage sont dépendants, pour moi ce n’est pas un problème fondamental au fait qu’on puisse cohabiter ou non avec eux. On est tous plus ou moins dépendant·es, on est tous plus ou moins vulnérables et ça ne nous empêche pas de co-créer des sociétés où les normes de justice et de réciprocité sont respectées. La position extinctionniste est critiquée par Jocelyne Porcher qui dit que les antispécistes ne veulent plus vivre avec les animaux, c’est un projet d’appauvrissement des liens sociaux, un projet un peu caricatural de citadins qui n’ont jamais vu une vache, un cochon et qui s’imaginent que c’est souhaitable de vivre dans des milieux totalement humano-centrés.
Mais en fait, il y a beaucoup d’antispécistes, et je pense ici notamment au livre Zoopolis, qui est sorti en 2011 et qui a été écrit par Sue Donaldson et Will Kymlicka, que les antispécistes ne s’inscrivent pas tous dans un projet extinctionniste, loin de là, et qu’on peut critiquer l’exploitation des animaux, les rapports injustes qu’on entretient avec eux, sans pour autant penser qu’on ne peut pas mettre en place d’autres types de rapports envers eux qui seraient fondés sur des normes de justice. Et donc Zoopolis propose des pistes comme ça de coexistence avec les animaux dans une société post-exploitation animale où les animaux ne seraient plus des biens, ne seraient plus des commodités, des objets, des marchandises qu’on utilise, mais ça serait des membres de notre famille, ça serait des concitoyens, ça serait des amis, ça serait des voisins, ça serait des membres de sociétés différentes des nôtres avec qui on ne collabore, on ne cohabite pas comme des animaux sauvages.
Mais ça ne veut pas dire arrêter de vivre avec eux. Alors après, c’est sûr que la fin de l’élevage, ça implique une réduction du nombre des animaux élevés, ça veut dire peut-être aussi la disparition de races spécifiques d’animaux d’élevage, parce que l’élevage, ce n’est pas seulement élever, tuer des animaux pour en tirer un profit économique, c’est sûr qu’il y a aussi tout un travail de sélection génétique, un travail culturel, patrimonial, un rapport au territoire. Quand on s’intéresse à ce qu’est l’élevage très concrètement, sociologiquement, etc., c’est sûr que mettre fin à l’élevage, ce n’est pas seulement réduire le nombre d’animaux, c’est aussi mettre fin à tout un univers, un monde, donc ça pose des questions intéressantes. »
Un discours de gauche ?
V : « J’aimerais qu’on adresse une question qui me semble vraiment importante. Pour beaucoup de personnes, le discours et les idées de Jocelyne Porcher sont de gauche, parce que c’est un discours qui s’affirme anticapitaliste, et dans la défense du monde paysan, et Jocelyne Porcher dit même dans une des envolées lyriques de son livre, vers la toute fin de son livre Vivre avec les animaux, que son projet de vie avec les animaux, son utopie, c’est une utopie communiste, socialiste, anarchiste et écologiste. Elle parle même d’une révolution. Donc en fait, elle inscrit son projet sous tout un tas de marqueurs d’une pensée ancrée à gauche. »
A : « Il y avait une formule comme ça que j’avais lue qui disait : « pour les animaux, tous les humains sont de droite ». C’était peut-être mieux formulé, mais j’avais beaucoup aimé cette formule. Effectivement, Porcher est de gauche, pas de doute là-dessus, mais c’est comme beaucoup de mouvements progressistes de gauche qui finalement sont humanistes, et qui laissent totalement de côté la question du spécisme.
Dans sa façon de défendre la mise à mort des animaux et de préserver l’élevage à tout prix, sur la question des animaux, elle est de droite. Enfin, je veux dire, si on doit reprendre ces terminologies-là, elle a un rapport conservateur vis-à-vis de nos rapports aux animaux. Il ne suffit pas de critiquer le complexe animalo-industriel pour avoir un projet de gauche sur la question animale. »
V : « Ce qu’elle dit aussi, c’est que à l’inverse, ceux qu’elle appelle les libérateurs des animaux, les antispécistes, ne sont pas de gauche parce qu’ils sont secrètement, enfin ils défendent un projet capitaliste, selon elle.
Par exemple, en défendant pour certains la viande de culture, ou en cherchant à soutenir les substituts, y compris quand ça vient de grandes entreprises, les substituts végétaux. Enfin, voilà, dans sa tête, en fait, elle renvoie les antispécistes à une défense du capitalisme, alors que elle se place en critique réelle et authentique des méfaits du capitalisme. »
A : « Oui, alors le fait de renvoyer toujours la position des antispécistes à est-ce qu’ils sont pro ou anticapitalistes, est-ce qu’ils sont des idiots utiles du capitalisme, est-ce qu’ils sont de gauche, de droite, sur ces questions-là, pour moi, ça montre bien à quel point on a besoin d’un mouvement antispéciste autonome.
C’est-à-dire qu’on soit capable de formuler une critique sociale et d’avoir un mouvement social qui porte des revendications et qui est reconnu comme tel, distinctes des autres mouvements sociaux et particulièrement des revendications anticapitalistes et des revendications écologistes, qui sont les deux principaux mouvements auxquels le milieu animaliste est subsumé, est toujours renvoyé. Parce que l’enjeu c’est de faire comprendre que du point de vue antispéciste, il n’y a pas de saut qualitatif entre l’élevage paysan et les productions animales.
Du point de vue des animaux, c’est-à-dire du point de vue de la cause antispéciste, parce que c’est ça l’identité du milieu antispéciste, c’est ça son but, c’est ça sa raison d’être, c’est ça son projet politique, c’est de représenter le point de vue des animaux. Parce qu’aucun autre mouvement social ne le fait. Bah du point de vue des animaux, un autre élevage est impossible.
La distinction entre élevage paysan et élevage industriel ne sert pas les intérêts des animaux. Jocelyne Porcher critique le capitalisme, mais elle le fait d’un point de vue spéciste. Parce qu’elle reconnaît pas la validité ou parce qu’il n’y a pas un rapport de force suffisant de la part du mouvement antispéciste pour se faire reconnaître comme un mouvement autonome qu’il faut prendre en compte dans les analyses croisées des rapports de domination, pour qu’on puisse formuler une critique à la fois anticapitaliste, mais respectueuse des revendications antispécistes. Une analyse qui serait à la fois anticapitaliste et antispéciste.
Aujourd’hui on en est pas là, donc Porcher elle incarne très bien la situation de la gauche de façon générale qui est une position quand même fortement anticapitaliste, mais totalement naïve sur les questions d’antispécisme.
À l’inverse, on a le mouvement antispéciste qui porte des revendications propres sur les questions de rapports humains animaux, de critique de l’élevage, qui pour la plupart sont également imprégnées des analyses anticapitalistes, et qui voient bien les raisons de critiquer l’industrialisation de l’élevage, les conditions de travail dans le système animal ou industriel ; mais c’est vrai que l’intersectionnalité, la compréhension croisée de tous les rapports de domination n’est pas parfaite chez les antispécistes, et on a des antispécistes qui s’intéressent peu aux questions d’anticapitalisme, qui ne les connaissent pas, et qui du coup ont une vision un peu monolutte de « tout ce qui est bon à prendre pour faire avancer la cause animale », que ça soit même le recours à des acteurs du système animal ou industriel pour développer des protéines alternatives, etc. soutiennent ça de façon non critique. Donc des deux côtés, il peut y avoir des analyses partielles. Donc les deux camps se renvoient un peu la balle de « Ah, t’es antispé, mais t’es pro-capitaliste. Ah, mais tu défends l’élevage paysan, mais t’es spéciste. » Donc voilà, des deux côtés, il y a un travail à faire, mais je pense que les analyses croisées ne peuvent se faire que s’il y a une reconnaissance de l’autonomie des axes de lutte. Et à l’heure actuelle, les analyses de Jocelyne Porcher sont totalement défaillantes du point de vue de la question du spécisme. Elle reprend le sens commun sur le sujet des rapports humains-animaux.
Donc elle a une critique capitaliste, mais qui continue de reposer sur une vision idéologique des rapports humains-animaux. »
V : « Il y a quand même cette idée que le projet antispéciste, s’il aboutit, sera un projet néfaste pour des personnes qui sont opprimées par d’autres systèmes, et notamment le système capitaliste, les petits éleveurs. C’est vrai que Jocelyne Porcher défend un projet de gauche, mais du point de vue des petits éleveurs.
Du point de vue des humains impliqués dans cette institution-là, mais jamais du point de vue des animaux.
Mais c’est une autre chose qu’elle nous oppose aux antispécistes ; elle dit que les antispécistes sont contre les petits éleveurs. Alors que à gauche, c’est maintenant relativement majoritaire d’être dans une défense des petits élevages, du monde paysan, de réintégrer une revalorisation du monde rural. Et donc, je vais vous poser la question très directement ; est-ce que les antispécistes sont contre les petites éleveuses et éleveurs ? »
A : « Alors, déjà, je voudrais rappeler qu’on n’est pas contre des individus en particulier. Je pense que c’est important de le rappeler que il ne s’agit pas de dire que les éleveurs sont des gens mauvais, des gens méchants, etc. bien sûr que non. C’est une analyse d’un système de rapports sociaux qui sont incarnés par des gens, mais qui ne sont pas directement produits par les gens en question. Donc, il y a ça. Et puis, est-ce que les éleveurs paysans sont les ennemis des antispécistes ? Oui et non, en fait. Parce que si on regarde du point de vue des animaux, encore une fois, l’ennemi principal des animaux, c’est le spécisme, c’est la classe humaine en tant que suprémacisme humain. Et dans ce cadre-là, oui, les éleveurs en tant qu’humains qui élèvent des animaux font partie de la classe qui opprime les animaux. Mais ensuite, si on regarde plus finement, plus sociologiquement, si on s’intéresse aux critiques, par exemple, je pense à un livre que j’ai lu récemment de Nicolas Legendre, qui a enquêté pendant sept ans sur le système agro-industriel breton.
Ce n’est pas du tout un ouvrage animaliste, antispéciste. D’ailleurs, il ne fait à aucun moment mention de la souffrance animale. Mais c’est très éclairant aussi pour la lutte antispéciste, parce qu’on voit à quel point les éleveurs sont contraints dans leur travail à ne pas prendre en compte les intérêts des animaux, donc il y a un ennemi commun aux éleveurs paysans et aux antispécistes, qui est le système agro-industriel. Il y a tout un réseau d’intérêts… »
V : « … les lobbys, les coopératives, les grands groupes. »
A : « Tout à fait. Donc ça vaut le coup de cumuler plusieurs points de vue pour avoir une analyse la plus précise possible. On peut faire des alliances, je pense, avec les éleveurs paysans dans certaines circonstances, des alliances politiques pour des buts communs, et j’aimerais que ça se développe plus, des alliances entre les luttes paysannes, écolo, animalistes, et on commence à en voir émerger. Je pense notamment au projet d’élevage terrestre de saumons en Gironde par l’entreprise Pure Salmon. Il y a une association qui s’est constituée, qui a été créée par 7 femmes, à la fois écologistes et antispécistes, l’association Eaux Secours Agissons. Je trouve que c’est un exemple de coalition possible pour s’attaquer à un ennemi commun, même si par ailleurs on n’a pas la même analyse des rapports humains-animaux. »
Le néocarnisme
V : « Et peut-être un élément d’analyse supplémentaire du fait que le discours spéciste de Jocelyne Porcher se dissimule derrière une image de gauche parce que anticapitaliste, c’est qu’en fait le discours de Jocelyne Porcher est une des versions du néo-carnisme contemporain. Est-ce que peut-être vous pouvez expliquer ce qu’est le néo-carnisme, et en quoi Jocelyne Porcher et son discours s’intègrent extrêmement bien là-dedans, et en est une des versions actuelles en fait ? »
A : « Pour comprendre ce qu’est le néocarnisme, il faut d’abord rappeler ce qu’est le carnisme, concept proposé par Melanie Joy, qui est chercheuse ou professeure en psychologie sociale, et qui définit le carnisme comme une idéologie invisible mais répandue dans la société spéciste qui est la nôtre, qui postule l’idée que manger certains animaux et pas d’autres, c’est quelque chose de normal, de naturel, de nécessaire. C’est un peu les trois N.
Voilà, et elle en a ajouté un quatrième un peu plus tard, le nice, c’est agréable, c’est convivial, c’est délicieux de manger des animaux. Donc c’est un tas de croyances, de discours qui est véhiculé notamment par la publicité ou dans le sens commun, c’est un ensemble de croyances qui est immédiatement disponible et partagé pour pouvoir justifier ces pratiques de consommation de produits d’origine animale. Et en fait, comme de plus en plus la production de viande des produits d’origine animale et la consommation de ces produits est contestée pour des raisons sanitaires, environnementales, mais aussi pour des raisons d’éthique animale, il y a tous les acteurs qui défendent l’exploitation animale qui vont réagir en essayant de relégitimer la consommation de viande qui ne va plus de soi à cause de toutes les critiques.
Donc le néocarnisme, c’est vraiment le carnisme qui se réinvente pour s’adapter aux nouvelles attaques qui sont faites vis-à-vis de l’élevage. Donc le néocarnisme met beaucoup plus l’accent sur l’origine des produits, sur le fait que c’est de la viande française, sur le fait que c’est bon pour la santé, qu’on va beaucoup inciter sur les labels, tout ce qui est étiquetage bien-être animal, c’est pour rassurer en fait, c’est pour éteindre le feu de la critique, des inquiétudes, le fait que ça ne va plus de soi, il y a de plus en plus de flexitariens, les gens commencent à se sentir coupables de manger de la viande. Donc il faut trouver de nouvelles stratégies pour rassurer les consommateurs… »
V : « ...Donner bonne conscience. »
A : « Voilà, exactement : donner bonne conscience. Donc c’est ça le néocarnisme, c’est relégitimer ce qui n’allait plus de soi. »
V : « Et le discours de Porcher s’inscrit extrêmement bien dans ce contexte de développement de nouveaux discours de relégitimation finalement de la domination sur les autres animaux. Mais notamment, en fait, c’est là qu’on voit que ce dont il est question dans l’épisode c’est pas Jocelyne Porcher en tant qu’individu, c’est en tant que ses idées et ses discours sont en accord et correspondent finalement à des idées plus générales, le néocarnisme, qui circule dans la société et qu’on retrouve partout. Enfin, il n’y a pas que dans le discours de Jocelyne Porcher qu’on retrouve ce mythe de la viande heureuse, par exemple. »
A : « Oui, et c’est assez perturbant de voir qu’on retrouve le même type de discours entre ce que propose Porcher et tous les discours néocarnistes qu’on trouve dans la publicité faite par l’industrie agroalimentaire. En fait, voilà, la publicité nous montre des poules qui dansent le french cancan et Jocelyne Porcher nous sert la théorie du don/contre-don pour expliquer ce que font les animaux dans le cadre de l’élevage. »
V : « Ça sert la même fonction, en fait. Et c’est d’ailleurs pour ça que Jocelyne Porcher est invitée partout, et y compris sur des tables rondes, dans des événements écologistes, sur l’alimentation. En fait, elle va servir de caution en apportant son discours en tant que chercheuse à l’INRAE, pour continuer à faire que rien ne change ou maintenir l’élevage tout en réduisant l’élevage industriel. »
A : « Oui, finalement, c’est là qu’on voit qu’on peut pas se passer d’une analyse antispéciste sur la question de l’élevage, parce que la différence que Porcher essaye de maintenir à tout prix entre élevage et production animale, elle tient pas longtemps. C’est une différence de façade, parce qu’il y a le recours aux mêmes tactiques idéologiques entre Porcher et les acteurs du complexe animalo-industriel pour préserver cette idée que c’est normal, que c’est naturel, que c’est nécessaire d’utiliser des animaux à des fins de meurtres alimentaires. »
V : « Merci beaucoup, Axelle Playoust-Braure. Merci. »
En Bref
On peut retenir que Jocelyne Porcher cherche à tout prix à distinguer les productions animales, l’élevage intensif d’un côté, de l’élevage paysan de l’autre, pour mieux défendre ce dernier. Qu’elle présente la relation d’élevage comme une relation de don/contre-don, pour mieux nier le rapport d’exploitation et de domination quasi totale sur les autres animaux, et que son discours est représentatif du néocarnisme contemporain qui se dissimule derrière un discours de gauche anticapitaliste.
[1] agentivité : En sciences sociales et en philosophie, l’agentivité, adaptation de l’anglais « agency », est la faculté d’action d’un être, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou les influencer.
Aussi en version audio sur Youtube. Diffusé le 31 octobre 2023 sur poissonpodcast.fr.
ce texte est aussi consultable en :
- MP3 par téléchargement, en cliquant ici (42.3 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.5 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.5 Mio)