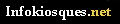Brochures
Dans les rouages de la ville-machine
Enquête sur la « Smart City » lyonnaise
mis en ligne le 20 mai 2024 - Les décablés
Avant-propos
« Le projet Lyon Smart Community est un projet ambitieux que nous sommes fiers de voir émerger sur le territoire de l’agglomération. Ce démonstrateur à l’échelle d’un quartier tout entier, celui de La Confluence, nous projette d’ores et déjà dans cette ville du futur que nous voulons construire ! Une ville intelligente qui associe croissance économique tout en réduisant l’impact des activités sur l’environnement… ».
Gérard Collomb
Ancien Sénateur-Maire de Lyon, et Ancien Président du Grand Lyon
« On ne parlera probablement plus de smart city. On l’aura intégré ».
David Kimelfeld
Ancien Président du Grand Lyon

Le terme de « Smart City » n’a pas eu le temps d’être questionné que sa réalité s’est imposée, à nous qui vivons aujourd’hui dans une ville en pleine « mutation ». Car en effet, que signifie cet anglicisme qui nous sonne si faussement familier, à nous de plus en plus cerné.e.s de smart-bidules (à commencer par les smartphones) ? Élégant, intelligent, habile, ou futé… Peut-être un peu tout cela à la fois, comme une manière de masquer par le flou ce qu’il se passe vraiment ! A Lyon peut-être plus qu’ailleurs, nous est promis de vivre dans la ville de demain, à la pointe de l’innovation qui la rendra plus agréable. En attestent les nombreuses distinctions glanées [1] par la métropole dans les classements qui confrontent les « Smart Cities » du monde entier, et dont se félicitent les élu.e.s locaux pour lesquel.le.s la smartification est le fer de lance d’un « territoire » en pleine conquête des premières places dans le juteux marché de « l’attraction territoriale ». Mais ne nous y trompons pas. Si la ville de Lyon joue la bonne élève lors des congrès « Smart Cities », si elle se plaît à apparaître à la première place des villes innovantes françaises, c’est que cette labellisation est un gage, pour les investisseur.se.s, de la pénétration chez la classe politique locale de l’impératif selon lequel aux maux d’aujourd’hui il faut apporter une réponse technologique, et qu’alors, Lyon est une ville à laquelle on peut tout vendre, où l’on peut tout tester, sur laquelle on peut compter pour trouver tout le soutien nécessaire à l’innovation… Bref, un bon « partenaire ».
Bien évidemment, il va falloir justifier les investissements consentis, et pour cela, une stratégie a fait ses preuves : s’appuyer sur les discours de la terreur, celui de la crise écologique, celui de l’insécurité, et enfin celui du risque sanitaire. La ville intelligente est en cela une ville « résiliente » dans laquelle sont « coconstruits » l’ « apaisement » et le « bien-être » au sein d’ « éco-quartiers » où l’on se connecte et l’on partage (des locaux, des voitures, des avis). En deux mots : la vie y est facile et meilleure.
Misère des mots quant ils ne renvoient plus à rien de réel, pire, lorsqu’ils masquent la réalité de ce qui se passe derrière les discours qui s’en vêtissent. C’est bien à travers le langage que les idées ont pris demeure dans nos vies et dans nos villes, et avant toutes les autres, l’idée que l’avenir est technologique, que la technologie est numérique, que le numérique est immatériel et donc libre… que la « Smart City » est en somme la ville de toutes les libertés ! Mieux, qu’elle est la ville de la libération.
Le discours smartificateur des médias, technicien.ne.s, entreprises et politiques cherche à apparaître comme étant de l’ordre du sens commun, du pragmatisme, de l’évidence. Pourtant, ces évidences n’en sont pas, et c’est ce que nous a révélé notre enquête, notre plongée dans les méandres des rapports des apôtres de la « Smart City ». C’est pourquoi nous avons choisi de construire ce texte à partir des 6 principaux préceptes qui structurent l’imaginaire smartien : La ville agile, La ville facile, La ville durable, La ville terrain d’expérimentation, La ville sûre, La ville participative.
Le label « Smart City », que l’on pourrait traduire par « ville intelligente », désigne un système où l’intelligence, étymologiquement le pouvoir de discernement, de décision et d’action, est captée par la machine de sorte que notre assujettissement à sa logique calculante est notre incrustation dans ce que nous appellerons désormais la ville-machine. Nous tentons alors dans cette brochure de mettre en lumière la réalité de cette ville-machine occultée par un discours, un imaginaire, une invasion des dispositifs numériques. De penser sa provenance dans le mode de gouvernementalité propre à la modernité occidentale, la cybernétique, et de montrer en quoi cette reconfiguration de la ville contribue à l’accomplissement de la cybernétique dans la réduction de la vie humaine à un fonctionnement. De rendre palpable l’unité de toutes ces transformations que subissent nos villes, nos jobs, nos vies... De lire entre les lignes et révéler ce qui se joue derrière les sermons et prophétismes envoûtants des « décideur.se.s », et d’en dénoncer le caractère inhumain et autoritaire. Nous restituons ici un travail amorcé en 2018 sur les formes que prend la ville-machine à Lyon, enquête réalisée à partir de documents de la métropole, rapports, revues d’ingénieur.e.s, articles, lectures diverses, débats et conférences mais aussi d’un sens commun revendiqué, de l’échange autour de nos ressentis provenant de nos vies citadines.
Genèse de la « Smart City », naissance de la ville-machine
Qu’est-ce que la « Smart City » ?
L’idée d’une « Smart City », traduite par « ville intelligente », serait née d’un défi lancé en 2005 par Bill Clinton à John Chambers, président de l’entreprise américaine Cisco (fournisseur leader d’infrastructures réseau à l’échelle mondiale), le premier ayant proposé au second de se servir de ses technologies informatiques pour rendre les villes plus « durables » (et « smart »). L’entreprise ne tarda pas à amorcer une recherche sur le sujet, qu’IBM s’empressa de rejoindre, flairant ce qui allait devenir un des plus gros marchés des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication). Ce n’est que quelques années plus tard que le concept de « Smart City » sera réellement popularisé, alors qu’IBM déposera officiellement la marque « Smarter Cities ». Bien qu’il soit difficile de définir précisément ce qu’est la « Smart City », nous comprenons que c’est une ville pensée à travers la logique du numérique et de l’informatique, qui repose principalement sur la captation et l’analyse de données (le Big Data) grâce au Très Haut Débit et à la 5G (qui permet une augmentation considérable des débits, soit des capacités accrues de transmission sans fil et une plus grande connectivité des objets). C’est une ville qui tend à s’équiper d’un arsenal de dispositifs formant un « écosystème d’objets » en constante interactivité. Les êtres vivants réifiés tout comme les non-vivants sont inclus dans ce réseau comme ses composants, et se trouvent alors gérés, administrés, à travers leur numérisation.
IBM et le projet de la « Smart Planet »
IBM (International Business Machines Corporation) est une multinationale états-unienne pionnière des nanotechnologies, présente dans les domaines du matériel, du logiciel et des services informatiques. Depuis 2008, la firme fait campagne « pour une planète plus intelligente ». Voyez par vous-même le niveau de mégalomanie atteint par les idéologues d’IBM :
« Tout d’abord, le monde est de plus en plus équipé. Les capteurs intégrés sont partout – voitures, appareils photo, routes, pipelines... jusqu’aux produits pharmaceutiques et au bétail. Imaginez un monde dans lequel il y aurait un milliard de transistors par être humain ! Par ailleurs, le monde est de plus en plus interconnecté. Avec bientôt deux milliards d’internautes, les systèmes et les objets peuvent aussi communiquer les uns avec les autres. (...) Enfin, tous ces équipements interconnectés deviennent intelligents : reliés à de puissants systèmes et à des outils d’analyse perfectionnés, ils sont capables de transformer en temps réel ces innombrables données en connaissances utiles. La puissance de calcul dépasse le champ d’application des seuls ordinateurs. Aujourd’hui, presque tout – personne, objet, processus ou service, quels que soient le type ou la taille de l’organisation – peut devenir digital, connecté et "intelligent". Avec une telle abondance de technologie et de connectivité, pour un coût peu élevé, pourquoi ne pas tout optimiser ? Pourquoi ne pas tout connecter ? Pourquoi ne pas tout analyser pour en retirer des connaissances [2] ? ».
La prose d’IBM suffit à rendre manifeste la volonté de puissance totalitaire à l’œuvre dans l’affirmation du désir forcené de tout recenser et compter pour tout optimiser. Pour le dire avec les mots de Pièces et Main d’Oeuvre : « La "planète intelligente" d’IBM est un immense réseau informatique dont chaque chose en ce monde – humains, animaux, milieux naturels, décors urbains, objets, infrastructures, services – est un composant. Un rouage de la machine, interconnecté avec tous les autres. Une fourmi dans la fourmilière [3] ».
Business is business pourrait être la devise d’IBM, c’est-à-dire fabriquer et mettre sur le marché tout ce qui est techniquement possible, en dehors de toute considération éthique. Preuve en est, si l’on s’intéresse un peu à son histoire, qu’IBM a rendu possible, grâce à ses machines à cartes perforées Hollerith D-11, le recensement nécessaire à l’identification des juifs et le contrôle de l’ « efficacité » du génocide nazi [4].
Mais si c’est IBM qui, avec d’autres, s’est emparé du projet de numérisation des villes, on doit reconnaître que l’entreprise ne fait que participer à un processus plus vieux qu’elle : celui qu’après la seconde guerre mondiale l’on a nommé la cybernétique, mais que l’on peut faire remonter à l’avènement de l’État moderne.
Le paradigme cybernéticien, vers la machine à gouverner
La cybernétique est le nom par lequel Norbert Wiener caractérise, après la seconde
guerre mondiale, le paradigme de vérité qui régit les sciences. Ce paradigme de vérité est celui de l’automation ou de l’automatisation des procédés scientifiques dans le but de mettre en place des systèmes autonomes capables d’apprentissage par la rétroaction. Pour le dire simplement, Wiener remarque que la recherche scientifique est portée vers l’objectif de produire des machines dont le fonctionnement devient autonome afin de pallier aux erreurs, aux défaillances ou aux impossibilités de notre condition humaine limitée. C’est ce qu’il a lui-même cherché à élaborer durant la guerre : une machine capable non seulement d’anticiper les trajectoires des avions de chasse ennemis à partir d’une analyse du comportement du pilote pourchassé, mais aussi d’intégrer les erreurs de visée et de les corriger jusqu’à ce que la cible soit atteinte. Il s’agit donc d’imaginer un système capable de s’autoréguler et de s’autocorriger – où nulle frontière ne subsisterait vraiment entre le pilote et la machine, tous deux étant désormais hybridés. Bientôt, cette science de l’automation, définie comme un « art d’assurer l’efficacité de l’action [5] » sort des laboratoires de guerre pour devenir un véritable mode de pensée, et enthousiasme nombre de scientifiques qui projettent alors d’en faire un modèle de gestion de la société. C’est ce deuxième aspect qui frappe Wiener et lui suggère le nom de cybernétique, du grec kubernêtikê, de kubernân, qu’on traduit par gouverner et qui désignait le pilotage d’un navire.
La vision cybernétique du monde se fonde sur une analogie entre le cerveau et l’ordinateur, ou encore entre les systèmes automatiques et les institutions humaines. L’humain y est décrit comme une machine constituée de circuits, de nerfs, assimilant des informations et traitant des données ; la société, quant à elle, y est semblable à un système qui tend naturellement à la désorganisation. Il s’agit là d’un glissement à partir du second principe de la thermodynamique dont le point d’appui est la notion d’information. Et en effet, nous pourrions définir l’information comme l’abstraction objective de ce qui se partage au sein de la communauté, d’un ensemble de savoirs communs et de ce qui communise la communauté, la met en ordre à travers son échange, son partage, sa transmission, sa négation, etc, et produit donc de l’organisation. Or, pour suivre le pas d’un monde où le temps s’est accéléré et l’espace s’est agrandi, où tout va toujours plus vite et où les frontières sont abolies, il faudrait, pour les théoricien.ne.s de la société efficace, développer des systèmes d’échange de l’information plus rapides, plus directs – ce que permet le langage machinique (code binaire fait de 0/1) issu des systèmes de codage de l’information. Il s’agirait alors de rendre chaque élément du système global « communicant » pour qu’il produise et échange de l’information, de l’organiser en réseau afin qu’il transmette cette information plus loin et plus vite. Cela demanderait de faire fusionner systèmes biologiques, mécaniques, électroniques - tous plus ou moins réductibles à des supports d’information – et de les mettre en réseau pour qu’ils s’autorégulent, prennent des décisions selon les données récoltées, « fonctionnent », en somme. Un ordre suprême émergerait alors du chaos de nos existences désordonnées abandonnées à elles-mêmes.
La « Smart City » réalise ce projet : la ville est désormais pensée comme un organisme complexe composé de dispositifs machiniques et vivants hybridés, aux comportements programmés. Le pilotage, nécessaire à la ville-machine pour huiler ses mécanismes, fluidifier ses flux, et anticiper tout risque de frottement, est réalisé par le puçage de tous ses éléments en vue de leur interconnexion et de leur gestion par la « main invisible » de l’Intelligence Artificielle.
Ce n’est pas une construction théorique après coup que de pointer la manière dont l’État, à travers le déploiement de l’informatique, gouverne nos existences. L’État est le lieu du pouvoir de la représentation (les élus) sur le représenté (censé.e être chacun.e d’entre nous), et il s’appuie sur la statistique (dont l’étymologie est commune avec État) c’est-à-dire sur la réduction des personnes à des nombres afin de les gouverner, voire de les programmer (comme à l’école, où règne le nombre sous la forme de la note, de la moyenne, du coefficient, du classement, du programme, etc.). Tout cela pour dire que la cybernétique n’est pas un programme de gouvernement mais qu’elle est le mode de gouvernementalité propre à la modernité occidentale. L’objectif étant de « suppléer aux faiblesses humaines en créant une machine capable de contrôler, de prévoir et de gouverner [6] », machinerie à laquelle l’État tend à déléguer ses pouvoirs pour au final n’être réduit qu’à sa fonction policière. Avec le déploiement de la cybernétique, s’accentue la logique de contrôle technocratique qui soutient aujourd’hui plus que jamais des tendances autoritaires à l’encontre des populations. L’informatique vient parachever ce mode de gouvernement en déployant la puissance de commandement conquise par la logique du calcul. Nous entrons dans l’ère de la « machine à gouverner », du gouvernement algorithmique, du remplacement du gouvernement des hommes par l’administration des choses.
La ville agile, surfer le monde
« Plus de mobilité, plus de vie [7] »
Voitures en autopartage, gyroskates, gyroroues, vélos électriques, hoverboards, trottinettes connectées en freefloating... Vous avez sûrement déjà croisé la route de ces « mobilités émergentes », avatars d’un nouveau style de déplacement aux allures de glisse urbaine. Du latin mobilis, mobilitas, la mobilité signifie facilité à se mouvoir, flexibilité, agilité, inconstance, ou encore instabilité. Un peu comme les « nouvelles technologies », les « nouvelles mobilités » se traduisent par un état d’esprit, en l’occurrence celui de l’humain mobile, se mouvant « en réseau », « en synergie ». Georges Amar, « prospectiviste spécialiste de la mobilité » et « chef de projets innovants » à la RATP résume : « Les mobilités émergentes ne qualifient plus seulement le déplacement d’un point A à un point B. Elles sont en train de poser les jalons d’une ville fluide, comme une amorce de réponse aux défis qui interrogent les organisations urbaines [8] », elles sont même désormais « le mode de vie et de fonctionnement dominant de notre société [9] ». Dans le prolongement de sa mobilité professionnelle, l’individu est dorénavant invité à devenir mobile dans sa vie de tous les jours, perpétuellement en mouvement, prêt à sauter sur une trottinette ou un Vélo’v électrique à tout moment, à se téléporter d’un endroit à l’autre de la ville, à calculer et paramétrer ses trajets grâce à ses prothèses électroniques pour s’en assurer l’efficacité, la fluidité.

Des personnes s’inquiètent déjà des nouvelles exclusions qui risquent de découler de ce paradigme de la mobilité. Cette multi-modalité connectée deviendrait une « compétence » indispensable, celle de la maîtrise des « ressources multimodales ». Pour Georges Amar, il est évident que « la maîtrise de la mobilité, dans un environnement urbain complexe et riche en potentialités, constituera une des exigences de la vie sociale, presque au même niveau que de savoir lire et compter ! ». Il ne croyait pas si bien dire. Une enquête [10] réalisée auprès de 3000 citoyens par Keolis, société de transport public qui exploite le réseau des TCL (Transports en Commun Lyonnais) et Netexplo, observatoire de l’innovation digitale, afin de cerner les usages du numérique dans la mobilité du quotidien, a en effet fait ressortir trois catégories de français.es : les « digi’mobiles » (31 %), accros au smartphone ; les « connectés » (39 %), qui ont encore besoin d’être accompagné.e.s ; et les « offlines » (30 %), qui utilisent peu le numérique. De même l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie) oppose dans un rapport [11] les « néomobiles », « caractérisés par l’usage assidu de l’ensemble des formes de mobilités émergentes, […] le groupe le plus agile dans sa mobilité, naviguant à travers l’ensemble des offres disponibles » et les « traditionnels », sortes d’illectronistes de la mobilité. Ce travail de catégorisation n’est toutefois pas neutre ni exempt d’intérêts. Il sert à rendre manifeste les nouvelles « inégalités » que produit le déploiement du numérique… inégalités contre lesquelles il faudra désormais « lutter ». De même que les acteur.rice.s du numérique prônaient jusqu’ici un « numérique inclusif », voilà que cela s’étend maintenant aux déplacements, de sorte que l’on parle de « mobilité inclusive ».
Au-delà des « mobilités horizontales » (oui, ils veulent bien dire : les pieds sur terre), il est désormais question de « mobilités verticales ». Les réseaux de transport devront rapidement permettre d’exploiter les différentes strates de l’espace urbain : aires de stationnement et de recharge en étage, ascenseurs, télécabines, plates-formes dédiées aux drones de livraison, accès en hauteur pour accueillir les navettes volantes... Les expérimentations vont du « téléphérique innovant » (Cabline 2.0 de Francheville à Lyon amorcé par Bouygues) aux véhicules volants autonomes (Airbus) et taxis aériens (Uber en partenariat avec la NASA) en passant par les inénarrables taxi-bateaux volants (SeaBubbles) du quartier de La Confluence. Par exemple, la société chinoise Ehang a choisi Lyon comme terre d’accueil pour son antenne européenne R&D, à proximité d’un site aéroportuaire, afin de réaliser les tests de vols stationnaires de ses drones-taxis. Dans l’attente que ces bidules volants survolent le nid de coucou, l’entreprise française Navya lançait en 2015 l’Autonom Shuttle, première navette autonome électrique de série sans chauffeur à être commercialisée. On peut croiser l’un de ces véhicules à Confluence sous le nom de Navly. Depuis, deux véhicules autonomes ont été intégrés au réseau des TCL et desservent quotidiennement le quartier autour du stade de Décines. Pour la première fois en France, des véhicules autonomes circulent en milieu urbain sur la voirie. Pour deux navettes, il aura fallu investir 487 000 euros, financés via Avenue, programme de recherche et d’innovation européen qui ambitionne de faire de l’Europe le leader des véhicules autonomes. La Métropole de Lyon a, pour sa part, généreusement investi pour adapter ses infrastructures routières. Les passagers se voient même offrir leurs trajets pendant deux années, histoire de les accommoder à cette nouvelle manière de se déplacer… La transition vers la mobilité connectée, ça n’a pas de prix !
« Nudgé [12] » à travers la ville
Outre le développement de nouveaux appareils, il s’agit de réguler l’ensemble des circulations afin de limiter les congestions et autres pertes de temps. « Pourquoi ne pas tout optimiser ? Pourquoi ne pas tout connecter ? Pourquoi ne pas tout analyser pour en retirer des connaissances ? [13] », s’impatientait IBM il y a quelques années. Pour optimiser, il faut anticiper, modéliser, programmer. Cela, la métropole l’a bien compris, puisque depuis quelques années elle s’est lancé le défi de rendre l’offre de transports « fluide, multimodale et personnalisée ». Au sein de la ville-machine, les déplacements ne peuvent pas être vains. Elle n’est pas l’espace de liberté et de rencontre où les individus interagissent les uns avec les autres dans le but de vivre ensemble en harmonie, mais plutôt le lieu d’un fourmillement dans lequel se mêlent personnes et choses réduites à de la donnée numérique. Cette abstraction de toute matérialité est ce qui digère chaque corps pour le diriger comme flux. Voyez par vous-même le niveau de contrôle social que rêvent de généraliser les idéologues/ingénieurs des Mines :
« C’est entendu : la ville intelligente rendra tout plus efficace. Elle chassera les consommations inutiles, les remplacera par des conseils comportementaux, des solutions palliatives, des scénarios optimisés de substitution. Les citoyens seront en permanence informés de la meilleure façon d’utiliser leur environnement immédiat, d’optimiser leurs parcours, de faire plusieurs choses à la fois tandis qu’ils seront invités à utiliser leur corps différemment : moins de gras, plus de mouvements, gestion en temps réel des calories, etc., et toujours de multiples possibilités pour gagner du temps [14]. »
Fini la discontinuité de « l’urbanisme de dalle », « source de confusion et d’inconfort », aujourd’hui, l’heure est au « sol facile », espace public dessiné « à partir des flux et des usages ». Analysé à tout instant à partir des données qu’il aura lui-même créées par son incrustation dans le réseau informatique, l’individu « agile » nourrit un système qui cherche à anticiper : anticiper les accidents, les bouchons, les bousculades, les erreurs, etc. Se rapportant lui-même à ces anticipations, pour ses propres déplacements et dans le but d’optimiser son temps, l’individu aussi mobile soit-il se fait dépasser par la machine qui le pilote sur le réseau des transports. Plutôt que de réagir aux données des réseaux de transport, la machine en vient à produire les flux et les canaux de transmission. Dans sa prétention à anticiper les nœuds et problèmes, la machine conquiert le pouvoir humain de l’inattendu, de la surprise ou de la spontanéité. Lui accordant un pouvoir prédictif, l’individu en quête de rationalité réalise la prophétie de la machine : il prendra la route qu’elle lui a indiqué et ce faisant répondra à son besoin de fluidité. Plutôt que d’intervenir là où il se passe quelque chose, la ville-machine empêche qu’il se passe quoi que ce soit : les flux sont régulés et contenus, empêchant qu’ils ne débordent, déterminés et suivis à la lettre (au message près ?) par le cyborg-urbain. Entre applications adaptant le trajet à la qualité de l’air (Air to go), et outils prédictifs algorithmiques pour rendre vos déplacements plus performants comme le propose l’application Optimod’Lyon (conçue par IBM), « 1er GPS urbain multimodal sur smartphone », ou sa version Web Onlymoov. Elles calculeront pour vous l’itinéraire le plus rapide, en y incluant tous les modes de transport possibles, tout en anticipant les évolutions du trafic, vous alertant sur des perturbations inattendues (quelqu’un a pris le dernier Vélo’v de la station vers laquelle vous vous dirigez, une manifestation a débuté dans le centre-ville ?), et adaptant en conséquence l’itinéraire pour un trajet sans encombre. Le chemin que vous empruntez est guidé par des algorithmes entraînés à éviter à tout prix la congestion, la formation de « grumeaux urbains », ces éléments qui ralentissent les flux de personnes ou d’activités. Vous serez à jamais délivré.e.s du poids de l’incertitude : vous n’aurez plus à vous demander si vous préférez passer dans cette rue qui vous évoque des souvenirs ou traverser ce quartier où loge un.e ami.e que vous espérez croiser. Vous réaliserez même peut-être que vos habitudes de déplacements n’étaient peut-être pas des plus efficaces. Sacrilège ! Alors vous circulerez là où l’on voudra que vous circuliez, et au rythme que la coagulation des flux aura décidé.
Le système CRITER, poste de gestion du trafic lyonnais situé à l’Hôtel de la Métropole, centralise déjà une myriade de données générées par plus d’un millier de capteurs souterrains et plusieurs centaines de caméras mobiles, mais aussi par la flotte de GPS et smartphones disséminés dans l’agglomération lyonnaise [15]. A partir de ces informations, il gère automatiquement les perturbations du trafic en choisissant donc d’orienter les usagers vers certains modes de transports qui évitent les zones congestionnées ou en pilotant à distance les feux de circulation et panneaux d’information routière. Ce même système serait également censé rendre plus efficace le transport de marchandises en ville (qui représente quand même 1/10e de la circulation), en rationalisant et optimisant les tournées (Freilot, Citylog). Marchandise parmi les marchandises, le ou la citadin.e se dissout dans l’optimisation de ses déplacements.
L’abstraction numérique de nos déplacements et notre accaparement par les outils de gestion des flux font écran à la vie réelle et à la matérialité des objets et des personnes que nous rencontrons. La fluidification de nos déplacements opère une désincarnation de nos existences visible jusque dans nos moyens de déplacements : sans conducteur sur la ligne D, sans paysage et sans repères dans le métro en général, face à des écrans dans le tramway, condescendant dans un Uber. Nous glissons sur la ville et sur le monde, sensation dans laquelle nous nous lovons sur les trottinettes électriques. Mais aussi dans l’urbanisme de nos villes : grandes avenues, places sans aspérités ni obstacles.
L’individu mobile de la ville fluide
Par delà les gadgets, comme le sont les iGirouette [16], panneaux de signalétique rotatifs et connectés, il faut reconnaître, dans les dispositifs cybernétiques de la ville-machine, le projet politique de pilotage des individus. La girouette, c’est nous. Les individus que l’on met en avant comme des collaborateur.rice.s à un système plus grand qu’elles et eux, la ville, ne sont en fait que des points d’attaches pour celles et ceux qui valorisent les données et maintiennent loin des communautés le contrôle et le pouvoir qu’elles pourraient avoir sur elles-mêmes. Comme dans nos déplacements urbains, nous sommes poussé.e.s dans une dépossession de notre capacité à choisir par nous-mêmes les directions que prendrons nos vies et la manière dont nous les organiserons. Le but est bien en effet de « connecter les individus au rythme de leur quartier », soit le quartier, la ville, la métropole, entités à part entière dans lesquelles les individus doivent se fondre, où les déplacements doivent être fluides, rapides, facilités. Le quartier n’est plus un espace ouvert, ouvert à une invention et à une appropriation de la part de ses habitant.e.s, de celles et ceux qui y travaillent, y vivent effectivement. Le quartier n’est pas vivant parce qu’habité par des personnes vivantes. Il est censé être vivant parce qu’organisé comme un organisme cyborgisé, géré par des processus automatiques.

L’immatérialité des décisions prises à l’aide d’applications pour smartphones nous sépare de l’expérience réelle de la ville dans ce qu’elle comporte de frictions et de rencontres, de pas lourds et de trajets interrompus ; elle entraîne dans nos imaginaires une valorisation du monde sans matière, où tout est facile et sans accroc. Cela produit la recherche du réconfort auprès de nos écrans, lesquels entretiennent le semblant d’une vie faite de socialité et de rencontres dans une ville qui se veut toujours plus lisse. L’excès de rationalisation finit par exclure le sensible. Il n’y a plus de hasard. Plus de heureux hasard. Plus de poésie. Plus cette personne aux allures de troubadour pour oser parler un peu plus fort que les autres pour vous demander, « Avez-vous du temps pour une poésie ? ». Il n’y a plus le temps. Vous êtes pressé.e.s. Vous devez arriver à l’heure si vous ne voulez pas rater le passage de votre navette autonome sans chauffeur, sinon vous devrez charger un nouvel itinéraire prédictif alors que vous aviez tout paramétré par avance. Votre trajet est minuté. Il n’y a plus personne pour oser clamer un poème, à la rigueur la seule poésie que vous verrez jamais sera celle affichée sur un panneau lumineux électronique de la ville, et peut-être qu’un jour ce ne sera plus vos poèmes qui seront affichés, mais ceux d’une IA, et le pire, c’est que vous ne verrez pas la différence. L’optimisation sans fin de notre mobilité ne démontre que l’inconstance, voire l’inconsistance de vies qui ne peuvent plus se donner de but à elles-mêmes, car « qu’est-ce que cette mobilité censément désirable, exigée en fait de tout un.e chacun.e ? Sûrement pas celle des nomades touaregs, tuvas ou roms mais celle du salarié déplaçable d’une fonction à l’autre, d’un site à l’autre selon les besoins du marché [17]. » Les flux de la ville-machine, optimisés et régulés chaque jour dans une sempiternelle répétition par les algorithmes, sont ceux de nos déplacements quotidiens bornés au métro-boulot-loisirs-dodo.
Mais, pas d’inquiétude, certain.e.s ingénieur.e.s préparent déjà un « usage "inefficace" de l’espace urbain reconverti en richesse nationale majeure [18] », grâce à des « technologies de l’inefficacité », promettant de programmer même l’imprévu, l’incertain, et l’aléatoire. On n’arrête pas le progrès...
La ville facile, être-à-l’écran
La mise en mesure du monde
Le « monitoring urbain » désigne l’ensemble des réseaux de capteurs implantés sur le « mobilier urbain » (c’est le nom donné aux éléments de décor de la ville-machine) et collectant en permanence des « données environnementales » : qualité de l’air, volume sonore, météo locale et niveau d’UV, trafic routier, flux piéton, taux de remplissage de bacs à déchets, etc. La métropole de Lyon a déjà déployé plusieurs réseaux de capteurs comme des capteurs de chaleur et d’eau dans les arbres de la rue Garibaldi pour les « monitorer » et prévoir leur arrosage automatique (projet Biotope), des capteurs dans des silos à verre pour optimiser les collectes de verre (Sigfox, Lora, MtoM GSM), des capteurs dans la chaussée pour assurer la maintenance hivernale (Grizzly, HiKoB). Sont aussi en projet des capteurs de mouvement pour éclairer les rues à la demande (Smart Lightning) ainsi que des capteurs pour analyser la pollution de l’air (Projet R Challenge). Des capteurs de bruit ont également été expérimentés (projet MONICA) lors des festivals Nuits sonores, Woodstower ou encore lors de la Fête des Lumières, faisant des spectateur.trice.s des sortes d’humains-capteurs équipés d’objets connectés, bracelets ou lunettes établissant des mesures sonores et les retransmettant aux organisateurs « en temps réel ». Le « monitoring urbain », c’est littéralement le « pilotage de la ville par le numérique [19] », la captation d’une infinité de gigabits de données par la Métropole, dans le but de « réaliser des tableaux de bord utiles dans l’aide à la décision ». Ce « monitoring », anglicisme dont l’étymologie renvoie à l’idée de « technique de surveillance » par l’intermédiaire d’un moniteur, « appareil de contrôle », se décline aussi en un « monitoring environnemental participatif » qui fait intervenir des groupes de citoyen.ne.s dans la mesure de tout : chacun.e étant invité.e à devenir un « capteur de son environnement » - comme ces « sentinelles du climat » qui, grâce à leur smartphone, feront des mesures citoyennes du « micro climat urbain » (Particule). « Le monde ne se regarde plus, il se mesure [20]. » A la relation sensible à l’arbre se substitue un rapport médié par un référentiel abstrait ; l’arbre est lui aussi relégué au rang de « mobilier urbain » dont on analyse le « stress hydrique » en temps réel par l’intermédiaire de capteurs, afin d’être alerté de la nécessité de son entretien.

Ici encore, nous n’entretenons plus de relation directe aux choses et aux êtres mais en sommes séparé.e.s par la médiation d’un écran. Nous ne nous y rapportons plus dans une relation singulière mais par le biais de la rationalité scientifique poussée à l’extrême qui nous fait connaître notre environnement dans les termes de la données chiffrée, de la moyenne, du pourcentage et de la normalité. Par la mesure et le calcul permanents de tout, nous nous trouvons coupé.e.s de nous-mêmes en tant qu’êtres sensibles capables d’une relation sensible aux choses et aux êtres. Nous déléguons notre pouvoir de lire le monde, de le connaître et d’agir dessus à des machines qui petit à petit se substituent aux savoirs et à la sensorialité humaine.
Urbanisation cyborg
Ce ne sont pas uniquement les collectivités publiques qui s’emparent de la numérisation des villes. Elles suivent même en cela les logiques économiques des entreprises privées à la recherche de plus de profits. Clear Channel teste déjà de nouvelles fonctionnalités qu’offrent les nouvelles techniques publicitaires : réalité augmentée, interactivité en « temps réel » avec les données qui émanent des réseaux sociaux et personnes qui croisent le « totem digital »… JCDecaux expérimente l’« eye-tracking [21] » sur ses panneaux publicitaires, procédé qui avant était seulement utilisé sur la Toile. Plus les villes s’équipent de technologies « smart », les transformant en plateforme pour l’IoT (Internet des Objets), moins il semble y avoir de moyens d’échapper au réseau, à la Toile ininterrompue de profilage, de captation des données personnelles et d’incitation à consommer. Selon la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés), « cette analogie liée à l’irruption de modèles économiques du Web dans la ville peut nous laisser craindre que les logiques de design à l’œuvre dans les plateformes Web (faire en sorte de rendre le consentement invisible, nous faire passer toujours plus de temps connecté, etc.) pourraient être reprises dès lors qu’il s’agirait de monétiser les services de la Smart City [22]. » Et c’est la CNIL, connue pour arrondir les angles, qui le dit ! Tout comme le suivi des clics de l’internaute, le suivi physique du consommateur.rice est donc désormais exploitable à grande échelle. La déambulation physique s’apparente à une navigation sur la Toile, régie par le sur-mesure algorithmique. Dans la ville-machine, il n’est plus sensé de penser l’Internet comme une chose à laquelle on a accès via un ordinateur ; pas quand la ville elle-même est ré-imaginée et reconstruite comme une plateforme au sein d’un « écosystème » informatique. Les logiques de l’immatériel prennent possession des rues. Mais la pseudo-immatérialité du réseau ne fait plus illusion dans des villes où elle tente encore de se cacher. Les panneaux publicitaires et abribus deviennent des réceptacles de capteurs et bientôt d’antennes 5G (small cells), des bâtiments sont réquisitionnés pour servir de datacenters au plus près de la source. Les startups de trottinettes connectées inondent les trottoirs du jour au lendemain comme l’on bombarde la vidéosphère d’une nouvelle application, d’un nouveau site ou d’une nouvelle plateforme, stratégie marketing invasive de l’espace public « disruptant » les codes établis. L’urbanisme est redessiné selon cette hybridation entre le monde d’Internet et le monde de la ville. La ville-machine est la facilitation de la consommation des biens et services dans un sentiment toujours plus grand de « fluidité » (paiement sans contact, pré-commande, borne de retrait de commande, coupe-file, géo-incitation par smartphone).
Dématérialisation des services, précarité 2.0
Dans ce mode d’habiter qui tend à s’étendre partout via sa structure immatérielle, c’est notre rapport au pouvoir et à sa participation qui sont transformées. L’un des objectifs annoncés par le gouvernement macronien est la mutation de l’État en « État plateforme » dont l’une des premières briques est FranceConnect, plateforme d’authentification et d’identification destinée à centraliser l’ensemble des démarches administratives (Sécurité sociale, CAF, impôts…) d’ici 2022, donc à dématérialiser la totalité des services publics [23]. Petit à petit, les « e-citoyen.ne.s » voient leurs droits et demandes être gérés automatiquement, grâce à des algorithmes. La ville-machine suit le pas : à Lyon, le guichet unique métropolitain Toodego, application mobile et portail Web, se propose de « faciliter » la vie de ses habitant.e.s qui peuvent déjà, « d’un clic » et avec un même identifiant, accéder à l’ensemble des services publics (demande de logement social, démarches administratives (PACS, livret de famille, liste électorale)…
A la SNCF, comme le montre la suppression de quelque cinq mille postes (guichetier.ère.s, agent.e.s d’information…) en France en 10 ans, la tendance est à l’automatisation et au développement d’infrastructures ne transitant que par le numérique. L’entreprise travaille à la fermeture de ses guichets au profit de la billetterie par Internet mais aussi de guichets virtuels avec télé-conseiller.ère.s à distance. Dans la « gare de demain », toute personne non-équipée d’un smartphone, mal à l’aise avec Internet ou tout simplement refusant l’idée d’être constamment connectée et potentiellement surveillée, se retrouvera bien en difficulté pour acheter un billet [24]. Ce sera désormais au smartphone d’adopter le rôle de « compagnon.e de voyage » pour accompagner nos trajets, nous orienter, nous informer, comme l’explique le site Digital SNCF. La maintenance dite prédictive, de son côté, tend à disqualifier les travailleur.euse.s pour les reléguer au rang d’exécutant.e.s d’une machinerie de capteurs et autres algorithmes d’analyse en temps réel, qui gère l’ensemble du réseau ferroviaire en pilotage automatique.
Il en est de même à Pôle Emploi, où l’on restructure, sous-traite et dématérialise tout. Concrètement, il s’agit de confier la mission d’indemnisation à des algorithmes alimentés par des entreprises de sous-traitance privées, en se passant au plus vite de 4 000 conseiller.ère.s. Côté chômeur.euse.s, un bon nombre d’entre elles et eux sont découragé.e.s et renoncent à leurs droits : leurs « conseiller.ère.s » et « assistant.e.s » désormais virtuel.le.s ne sont pas là pour répondre à leurs besoins, questions, prendre en compte la particularité de leurs situations. Le travail des salarié.e.s de Pôle Emploi, ne s’en trouve pas simplifié pour autant : la réduction des rencontres physiques se compense par une augmentation de la charge de travail par mail et par téléphone, il faut reprendre les dossiers traités par l’algorithme, souvent mal traités et bardés d’erreurs, et ramasser les « usager.ère.s » en miettes qui n’ont plus plus la possibilité de prendre la parole et d’exprimer leurs difficultés devant un être humain. « La gestion informatisée permet aussi au système de se rendre suffisamment inaccessible pour ne plus avoir à se justifier. Elle met donc à distance les usagers et leurs conseillers et renvoie chacun.e derrière son écran. Elle tend aussi à s’autonomiser de la décision humaine. […] Pour les salariés qui tenaient encore à leur mission d’aide et de conseil, cette relégation derrière l’écran les cantonne à une gestion comptable et désincarnée d’humains devenus des numéros de dossiers. En même temps qu’eux, c’est le sens qu’ils donnaient encore à leur travail qui se flétrit [25]. »
L’individu simplifié
Nous pouvons tous et toutes constater à quel point il est devenu difficile d’obtenir un rendez-vous ou un échange direct avec un agent.e des services, publics comme privés. Naviguant sur les plateformes Internet à la recherche d’un raccourci vers un numéro de téléphone, il est bien souvent nécessaire de passer par une zone de FAQ qui tente de faire rentrer notre demande singulière dans les cases pré-établies de la complainte. Nos problèmes complexes bien ancrés dans la vie sont ainsi réduits à des « questions fréquentes » et renvoyés à des réponses infantilisantes ou vagues où nous sommes le plus souvent pris.es pour des demeuré.e.s qui n’ont pas bien intégré la procédure. Nous devons accepter la précarité du flou et l’anxiété du couperet, de la décision que nous aurions provoquée par notre incompréhension des modules de la plateforme. On peut déplorer que ce soit les agent.e.s des services publics qui reçoivent notre frustration à l’égard d’un pouvoir injuste de la procédure et de la normalisation. Mais aujourd’hui, nous sommes plus encore renvoyé.e.s à nous-mêmes dans notre impuissance face aux procédures car nous dépendons de logiques abstraites et d’algorithmes qui traitent automatiquement nos embarras administratifs dont la résolution peut être essentielle à notre survie. Pour nous en sortir nous faisons face à une nébuleuse sans visage supprimant la matérialité d’une autorité face à laquelle nous retourner et à laquelle exprimer notre colère.

Bien loin de rendre « facile » l’accès à ses services, la ville-machine complexifie davantage le parcours du combattant qu’il peut représenter pour nombre d’entre nous, nous renvoyant toujours aux réponses bornées de machines programmées. La ville-machine offre non pas une facilitation mais une simplification des échanges devant nous permettre de vivre ensemble et de nous organiser. Si elle semble les « faciliter » ce n’est seulement que parce que la socialisation, l’intersubjectivté, l’organisation collective nous sont déjà étrangères, et parce que nos interactions humaines sont déjà menées par les logiques abstraites du code, du prix et de l’efficacité, c’est-à-dire qu’elles sont robotisées. Cette simplification sert le contrôle des personnes les plus démunies et isolées quand elle ne rend pas impossible la vie des laissé.e.s-pour-compte (ceux et celles qui comptent pour rien, que l’on ne compte pas, que l’on intègre pas au calcul dans cette société qui n’accorde d’existence qu’à ce qu’elle peut comptabiliser). Elle contraint les personnes, en rendant nécessaire leur connexion au réseau et forçant leur intégration à ses logiques gestionnaires informatisées.
La ville durable, ou la nature morte
Lyon, territoire pilote du désastre
L’anglicisme « Smart grid » désigne ce qu’on pourrait traduire par « réseau électrique intelligent ». Cette nouvelle étape dans la gestion et distribution de l’énergie serait un des piliers de la « troisième révolution industrielle » prophétisée par l’économiste idéologue Jérémy Rifkin et adoptée par les gouvernements des pays industrialisés. Elle combinerait : pilotage, optimisation du réseau électrique par le numérique avec insertion de sources d’énergie alternatives (photovoltaïque, éolien, hydroélectrique...) et développement de nouveaux usages (mobilité électrique, habitat connecté...). C’est dans cette logique que s’inscrit le déploiement des compteurs communicants Linky : puisque les énergies renouvelables, par nature intermittentes, imposent une prise en compte des pics de production et des périodes d’absence de production, il faut évaluer les besoins énergétiques des équipements électriques « en temps réel » en les puçant et les reliant au réseau afin d’assurer l’alimentation permanente de la ville-machine - qui n’est autre qu’une ville électrique. Parallèlement à l’essor des mobilités « douces » on voit peu à peu apparaître de nouvelles applications des fameuses énergies « propres » : bornes de recharge pour véhicules électriques à énergie « certifiée 100 % d’origine renouvelable » (Move in pure), services d’auto-partage de voitures électriques (Bluely), e-Velo’v à batterie individuelle… Mais c’est surtout au cœur du quartier de Confluence que s’opère un véritable tournant avec l’apparition de projets tel qu’Hikari, premier « îlot urbain à énergie positive » (Lyon Smart Community). A la fois « démonstrateur smart grid à échelle réelle et la première brique d’un réseau électrique intelligent à l’échelle de la métropole [26] », il a permis à Enedis et EDF d’expérimenter des techniques de pilotage du réseau grandeur nature (Greenlys, Smart Electric Lyon, Smarter Together, Linky). Né d’une alliance entre le Grand Lyon et le Nedo, agence japonaise de soutien à l’innovation, il s’est développé avec entre autres le soutien de Toshiba, Bouygues Immobilier, Veolia et des startups innovantes de la tech lyonnaise. Hikari est un ensemble d’immeubles conçu de manière à être non seulement auto-suffisant énergétiquement mais également à alimenter un service d’autopartage de voitures électriques (Sunmoov’). Comment ? Eh bien, c’est tout simple : en équipant des bâtiments « éco-rénovés » de panneaux photovoltaïques, d’une centrale à chaleur fonctionnant à l’huile de colza et d’un système de production de froid grâce à l’absorption de l’eau de la Saône ; mais aussi en les truffant de capteurs mesurant la température, détectant le CO2, les mouvements dans une pièce, surveillant la ventilation, l’éclairage… Bref, en calculant et optimisant en continu les consommations.

La ville infantilisante
Dans ces expérimentations de « smart buildings », chaque ménage est sommé de suivre ses consommations « en temps réel » depuis des applications sur smartphone (Oh my watt, Blue Tic) ou avec une tablette numérique de suivi énergétique (Consotab). Il s’agit de nous doter de plateformes et interfaces « de test des solutions de maîtrise de l’énergie [27] » et d’autant d’« équipements "intelligents" et connectés », pour nous aider à contrôler notre consommation individuelle d’énergie. Chaque citoyen.ne peut dès lors « développer [sa] sensibilité à l’environnement et à l’écocitoyenneté », et devenir « consomm’acteur ». Parmi les propositions du programme Smart Electric Lyon, il y a l’idée que je peux choisir d’« améliorer mon confort au quotidien avec un chauffage connecté [28] », et bénéficier de « l’objet connecté BlueTic et de son application ConsoElec », de cette manière « mon bien-être à la maison est optimisé, ma facture maîtrisée et mon environnement préservé ! » ; de plus si « je réduis mes consommations lors des pics nationaux, j’allège ma facture et EDF me récompense ! ». Si ces technologies sont vendues sous prétexte de favoriser la « transition écologique », en réalité le but de l’« efficacité énergétique » promue par les « Smart grids » n’est pas de réduire la quantité totale d’énergie que nous utilisons, mais de dégager plus d’énergie pour d’autres usages. C’est ainsi que sont conçus la quasi-totalité des schémas d’efficacité énergétique et des technologies soi-disant efficientes exhibées aujourd’hui : « il n’est pas question de réduire la consommation d’électricité globale, mais de rationaliser la distribution pour mieux numériser notre passage sur Terre [29] ».
Il est amusant d’ailleurs de lire les entrepreneur.euse.s du « monitoring d’immeubles » augmenté de « green tech » relativiser sur le potentiel de ces technologies : « on peut peut-être gagner 10 % [sur notre consommation habituelle] mais on apporte surtout plus d’automatisme et plus de confort [30] ». D’abord, le pauvre pourcentage de gain, dont la relativité ne montre que la futilité de l’argument, vaut seulement lorsque les expérimentations ne sont pas un formidable échec comme l’est l’îlot Hikari mentionné plus haut : « La cogénération au colza ne fonctionne qu’à 30 % au lieu des 70 % prévus avec des coûts de fonctionnement exorbitants et des pannes à répétition. Du coup, la principale source d’énergie thermique depuis quatre ans provient du gaz fossile. Les 3 000m2 de panneaux photovoltaïques placés sur le toit et les vitrages produisent de l’énergie, en revanche leur rendement n’est pas optimisé et les batteries de stockage d’électricité sont hors d’usage [31] ». Les bâtiments sont truffés de gadgets made in Japan non maîtrisés qui sont inutilisables et les copropriétaires, pourtant jadis acteur.trice.s de la valorisation du projet, contestent aujourd’hui l’utilisation vitrine d’Hikari comme emblème d’un soi-disant « quartier durable ». On sent alors que les arguments et prospections en vue de la vente et de l’acceptation sociale n’étaient sûrement qu’un écran de fumée pour conquérir des parts de marché. Ensuite, l’objectif n’est pas tant de réduire la consommation que celui de nous procurer un sentiment de plaisir et de bonne conscience. Nous confions aux machines notre rapport au monde, plongés dans l’abstraction de nos vies énergivores laissant les logiques de la mesure et de l’efficacité envahir le chez-soi. Les interfaces numériques de gestion de nos appétits énergétiques accentuent notre éloignement de la réalité concrète et sensible des matières et infrastructures dans lesquelles nous puisons les flux nécessaire à nos existences au sein desquelles 1kW d’électricité n’est qu’une ligne sur une facture ou des données encodées sur notre écran de contrôle.
Des datacenters poussent, pas des jardins…
Ce dont il faut avoir conscience par ailleurs, c’est que notre consommation individuelle (logement, déplacements etc.), sans arrêt mise en avant par les discours culpabilisants du pouvoir, ne représente qu’une part infime de la consommation totale d’énergie comparée à ce qui est englouti par le complexe industriel (usines, chantiers, mines, transport de marchandises, réseaux de distribution…). Alors que notre marge d’action se réduit à des éco-gestes dictés par des appareils de mesure, la ville-machine impose le déploiement des compteurs connectés Linky, remplaçant quelques millions d’anciens compteurs en parfait état de marche depuis plus de 40 ans pour la majorité par une version hi-tech dont l’obsolescence est programmée à une quinzaine d’années. Il en va de même pour le réseau 5G impliquant de renouveler l’ensemble du parc de téléphones portables et de fabriquer massivement antennes ou small cells... Le ciment de la ville-machine est fait de réseaux connectés, dont les centres névralgiques sont les datacenters, usines de stockage et de gestion continue de milliards de données issues des « Smart grids » ou encore du « monitoring urbain ». Rien que l’invisibilisation physique et la surconsommation énergétique de ces derniers vont à l’encontre de la sobriété énergétique. La multiplication, sous couvert d’écologie, d’applications sur smartphones, tablettes tactiles, capteurs, complexes informatiques, objets électriques et connectés, est une absurdité qui illustre l’utilisation de la pseudo dématérialisation numérique pour cacher le caractère intrinsèquement polluant et énergivore de cette industrie. Voyez la démesure du projet de smartification à travers cette citation du patron d’IBM :
« Pensez maintenant à un monde qui compterait un milliard de transistors par être humain [...]. C’est ce que nous aurons d’ici 2010. Le nombre d’abonnés aux téléphones mobiles atteindra probablement le chiffre de quatre milliards d’ici la fin de cette année, et 30 milliards d’étiquettes d’identification par radiofréquence seront produites à l’échelle planétaire dans les deux prochaines années. Des capteurs sont intégrés à des écosystèmes complets – chaînes d’approvisionnement, réseaux de soins de santé et villes – même les milieux naturels, comme les rivières, y ont droit [32] ».
La fascination que suscitent cette urbanité numérique en devenir et son économie reste toutefois oublieuse de leur matérialité. Cette dernière est masquée par la nature synthétique, façade de la ville morte que l’on fait pousser sur les murs et toits des bâtiments de béton. Décors aseptisés des quartiers vitrines où règne la léthargie d’une vie morne, calculée jusque dans ses moindres recoins. L’espace urbain se bâtit en îlots de « nature préservée » et en implantation d’innovations informatisées. De la « végétalisation de façade » aux bornes dépolluantes pour purifier l’air ambiant, comme celle développée par le groupe lyonnais La Barrière Automatique, l’espace de la ville-machine doit demeurer karchérisé, exempt du caractère foisonnant de la vie dans son déploiement. Si nous pouvons alors déambuler dans ce spectacle de l’écologie, c’est seulement au détriment de ce qui nous est proprement dissimulé et qui se joue, bien loin de nos yeux, dans les coulisses de la société industrielle.

… et la Terre et les humains se meurent
L’illusion de la transition écologique par la « dématérialisation » numérique s’arrête aux portes de nos cités futuristes. Elle se matérialise par l’extraction de toujours plus de matières premières et leur transformation aux quatre coins du monde par des procédés industriels lourds dont on ne peut méconnaître l’ampleur des ravages pour l’air, les eaux, les sols et les êtres vivants. Elle se dévoile furtivement la nuit lorsque nous apercevons ces autoentrepreneur.euse.s uberisé.e.s qui jusqu’à l’aube, pour parfois deux euros de l’heure, ramassent des trottinettes connectées pour les recharger chez elles et eux à l’aide de notre bonne veille énergie nucléaire. La réalité de la société nucléaire (mines d’uranium, rejets autour des centrales, production de déchets radioactifs, travailleurs irradiés, accidents industriels, etc.), ne saurait plus nous faire avaler le caractère « doux » et « vert » d’une ville qui repose sur le tout électrique. Tout comme les énergies dites renouvelables qui ne se substituent pas mais s’ajoutent aux énergies fossiles, dont elles dépendent à tous les stades de leur production : lors des opérations d’extraction des matières servant aux nouvelles infrastructures, lors de la fabrication, l’installation et la maintenance de ces dernières, ainsi que lors de leur démantèlement, dont les déchets non-recyclables finiront dans des décharges à ciel ouvert, polluant et intoxiquant de nouvelles régions du monde et leurs habitant.e.s [33].
En effet, l’externalisation des destructions nous permet de vivre le mythe de la ville-machine « propre » et « durable » sans se questionner sur ses coûts réels. Nous intégrons, sans nous poser de questions, le solutionnisme technologique au lieu de remettre en cause la demande sociétale en énergie et matières premières ainsi que les conditions de leur obtention. L’électrification du monde à laquelle ces technologies contribuent repose sur le secteur des extractions minières, sur une chaîne de production mondialisée, sur l’économie industrielle hégémonique, et donc sur une situation géopolitique faite de guerres et d’exploitations. Afin de soutenir les secteurs industriels porteurs de la croissance économique, ces réalités sont maintenues loin de nous alors qu’elles sont la structure matérielle de nos existences. Plongé.e.s dans la pseudo-immatérialité de nos modes de vie, nous n’entrevoyons le désastre que de manière passive et éloignée au travers de nos écrans. Dans la ville-machine, au sein de laquelle chaque comportement est dicté par une raison écologique culpabilisante, répressive et illusoire, nous échappe la possibilité de nous poser les questions fondamentales du devenir de nos communautés et des limites qu’elles pourraient vouloir se donner.
La ville terrain d’expérimentation, innover pour déposséder
L’utopie de la technopole
Derrière le discours verdoyant qui promeut la ville-machine comme une réponse à la crise globale se découvre le réel projet de faire de la ville « un écosystème proche de celui de la Silicon Valley [34] », c’est-à-dire une technopole, lieu de convergence entre universitaires, chercheur.euse.s, entrepreneur.euse.s, mais surtout startups. Lyon doit se placer parmi les villes attractives « riches d’une telle concentration de ressources intellectuelles qu’elles ont toutes les cartes en main pour apporter également des solutions à ces problèmes », entendez à ceux occasionnés par le changement climatique. Dans ce genre de phrases où se mêlent concentration capitaliste des pouvoirs, expertise et solutionnisme technologique, l’écologie se révèle à sa vraie place, à savoir celle d’un « problème » qui se trouve « également », accessoirement, traité. Une bonne aubaine pour une ville qui « possède l’une des French Tech les plus développées » ! Et une manière de remettre à l’endroit la hiérarchie entre économie de croissance et questionnements sociétaux.

Le grand Lyon se veut désormais « accélérateur de projets intelligents [35] » avec « à la clé, l’émergence de nouveaux marchés et relais de croissance ». La collectivité se met au service des entrepreneur.euse.s en livrant aux « acteurs du territoire les infrastructures et conditions nécessaires à la conduite de projets à fort potentiel : Très Haut débit, tests en situation réelle, mise à disposition de données, de panels utilisateurs, accompagnement personnalisé dans la démarche d’innovation (immobilier dédié, espaces de coworking, pépinières...) ». Pour le dire d’une autre manière, vie et ville, habitations et habitant.e.s sont livré.e.s aux secteurs privés qui sauront les valoriser sur les nouveaux marchés de la donnée, de l’urbanisme, de la sécurité, de l’Internet des objets, des nouvelles mobilités, etc. La technopole se résume dans l’idéologie d’une ville « dynamique », censée donner sa chance à celui ou celle qui saura la saisir, mais qui en réalité s’appuie sur un niveau d’expertise extrême et soumet la majeure partie de la population à ses expérimentations et aux fluctuations de ses marchés (emploi, inflation, notamment dans l’immobilier). L’informatisation de tout, comme moteur de l’économie et lieu de l’innovation, fait de la technopole la ville de l’imbrication de l’humain et de la machine, avec la promesse que c’est « dans la matrice verte, technologique, radieuse, [que] pourront se rassembler et renaître les hommes de demain [36] ». En témoignent les projets architecturaux cyborg comme le site Lyon Parilly Factories destiné à accueillir « l’industrie 4.0 », au cœur même de la métropole, qui se rêve traversé d’« une grande artère verte [37] » ; ou encore le Campus Région du Numérique récemment implanté dans la banlieue ouest de Lyon, dont le toit s’apparente à une « canopée digitale [38] » : structure métallique surmontée de panneaux solaires, d’une installation lumineuse LED, et dont le plan inférieur formerait une sorte d’écran numérique pouvant reproduire différents motifs, elle serait censée créer « un dialogue avec la forêt naturelle alentour. »
« The world is our lab [39] »
La ville doit devenir un « laboratoire d’innovation », un « terrain de jeu pour innover, développer, vivre en harmonie », un « espace d’expérimentation pour anticiper et accompagner la transformation digitale [40] » - ce que l’on trouve aussi désigné sous le nom de « bac à sable ». Dans la novlangue informatique, cette notion fait référence à un « environnement de test pour logiciels ou sites Web ». Pour le dire simplement, il s’agit de favoriser l’innovation en fluidifiant et en facilitant les parcours entrepreneuriaux encombrés de lourdeurs administratives, et d’offrir des terrains d’expérimentation en conditions réelles en assouplissant temporairement les contraintes réglementaires.
Comme le montre la métaphore du bac à sable, la ville est conçue comme un terrain de jeu où la matière est faite d’une multitude d’unités identiques. L’on peut y construire des infrastructures, matérielles et immatérielles, et les détruire d’un coup de pied aussi facilement qu’une tour de sable. Le dispositif mis en place, dans lequel les individus ont pris place tels des grains de sables malléables, est écrasé et renvoyé à un tas informe qu’il s’agit de remettre en ordre différemment. L’ingénieur.e et l’entrepreneur.euse sont les démiurges qui viennent donner forme à la masse des gens et des choses qui habitent et emplissent la ville, jusqu’à ce qu’une nouvelle lubie ou un nouveau marché redéfinisse les règles du jeu, objectifs et stratégies.
Il semble que le monde soit devenu dans l’imaginaire technicien un espace de jeu, une sorte d’étendue entièrement disponible à leurs activités et expérimentations . La planète-laboratoire est le modèle de développement qui consiste à jouer à l’apprenti sorcier avec le vivant sous prétexte d’ « innover », et ce en balayant toute considération éthique. « La thèse andersienne du "laboratoire-monde", selon laquelle avec les premiers essais nucléaires le "laboratoire" était devenu coextensif au globe, se voit reprise positivement, sans révolte ni intention critique aucune : comme plate constatation de notre incarcération dans le protocole expérimental de la société industrielle [41] ».
Innover ou crever
La ville s’offre à des « partenaires » qui n’ont pas comme objectif le « bien public » ou le « vivre ensemble », mais la réalisation de profits. Assoiffées de subventions et de marchés publics, ces « entreprises innovantes » s’installent ou naissent sur les « territoires » les plus propices à l’innovation. Elles les soumettent alors à leur logique de concurrence qui fait des villes des métropoles en guerre les unes contre les autres. Innover pour ne pas dépérir, comme un second exode mais qui s’étend, quant à lui, prenant possession des périphéries dans lesquelles sont repoussé.e.s les habitant.e.s indignes des tous les nouveaux city centers pour ingénieur.e ou business (wo)man.
L’innovation est « devenue l’autre nom du développement, le maître-mot de la restructuration des territoires. L’innovation est sacro-sainte. L’innovation est le nom de ce qu’il faut faire. Le modèle de la technopole, loin d’être une simple mode, s’est imposé comme avatar quasi hégémonique du capitalisme [42] ».
La direction à suivre est toute trouvée pour Lyon, à savoir s’appuyer sur les forces existantes, principalement ses universités et écoles : Lyon 1, l’INSA Lyon, Epitech Lyon, EM Lyon pour la partie innovation qui a des experts en IA sur Lyon 2 et son labo de sciences cognitives, Centrale Lyon, la Fédération informatique de Lyon, l’Inserm avec son laboratoire en neurosciences et traitement du langage, l’ENS et son parcours « Villes Intelligentes et Villes Apprenantes » ; mais aussi son « écosystème » d’entreprises, pour développer des produits digitaux made in Lyon. Et c’est donc chez soi que l’on testera ces gadgets, prenant la population pour cobaye d’expérimentations grandeur nature, en vue de vendre ces solutions technologiques à l’international. La ville de Lyon se place donc à la pointe de l’innovation des dispositifs de la ville-machine tant dans le domaine de leur production que de leur mise en service. Elle conquiert ainsi une forte attractivité pour un marché en plein essor en garantissant un terrain de jeu de la taille d’une métropole, et sert de vitrine vivante pour les joujous qui y sont produits. Certain.e.s investissent déjà dans la recherche de nouvelles technologies pour « personnaliser » l’expérience de la ville, qui semble véritablement se confondre avec une expérience client.e. Parmi les projets évoqués, le développement d’ « amplificateurs d’ambiances urbaines [43] », comme le seraient la possibilité de changer la couleur de l’éclairage d’un bâtiment en cliquant sur son smartphone, ou celle d’obtenir plus d’informations sur le lieu où nous nous trouvons par le biais de flash-codes urbains. « Peu de technologies de l’espace public travaillent aujourd’hui sur nos cinq sens qui resteront peu sollicités dans l’espace numérique : bientôt les technologies des odeurs, des ambiances sonores ou du goût en tant que révélateurs des espaces à vivre dans la ville ? ».
« Terreau fertile » de l’économie numérique
L’infrastructure à bâtir est à la fois matérielle (immeuble, centre d’affaires, « pôle de mobilité multimodal », mobilier urbain, capteurs, datacenter) et immatérielle (application, algorithme, consentement et participation citoyenne, « culture numérique », plateforme d’open data comme le projet Grand Lyon SmartData). Pour la première, le secteur privé s’accapare argent et espaces publics. Des quartiers hors-sol émergent du béton à coup de millions d’euros d’argent public (Confluence construite par les ingénieur.e.s pour les ingénieur.e.s), tandis que d’autres sont restructurés autour de leurs symboles et « atouts » pour le commerce international (Part-Dieu : gare et accès aéroport, architecture verticale). Il faut subventionner en masse des « tiers-lieux » pour l’ « innovation », dans lequel des petits soldats du numérique tapis dans leurs espaces de co-working sont chargés de chercher des justifications à d’énièmes projets de « services urbains innovants », évidemment basés sur le numérique, en les maquillant d’un humanisme aux allures d’ « inclusion » et de « mieux vivre-ensemble », en faisant émerger dans les rapports officiels des « bénéfices qualité de vie » derrière les « opportunités business ». Comme au H7, ancienne chaudronnerie reconvertie en « lieu Totem », « hub de l’écosystème numérique lyonnais », « incubateur » qui accueille depuis fin 2018 dans ses 3500m2 « les projets qui seront la vitrine de l’innovation en action dans la métropole [44] » (dont une école d’Intelligence Artificielle montée par Microsoft). Comme au Bel air camp à Villeurbanne, « réseau de Tiers-lieux Business » relocalisé et « résilient » après être parti en fumée en octobre 2019, ou encore comme à la Ruche industrielle de Vénissieux où les doux.ce rêveur.euse.s imaginent « l’industrie du futur ».

Pour la seconde, la municipalité joue le rôle de professeure et verse dans la pédagogie et l’habituation au numérique. Afin de diffuser la « culture numérique », ce ne sont pas moins de 600 événements [45] qui sont portés chaque année à Lyon par les « médiateur.trice.s » du numérique, soit pour feindre de laisser de l’espace pour réfléchir à « la ville que nous voulons », avec des titres de débats tels que « Citoyens, la ville de demain nous appartient ! » (tandis que tout est déjà pensé et programmé sans nous) ; soit pour forcer l’acclimatement des populations à un milieu de vie entièrement envahi par l’informatique, comme le fait par exemple l’Association Fréquences École, laquelle déclare que « le numérique est partout, [qu’]il concerne tout le monde, tout le temps [46] », accomplissant par là-même l’intégration de ce « tout le monde » à la ville-machine [47].
La ville comme environnement stérile
De cette même dynamique d’acculturation et d’acclimatement au numérique est né le Tubà, « tube à expérimentations urbaines », fruit d’un consortium entre partenaires publics et privés (le Grand Lyon, la Région Rhône-Alpes, EDF, Veolia, SFR, startups...), réunissant les « développeur.euse.s » et « makers » de la ville-machine au cœur du quartier de la Part-Dieu. Si ceux-ci affirment hypocritement « co-produire » la ville avec ses habitant.e.s en cherchant à les inclure dans sa transformation, cette soi-disant participation se résume en réalité à en faire les sujet.te.s d’une expérience client.e, des « utilisateur.trice.s tests », pour accélérer la mise sur le marché des prochains objets de la ville-machine. Un exemple de projet censé répondre aux besoins de la population par le « laboratoire à idées » : le test des iGirouettes, panneaux directionnels connectés. Bien loin de favoriser une logique horizontale qui laisserait aux êtres la possibilité d’agir instinctivement sur leurs lieux de vie, d’avoir une emprise sur le réel pour se l’approprier et y donner une âme, un sens, la ville-machine donne l’illusion d’inclure les personnes qui la peuplent dans son auto-production, bien qu’elle ne crée que de la passivité. Elle fait de nous un maillon du système industrialisé de production de la ville, un rouage au cœur du processus d’innovation. « La ville est donnée et préconstruite puis elle est à disposition, alors qu’ailleurs la disposition permet de rendre l’individu architecte d’un lieu [48] ». La concentration et la densité saturent l’espace et nous rendent la ville indisponible. « Cette ville markettée se dote de toute une clique de techniciens, acteurs de notre dépossession. […] Elle devient une ville-objet, à polir et à policer, non plus une ville aux formes et forces vives ». Ses « espaces se renvoient leurs propres reflets : les écrans, les vitres et vitrines, l’eau et le verre, l’acier et les panneaux solaires... Ils se reflètent l’image de leur perfection. [...] c’est un "surlieu". Une création du naturel parfait, bel oxymore. Il a tout. Le surlieu a de la réflexivité, il se pense, il fait retour sur lui même, comme dans un miroir ».
Quant aux espaces de liberté qui éclosent spontanément d’un besoin, d’une envie partagée par plusieurs personnes - friches squattées, lieux d’expression de la créativité humaine, zones vivantes et autonomes d’activités, d’entraide, de convivialité, d’habitations… -, ils sont difficilement tolérés, et la plupart du temps criminalisés. Toute initiative populaire ne faisant pas appel au numérique, à des entreprises et à l’administration, refusant les logiques de privatisation de l’espace, proposant d’autres pratiques de la ville, se retrouve précarisée, menacée à chaque instant par des contrôles administratifs et la pression policière, puis finit par être expulsée pour être démolie au profit de la promotion immobilière. La ville-machine, dictée par les intérêts du capitalisme technologique, se rit bien des besoins en locaux associatifs, lieux qui répondent gratuitement aux premières nécessités ou contribuent à rendre un quartier vivant. La ville-machine n’aime pas les pauvres, ni celles et ceux qui prennent part aux luttes sociales, solidaires, écologistes et autres, d’aujourd’hui. Elle n’aime pas non plus ceux et celles qui n’ont pas de projet. Vous n’êtes pas un.e « porteur.euse de projets innovants » encravaté.e et détenteur.trice d’un Macbook ? Passez votre chemin !
De l’ « utilisateur-test » à l’individu entrepreneur de lui-même
Il s’agit pour les individus eux-mêmes d’innover dans leur propre vie, du moins de suivre la fuite technologique et de s’adapter aux nouvelles infrastructures. S’adapter est l’injonction faite aux individus aux temps de l’innovation. Dans la technopole, c’est une nouvelle manière de vivre « ensemble » qui se dessine, chacun.e étant renvoyé.e à l’idée que les citoyen.ne.s, devenu.e.s tous et toutes petit.e.s entrepreneur.euses, ne serait-ce que de leurs propres vies, seraient « libres de s’associer et de s’entraider sur des "projets" [49] ». On produit l’image et la matrice d’une ville où tout un chacun.e est « libre » d’entreprendre et de vivre sa vie selon les codes de l’innovation, de compter sur les autres comme on fait un partenariat et de croire en soi comme on investit et on prend des risques avec un capital. Ainsi les relations humaines se marchandisent petit à petit via des plateformes qui valorisent tout capital, : une voiture ? Uber, Ouicar ou Blablacar ! Un vélo ? Foodora ou Deliveroo ! Quelques connaissances ? Superprof ! De la générosité ? Homeless Plus ! Valorisation de la misère ou misère de la valorisation qui se trouve bien loin des « quartiers numériques » qui possèdent des réseaux ultra haut débit fixes et mobiles, un fab lab, un « écosystème d’acteurs » dont au moins un « tech champion », etc.

La ville sûre, ou le règne de la Technopolice
« Make the World See [50] »
Selon les discours des politiques et les campagnes marketing des développeur.euse.s de solutions de techno-surveillance, nous vivons « dans un monde où les citoyens aspirent à se sentir en sécurité [51] ». Ce que nous pouvons constater, c’est plutôt que le pouvoir qui met en place les dispositifs de surveillance toujours plus intrusifs dans la vie urbaine n’est pas contesté par la plupart des individus qui ne se sentent tout simplement pas concernés par la surveillance, n’ayant, eux, « rien à se reprocher ».
Le pilier « sécurité » est l’un des objectifs les plus vantés par les promoteur.trice.s de la ville-machine, comme l’explique Marc Darmon, directeur général adjoint de Thales, groupe d’électronique spécialisé dans l’aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre : « la sécurité est, avec la mobilité, le pilier le plus réaliste de la smart city [52] ». Caméras de vidéosurveillance, drones, reconnaissance faciale, police prédictive... Nombreux sont les dispositifs imaginés et mis en place, lesquels, bien loin de ressembler au monde apaisé promis par la « vidéo-protection », nous plongent davantage dans un univers dangereusement sécuritaire. La métropole de Lyon ne manque pas à l’appel et saute même sur l’occasion pour se positionner en cheffe de file du projet européen Secur’cities. La région quant à elle se pose en Pôle d’excellence européen pour la Sécurité globale, projet né en 2013 en collaboration avec la Préfecture, la Métropole de Lyon et le cluster Safe, regroupement d’entreprises du secteur de la sécurité, dans l’idée de faire de la France le « leader européen de la sécurité [53] ».
Tout d’abord, les caméras de vidéosurveillance n’ont cessé de se multiplier : elles nous filment dans la rue comme lorsque nous empruntons des transports ou nous rendons dans un commerce. Le site non exhaustif Lyon Sous Surveillance [54] comptabilise dans les rues lyonnaises plus de 2000 caméras en prenant en compte les caméras privées – les caméras publiques s’élevant au nombre de 560. Le réseau bus-métro-tram Sytral serait de son côté armé de pas moins de 7700 caméras (embarquées et à quais). Quant au réseau TER d’Auvergne Rhône-Alpes, il fait l’objet de l’expérimentation d’un nouveau système de vidéosurveillance en temps réel comptant près de 1400 caméras [55].
La vidéosurveillance s’élargit désormais notamment à la vidéo-verbalisation, une des premières mesures de la mairie écologiste après les élections municipales de 2020. La vidéo-verbalisation est déjà expérimentée sur la Presqu’île et dans les 2, 3 et 7emes arrondissements depuis 2019. Son fonctionnement est le suivant : un.e agent.e assermenté.e se saisit des images pour dresser un procès verbal. Pour le moment, pas de traitement automatique de la donnée enregistrée. Selon le cadre de l’expérimentation lancée en 2019, il faut qu’un.e agent.e se trouve au Centre de supervision urbain pour pouvoir verbaliser. Les infractions verbalisables sont celles du code de la route : rodéos, stationnement gênant sur un trottoir ou en double file, conduite à contre-sens ou sur une voie de bus, franchissement d’un feu rouge ou d’une piste cyclable.
Par ailleurs, le Grand Lyon est désormais équipé du logiciel VisiMAX de l’entreprise grenobloise CASD, « solution d’enregistrement » dont les dernières mises à jour permettent « dorénavant de faire des recherches par vitesse, couleur, type et classe du véhicule, détection de visage ou de personne sur les caméras compatibles » et intègre « un nouveau module de géolocalisation » ainsi que la possibilité de la fameuse vidéo-verbalisation. Du côté de la périphérie lyonnaise, les villes de Vaulx-en-Velin et Vienne sont clientes de l’entreprise Briefcam, spécialiste des logiciels de traitement des données vidéos, comme le Vidéo Synopsis qui permet de regarder une heure de vidéo en une minute, de rechercher des éléments par taille, couleur, etc., mais aussi d’appliquer la reconnaissance faciale.
Caméra et logiciels auxquels s’ajoute l’apparition de drones dont l’usage par les forces de police s’est d’ores et déjà affranchi du cadre légal qui régit leur utilisation (cadre qui va subir quelques changements à l’occasion de la loi dite « Sécurité Globale »). Ils ont jusqu’à maintenant principalement servi à repérer, surveiller et signaler des attroupements, comme lors de manifestations ou pendant le confinement du printemps 2020 [56].
Enfin, Lyon et Villeurbanne utilisent les algorithmes de police prédictive de Map Revelation, « révélateur de territoire [57] », de l’entreprise Sûreté globale dont le but est de prédire la probabilité d’un méfait à partir des données de la police afin d’envoyer une patrouille au lieu et à l’heure déterminée. Ce « système complet [...] offrant toutes les fonctionnalités d’analyses, de statistiques, de planification, de gestion temps réel, de prédictions et de simulations spatiotemporelles » est opératoire dans différents domaines : police, sécurité et sûreté mais aussi big data, grid, géomarketing, open data, etc. Le caractère systématique, intrusif et totalisant saute aux yeux à la lecture des expressions publicitaires mises en ligne.
La machine à pénaliser
La tendance à la machinisation des procédures de contrôle ainsi qu’à l’automatisation de celles de gestion marque une avancée dans un monde toujours plus déshumanisé où l’objectivité froide d’une machine à incriminer se substitue à la vérité humaine. Les situations dans lesquelles nous pouvons faire l’expérience de notre obsolescence face à cette logique machinique ne manquent pas. Vous roulez sur l’autoroute, quand tout à coup pour éviter un accident vous êtes forcé d’accélérer. Quelques semaines plus tard, vous recevez une amende pour excès de vitesse. Vous voulez contester cette amende ? On vous rétorquera que les images enregistrées vous montrent bien en train de rouler au-dessus de la vitesse recommandée. Et cela est indubitable, vous en êtes coupable ! Vous ne pouvez contestez la réalité de ces images. Et pourtant votre témoignage pourrait vous disculper de cette infraction, mais votre parole importe peu. La parole humaine est mise au rebut, humiliée, délégitimée à chaque fois que les images et les machines prennent davantage de place dans la vie. L’image peut tout au plus capturer des instantanés du réel, et la machine, en déduire des comportements pré-dits « autorisés » ou « interdits », elle opère une réduction de la réalité par l’exclusion du sens qui a agi les situations.
Il ne s’agit pas de regretter l’existence d’une relation police-individu, comme si cette dernière multipliait les possibilités d’échapper à la logique indifférente de la procédure, mais de souligner la précipitation dans un monde où les possibilités d’explication, de friction, de confrontation à une autorité sont toujours plus rares au fur et à mesure que l’automatisation prend du terrain. Les faits verbalisables ne sont plus seulement ceux constatés sur place, au moment où ils arrivent, mais tous ceux qui peuvent être saisis par un.e agent.e suite à un enregistrement, et bien qu’il semble que, pour le moment, seuls les faits visionnés en direct puissent être verbalisés, on peut craindre un élargissement du procédé dans deux sens : à toutes les caméras et à tous les enregistrements. Nous voyons en outre poindre l’idée d’installer des logiciels capables de reconnaître toute une liste d’infractions et de traiter les images automatiquement (comme c’est d’ailleurs le cas pour les nouveaux radars qui en plus de la vitesse pourront déterminer le port de la ceinture et l’utilisation du téléphone portable), ce qui rendrait possible la mise sous surveillance de toutes et tous à tout instant, selon le déploiement et les angles de vues des caméras.
Dans le volet vidéo-surveillance, nous avons eu à Lyon courant 2020 deux cas de personnes condamnées après avoir été identifiées parce que filmées. La méthode utilisée jusqu’à maintenant, puisque le recours à la reconnaissance faciale automatisée n’est pas encore autorisé, est de croiser une capture d’image prise au moment des faits avec l’un des dossiers qui répertorient les identités des personnes déjà connues des services de police ou de gendarmerie [58]. Dans l’un des deux cas mentionnés, c’est donc un algorithme de reconnaissance faciale qui a été utilisé et qui a identifié Monsieur H. comme la personne dont l’image a été capturée par la caméra. Si cette affaire pose problème, c’est d’une part parce que la gendarmerie ne dispose pas d’image délictueuse, mais seulement d’une image de Monsieur H. à proximité du lieu où ont été commis les faits (vol de véhicule) ; d’autre part, parce que la recevabilité de la méthode d’identification est contestée. Ne nous attardons pas, toutefois, dans les méandres juridiques pour dénoncer directement, et une fois encore, un procédé machinique auquel est accordée une fiabilité démesurée (la reconnaissance d’un visage s’accompagne d’un taux de probabilités).
L’outil informatique sert d’ores et déjà les abus et un tribunal valide le recours à un procédé opaque : quels sont les biais inscrits dans l’algorithme, quels sont ceux ajoutés par les décisions humaines ? On remarque les abus et raccourcis qu’amplifie la délégation de la verbalisation ou de l’identification à des machines lesquelles répètent leurs biais discriminatoires sans contrôle.
Prédire le crime
Toutefois l’assistance technologique des forces de l’ordre ne s’arrête pas là. Parmi les promesses de la vidéo-surveillance assistée de l’intelligence artificielle, il y a celle de pouvoir empêcher les crimes et délits avant même qu’ils n’aient lieu ! C’est ce qu’on appelle la police prédictive et qui dans les faits est beaucoup moins mystique que dans le film Minority Report où les « précogs » télétransmettent les crimes à venir depuis un jacuzzi.
Nous pouvons adresser deux critiques à l’idée même d’une prédiction des méfaits (ou ceux jugés comme tels : crimes, délits ou autres). Premièrement, il est impossible de contredire l’efficacité du système de prédiction qui ressort toujours gagnant : si le méfait a lieu, l’algorithme a vu juste, s’il n’a pas lieu, c’est qu’il a été efficace grâce à la présence de l’équipage de police dans sa mission de prévention. Deuxièmement, l’expérimentation du système de prédiction montre que celui-ci renforce doublement la discrimination de certains quartiers où la présence policière est déjà forte. En effet, la donnée est alors plus nombreuse et l’algorithme traite donc le quartier concerné comme un lieu où la surveillance doit être accrue : « Les biais racistes dans les méthodes de collecte de données de la police se retrouvent à la fois blanchis par la prétendue objectivité de la machine et décuplés par un effet de renforcement (plus de données sur les quartiers en proie à la sur-policiarisation conduit à prédire davantage d’actes de délinquance dans ces quartiers, et donc à plus de patrouilles, qui génèrent à leur tour plus de données, et ainsi de suite) [59] ». De plus, les villes qui installent ce genre de logiciels échangent dans certains cas leurs bases de données avec celles de la police nationale comme « c’est le cas à Montpellier où pour nourrir le logiciel, la ville récupère de la police nationale plusieurs jeux de données (vols de véhicule, cambriolages, vols à main armée…). En échange, la ville communique à la police des données dont l’État ne disposait pas ("enquête de victimisation, interventions des services sociaux, remontées des bailleurs sociaux…") ». Ainsi des fichiers aux informations parcellaires deviennent de vrais dossiers d’informations globaux auxquels la ville de Montpellier envisage par exemple d’ajouter des données du type : « "mise en fourrière", "absentéisme, atteinte aux personnes et aux biens (éducation)", "signalement d’évènements d’insécurité provenant des services techniques et ressources humaines", "milieu associatif"… ».
L’intelligence artificielle appliquée à la vidéo-surveillance s’impose comme une instance pseudo-objective de surveillance de toutes et de tous dans tous les domaines de la vie. Elle reproduit et alimente la répression sur les populations dont la vie est déjà sous surveillance accrue, celles des allocations sociales, des quartiers populaires et cosmopolites, des marchés clandestins et de la marginalité, en un mot, celles qui offrent une résistance à la normalisation.
Gérer l’anormal
Derrière le discours sécuritaire d’une ville apaisée, le but est de gérer l’anormalité en se dotant d’une puissance d’analyse des situations. C’est ce que permet la généralisation de la vidéo-surveillance intelligente, reposant sur les caméras déjà installées, augmentée d’un logiciel de détection des « évènements anormaux » afin de faire remonter des alertes aux services de police. Les images sont analysées par une IA permettant un « traitement intelligent de l’image avec détection des mouvements de foules, objets abandonnés, situations inhabituelles… [60] ». Mais les applications visent aussi d’autres « anormalités », comme à Marseille où un « cahier des clauses techniques » définit ainsi les objectifs de la ville-machine : « détecter la préparation d’événements sauvages ou d’actes de délinquance [61] », comme des « apéros géants » ou des « marchés à la sauvette », de conduire une « analyse des Tweet, en s’appuyant sur l’identification des acteurs » par « remontée des fils de conversation ».
Parmi les comportements anormaux mis à l’index nous découvrons par exemple l’item « franchissement de ligne imaginaire », « mouvement de foule » ou « personne se mettant subitement à courir ». A quand l’item « marcher à contre-sens » qu’illustrerait l’image d’une personne qui se fraye un chemin à contre courant d’une foule se déplaçant d’un seul corps, cette image des mégalopoles aux heures de pointes et de « l’original.e » luttant contre cette marée humaine prête à l’emporter ? Cette image serait captée par l’une des caméras de la ville, vue de haut depuis un immeuble de plusieurs dizaines d’étages. Elle est le symbole des conséquences de la surveillance qui se mue en auto-répression chez les personnes qui se savent surveillées, qui restent dans les clous, surveillance qui se mue en contrôle, contrôle des masses par la stigmatisation du singulier. Ces masses qui d’ailleurs peuvent être désagrégées par la discrétisation des situations en petits morceaux, saisissables dans leur individualité (une personne, un geste, une parole).
La suspicion s’étend en outre aux domaines des libertés d’expression et d’association, libertés collectives. Lorsque les villes s’équipent de machines et logiciels toujours plus perfectionnés pour observer, capter, analyser, nous avons davantage de chances de nous trouver « capturé.e.s » par le filet des dispositifs. L’étau se resserre pour tous ceux et toutes celles qui subsistent dans les interstices ou dérogent à l’ordre établi, résistent à l’uniformisation et la passivité (en récupérant de la nourriture dans une poubelle, en fraudant les TCL, en organisant un marché solidaire…).
Intériorisation de la contrainte
Avant même toute répression, nous rappelle à l’ordre la présence des dispositifs de contrôle qui encadrent l’espace public (caméras, portiques, données émises par les smartphones et autres objets pucés, nudges, etc.). Dans l’incertitude face à une autorité diffuse, nous nous laissons, plus ou moins consciemment, influencer dans nos comportements. Par exemple : nous sommes dissuadé.e.s d’aller manifester, craignant d’être exposé.e.s à l’œil des caméras et logiciels de reconnaissance faciale [62]. Ou encore, le dispositif de surveillance encadre la manifestation et restreint le champ des possibles dans la conscience et la volonté des individus. Donc cette surveillance qui se couple avec le contrôle et la répression agit aussi par dissuasion : savoir qu’il est possible d’être arrêté.e chez soi après avoir participé à un mouvement peut être suffisant pour s’en décourager ou s’auto-censurer dans les moyens d’actions - comme ce fut le cas d’un gilet jaune lyonnais interpellé à son domicile, soupçonné d’avoir dégradé des banques lors d’une manifestation, identifié par le biais de la vidéo surveillance [63]. L’humain se trouve ainsi modifié par cette existence fondue dans les techniques de surveillance. Son rapport au monde est médiatisé par ces techniques qui réquisitionnent chaque fait afin de déterminer si c’est une donnée problématique. Les effets du Panopticon se sont échappés des cellules individuelles conçues par Bentham [64], mais les ressorts restent identiques. Nous savons qu’une surveillance est possible, sans savoir déterminer si elle est effective et efficace. Certain.e.s que nous pouvons être regardé.e.s, nous ne savons pas si nous le sommes effectivement. Le fonctionnement du pouvoir devient automatique. La puissance s’actualise, s’effectue, en chacun.e de nous. Nous avons intériorisé le regard extérieur dans nos propres conduites, et ce regard s’est étendu à la ville toute entière.
« Naviguer en mode privé » dans l’espace public ?
Enfin, le développement des dispositifs numériques d’authentification qui envahissent la ville semble signer la fin de la possibilité d’une forme d’anonymat. C’est le cas dans les transports où se multiplient les moyens d’identifier et tracer les usager.ère.s. Voyez par exemple les TCL et la propagande autour des « E-Tickets » dont l’achat est automatiquement rattaché à un ou plusieurs matricules (compte TCL, carte bancaire, téléphone et toutes les métadonnées qu’il moucharde : heure, lieu, marque, etc.). La volonté également de voir disparaître « les tickets magnétiques au profit de tickets sans contact rechargeables [65] ». Ces derniers intègrent une puce RFID qui permet le stockage d’un numéro d’identification. Dans un futur hypothétique, ces tickets rendraient possibles de nouveaux moyens de traçage. Toujours de manière hypothétique, on peut imaginer le rattachement du numéro du ticket avec celui de la carte bancaire qui a servi à l’achat ou encore, le pointage des entrées et sorties grâce à des capteurs installés sur les portes d’accès aux moyens de transports (bus, tram, rames de métro). Fin de l’anonymat également à la SNCF où la normalisation des e-billets s’est faite en même temps que leur nominalisation obligatoire pour quasiment tous les trajets. Seuls les trajets en TER peuvent encore s’effectuer de manière anonyme, même si la non-présentation d’une pièce d’identité lors d’un contrôle est passible d’une amende. De toute évidence, le e-billet s’impose, ainsi que son achat sur Internet via son compte client, aidé par la fermeture des guichets. Dans la même dynamique, Sébastien Kaiser, directeur Connectivité & Réseaux chez SNCF évoque, parmi une panoplie d’usages attendus de la 5G, l’installation de portes d’embarquement automatiques à reconnaissance biométrique dans les gares [66]. Les portiques à reconnaissance faciale sont d’ailleurs déjà expérimentés par Vinci à l’aéroport de Lyon, via deux compagnies aériennes qui y séjournent.

Mais la logique d’un traçage total peut aller plus loin encore, et le Grand Lyon expérimente depuis plusieurs années un pass urbain, récemment baptisé Trabool, « porte-clé RFID », support unique d’accès à l’ensemble de ses services (péages, parkings, TCL, TER, Vélo’v, crèche, déchetterie, musée, bibliothèque, piscine… et pourquoi pas y inclure des services privés), « pour faciliter la vi(ll)e de tous les habitants [67] ». On accède désormais, et à la demande, à la diversité offerte par la fête urbaine grâce à son smartphone ou une carte à puce sans contact, ou même comme c’est déjà le cas dans certains endroits du monde, avec une puce biométrique sous-cutanée. Le sujet de la surveillance est en lien intime avec celui de la ville-machine, comme l’une de ses composantes qui lui permet de s’accomplir. Le discours sécuritaire de la « Safe city » légitime à ses yeux l’expansion des dispositifs de contrôle des masses, de surveillance et de répression des marges dans tous les domaines de la vie. Ces dispositifs se déploient via leur acceptation myope par des individus dont la vie conforme semble ne pas laisser craindre la répression. Ils se déploient par la contrainte exercée sur les récalcitrant.e.s qui refusent qu’on les prenne pour des suspect.e.s ou qu’on leur impose toujours plus de gadgets et d’appareils, mais aussi par la force face à celles et ceux pour lesquel.le.s la question ne se résume pas à la vie privée et à la tranquillité mais met directement en cause l’autorité et l’hétéronomie.
La ville participative, ou la fin du politique
Remplacer le sens par le signal
Que ce soit entre l’administration et le ou la citoyen.ne, le propriétaire et le locataire, l’habitant.e et l’institution, la métropole est décidée à mettre en place partout où cela sera possible des « outils numériques ». En effet, les interfaces digitales et autres plateformes de contribution dématérialisées seraient la solution pour « renouveler le dialogue entre habitants et institutions [68] » ainsi que « (re)créer une relation de confiance ». Le numérique deviendrait le « nouveau support de communication entre les habitants et les pouvoirs publics », censé favoriser « un contact plus direct entre le citoyen et l’administration et une remontée d’informations de l’habitant aux décideurs facilitée pour une meilleure prise en compte de leurs besoins ». A Lyon, c’est par exemple l’application CityLity, devenue aujourd’hui CityZenDesk, conçue par une start-up locale, qui a vu le jour pour remplir ce rôle. A l’origine, plateforme pour « aider les syndics d’immeuble à mieux communiquer avec les copropriétaires et les locataires [69] », elle s’est d’abord étendue à la communication entre voisin.e.s pour finalement proposer aux villes et collectivités des « outils numériques » pour améliorer l’ensemble du « service urbain ». Les habitant.e.s sont désormais invité.e.s à faire remonter à la collectivité les « bugs » de la ville, afin que les services concernés puissent agir ; c’est-à-dire signaler, depuis leur smartphone « un nid de poule, un éclairage défaillant » ou bien répertorier, photo à l’appui, « les poubelles de recyclables, les prises pour véhicules électriques, les défibrilateurs... ». L’application offre également un service pour « accompagner » l’habitant.e-usager.ère dans sa citoyenneté. « La ville peut lui communiquer des choses ou lui demander son avis », mais le ou la citoyen.ne doit aussi pouvoir « "customiser" les services et applications déployés [70] ». Comme le clament fièrement les concepteur.trice.s de l’application, « participer au confort de son quartier et s’impliquer en faveur de sa ville n’a jamais été aussi simple [71] ». Enfin, la ville-machine promet de booster « l’empowerment » des citoyen.ne.s à coups de civic tech, « nouvelles formes d’engagement par le numérique », encourageant les habitant.e.s à dialoguer avec leurs élus, participer à des sondages, exprimer leurs opinions ou encore mieux, faire du « lobbying citoyen » sur la Toile.
En réalité, les « interfaces conversationnelles » reliant les individus entre eux permettent moins la conversation qu’un échange de signaux robotisé en vue de répondre à des objectifs le plus souvent utilitaristes. Nos relations sont davantage stratégiques, orientées vers un but, que communicatives, soit orientées vers l’entente. Par la facilité avec laquelle nous pouvons instantanément « accéder » à l’autre, par le caractère codifié, programmé de ces échanges médiatisés par le numérique, où règnent l’efficacité, la réaction, l’instantanéité, où nous cherchons à faire aboutir des demandes précises, les relations humaines sont toujours plus instrumentalisées, et nos manières d’être avec les autres, toujours plus simplifiées. Or la politique implique la discussion (discutere : fendre, fracasser, s’opposer), la capacité de parlementer (converser, délibérer). Comme cela peut-être le cas dans une causerie, dans un bar associatif de son quartier, dans une Assemblée Générale, dans les rues de la ville, où colères et rêves prennent corps dans des voix animées. La pénétration de la cybernétique jusque dans nos rapports sociaux se dévoile dans la réduction de la pensée dialectique à un processus de « feedback ». Cet échange de signaux est conditionné par des règles programmées : il doit viser la simplicité, l’économie de signes, la transparence totale et donc l’absence d’intériorité… Alors que dans la communication (communere, mettre en commun), c’est tout l’être qui s’exprime et sa vie intérieure qui se devine, ce qui permet qu’il s’intègre dans un processus de dialogue, lequel ne peut être réduit au système stimulus-réponse informaticien. En cédant à la ville-machine et ses supports de citoyenneté, nous abandonnons l’usage explicite de la parole et ce qu’elle contient de riche, d’implicite, de sens cachés, au profit du langage d’information purement fonctionnel de nos machines : un émetteur envoie un message à un récepteur, point. Enfin, plutôt que d’encourager l’aménagement d’espaces autonomes de réunion et d’auto-organisation, qui demandent assez peu de moyens, numériser la citoyenneté implique de soumettre les rapports sociaux à une dépendance toujours plus forte aux nouvelles start-up du Web qui se régalent de ce nouveau marché qu’est la « démocratie digitale ». Sans parler des laissé.e.s-pour-compte pour lesquel.le.s il deviendra difficile, sans smartphone ou connexion Internet, d’« exprimer sa fibre citoyenne ».
Citoyennisme 2.0
Les dispositifs numériques, conçus pour créer un ersatz de pouvoir politique, réduisent le sentiment d’appartenance à une communauté – dont pourtant ils font la pub - et la capacité d’agir sur la société à un « retour client », faisant de l’habitant.e une sorte de consommateur.trice-touriste de la ville, renseignant les éléments perturbateurs de son « expérience » de la ville, « laissant son avis » comme il ou elle le ferait sur Tripadvisor ou sur Google. Sa marge de manœuvre est limitée à la contribution à une grande base de données ne favorisant rien d’autre que la gestion de la ville fluide ainsi qu’à la cartographie de ses dispositifs machiniques pour mieux en huiler les rouages. Ensuite, toutes les interfaces individuelles, produits de l’individualisation, accentuent l’atomisation de la société bien plus qu’elles n’y pallient, substituant à l’expression touffue de collectifs plus ou moins organisés la froideur d’une somme d’avis particuliers. Comme sur les réseaux où chacun.e exprime son propre « coup de gueule » sur son mur, partage des idées à travers des « publications », sans que jamais n’en résulte une tentative de mise en commun pour en faire émaner un prolongement dans le réel. De plus en plus, habiter une ville consiste à être un acteur.trice du spectacle immatériel qui se joue sur nos écrans (les TCL nous invitent à poster sur Instagram, la vie politique a lieu au sein de batailles de hashtag, toutes les institutions communiquent via Facebook, etc.). Alors que nous avons toujours plus le sentiment que tout nous échappe et que nous ne pouvons pas changer le cours des choses, nous sommes renvoyé.e.s à notre propre solitude derrière nos écrans sourds et muets ; et alors que les espaces publics se dépeuplent, les non-lieux numériques cultivent notre sentiment d’impuissance, nous ramenant à notre petitesse face à des forces qui nous dépassent. La ville-machine fait disparaître les corps de l’espace public pour les isoler dans des cellules individuelles [72], elle tend à réduire les occasions où nous occupons physiquement l’espace public et ressentons dans notre chair que nous faisons corps ensemble, que nous pouvons faire poids, peser, constituer une force. La ville n’est plus l’espace public d’une co-habitation, mais le produit de l’agrégation d’une multitude de comportements privés et encadrés : elle n’est pas le lieu d’un être-ensemble mais celui où est réunie la séparation d’individus seuls ensemble.
Cyber-communauté et communauté déréalisée

La ville-machine en tant que lieu politique a donc comme horizon la formation non pas d’une communauté humaine, mais d’une cyber-communauté. L’espace public devient le Web, un cyber-espace où la connectivité prend la place de la socialité. Les liens réels sont remplacés par la connexion de toutes et tous au réseau qui relie les individus aux organes de décision. L’on pourrait y voir une démocratisation de la parole, une multiplication de la participation, mais nous assistons en fait à l’étiolement des liens humains qui font la richesse des interactions et des rencontres, au profit d’une dispersion et d’un isolement des individus, chacun.e derrière son écran, chacun.e borné.e à son point de vue. Grâce au Web, je peux d’ailleurs me sentir beaucoup plus « proche » d’une personne qui, à l’autre bout du monde, partage les mêmes passions, hobbies, ou centres d’intérêt, que de mes voisins et voisines avec lesquelles je partage le même lieu de vie. C’est la communauté réelle qui se trouve ainsi dissoute. La ville comme lieu politique se désintègre dans le spectacle total de sociétés au sein desquelles n’est offerte aux individus que l’illusion de la participation. La participation politique qui nous est promise appartient en effet à une vision galvaudée de la politique. La ville-machine accomplit bien plutôt, à son échelle, le gouvernement par les nombres [73], en collectant toujours plus de données et en adaptant les discours en fonction de la « température » ainsi sondée.
Tyrannie technologique et fabrique du consentement
La démocratie participative devient un marché, comme le démontrent les études menées par l’ObSoCo (Observatoire Société et Consommation), « société d’études et de conseil en stratégie », pour tâter le terrain des imaginaires et aspirations des êtres humains afin de délivrer des conseils aux institutions et entreprises dans le but qu’ils optimisent leurs discours. Une première étude destinée aux usages émergents de la ville [74] montre une aspiration des habitant.e.s des grands pôles urbains à vivre ailleurs, dans une ville plus petite, ou à cultiver des jardins partagés. Plus de la moitié des métropolitain.e.s aspirent à quitter la ville et changer d’air, y dénotent l’omniprésence des nuisances telles que la pollution, le bruit, la promiscuité ou encore le manque de lien avec la nature. L’idéal de la « ville nature » et « autosuffisante » l’emporte largement sur celui de la « ville connectée » et « diffuse », relégué à la dernière position. Une seconde étude dédiée à la question de l’habitat [75] montre que l’« habitat connecté intelligent » est la dernière préoccupation des gens parmi leurs critères de choix décisifs du logement. Quant à l’idéal de cadre de vie, le village arrive en première position et la ville futuriste et dense, en dernière. Autre information intéressante : plus de deux français.es sur trois refusent le principe de captation de leurs données personnelles, élément pourtant essentiel à la machinerie cybernétique. Paradoxalement, la ville-machine est bien l’horizon commun dans lequel nous sommes incrusté.e.s. Dans sa volonté totalisante, elle nous dépossède de toute parole porteuse d’un autre projet de société. Opérer le virage des nouvelles technologies pour la ville, ce n’est pas une option dont on envisage la discussion ; c’est une réalité « inéluctable ». En ce sens, ce n’est pas à nous de décider si ce virage est souhaitable, nécessaire ou non, c’est aux représentant.e.s de la technocratie et ses individus agentiques, petits soldats de la dépossession organisée, de prêcher son incontournabilité, afin d’en faire un projet en apparence pragmatique mais qui porte en lui l’idéologie froide et machinique de la gestion. La ville-machine clôt une dimension essentielle de l’existence : l’ouverture vers l’à-venir à partir de laquelle se déploient nos vies. La litanie d’un futur déjà présent, omniprésente dans les discours médiatiques en tous genres, nous empêche de se rapporter à l’avenir comme à quelque chose qui résulterait de choix personnels et collectifs. Comme lorsque la ville dans laquelle nous vivons est celle « de demain » ou qu’EDF base sa propagande sur le slogan « Notre avenir est électrique, et il est déjà là [76]. »

Les promoteur.trice.s de la ville-machine l’ont bien compris : son déploiement sans l’adhésion de ses habitant.e.s, risque de rencontrer certains obstacles, et d’aller contre l’image d’une « ville participative », de grignoter son vernis démocratique. Alors ils et elles se démènent, passent d’un poste à un autre, du secteur privé au public, d’une tribune à un conseil d’administration. Quelques exemples suffisent à montrer l’accointance public/privé très généralisée : l’ancienne cheffe de projet ville intelligente de la métropole a fait ses armes chez Véolia et Total pour ensuite aller diriger le H7, ou encore Gérard Collomb lui-même qui se mue en VRP d’Enedis lorsqu’il s’agit de faire accepter les compteurs Linky. Il y a donc un travail à opérer sur les consciences pour garantir l’acceptabilité sociale de la ville-machine. Comme on le trouve bien résumé dans le rapport d’Amcham France (Chambre de commerce américaine) sur le futur des villes, le principal enjeu réside dans « la capacité des opérateurs à faire accepter la digitalisation des villes et à l’intégrer concrètement dans la vie des gens [77] ». Ou encore, dans « l’éducation des usagers à l’importance de la donnée en tant que matière première de la Smart City, pour une collecte consentie et légitimée ». La communication et la pédagogie sont donc au cœur du vaste projet d’intégration de l’humain à l’inévitable monde-machine [78]. Comme stratégie pour remédier au manque d’enthousiasme pour une ville connectée, naît l’illusoire « réponse aux besoins des usagers » : « autre écueil à éviter : partir des solutions et déployer des outils sans avoir sondé assez finement les attentes des usagers. La solution technique ne signifie pas l’acceptabilité sociale : certains projets smart ne parviennent pas à se faire adopter par les citadins. Le point essentiel tient dans cet énoncé : la ville intelligente doit avant tout répondre aux besoins des usagers [79]. » Et pourtant nombreux sont les exemples qui témoignent de cette supercherie.
Autoritarisme de l’innovation et impuissance politique
Courant 2017, la multinationale américaine de la publicité urbaine Clear Channel se voyait attribuée par le Sytral la mission de digitaliser le métro de Lyon. Du jour au lendemain, les quais des différentes stations du réseau étaient envahis de « totems digitaux » diffusant en continu publicités mouvantes et lumineuses, et la station Bellecour se retrouvait équipée d’un écran géant double face. Au même moment, la Métropole acceptait que l’industriel JCDecaux dissémine une centaine de panneaux publicitaires numériques dans les rues - bien que la réglementation en vigueur ne le permette pas -, en échange du financement d’une nouvelle flotte d’E-Vélov, vélos hybrides avec batteries amovibles, destinés à remplacer les obsolètes Vélo’v à énergie humaine, épaves d’une époque définitivement révolue. Un collectif d’habitant.e.s s’emparait alors de l’affaire pour dénoncer cette invasion de l’espace public par toujours plus d’écrans : une pétition fut lancée et de nombreuses actions menées dans la rue pour contester la décision de la Métropole. Face à cette indésirable agitation, celle-ci lançait en janvier 2018 une « concertation publique » pour l’élaboration du Règlement local de publicité (RLP). Quatre mois plus tard, le collectif transmettait à la Métropole un rapport [80] sur les nombreuses nuisances (sanitaires, environnementales, esthétiques…) induites par les écrans de JCDecaux. Insatisfait par la passivité de la Métropole, début 2019, le collectif lançait sa propre enquête [81] sur le rapport des habitant.e.s à la publicité dans l’espace public, recherche qui a permis de confirmer que pas moins de 97% des habitant.e.s se déclaraient défavorables ou très défavorables à ces écrans. Quelques mois plus tard, la Métropole publiait une nouvelle proposition de RLP qui ne fit que renforcer le sentiment d’impuissance des habitant.e.s. L’institution continuait en effet de faire la sourde oreille, défendant l’expansion des supports de publicitaires digitaux, sans jamais prendre en compte, ni répondre aux arguments du collectif. Elle balayait d’un revers de main toutes les problématiques soulignées par les habitant.e.s, trop occupée dans sa rhétorique technologiste à parler « marché économique », « offre numérique » et « levier de croissance ». Malgré leurs nombreuses tentatives de se faire entendre, et bien que le RLP n’ait pas encore été acté, en octobre 2019 plusieurs panneaux publicitaires temporaires apparurent sur les berges du Rhône, dont un panneau numérique, expérimenté pour promouvoir les JECO (journées qui réunissent des économistes dont un des thèmes principal est… le numérique). Le collectif dénonça aussitôt l’implantation illégale de ces dispositifs dans le plus grand mépris des habitant.e.s et demanda son retrait immédiat. Quelques jours plus tard, le panneau fut finalement cassé. Interrogé par Lyon Capitale, le directeur régional de JCDecaux osait dénoncer des « pratiques totalement anti-démocratiques [82] » et affirmer « que les citoyens sont très satisfaits des fonctionnalités et services apportés par le digital ». Aujourd’hui, la Métropole de Lyon a finalement trouvé un autre moyen de financer ses Vélo’v 2.0… Une victoire pour les habitant.e.s ? Pas si sûr…
Dans le même contrat datant de 2017, parmi les prestations supplémentaires éventuelles proposées par le géant industriel, la Métropole retenait l’installation d’antennes (small cells) sur les mobiliers afin de répondre à la demande des opérateurs télécoms d’une extension de leur réseau mobile 3G, 4G et 5G [83]. Bien avant que la question de la mise en place de la 5G ne devienne publique, au moment où les premiers appels à la prudence, critiques et contestations peinaient à se faire entendre autour du globe, la ville se tenait donc déjà prête à l’accueillir. Et alors même que les personnes réquisitionnées pour la Convention Citoyenne pour le Climat, cette « expérience de démocratie participative » lancée par Macron lui-même, votaient en juin 2020 à 98 % pour un moratoire « en attendant les résultats de l’évaluation de la 5G sur la santé et le climat », elles se virent simplement répondre avec cynisme par le président que la 5G serait déployée coûte que coûte, tout simplement « parce que c’est le tournant de l’innovation [84] ».

Ces différents cas nous donnent une idée de la manière dont les « innovations » sont imposées dans la société : des dispositifs sont imaginés, conçus par une alliance entre l’État et les entreprises pour conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles sphères d’extension de leur puissance, complètement déconnectés des réels besoins et désirs des personnes concernées en premier lieu par ces changements. Des expérimentations illégales ou « provisoires » s’installent afin de nous y habituer, puis les normes légales sont revues pour obtenir leur dissémination. Parfois, des pseudo-débats ou concertations sont organisées dans une totale discrétion, prenant le silence d’une majorité désintéressée par la chose publique pour un consentement. Quant à ceux et celles qui s’y intéressent de plus près, ils et elles sont mis.es devant le fait accompli. Leurs avis sont recueillis au mieux pour être ignorés, au pire pour être détournés en matière à donnée. Cette matière alimentera les études des sociologues, lesquels en déduiront les « conditions d’acceptabilité » d’un dispositif ainsi que le discours idéal pour le rendre « acceptable », ou même donner l’illusion qu’il est au service de diverses causes (écologique par exemple). « Des travaux sont menés sur les mots, sur le vocabulaire employé, qui peuvent faire barrière à une bonne compréhension et utilisation de ces nouvelles technologies [85] ». Si la ville-machine se dit en façade « concernante », voulant soi-disant permettre à chacun.e de devenir « acteur.trice du territoire » en facilitant « la participation citoyenne », la réalité donne davantage l’impression d’un autoritarisme qui avance masqué [86]. C’est peut-être ce que signifient les mots de l’ancien président de la Métropole lyonnaise, lorsqu’il déclare que d’ici quelques années, « on ne parlera probablement plus de smart city. On l’aura intégré [87] ».
Conclusion
Tandis que la ville pose une limite et se définit par sa finitude (elle est originairement marquée par une enceinte/des remparts), et qu’ainsi elle vient installer l’être humain au sein du monde et configure son être-dans-le-monde par la différenciation d’avec le Tout, la métropole marque la disparition de la limite. C’est de cette manière que nous avons tenté d’en esquisser les dynamiques et non plus les contours qui explosent sous l’influence de celles-ci. La ville ne peut plus désormais se définir par rapport à une limite car ses mutations l’intègrent essentiellement au réseau planétaire de mobilité des flux. La communauté elle-même est communauté mondiale dont les liens se font et se défont au gré des connexions à l’Internet. Dans ce réseau de villes, chacune entre en concurrence et en compétition avec toutes les autres.
Extension planétaire d’une part, mise en concurrence et compétition d’autre part, sont deux caractéristiques du capitalisme qui impose sa logique d’illimitation : accroissement infini du capital par le mouvement répétitif et sans repos des marchandises. La ville est le lieu de circulation de la marchandise : son point de passage ou d’acheminement. Elle est surtout le lieu où l’entassement des humains et le fourmillement de leurs activités produit une nouvelle marchandise, la donnée, et permet l’extension du capital par la conquête ou l’ouverture du cyberespace. La ville n’est donc plus le lieu de la fixation des individus et des flux, mais le lieu à fluidifier plus encore pour générer de la donnée. Elle n’est par la suite plus un point de repère mais doit devenir un accélérateur. Dans les réflexions qui entouraient la cité antique, dans sa vie et son exercice même, s’imposait la question de sa mesure. La voix et le regard mesuraient sa dimension. La portée de la première devait permettre à chacun.e de s’exprimer à l’ouïe de toutes et tous lors d’une assemblée, tandis que le champ de vision du second devait l’englober toute entière. Le doigt, la paume et le pied étaient des unités de mesure qui nous indiquaient que l’individu en chair et en os, doué de sensibilité, était le maître étalon d’une ville « à taille humaine ».
Il nous faut, quant à nous, reconnaître que les plus beaux points de vue sur la ville de Lyon ne nous permettent pas de la saisir d’un seul coup d’œil. Le site où se tient Lyon, entourée de collines, nous donne toutefois le loisir de jeter un œil sur ce qu’on appelle encore le « centre ». Mais c’est pour mieux voir que le bâti s’allonge démesurément, que notre existence ne représente qu’un minuscule point dans une aire urbaine si étendue. Cet aperçu nous permet également de remarquer la structuration de la ville par les axes de mobilité motorisée (les cours qui la quadrillent, les voies rapides qui la percent). Sa magnétisation par les points cardinaux que sont les gares et les avenues commerçantes. Un regard plus lointain devine sa situation internationale (port et aéroport). L’œil perçant peut reconnaître, les distinguant des nuages, les fumées soufflées au vent s’échappant des cheminées des réacteurs nucléaires qui approvisionnent la ville en énergie. Dépassement de la limite autrefois théorisée mais aussi déplacement des étalons de la mesure : touristes, étudiant.e.s et néo-habitant.e.s désigné.e.s comme « talents », investisseur.euse.s et investissements, témoignent, par leurs flux, de l’attractivité de la ville. Le maître étalon, quant à lui, est la devise monétaire dont le compte a depuis longtemps dépassé l’ordre du sensible (millions et milliards !).
Ces lignes sont écrites dans une agglomération dont le slogan est archétypique de ce que sont devenues les villes : « entre ville et campagne ». Soit dans un non-lieu, la banlieue, continuation des villes qui se sont affranchies de leurs limites. Les villes implosent dans leur processus de métropolisation, annulent leur différence avec la campagne puis se trouvent dissoutes dans l’indifférenciation. C’est donc la banlieue qui s’étend partout pour conquérir la différence ville/campagne. Ainsi la ville est remplacée par la zone urbaine, véritable zonage de béton et de tôle qui n’en finit plus de s’étendre. Cette mort de la ville au profit de la zone engendre un bannissement du lieu.
L’urbanisation est une rationalisation de la production de l’espace bâti, et toutes les banlieues se ressemblent, tous les centres-villes s’uniformisent. Le processus d’urbanisation est conduit selon les plans eux-mêmes construits (dessinés, maquettés, modélisés sur ordinateur) à partir d’abstractions. Ce sont les normes juridiques et celles des logiciels, l’uniformisation des matériaux et des techniques de construction, qui commandent les appels à projet.
Ainsi encore, la ville n’est pas construite à partir d’une expérience quotidienne et vécue mais au contraire donne à vivre l’expérience de la concrétisation d’un plan. Plus encore avec sa numérisation, elle se donne tout d’abord à l’écran, puis comme un prolongement de la vie écranique. Avec la ville-machine, ce sont les existences qui se rationalisent, c’est-à-dire qui se trouvent soumises au calcul, à la prévision et à l’évaluation. Elles doivent être fluides et efficaces, on y mesure et compare les flux, que l’on contrôle et qui doivent générer des profits.
Dans la banlieue, les places et endroits deviennent des points sur une cartographie numérique ou sur un plan de métro. S’ils sont toujours les endroits où l’on se rend, on désapprend à emprunter les voies qui y mènent. Nous repérons seulement les points sur une carte et suivons les segments les plus rapides. Souvent, ceux-ci sont dessinés par le métro, ainsi « à vol d’oiseau » se parcourt sous terre, dans le véritable système nerveux de la ville. Nous n’habitons plus la rue.
Ne comptent plus les chemins (les aventures et expériences : le cheminement) mais seulement les destinations, les points de la carte (que pourrait valoir un trajet en métro, chaque jour répété et monotone ?). Et d’ailleurs, les stations de métro orientent désormais l’habitant.e devenu.e zoneur.euse, donnant son nom à la zone d’influence créée par son ouverture souterraine sur le réseau, sa béance infernale. La banlieue s’intensifie de deux manières : aux points de coordonnées qui sont ses épicentres et par les flux qui l’animent. Cette prédominance des coordonnées et des flux dans l’expérience de la ville rend impossible de la vivre comme lieu d’habitation.
La ville n’est alors plus vécue mais tout juste vue, à travers un écran bien sûr. Le boulot, les courses, la sécurité, les relations, les rencontres, etc. ont toutes besoins d’une interface. La caisse, la caméra, le smartphone, qui tous sont des ordinateurs, ordonnent, qui tous sont des computer, comptent et calculent. Interfaces où se manifeste la vie bafouée, biffée, par le calcul, la ratio. Spectateur.trice de l’écran, nous devenons passif.ve.s. Re-dimension de l’espace par la fusion de la ville avec son double numérique. La ville-machine ne fait pas que prendre possession de l’espace matériel, mais colonise les savoirs-faire, les savoirs-être et les imaginaires des individus pour les dissoudre dans le tout de la ville numérique, où chaque chose se fait ou se rêve derrière un écran. Glissement de la réalité derrière les écrans, qui justement ne sauront plus pour longtemps faire écran, d’une part devant l’immense perte des rapports humains qui se délitent et se défilent, d’autre part devant l’immensité de nuisances qu’ils provoquent.
Nous nous sentons plongé.e.s dans des modes de vie toujours plus oppressés et restreints au champ du numérique, où les relations humaines, pour ce qu’il en reste, sont de plus en plus codifiées et médiatisées par les technologies de l’information et de la communication et par les réseaux dits « sociaux », soit au sein d’existences dont l’affairement est le signe d’une agonie qui ne sait pas comment faire pour ralentir. Pour donner avec les mots d’un autre ce que nous pensons être l’avenir proche de nos sociétés, telles qu’en elles, la vie hybridée avec la machine est réduite au fonctionnement :
« Au-delà de certains seuils, la rationalisation de la vie sociale en vue d’une plus grande efficacité administrative, technique et économique engendre de nouvelles forme d’oppression, en s’opposant au mouvement spontané de la vie, en réduisant l’autonomie de ses membres et en portant atteinte à la liberté des individus. Pour Mumford, la "Mégamachine" est l’organisation sociale dont le modèle est la machine, dont les éléments ont des rapports fixes et déterminés une fois pour toutes et dont l’action est calculable et prévisible, réduite à ses fonctions strictement matérielles : organisation de la production et de la distribution des biens et des services. Pour lui, le totalitarisme dépasse donc largement le cadre des seuls régimes nazis ou staliniens, et ses tendances sont encore à l’œuvre dans le « monde libre », les sociétés industrielles avancées [88] . »
Face au solutionnisme technologique, au nom duquel nous est imposée la ville-machine, nous aimerions mettre en avant deux choses. La première : qu’il n’est aucune situation, qui pourrait être déterminée ou définie comme étant la nôtre, à laquelle il s’agirait tout bêtement (ni même de manière smart) d’apporter une solution, La Solution. Ce raisonnement est proprement technicien qui cherche à dissoudre les problèmes dans des solutions sans jamais (s’)ouvrir au questionnement. La deuxième : que les solutions qui nous sont « proposées » le sont de manière hétéronome par une société où priment l’expertise et la spécialisation. Ainsi, nous pensons que plus nous faisons appel à des technologies de pointe, plus nous accentuons notre dépendance à l’égard des logiques qui concordent à leur fabrication et à leur mise en vente, ainsi qu’à la dépossession de notre pouvoir de décider collectivement et d’agir. Pour donner un exemple, le développement durable et la transition écologique, qui s’appuient toutes deux sur un dispositif démesuré de technologies hautement sophistiquées, sont des enjeux proprement industriels.
Contre ce que nous pourrions désigner avec Lewis Mumford techniques autoritaires, nous aimerions voir émerger ce qu’il appelle des techniques démocratiques. Face au mot vague et mystificateur de Smart City, nous préférons celui (plus révélateur) de ville-machine.
Par ce texte nous avons voulu faire apparaître pleinement les mutations qui gangrènent la ville. Car si ce n’est pas une « simple facilité rhétorique » de « parler du monde actuel [de la ville-machine] comme d’un cadavre en décomposition [89] », il faut tout de même savoir reconnaître d’où proviennent les puanteurs qui s’échappent de ce corps putride. Nous avons tenté d’en signaler quelques caractères, points névralgiques, éléments de propagande, ainsi que les dynamiques qui sous-tendent tout cela. A chacun.e alors d’approfondir le constat que nous essayons de dresser et que nous proposons. A chacun.e également de trouver les manières de résister, de contrecarrer, de s’opposer, ou de combattre, seul.e et collectivement, les forces qui imposent à la vie et à la ville, l’enfermement dans les lois abstraites de la rationalisation, de l’efficacité, de la rentabilité. Nous réservons donc l’étude de ces moyens et des forces d’oppositions déjà existantes au discernement de chacun.e. Loin de mots d’ordres prémâchés et sans rentrer dans une exhortation de type guerrier voire militaire, au fondement de notre rébellion il y a l’idée qu’un espace politique commun ne peut se réaliser sans un aller-retour perpétuel entre action et rencontre ; qu’en celui-ci se forgent les préoccupations et valeurs communes qui créent un collectif, une communauté retrouvée.

[1] Élue première « Smart City » française au Global Smart Congress and Awards (2013) ainsi que première ville intelligente française au M2OCity (2013). Sur la plus haute marche du podium des « Smart City » française, et portée par son implication dans l’expérimentation des « Smart grids », au classement établi par le magazine objetconnecte.com. Lauréate du Prix de l’innovation urbaine pour le quartier Lyon-confluence au concours Le Monde Smart Cities (2017). Classée vingt-huitième « Smart City » mondiale et première française par le Smart Cities Index du groupe EasyPark (201f9), avec, nous apprend-on un score « quasi-parfait en Protection de l’environnement ». En chute de 28 places, cinquante-et-unième mondiale, mais toujours première française au très sérieux « Smart City » index élaboré par l’International Institute for Management Development (IMD), le Smart City Observatory (SCO) et l’Université de technologie et de design de Singapour : sanctionnée car elle n’a pas réussie à imposer les panneaux numériques dans ses rues ?
[2] Le Monde, 17 mars 2009, (publicité en 7 épisodes).
[3] Pièces et main d’œuvre, IBM et la société de contrainte, brochure, 2010. Retrouvez ce texte parmi d’autres dans leur livre L’Industrie de la contrainte, L’Échappée, 2011.
[4] Edwin Black, IBM et l’Holocauste. L’alliance stratégique entre l’Allemagne nazie et la plus puissante multinationale américaine, Robert Laffont, 2001.
[5] Louis Couffignal, « Essai d’une définition générale de la cybernétique », Actes du 1er Congrès international de cybernétique, 26-29 juin 1956-1958.
[6] Céline Lafontaine, L’empire cybernétique. Des machines à penser à la pensée machine, Le Seuil, 2004.
[7] Slogan du groupe Keolis, opérateur du réseau TCL.
[8] Les Échos, 22 mai 2018.
[9] Georges Amar, Homo mobilis. Le nouvel âge de la mobilité : éloge de la reliance, FYP éditions, 2010.
[10] Keolis et Netexplo, 2016, Observatoire des mobilités digitales.
[11] ADEME, L’ObSoCo, Chronos, 2017, Observatoire des mobilités émergentes.
[12] « La théorie du nudge (ou théorie du paternalisme libéral) est un concept des sciences du comportement, de la théorie politique et d’économie issu des pratiques de design industriel, qui fait valoir que des suggestions indirectes peuvent, sans forcer, influencer les motivations, les incitations et la prise de décision des groupes et des individus, au moins de manière aussi efficace sinon plus efficacement que l’instruction directe, la législation ou l’exécution. » Source : Wikipédia.
[13] Le Monde, 17 mars 2009, op.cit.
[14] Mines : la revue des ingénieurs, Villes connectées, n°478, mars/avril 2015.
[15] Plaquette CRITER du Grand Lyon, 2020.
[16] Voir l’article « Qui souffle le vent ? » issu du Bulletin décâ(b)lé, Tentative de technocritique constructive en milieux lyonnais et environs, n°1, hiver 2018.
[17] Tomjo, L’enfer vert. Un projet pavé de bonnes intentions. Suivi de Critique de la planification écologique, L’Échappée, 2013.
[18] Mines : la revue des ingénieurs, op.cit.
[19] Plaquette « Lyon Smart Community, bilan et perspectives », octobre 2017.
[20] Groupe sanguin rhésus négatif, Sur-mesure, Pour en finir avec la mise en mesure du monde, brochure, septembre 2016.
[21] Technique qui permet d’analyser le mouvement des yeux lorsqu’une personne pose son regard sur l’écran, afin de déterminer quels éléments ont été vus, dans quel ordre, combien de fois, combien de temps, et ainsi d’ajuster la campagne publicitaire en conséquence.
[22] CNIL/LINC, « La plateforme d’une ville - Les données personnelles au cœur de la fabrique de la smart city », Cahier IP (Innovation & Prospective), n°5, 10 janvier 2017.
[24] Collectif Écran Total, Appel de Matabiau, tract, février 2020.
[25] Collectif Écran Total, Pôle Emploi : Précarité 2.0, tract, juin 2018.
[26] les-smartgrids.fr/lyon-smart-grids-quartier-de-confluence
[27] Plaquette « Lyon Métropole Intelligente : Inventons ensemble une métropole co- intelligente ! », 2016.
[28] Nous trouvions toute une suite de termes du même acabit dans un document du projet Smart Electric Lyon qui a désormais disparu d’Internet.
[29] Pièces et Main d’Oeuvre, « Linky : La filière grenobloise : Quand le laboratoire grenoblois nous prend dans ses filets électroniques », Dans les filets de Linky. Big data et surveillance électronique, pièce détachée n°79, octobre 2015.
[30] Bref Éco Auvergne-Rhône Alpes. Hors-série Smart City - La ville se réinvente, octobre 2018.
[31] LyonPlus, décembre 2019.
[32] Discours de Sam Palmisano, patron d’IBM, prononcé lors de l’IBM Business Leadership Forum à Istanbul, le 12 novembre 2008. www.ibm.com/ibm/cioleadershipexchange/us/en/pdfs/SJP_Smarter_Planet.pdf
[33] Voir Revue Z, Guyane - Trésors et conquêtes, n°12, septembre 2018 ; L’assemblée antinucléaire de l’ouest, Antinucléaires ? pas que !, brochure, 2014 ; Collectif libertaire anti-nucléaire amiénois, Le vent nous porte sur le système, ou comment être contre le nucléaire sans devenir pro-éolien, brochure, juillet 2009 ; Roger Belbeoch, La société nucléaire, brochure, 1990.
[34] Interview de Gérard Collomb par L’Atelier BNP Paribas à l’occasion des Prix de l’innovation "Le Monde" Smart Cities, juin 2016.
[35] Plaquette « Expérimenter pour mieux vivre en ville demain », 2013.
[36] Yan de Kerorguen, « Technopolis », revue Autrement, n°74, 1985.
[37] Le Moniteur, 05 avril 2019.
[38] campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr
[39] « Le monde est notre laboratoire », Slogan d’IBM.
[40] Dossier de presse du festival Super Demain, 14 novembre 2018.
[41] René Riesel et Jaime Semprun, Catastrophisme, administration du désastre et soumission durable, éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 2008.
[42] Célia Izoard, « Technopoles radieuses », Revue Z, n°9, 2015.
[43] Mines : la revue des ingénieurs, op.cit.
[44] The OnlyLyon’s Makers Magazine : Business & Good News, n°7, 2017.
[45] Outre la médiation populaire, certains de ces événements sont des rendez-vous d’affaires, lieux où se remplissent carnets d’adresses et de commandes ; d’autres encore sont des rendez-vous où se forgent les visions du monde consensuelles et politiquement tièdes qui gouvernent la recherche. Pêle-mêle citons les Rencontres de la métropole intelligente (2018), le salon Smart industries, le Digital Summit (2019), le SIDO, Super Demain, A l’École de l’Anthropocène, etc.
[46] The OnlyLyon’s Makers Magazine : Business & Good News, n°10, 2018.
[47] Julia Laïnae, Nicolas Alep, Contre l’alternumérisme, La Lenteur, 2020. Voir le chapitre « derrière le numérique "social et inclusif", l’injonction de l’adaptation ».
[48] Poiscaille, « Le surlieu ou le quartier-Narcisse », 19 mars 2011, sur le site d’informations alternatives lyonnais rebellyon.info.
[49] Célia Izoard, « Technopoles radieuses », op.cit.
[50] « Faire en sorte que le monde voie », Slogan de Milestone Systems.
[52] Le Monde, 20 décembre 2018.
[53] Le Progrès, 07 juillet 2019. A la « sécurité » proprement dite s’ajoute l’aspect économique d’un marché en plein essor.
[54] lyon.sous-surveillance.net
[55] Le Progrès, 19 octobre 2020.
[56] Voir La Quadrature du Net, « COVID-19 : l’attaque des drones », 01 avril 2020. www.laquadrature.net
[58] « Un décret de 2012 crée le TAJ (Traitement des antécédents judiciaires) en fusionnant les fichiers de police et de gendarmerie, le STIC (Système de traitement des infractions constatées) et le JUDEX (système judiciaire de documentation et d’exploitation de la gendarmerie). À tout ceci s’ajoute la possibilité d’intégrer les photos de GASPARD (Gestion automatisée des signalements et des photos anthropométriques répertoriées et distribuables), qui prend en compte les clichés issus de gardes à vue, de vidéosurveillances ou ceux saisis durant une enquête ». « À Lyon, la reconnaissance faciale en procès », Korii, 07 novembre 2019.
[59] La Quadrature du Net, « La police prédictive progresse en France. Exigeons son interdiction ! », 23 juillet 2020. technopolice.fr
[60] « Valenciennes inaugure un nouveau système de vidéo-protection et s’inscrit dans une démarche de "ville intelligente" avec Huawei », 13 février 2017. e.huawei.com/fr
[61] Le Monde, 20 décembre 2018, op.cit.
[62] La Quadrature du Net, « La reconnaissance faciale des manifestant.e.s est déjà autorisée », 18 novembre 2019. www.laquadrature.net
[63] Lyon Mag, 12 août 2020.
[64] Le Panopticton est un type d’architecture carcérale imaginé par Jeremy Bentham à la fin du XVIIIe siècle, dont le philosophe Michel Foucault tire le modèle symbolique de la société disciplinaire : il s’agit d’un bâtiment à la forme circulaire divisé en de multiples cellules, au centre duquel est disposée une tour. Les matériaux utilisés et la disposition de chacun des éléments doivent permettre d’assurer une surveillance totale et continue des détenus depuis la tour centrale sans que le surveillant ne soit lui-même visible depuis les cellules.
[65] Communiqué de presse du Sytral « Le ticket TCL désormais disponible sur smartphone ! », novembre 2019.
[66] Séminaire « La 5G dans la défense », infographie « 28 cas d’usage », p.44, 15 janvier 2020.
[68] Grand Lyon, 2017, La « ville intelligente » dans les quartiers prioritaires de la Métropole de Lyon.
[69] Bref Éco Auvergne-Rhône Alpes, op.cit.
[70] Plaquette « Lyon Métropole Intelligente : Inventons ensemble une métropole co-intelligente ! », 2016.
[71] apps.apple.com/fr/app/cityzendesk/id1486085248
[72] Si la surveillance telle que nous la décrivions dans la partie précédente s’était « échappée des cellules individuelles », il ne faut pas comprendre par là que nous disions que ces cellules n’existent plus. Elles sont ouvertes par ces fenêtres (Windows) que sont nos écrans qui ne constituent pas moins une ouverture pour la surveillance, le contrôle et la contrainte, la répression, l’uniformisation et la normalisation. La captation de toute la vie privée effectuée à partir de nos comptes personnels, nos usages et leurs méta-données, nos connexions au réseau rend transparente et disponible notre vie intérieure. Nos cellules individuelles ne sont pas si hermétiques que nous pouvons le penser.
[73] Essence de l’État, du latin status, qui a une origine commune avec statistique. On peut montrer qu’au fondement du pouvoir de l’État se trouve la puissance de dénombrement de la population, qu’au fondement de l’organisation se trouve la maîtrise par les chiffres des statistiques.
[74] L’ObSoCo, Chronos, 2017, Observatoire des usages émergents de la ville.
[75] L’ObSoCo, Nexity, Somfy, CDC Habitat, 2019, Observatoire de l’habitat.
[76] Slogan accompagnant la campagne de publicité déployée à la télévision, au cinéma, dans la presse et sur internet en 2015.
[77] AmCham, « Human cities : Pour en finir avec les "smart" cities », Livre Blanc, 19 novembre 2019.
[78] Et c’est pourquoi nous prenons pour cible de nos critiques le festival Super demain de l’association Fréquence école dont « le métier » est de « développer l’éducation aux médias numériques », manière de dévier un peu plus et un peu plus tôt les enfants, leurs désirs et leur attention, vers les écrans dont la littérature n’arrête pas de dire la multitude de désastres que cela engendre (en 2019, des ateliers se tenaient autour du thème des écrans et des enfants de 3 à 6 ans !) .
[79] « La Smart City au cœur du nouveau contrat social », Journal du net, 21 décembre 2018. Notons que les rédacteur.trice.s ne se donnent pas la peine de signaler les mots étrangers comme « smart » ou « Smart City » en italique comme le veut la convention. Ils sont devenus tout à fait banals bien qu’incompris par la plupart d’entre nous, leur transposition dans la propagande propage le flou et la dépossession.
[80] Collectif Plein la vue, Contribution pour l’élaboration du RLPI de la Métropole de Lyon, 25 mai 2018. pleinlavue.org
[81] Collectif Plein la vue, Consultation citoyenne sur le rapport à la publicité dans l’espace public de la métropole de Lyon, 2019. pleinlavue.org
[82] Lyon Capitale, 31 octobre 2019.
[83] Document du Grand Lyon « Extrait du registre des délibérations du conseil », 18 septembre 2017.
[84] Discours du lundi 14 septembre 2020.
[85] Les Échos, 29 juin 2016.
[86] A celles et ceux qui ne s’adaptent pas, sous le joug de la contrainte, aux dispositifs imposés, il reste l’exclusion et la marge. Ceux et celles qui ne désirent pas rentrer dans la grande comptabilité de la ville-machine, se révèlent être des « laissés-pour-compte ».
[87] Interview de David Kimelfeld pour la revue Bref Éco Auvergne-Rhône Alpes. Hors-série Smart City T2 - Mieux vivre la ville !, avril 2019.
[88] Orwell et Mumford, La mesure de l’homme, Notes et morceaux choisis n°11, La Lenteur, 2014.
[89] Jaime Semprun, L’abîme se repeuple, éditions de l’Encyclopédie des Nuisances, 1997.
Les décâblés
Au milieu de la déferlante technologique actuelle, nous proposons une brèche en redonnant une place au débat technocritique. Portés sur la sensibilisation et l’échange, nous abordons les différents enjeux liés au monde industriel et numérique, à travers discussions, conférences et écrits. Nous prônons la résurgence de savoir-faire artisanaux ainsi que des techniques à échelle humaine, que nous cherchons à mettre en œuvre par des expérimentations collectives de décâblage.
Pour mieux comprendre notre vision des choses, nous vous renvoyons vers LE MANIFESTE DES DÉCÂBLÉS, qui s’articule autour de 4 propositions : Se réapproprier nos outils ; Repoétiser l’existence ; S’enraciner dans la réalité écologique ; Façonner une alternative décâblée.
Ce texte est à reproduire, photocopier, dactylographier, duplicopier, risographier, slamer, crier, partager, diffuser, autant que possible. En échange de quelques timbres, nous nous ferons un plaisir de vous faire parvenir des exemplaires de cette brochure, et sur demande, nous pouvons aussi y joindre le manifeste, ainsi que les premiers numéros du bulletin décâblé.
Pour nous écrire :
Maison des Étudiants / Les décâblés
25 rue Jaboulay - 69007 LYON
lesdecables@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (28.4 Mio)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (27.5 Mio)