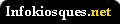Q
Qu’est-ce qu’on fout ?
Reprise de La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ? (Chi-Chi Shi)
mis en ligne le 8 mars 2024 - anonymes
Le texte
L’un-e d’entre nous est tombé-e par hasard sur ce texte dans la revue en ligne Période. Son auteure, c’est Chi-Chi Shi, qui est diplômée en théorie politique de l’université d’Oxford.
À la base, c’est un article universitaire paru en 2018 dans le n°26 de la revue Historical Materialism sous le titre « Defining my Own Oppression : Neoliberalism and the demands of Victimhood ». Il est dispo sur historicalmaterialism.org.
Qui on est ?
On est des gens qui traînent et qui s’organisent dans les milieux anticapitalistes, féministes ou queer. On a fait un passage plus ou moins long et plus ou moins récent par la fac.
Pourquoi on a repris ce texte ?
Même si on n’est pas d’accord avec tout ce qu’il contient, plusieurs raisons nous ont motivées à le rendre plus accessible :
• prendre conscience de comment la culture dans laquelle on vit influence (et limite) nos manières de lutter contre ce qui ne nous va pas dans cette société.
• mettre en valeur et en circulation un texte qui se donne la peine de contextualiser et d’analyser en plusieurs temps comment on pratique les politiques de l’identité et ce que ça produit. Même s’il est HYPER compliqué à la base.
• rendre le texte accessible à plus de personnes. On trouve ça stratégique parce qu’on pense que ce texte est précieux et on espère qu’il provoquera des discussions entre amis et camarades.
• naviguant dans les milieux queers et souhaitant l’anéantissement du capitalisme, on s’est dit que ce texte vient mettre des mots sur des malaises ou des désaccords politiques que l’on peut avoir en discutant ou en s’organisant avec d’autres gens. Avec qui fait-on des alliances dans une lutte ? Avec qui on fait l’évidence qu’on a des intérêts communs ? Est-ce que la non-mixité est aussi souvent pertinente que nous la pratiquons ? Pour quoi on lutte ? Pensons-nous suffisamment en termes
stratégiques ?
• ce texte est aussi une occasion d’aborder des problèmes interpersonnels ou même politiques se répétant dans certains milieux de gauche. On trouve de plus en plus étouffants et paralysants les réflexes d’utiliser son identité (et sa souffrance) comme des cartes pour mettre fin aux discussions ou faire plier des avis dissidents.
• faire cette brochure ça a aussi été un prétexte pour (re)définir des concepts politiques qu’on utilise beaucoup dans les milieux de gauche radicale/queers/féministes sans plus se donner le temps d’expliquer ce qu’on entend par là.
Comment on a écrit cette brochure ?
On est 3-4 personnes qui ne se connaissaient pas d’avance, qui ont trouvé le texte intéressant et qui ont décidé d’en faire une brochure. On a aussi demandé de l’aide, des conseils et de la relecture. Alors en tout, on est une dizaine de gens et plusieurs dizaines d’heures de travail à avoir permis que cette prochure existe.
L’intention de base, c’est de faire sortir de l’université un article qui nous a paru hyper intéressant même s’il est hyper compliqué à la base à cause des normes universitaires d’écriture et du niveau de langage très élevé.
Notre démarche, ça a été de le lire chacun.e de son côté, d’en simplifier une partie puis de mettre en commun, s’aider à comprendre certains passages et puis lisser le tout.
Et donc, ce que vous allez lire, ce n’est pas juste une synthèse de l’article, c’est pour ça qu’on a notre propre titre. On l’a vulgarisé, simplifié, transformé, commenté, même si la structure de base est presque la même. On a essayé de passer d’une analyse universitaire (extérieure et surplombante) des mouvements sociaux à une vision du dedans, comme si on en parlait avec les gens avec lesquel-le-s on fait de la politique.
On s’est donné quelques règles pour la réécriture :
✎ on fait des phrases courtes.
✎ on simplifie les mots compliqués utilisés ou on les explique tout de suite (autant que possible). Par exemple, on a fait ça pour des concepts philosophiques ou des mots assez rares.
✎ on s’exprime comme si on expliquait le texte aux gens de notre entourage politique.
✎ on essaie de ne pas (trop) modifier le sens du texte. Ça n’a pas été possible à 100% parce qu’on a interprété certaines choses quand on ne les trouvait pas assez claires. Donc peut-être que des fois on a cru comprendre le sens que l’auteure mettait et en fait non. Mais on s’est dit que ce n’était pas très grave.
✎ on contextualise les exemples ou les noms de gens ou de collectifs mentionnés.
✎ on ajoute nous-mêmes des exemples concrets pour que les propos fassent du sens et qu’on voit comment ça joue vraiment dans la vraie vie. On a notamment rajouté des exemples qui se passent en France quand c’était possible.
✎ on supprime les formes universitaires inutiles comme : “premièrement je formule l’hypothèse blablabla…”
✎ quand un lien entre deux phrases n’est pas clair, on essaie de rajouter des éléments pour mieux le mettre en évidence (pourquoi tel truc cause tel truc…). On explicite toujours au maximum, quitte à rallonger le texte.
✎ on reprend le plus souvent le texte de l’auteure en disant : "l’auteure dit, pense…"
✎ on reprend la plupart des citations de l’auteure en les laisssant telles quelles.
✎ on fait des listes qui énumèrent des points dès que c’est possible, pour mieux mettre en évidence les arguments importants d’un paragraphe.
✎ on genre de manière aléatoire, des fois ielles, des fois ils…
✎ on s’est inspiré-e-s de la méthode de vulgarisation FALC (Facile à Lire et à Comprendre), disponible sur inclusion-europe.eu. Elle est issue d’un projet européen autour de la formation continue des personnes handicapées intellectuelles.
QU’EST-CE QU’ON FOUT ?
Reprise de La souffrance individuelle (et collective) est-elle un critère politique ? (Chi-Chi Shi)
Dans ce texte, on parle des paradoxes des politiques de l’identité (identity politics*).
On va voir en particulier que, selon l’auteure, ces
politiques telles qu’elles sont pratiquées aujourd’hui
encouragent à une solidarité entre opprimées* basée
uniquement sur la souffrance qu’iels partagent.
De plus, on va voir que cette façon de lutter est
influencée par l’impératif néoliberal* de création d’un “soi
authentique”, ce qui s’oppose à la constitution de la
solidarité collective des humain-e-s et à leur capacité à agir
sur le monde, les choses, les êtres (leur agentivité).
C’est possible que certain-e-s d’entre vous soient
brassé-e-s, en colère, soulagé-e-s, perplexes à la lecture de
ce texte. Parce que ce qu’il pointe touche directement à
nos façons de nous représenter le monde, de nous
organiser, de parler de nous, des autres... C’est aussi pour
ça qu’on a décidé de le faire circuler.
Plan de la brochure
(Dans ce numéro on s’arrête après le 3)
1) Quelques bases : le néolibéralisme, qu’est-ce que c’est ?
Expliquer la transition du libéralisme vers le néolibéralisme, comprendre l’influence des changements économiques sur les comportements individuels et sur la capacité à s’organiser collectivement.
2) Identity politics : petit historique
3) De la création de l’intersectionnalité à la concurrence des identités
Comprendre les accords et désaccords entre politiques de l’identité et intersectionalité.
4) La politique qui part du ressentiment et du trauma
On parle de la prise d’importance du ressentiment dû à l’oppression avec l’idée qu’il donne l’impression de pouvoir agir politiquement mais qu’en fait il empêche de penser la fin du système.
On voit aussi que l’intérêt accru pour le trauma est en même temps une conséquence et une réponse au néolibéralisme.
5) Soigner les symptômes, négliger les causes
Comment on se concentre sur les effets et symptômes du système plutôt que sur son fonctionnement. On verra que ça pose le capitalisme et le néolibéralisme comme nécessaires et incontestables.
6) Souffrir = savoir ?
Est-ce que la connaissance, la légitimité et la vérité c’est la même chose que l’expérience de la souffrance ?
7) Reconnaître les obstacles à la résistance collective
Comment tout ça empêche de créer du collectif autour d’objectifs communs ?
Introduction
Ce texte nous propose de revenir sur ce dans quoi certain-
e-s de nous baignent : les politiques de l’identité. C’est sans
doute particulièrement vrai si on évolue dans des communautés
queers, féministes et/ou antiracistes.
On abordera à la fois l’histoire des politiques de l’identité :
comment elles sont apparues, dans quel contexte et comment
elles ont évolué pour donner ce que nous en connaissons
aujourd’hui. Surtout si on est jeune et/ou qu’on se politise depuis
quelques années.
Un des intérêts de faire cette histoire militante (et
universitaire) est de nous donner du recul sur nos pratiques et
logiques militantes. Comment on en est arrivé-e-s là ? Comment
certains concepts reviennent maintenant dans toutes les
bouches ? Comment on se retrouve dans certaines formes
d’organisation collective ? C’est quoi notre héritage politique ?
C’est intéressant de ce poser ces questions parce que cet
héritage a du poids sur nous aujourd’hui, même (surtout ?)
quand on ne le connaît pas.
En plus de ça, l’auteure a à peu près dû se dire ceci : c’est
bien de faire l’histoire des luttes et des pensées politiques, mais
les militant-e-s ne sont pas que des militant-e-s. Iels sont aussi
des gens qui vivent dans un certain type de société. Et ça, ça
joue aussi sur comment ils luttent et pour quoi. C’est pour cette
raison que Chi-Chi Shi revient aussi sur une histoire plus large :
celle du capitalisme en Occident. On va donc parler de comment
notre système économique a de l’influence sur le type de
société dans lequel on vit : comment on se représente le
monde ? Qu’est-ce qui nous importe ? Quelles divisions sont
engendrées entre les gens ? On va aussi parler de comment
notre système économique a de l’influence sur notre façon de
lutter contre ce monde.
Voir un peu d’histoire de l’économie et de la société, ça
nous permettra de saisir que le capitalisme a changé, lui aussi, depuis ses débuts. Ça vise aussi à comprendre comment ces
changements nous conditionnent. C’est ce qu’on va retrouver
dans cette première brochure : de l’histoire, des définitions...
En gros, ce texte nous propose de nous sortir un peu la tête
de l’eau dans laquelle on baigne ! De nous rendre compte de
comment on est nous aussi les produits de notre société, même si on veut la changer.
Le capitalisme nous conditionne et nous limite toustes. Ce texte fait le pari que nous aider à comprendre ça nous aidera à mieux détruire ce qui nous est insupportable.
1) Le néolibéralisme, qu’est-ce que c’est ?
À la base, y a le
libéralisme “classique”. C’est
un courant de pensée
politique qui apparaît dans les
années 1500. Quand on parle
de libéralisme en économie,
on considère que c’est le
système capitaliste* qui
répond le mieux à la tendance
naturelle des gens à échanger
des biens. Le libéralisme
pense que le bonheur des
gens dépend de leur liberté à
échanger et produire.
L’addition du bonheur des
gens ferait des nations
heureuses. Pour faire court, le
libéralisme est une
philosophie globale qui,
appliquée au secteur
économique, prend la forme du capitalisme.
Au moment où les crises
économiques se succèdent
(crise de 1929, crises après
les guerres mondiales…), les
politiques et économistes
libéraux estiment que le
problème, c’est que l’État
intervient trop dans les
échanges marchands
(limitation de certains prix,
nationalisation de certaines branches comme les transports ou les chaînes de
télé…) pour que les choses
puissent se faire
“naturellement”/rationnellement. Le message,
c’est que tout marcherait bien
mieux sans l’État qui fausse
l’économie. Par exemple, en
France, c’est l’État socialiste
de Mitterrand qui a introduit
tout un tas de mesures pour
libéraliser l’économie mais
aussi la culture ou la santé.
Alors il y a un passage du
libéralisme au néolibéralisme,
qui met l’accent sur l’importance de la compétition
de marché, c’est-à-dire par
une économie non entravée (par des subventions ou des taxes…) pour :
• stimuler les
producteurs à donner le
meilleur d’eux-mêmes (en
terme de qualité et quantité)
s’iels ne veulent pas être
remplacés sur le marché,
• permettre aux
consommateurices d’accéder
aux meilleurs produits et à de
meilleurs prix.
Le concept du néolibéralisme se fonde sur l’économie de marché*. Ça veut dire que :
• les individus doivent être “libres” économiquement = faire des échanges directement entre eux pour éprouver un maximum de
satisfaction : chaque intérêt
personnel rencontre un autre
intérêt personnel (offre et
demande). L’État ne se mêle pas de ça.
• ce qui détermine ce
qui va être produit, échangé
et le prix auquel ça va l’être,
dépend seulement des
intérêts des individus
concernés par l’échange. Par
exemple, plus un bien est rare
à cause d’un manque d’offre / d’une trop grande demande
(logement, eau...), plus il est
cher. Peu importe si on estime qu’il est vital.
• les idéaux sociaux, écologiques ou
communautaires ne devraient
pas avoir de place dans
l’arbitrage économique. Ou
alors ils sont convertis en
données économiques ! Par
exemple, les entreprises
peuvent choisir entre moins
polluer ou payer des taxes
supplémentaires pour pouvoir
continuer à polluer autant.
Ce qui change dans le néolibéralisme par
rapport au libéralisme, c’est
que l’État ne doit plus se
limiter à ne pas contraindre le
marché, mais le servir et le
protéger. Et cette logique ne s’applique pas qu’aux
échanges de biens. Elle grignotte tous les aspects de notre vie, qui sont
transformés en marchés : autostop remplacé par le Blablacar, hébergement
gratuit par Airbnb, applications de rencontre où
les profils doivent se
démarquer les uns des autres
(originalité, diplômes, sex
appeal…), les services et les
prêts entre voisines vers des
prestations payantes ou des
locations de matériel... On est tous invités à penser à
maximiser notre profit à tout moment.
Aussi, un tour de passe-passe
du néolibéralisme est qu’il se
réapproprie la notion de
liberté en la redéfinissant
“comme le pouvoir de chacun
de s’auto-façonner.” Ainsi, si
certains aspects de notre vie
ne nous vont pas, on nous
rappelle qu’il n’est qu’une
question de volonté
personnelle pour les changer.
Y compris les problèmes
collectifs.Et donc, dans une
société où la plupart des
postes à responsabilité sont
occupés par des hommes, on
propose du coaching
personnel pour les femmes
voulant accéder à des postes de direction. Pour le stress au
travail, on crée des applis de
méditation. Chacun-e est
sensé investir sur sa vie, son
corps, sa personnalité comme
il le ferait dans une
entreprise. Mais, un peu comme une
entreprise ne peut pas
survivre parmi les autres sans
se démarquer par le prix,
l’image ou la qualité... chaque
individu doit se démarquer
pour survivre dans un monde
où la rareté est créée (par
exemple pour l’accès au
logement) et où d’autres
ressources comme les "bons
postes" sont réellement
limitées. En bref, on vit dans un monde
où la concurrence est
valorisée et généralisée.
Pour (sur)vivre dans ce
monde, il faut que nos
comportements d’êtres
humains s’adaptent. Avec le
temps, la propagande et les
règlementations nationales et
internationales, nos cultures
changent. Nous intégrons
sans même le sentir un
modèle de comportement et
des rapports basés sur la
compétition. Par exemple,
l’industrie de la beauté et de
la mode ont contribué à faire émerger le concept de sex appeal en le rendant
nécessaire dans les critères
de recherche de partenaires
amoureux. Cela a créé des
marchés parmi les plus
lucratifs qui nous poussent à
consommer (régimes, vêtements, sport, applis...) pour rester dans la course au
bonheur amoureux.
Pour gérer cette rivalité
constante dans tous les
domaines de la vie (meilleurs
parents, amantes, employé,
ami, les plus beaux, les plus
sains...), on est ainsi amenées
à fonctionner par des logiques
égoïstes et orientées vers le
marché. D’un contrôle des
comportements qui passait
autrefois surtout à travers les
appareils d’État, on passe
ainsi à un contrôle intériorisé :
on devient juge de nous-mêmes dans tous les
domaines sans même qu’on
nous le demande ! Bon, bien
sûr, on continue de nous
assommer de réformes pour
accélerer la marche du
néolibéralisme. Mais le
mérite, l’effort, la compétition
sont devenus nos goûts et nos
valeurs. Et cela sert la logique
de la compétition capitaliste.
Puisque la concurrence devient à la fois une nécessité économique (libéralisme) et
un impératif moral (ajouté
avec le néolibéralisme), les
liens sociaux et les sécurités
collectives, par exemple les
syndicats qui aident les
travailleuses à connaître leur
droits et les faire valoir,
deviennent à leur tour une
entrave à ce type de
fonctionnement économique.
Les liens sociaux, en renforçant le sentiment de solidarité, d’empathie et de force collective, empêchent en effet de fonctionner selon les logiques individualistes de la concurrence.
D’une part, les structures collectives sont remises en cause par :
• l’atomisation du
travail (détruire la cohésion
de groupe au travail de
différentes manières, comme
la division des tâches),
• les attaques contre
les syndicats,
• le démantèlement de
l’État providence* (intervention de l’État dans le
domaine social, qui vise à
assurer un niveau minimal de
bien-être à la population, en
particulier à travers le
système de protection
sociale), qui est un système articulant plusieurs formes de
solidarité collective comme la
solidarité intergénérationnelle
(retraites), celle entre les
travailleurs et ceux qui ne
peuvent pas travailler, etc.
• la privatisation des
ressources collectives (forêts,
connaissances issues de la
recherche...)
• l’impératif moral à
travailler, ce qui fait qu’on
condamne les gens qui ne le
font pas. On voit donc moins
d’intérêt à être solidaires avec elleux.
D’autre part, l’internalisation
du contrôle chez les employés
se manifeste par un impératif
d’auto-perfectionnement, on
investit sur nous-mêmes. En
effet, si avant les ouvriers
étaient contrôlés par des
surveillants dans leur lieu de
travail, ce contrôle est
désormais de plus en plus
intériorisé par l’idée que le
travail est l’endroit où l’on
s’épanouit en tant que
personne, où on est utile.
Cette intériorisation participe
à briser la distinction entre le
capitaliste (celui qui est
propriétaire des moyens de
production*) et l’ouvrière car
celle-ci se définit maintenant
en tant que sujet de
l’entreprise au même titre que le capitaliste / patron (par exemple on demande aux
travailleurs de se voir aussi
comme les membres d’”une
communauté de travail, voire
d’une “grande famille” où
tout le monde est responsable
du bien-être et de l’efficacité
de l’entreprise). Les
divergences d’intérêts dans
l’entreprise sont gommées. Les travailleur-ses
deviennent un capital* humain. Comme ils ne
possèdent que leur force de travail (dans la
compréhension marxiste* il s’agit de ce que le
travailleur “loue” à un patron : en l’occurrence
ses bras, jambes etc.) leur
responsabilité est
d’accroître leur propre
valeur. Ils doivent donc
investir sur eux-mêmes
(par exemple avec
l’accumulation de formations
avec le Compte Personnel de
Formation, la formation continue...).
Le néolibéralisme influence
nos aspirations, nos goûts,
nos représentations du
monde... Il nous façonne dans
le plus profond de nous-mêmes.
Cela commence à nous mettre sur la voie pour
comprendre comment nous
construisons et mobilisons
notre identité dans les
mouvements politiques actuels.
Le néolibéralisme constitue
une attaque contre la
solidarité collective et
transforme les bases sur
lesquelles le peuple s’unit. On
bascule d’une solidarité de
classe à une logique de
mérite individuel.
Le néolibéralisme a aussi des
impacts moins directs ou évidents :
• il participe à personnaliser les causes de la
souffrance, en les présentant
comme des traumas* individuels. Nous verrons cela
plus en détails dans la partie 4.
• une partie des forces
de gauche priorise la
constitution d’une identité
authentique, unique et
individuelle, ce qui affaiblit la
compréhension de
l’expérience collective. La
lutte contre le capitalisme est
ainsi dépolitisée par une
présentation de l’oppression* comme subjective. Pour le
dire autrement, c’est le ressenti d’une violence et le récit personnel de la souffrance qui sont mis en avant plutôt que l’explication
systémique qui sous tend
l’oppression. Nous le verrons
mieux dans les parties 5 et 6.
• cette doctrine endommage le savoir expérientiel du collectif, c’est-à-dire qu’il nous fait perdre notre capacité d’imagination et à s’organiser collectivement.
En somme, le néolibéralisme, avec sa concurrence généralisée
et son individualisme*, fait qu’on remplace la
question du collectif et du
structurel* par un langage
qui s’intéresse davantage
aux comportements et aux
vécus individuels. On
retrouve donc un des effets
du néolibéralisme sur notre
façon de faire de la politique :
l’obsession pour le soi. Et
même malgré la considération du caractère
systémique* dans nos
compréhensions du monde,
la focale est mise sur les
effets individuels de
l’oppression* (par
exemple sur le vécu
traumatique des femmes
ayant vécu des agressions sexuelles, avec
l’importance du
témoignage personnel),
plutôt que sur ses causes
(la fonction et le rôle de
cette position opprimée
dans une societé capitaliste).
C’est la vulnérabilité qui est
valorisée par les mouvements
émancipateurs. On s’intéresse
aux victimes qui n’ont pas eu
reconnaissance sans analyser
pourquoi il y a non-reconnaissance.
Cette focalisation sur
l’expérience personnelle de
l’oppression par la victime se
fait dans un cadre qui
valorise l’impuissance. En
effet, ce cadre place les
identités dénigrées dans un
registre moral : ces identités
sont bonnes parce qu’elles
sont victimes, qu’elles ont été
privées de pouvoir. Ce cadre
essaie d’un côté d’intégrer la
souffrance dans un
programme politique, et de
l’autre il encourage une
politique de la culpabilité qui
assimile l’autoflagellation à la
transformation.
Par exemple, il est devenu
banal de considérer que faire
justice contre le sexisme
revient à enjoindre les
hommes (détenant plus ou moins de pouvoir) qui ont eu
des comportements jugés
oppressifs à faire des excuses
publiques, à assumer un
statut de bourreau, à
reconnaître ses privilèges
masculins sur les réseaux
sociaux. On est un peu dans
une logique de "laver ses
péchés" par la confession. Les
excuses publiques sont vues
comme une manière de ne
pas laisser le crime impuni.
Or, elles ne menacent pas
beaucoup le système qui
permet et banalise ces
crimes. Par exemple, quand il
s’agit d’acteurs ou de
réalisateurs, ce processus
d’aveu ne désigne pas
l’industrie du cinéma qui se
nourrit du sexisme, de
l’objectification des femmes.
Mais sous le néolibéralisme, c’est ressentir la culpabilité et montrer qu’on la ressent qui est censé refléter qu’on porte un projet de transformation sociale.
2) Identity Politics : petit historique
Les mouvements
sociaux occidentaux ont
longtemps mis au centre de la
révolution l’homme ouvrier
blanc. Afin de décentrer et
complexifier cette approche,
différents mouvements
(libération des femmes, LGBT
et droits civiques des Noirs)
se mobilisent contre des
injustices spécifiques à leurs
groupes à partir des années 1960.
Ces identités sont politisées,
c’est-à-dire que les militant-e-s s’appuient sur elles pour
former les bases de nouvelles
organisations politiques. Les
militant-e-s formulent des
revendications collectives à
partir de leurs problématiques
de vie communes et les
amènent dans la sphère
publique. L’identité devient
donc un rapport politique.
C’est ainsi qu’à l’origine, les
politiques de l’identité
n’étaient pas opposées au
socialisme*, elles visaient
surtout à l’enrichir.
En effet, aux Etats Unis,
l’exclusion fréquente des
femmes noires des
mouvements féministes et de
libération noire a montré la
tendance de ces derniers à
essentialiser* l’expérience
des identités des “Noirs” et
des “femmes”. C’est-à-dire
que ces luttes prétendaient
parler pour toustes les Noirs
et toutes les femmes en
homogénéisant les vécus et
revendications de chacun des
groupes.
Par exemple, être féministe
c’était vouloir accéder à la
contraception ou sortir du
foyer familial. Alors qu’en fait,
ces revendications
correspondaient surtout aux
femmes blanches de classe
moyenne ou bourgeoise. En
effet, les femmes noires
étaient peu à partager les
mêmes conditions de vie :
beaucoup étaient précaires et
travaillaient pour des Blanc-hes. Certaines ont fait valoir
que s’occuper de leur propres
enfants (et en avoir, car il y a
eu beaucoup de contrôle de la
reproduction des femmes
noires de la part des Blancs et
du système raciste), c’était un
luxe que peu de femmes
noires ont en Amérique. De
plus, beaucoup d’elles ne
vivaient pas leur famille
comme le berceau de leur oppression malgré le sexisme,
mais comme le seul espace
de sécurité contre le racisme.
bell hooks (théoricienne du
black feminism) écrit plus
tard, dans son livre De la
marge au centre (2015) : "Les
femmes blanches qui
dominent le discours
féministe aujourd’hui se
demandent rarement si leur
point de vue sur la réalité des
femmes est fidèle aux
expériences vécues par les
femmes en tant que groupe
collectif. Elles ne sont pas non
plus conscientes de la mesure
dans laquelle leurs
perspectives reflètent des
préjugés de race et de classe".
Ce féminisme essentialisant
semble définir les femmes par
leurs attributs biologiques ou
leur apparence féminine. Ce
qui est très réducteur et ne
prend pas en compte
certaines dynamiques
sociales. Certaines Blanches
devaient sans doute penser
leur condition universelle,
mais c’était aussi une occultation stratégique. Et
oui, si les Blanches voulaient
remettre en question les rôles
genrés, il n’était peut-être pas
dans leur intérêt de classe de remettre en question leur domination économique. De
plus, leurs revendications
libérales* nécessitaient de
continuer l’exploitation des
Noir-e-s, notamment celle des
femmes noires qui leur
permettaient de quitter leur
foyer bourgeois en élevant leurs enfants et en entretenant leur maison à leur place.
Donc, malgré l’apparition de nouveaux groupes comme acteurs politiques
supplémentaires, puisque les
hommes noirs étaient au
centre de la lutte antiraciste
et les femmes blanches de
classe moyenne/bourgeoise
au centre de la lutte
féministe, les intérêts des
femmes noires n’étaient
représentés ni par l’une, ni
par l’autre. Comme le dit simplement bell
hooks en pointant l’erreur que
constitue la comparaison
fréquente entre l’oppression
du peuple noir et l’oppression
des femmes : “Cela implique
que toutes les femmes sont
blanches et que tous les noirs
sont des hommes”.
En France, on peut mentionner un processus
similaire avec les Gouines Rouges qui sont un collectif de lesbiennes féministes radicales
fondé en 1971. Elles voulaient
faire valoir les problématiques
des lesbiennes dans le
mouvement féministe (MLF) et
celle des femmes dans le
mouvement homosexuel (FHAR).
La période des années 1960 est
donc celle de l’apparition des
politiques de l’identité, ou
“identity politics”. Cette
expression est attribuée au
Combahee River Collective. Le
CRC est un groupe de
féministes lesbiennes noires
qui apparaît dans les années
70 dans un contexte d’extrême
racisme, causant entre autre
de nombreux meurtres contre
les Afro-Américain-e-s à
Boston. Voici la définition qui
en est donnée : “Cette
concentration sur notre
propre oppression s’incarne
dans le concept de
politiques de l’identité.
Nous croyons que la
politique la plus
approfondie, et
potentiellement la plus
radicale, vient directement
de notre identité, en
opposition avec le travail
effectué pour mettre fin à
l’oppression de quelqu’un d’autre.”
On a donc :
• une idéologie
d’émancipation universelle*
(des Noirs, des femmes, des
travailleurses…) plutôt que
séparatiste* qui aurait plutôt
visé à une séparation politique
et sociale (partielle ou totale)
du reste de la société.
• un pont avec les
mouvements anticoloniaux* dans le Tiers Monde (terme
créé dans les années 1950 pour
désigner l’ensemble des pays
qui ne faisaient ni partie de
l’ensemble des pays riches du
Nord regrouppés dans l’OTAN,
ni des pays du bloc de l’Europe
de l’Est) et avec l’internationalisme* socialiste*
qui revendique que la lutte contre le capitalisme doit dépasser les échelles nationales.
• un sentiment “qu’en
luttant pour les intérêts de
notre peuple, nous luttons
également pour ceux du
monde entier.”
L’objectif de ce groupe était
donc de lutter pour la
libération de toustes à partir
des systèmes particuliers :
“Nous réalisons que la
libération de tous les peuples
opprimés nécessite la
destruction des systèmes
politico-économiques du capitalisme et de l’impérialisme, tout comme celui du patriarcat.”
Qu’on puisse passer par le
particulier pour viser l’
universel, ça peut paraître
compliqué à comprendre.
Surtout dans un pays comme la
France qui se fait passer pour
très universaliste, et donc
contre les formes de
particularisme.* On peut
reprendre l’exemple du CRC. En
partant de leurs expériences
de lesbiennes noires, le CRC a
exposé les limites du
féminisme blanc qui se
concentre sur la question du
genre. Mais le CRC montre
aussi les limites du National
Black Feminist Organization
(NBFO) qui échoue à adresser
les problèmes propres aux
femmes noires au sein du
mouvement de libération
noire : agressions sexuelles,
stérilisations, droits du travail...
Par leur travail, elles ont
montré que les identity politics
étaient un outil politique
puissant, notamment pour les
personnes situées aux
intersections de plusieurs
oppressions. Elles ont aussi
amené à la création de
coalitions politiques variées,
participé à la déségrégation
dans les écoles, à des projets contre les violences policières ou encore faites aux femmes. En effet, leur position
particulière a permis de mieux
appréhender la teneur genrée,
homophobe et raciste des
meurtres de Boston.
Finalement, des femmes
ciblant leurs propres
problématiques ont éclairé des
mécanismes globaux de
l’exercice des oppressions.
Le travail du CRC a posé les
racines de l’intersectionnalité* (on en parle juste après !) tout
en s’opposant au réflexe de chaque lutte politique
identitaire* à imposer une question unique (la libération
noire pour les Noirs, la
libération des femmes pour le
féminisme). Avec l’exemple des
femmes noires donné plus
haut, on comprend bien
qu’avoir une “question unique” (ou une lutte
prioritaire) occulte la complexité de l’oppression* et de l’exploitation*. Ceci
empêche de lutter efficacement contre ces dernières.
Schématiquement :
des conditions d’existence similaires subies par un groupe créent une
↓
identité de groupe imposée par le système (exemple : les femmes noires)
↓
le groupe se ressaisit de cette identité en en faisant une base politique (exemple : les féministes pour la libération noire)
3) De l’intersectionnalité à la concurrence des identités
Le terme intersectionnalité* a été utilisé la première fois par
la juriste Kimberlé Crenshaw en 1991. K. Crenshaw est une
féministe américaine et une professeure de droit
spécialisée dans les questions
de race et de genre. Elle
utilise le terme intersectionnalité pour décrire
la discrimination* spécifique à laquelle sont
confrontées les femmes
noires de classes populaires
sur leur lieu travail.
À cette époque, Crenshaw
travaillait sur le cas d’une
femme noire, Emma
DeGraffenreid, qui avait porté
plainte en 1976 pour
discrimination sexiste et
raciste suite à un entretien
d’embauche infructueux à
General Motors. En effet,
l’entreprise réservait les
postes de secrétaires aux
femmes blanches et ceux de
l’usine aux hommes noirs.
Mais ni le droit du travail
états-unien contre le racisme
et ni celui contre le sexisme
ne la protégeait contre la
discrimination spécifique
qu’elle vivait en tant que femme noire. Madame DeGraffenreid a vu sa
demande rejetée car General Motors ne
pouvait pas être accusée de
racisme ou de sexisme vu
qu’elle embauchait des
femmes et des Noirs !
Finalement, Crenshaw
proposa l’outil d’analyse de
l’intersectionnalité pour
rendre compte du fait que
l’employée n’était pas
discriminée pour être une
femme ou pour être noire,
mais pour être une femme
noire.
Ce nouvel outil permet donc
de mettre en évidence des
situations invisibilisées (zones
grises juridiques) jusque là
par le cadre d’analyse de la
justice, partiel et déformant.
C’est aussi ce cadre qui
explique qu’on connaisse peu
le nom de toutes les femmes
afro-américaines tuées par la
police, encore aujourd’hui.
La situation d’Emma se
trouvait à l’intersection de
deux routes : celle de la
structuration sexiste du
marché du travail influençant
les politiques d’embauches, et
celle de la structuration
raciste de ce même marché.
Il est parfois impossible
d’imputer une cause précise à
la souffrance d’une personne à l’intersection de plusieurs
oppressions. Dans ce cas, on
ne cherche pas à quantifier la
discrimination (impossible de
déterminer qu’elle vit 60% de
racisme et 40% de sexisme ou
quelle oppression est la pire)
mais à évaluer les effets sur la
personne victime de la situation.
• l’intersectionnalité ne
remet pas en question la
politisation de l’identité mais
plutôt le caractère simpliste
de ses catégories (genre,
classe, race…). En effet,
Crenshaw affirme que : “Le
problème des politiques de
l’identité n’est pas qu’elles
échouent à transcender la
différence (...) mais plutôt le
contraire - elles amalgament
ou ignorent les différences
intragroupe”. C’est-à-dire que
les identity politics
reconnaissent les différences
entre les groupes (par
exemple entre les hommes et
les femmes) mais pas les
différences intragroupes (par
exemple entre les femmes
noires et les femmes
blanches).
• l’intersectionnalité
conçoit ainsi les identités
sociales comme des
constructions complexes (c’est
à dire un “assemblage” de
plusieurs identités, par exemple femme - noire - lesbienne). Ces identités ne peuvent donc pas être considérées indépendamment les unes des autres.
Crenshaw a eu une grande
influence sur le renouvellement des versions
des politiques de l’identité.
Selon l’auteure du texte, il
faut comprendre les
causes d’une oppression
pour lutter efficacement
contre elle. Or, le problème
de la conception de
Crenshaw, c’ est qu’elle
n’explique pas l’oppression*.
L’identité y est imposée par le
pouvoir, on ne peut s’en
défaire. En occultant que les
identités sont créées dans des
contextes sociaux et
historiques précis, on oublie
qu’elles peuvent changer
voire disparaître. L’identité est
ainsi décontextualisée, ce qui
nous fait penser qu’elle est
naturelle : de tout temps et
partout, les femmes noires ont
été / sont / seront opprimées
en tant que telles. L’intersectionnalité
appréhende les catégories identitaires de "femme" et de
"Noir.e" comme des traits hasardeux hérités à notre naissance et pour lesquels on
ne peut pas faire grand chose
(de la même manière que la
couleur des yeux, par exemple). Les gens qui vivent
l’oppression n’y peuvent rien,
à part porter plainte une fois
que le mal est fait. On naît
dans une société sexiste et
raciste, dans laquelle les
femmes noires subissent
les deux. Point.
Il s’agit de faire avec. En
ayant recours aux
règlementations contre les
discriminations par exemple.
Et même si Crenshaw a en
tête que ce sont des groupes
qui subissent certaines
oppressions, son concept
aborde l’identité comme
quelque chose que chaque
individu doit subir
individuellement.
L’intersectionnalité permet
d’attaquer en justice une
entité précise (ici General
Motors) pour obtenir
réparation dans une situation
de discrimination individuelle.
En se limitant à personnaliser
les effets de l’oppression et de
l’identité (des gens vont se
retrouver à des intersections
et souffrir), on ébranle
difficilement la société car on n’arrive pas à penser des
actions collectives visant les
bases du système sexiste, raciste et capitaliste.
Puisque le discours de
l’intersectionnalité* conçoit
l’identité comme préexistante
à la construction du monde
social, sa compréhension
commune fait que :
• l’identité (ici de
femme noire) n’est pas
appréhendée du point de vue
de ses fonctions de maintien
du capitalisme, c’est-à-dire :
→ le racisme et
le sexisme justifient qu’on
relègue les femmes noires
dans des positions inférieures,
d’emplois précaires et
dévalorisés. En les
déshumanisant, ces
oppressions permettent aussi
de rendre supportable qu’on les exploite ;
→ faire des strates sexuelles et raciales
entre travailleurses permet
aux exploiteurs de masquer
les intérêts communs que les
travailleurs partagent. On se
retrouve par exemple avec
des discours sur les périls que
représentent les migrants
pour les travailleurses françaises. Ça permet aussi d’exercer de la pression sur
les travailleurs les moins mal
loties : s’ielles ne se plient
pas à certaines contraintes,
on peut embaucher moins cher / délocaliser...
→ ce maintien des Noir-e-s dans des
positions inférieures permet
aux femmes blanches de
classes supérieures de se
décharger de leurs tâches
domestiques quotidiennes.
L’organisation raciste et
sexiste du marché du travail
leur permet d’éviter des
postes pénibles et mal
reconnus qui leur incomberaient sans doute en
partie (aide à la personne, infirmières...) ;
→ les discours libéraux* sur l’identité*
entretiennent chez certaines
féministes le fantasme
d’égaler les possibilités de
carrière de leur pairs
masculins blancs. Or, tout le
monde ne peut pas
déserter la maison ou les
métiers du soin. Tout le
monde ne peut pas atteindre
le modèle de l’homme blanc
cadre. Pour être au sommet, il
faut des gens en-dessous. Le
fonctionnement du
capitalisme c’est que des
gens s’enrichissent en volant les fruits du travail d’autres gens. Derrière tout
enrichissement il y a donc de
l’ exploitation. Masquer cela
permet de rendre crédibles
les discours individualistes de
mérite, d’effort et de carrière.
C’est nous faire miroiter qu’on
peut toustes se hisser vers le
haut de la pyramide sociale.
• l’usage commun de
l’intersectionalité se
concentre sur la mise en
avant de toutes les
intersections d’oppressions
possibles, les multiples
différences entre les groupes,
les intersections avec
d’autres groupes puis à
l’intérieur des groupes.
Appliquée au militantisme
elle n’encourage pas à
beaucoup plus que
nommer les intersections
de système d’exclusion.
Elle ne nourrit pas l’analyse
de ces systèmes ou l’action
collective. Au contraire, cette
focalisation sur la diversité
des intersections a amené à
définir l’identité en termes
culturels (ce que chaque
groupe vit, souffre, crée et
valorise…). On y revient dans
la partie 5.
L’ennui, c’est que sans expliquer les systèmes oppressifs, se retrouver à une
intersection est juste quelque chose "cool", ou de pathologique et d’indésirable. Bref, c’est paralysant.
C’est sans doute un des
problèmes posé par le
glissement d’un outil juridique
vers une valeur politique.
Aujourd’hui, intersectionnel
devient même une identité...
C’est devenu synonyme de
lutter contre toutes les
oppressions. Ce qui a une
valeur surtout déclarative. Et
en plus du caractère faux et
impossible de cette prétention, on glisse vers des
non-sens comme qualifier des
associations d’intersectionnelles, et à
condamner des gens qui ne diraient pas qu’ils sont intersectionnels !
Cette conception actuelle
de l’intersectionnalité*
reflète les tensions
actuelles des politiques de
l’identité. Tout d’abord, les deux
conceptions (identity
politics et
intersectionnalité)
conçoivent l’identité
comme une imposition sur nous, comme une marque
de pouvoir. Ceci engendre
que nous cherchons de la
reconnaissance (auprès de
nos pairs et des
institutions) sur la base d’
identités* imposées et
essentialisées*.
Ensuite, valoriser des
identités imposées par
l’extérieur et liées à un vécu
d’oppression revient à
revendiquer l’impuissance
comme une vertu
politique. C’est valoriser
d’avoir été privé de
pouvoir. La situation subie
des opprimé-e-s est donc
presque présentée comme
choisie, comme un mérite qui
consiste à renoncer
volontairement au pouvoir,
voire à souffrir pour être bon.
On se retrouve alors avec des
aberrations comme le fait de
mesurer si des personnes
souffrent assez/sont assez
privées de pouvoir pour
s’affilier à des identités
(exemple de l’inclusion des
bisexuel-le-s dans les
communautés transpédégouines).
Malgré les racines évidentes qu’elle partage avec le CRC, l’intersectionnalité a donc
évolué en prenant de la
distance vis-à-vis de la
défense d’une émancipation
universelle*. Ça coïncide avec
la tendance néolibérale à la
concurrence individuelle,
représentée en politique par
l’orientation sur le besoin de
reconnaissance des
spécificités propres à chaque
petit groupe. On retrouve ça dans
l’analogie du sous-sol de
Kimberlé Crenshaw. Dans cet
exemple, les opprimé-e-s sont
superposé-e-s les un-e-s sur
les épaules des autres et
confiné-e-s dans un sous-sol :
• les plus désavantagé-e-s se trouvent en bas,
• ceux qui le sont par un seul facteur effleurent le plafond,
• au plafond se
trouvent les personnes qui ne
sont pas désavantagées.
• les moins désavantagées peuvent se
faufiler jusqu’à l’étage supérieur, par le plafond.
Avec cette analogie, l’auteure met en évidence que dans l’intersectionnalité :
• on voit l’oppression comme une
addition, les oppressions
sont “superposées”.
• le pouvoir apparaît
comme fonctionnant à
travers des
discriminations
interchangeables (les
oppressions sont vues comme
"égales") et interpersonnelles.
Elles peuvent se cumuler les
unes sur les autres.
Mais c’est faux. Les pouvoirs
sociaux n’ont pas les mêmes
formes et les mêmes
fonctions. Et avoir du pouvoir
n’est pas toujours oppressif.
Les dynamiques de pouvoir
produisent des gens qui ont
des histoires complexes et
souvent fragmentées. En
effet, certains pouvoirs sont
modifiés voir contredits ou
renforcés par d’autres. Ils ne
jouent pas forcément dans
des mêmes sphères de la vie,
et ils ne se manifestent pas
tous de la même manière.
C’est pourquoi on ne peut
pas juste faire des
additions ou des
soustractions. En plus,
penser comme ça
encourage la mise en
concurrence entre les
luttes et entre les gens.
On peut penser à la course aux oppressions qui existe dans certains milieux politisés, où en cas de conflit, montrer qu’on cumule des
oppressions permet de rendre
moins entendables les
opinions ou les besoins de
personnes qui en vivraient moins.
Rappelons encore qu’il est
maladroit de comparer
sexisme et racisme parce que
cela sous-entend que toutes
les femmes sont blanches et
que toutes les personnes
noires sont des hommes.
• Les opprimées sont
vues comme étant en
concurrence, se hissant les
unes au-dessus des autres
pour atteindre le sommet ;
• les personnes
privilégiées, discriminées
singulièrement, sont
admises individuellement
en se faufilant à travers une
trappe ouverte par ceux de
l’étage supérieur.
Il s’agit-là d’une vision dans
laquelle la solidarité entre
opprimés est impossible,
car il s’agit d’un rapport de
concurrence entre personnes
différemment discriminées. La
possibilité d’être invitées par
les plus privilégiés à se
faufiler dans la trappe
réaffirme le pouvoir des structures existantes pour
contrôler qui est inclus. Ceci
crée plutôt une politique de la
demande (d’inclusion) qui
dépolitise le conflit : les progrès ne sont pas perçus
comme étant gagnés ou pris, mais réclamés et accordés.
Pour être claires et expliciter
le lien avec la partie 1) sur le
néolibéralisme, on rappelle
que l’auteure fait la différence
entre la période de naissance
des politiques de l’identité
(conceptualisées par le CRC),
qui étaient directement
reliées à des conditions
matérielles partagées ; et les
politiques de l’identité
d’aujourd’hui, qui risquent de
plus en plus d’entrer en
compatibilité avec le
néolibéralisme. Pourquoi ?
Parce que les politiques de
l’identité d’aujourd’hui :
• se concentrent sur la
reconnaissance et les
dynamiques interpersonnelles, incarnées
dans le cadre de l’intersectionnalité.
• lient aujourd’hui l’identité à l’authenticité*, à une vérité intérieure qui
l’emporte sur ses bases
matérielles. Ce qui prime
maintenant pour s’affilier à une identité c’est le ressenti personnel, l’affinité psychologique qu’on ressent pour une identité.
• en s’éloignant de la
compréhension des racines de
l’oppression, l’identité est
devenue une fin en soi, où
l’on cherche à affirmer les
identités dénigrées. Il faut
que chacun-e "trouve" ce qu’il est...
• encouragent la
tendance à l’affirmation de
soi (comme l’injonction à la
visibilité) et entre ainsi en
compatibilité avec la logique
néolibérale. Il faut être soi,
être authentique*… Ce qui est
important c’est de trouver des
pairs, de s’assumer...
L’intersectionnalité est devenue le cadre dominant à travers lequel l’identité est
imaginée, non seulement
dans les milieux activistes
mais aussi dans les ONG et
les institutions gouvernementales !
Même si à la base, l’intersectionnalité était prévue
pour rejeter des conceptions
uniformes et essentialistes* de l’identité (ce qu’est être
une femme, être noir…), elle
a surtout participé à multiplier
les catégories d’identité sans
troubler ce qui est affirmé par
les identités. Ceci car
l’intersectionnalité pose au
centre l’affirmation de
l’identité. Par exemple, on
répond au patriarcat par la
création de multiples identités
sexuelles et de genre non
conformes ou encore par la
demande de représentation
des personnes trans au
cinéma. Et on peine à
remettre en question ce qui
est affirmé et ce qui fait
communauté, comme la
division genrée et raciste de
la production dans une
société capitaliste. Selon
l’auteure, la multiplication des
identités "hors-normes" ne
fait que renforcer l’idée qu’il
existe une norme naturelle et
est donc essentialiste*.
Pour prendre exemple sur
le féminisme, on peut
penser à la création de la figure du "cis hétéro", ou dans une version plus éveillée
le "cis hétéro riche blanc valide", qui fige dans une
identité et certains traits de personnalité la figure de l’oppresseur :
1) cela transforme la lutte
contre le patriarcat en une
lutte d’une/plusieurs identités
contre une autre. On passe
d’une lutte à objectifs
universels (fin de l’exploitation pour toustes) à
des luttes identitaires ;
2) ce glissement de
grammaire politique empêche
de penser que l’oppression
est une dynamique complexe
et changeante selon le
contexte et les transformations du capitalisme ;
3) la vision identitaire du
féminisme ou des mouvements queers fige les
individus dans une ou plusieurs identités, alors que
les dynamiques sociales sont
tellement complexes et multiples que chacun-e peut
passer d’une situation d’exercice du pouvoir contre
autrui à subissant le pouvoir d’autrui ;
4) réduire la lutte politique à
une histoire de camps réduit
les individus aux identités
qu’on leur colle. Cela
empêche de penser la complexité des individus et
de leur prêter la capacité à se
réunir pour des projets
politiques dépassant leur
intérêts identitaires. Nous
sommes donc privés de notre
créativité pour penser des
alliances stratégiques.
Par exemple, on peut citer
l’intérêt que les personnes
trans blanches et les
personnes noires et/ou
migrantes auraient à
s’organiser autour des
questions administratives et
de contrôle d’identité par la
police. On peut aussi penser
aux questions de masculinité,
que la vision féministe
identitaire (les femmes contre
les hommes ou les queers
contre les hommes cis ou cis
hétéro) nous empêche
d’aborder dans toute leur
complexité. En effet, de par la
forme de leur corps, leur
orientation sexuelle et/ou leur
race... tous les hommes n’ont
pas le même accès au privilège masculin ;
5) les dérives des identity
politics situent aussi le
pouvoir chez l’autre, qui est
vu comme mauvais. Ceci
entraîne à condamner dans le
même élan tout type de
pouvoir. Et donc à s’en priver.
6) pour chaque oppression, on
a donc deux camps : ceux qui
profitent et ceux qui subissent. Ce postulat est
problématique parce qu’on
est toustes traversées par les
systèmes oppressifs. Même
quand on subit une
oppression, on est partie
prenante et donc en mesure
de jouer un rôle pour s’y
opposer. De plus, même
quand on subit une
oppression, on peut la
véhiculer. Par exemple, le
patriarcat est en partie appris
et reproduit dans les familles
et donc notamment véhiculé par les mères.
Pour finir sur cette partie,
l’auteure pense que si on a
pu reprocher aux
politiques de l’identité
d’être essentialistes*,
particularistes* et
déterministes*, c’est
qu’elles ont échoué à être
attentives aux différences
dans les groupes et ont
plutôt reproduit les
structures de domination
en leur sein.
NB : Les mots suivis d’une * sont définis dans le "lexique (très) orienté à gauche" que vous pouvez retrouver dans les PDF de la brochure.
S’il y a :
◎ des choses pas claires,
◎ des besoins d’expliciter des enjeux complexes du texte,
◎ des envies de discuter de ça avec nous,
on a créé une adresse mail et elle est faite pour être contactée :
souffrance-politique@@@riseup.net
On ne répondra pas aux attaques sur le contenu, aux procès d’intentions, ou aux arguments qui “moraliseraient” le texte comme mauvais, à ne pas diffuser, etc., trop la
flemme, désolé !
Voilààà, bonne lecture, hâte d’avoir vos retours, de voir les effets directs ou non du texte sur les espaces politiques et on vous donne rendez-vous hyper bientôt pour la suite du texte !
Marseille, France, octobre 2023.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.4 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.3 Mo)