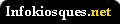R
La route est longue, mais je lâche rien
Témoignage d’un parcours de soin post-traumatique
mis en ligne le 8 janvier 2024 - Marvic
Témoignage d’un parcours de soin post-traumatique, ou comment la culture du viol et le tabou entravent les victimes en quête de résilience.
Le texte qui va suivre est la postface du roman autobiographique Pente raide, disponible aux éditions Ici-bas, et dont voici la 4e de couverture :
« Je voudrais parler de tous les viols, je voudrais que ce récit, comme d’autres qui ont fait émerger en moi le désir, le courage et la force de raconter, te donne aussi la force à toi, lectrice ou lecteur à qui c’est arrivé hier, à qui c’est arrivé enfant, de raconter à ton tour, pour que se fissure de plus en plus le mur de ce tabou. »
Marvic, extrait de l’introduction
* * *
Voici une femme qui voyage seule, à pied. Avec elle, des rêves, des désirs, des émerveillements. Et dans son sillage, des hommes parfois amicaux, souvent prédateurs, et quelques fois agresseurs.
Dans ce récit de voyage qui nous amène jusqu’en Iran, l’autrice raconte le harcèlement, un viol et les pentes raides qu’elle a dû gravir pour continuer à vivre après son agression. Empreint d’une lucidité et d’une sincérité totales, toujours poignant, parfois déroutant, Pente raide est un témoignage sans fard sur l’entrave que constitue la culture du viol pour les victimes en quête de reconstruction. Il contribue aussi à une réflexion essentielle sur la justice, le processus de réparation après une expérience traumatique, ainsi que l’indépendance et la liberté.
Marvic est autrice. Pente raide est son premier livre.
Lyon, librairie La Gryffe, un samedi de manif en 2020.
— C’est toi, l’autrice de Pente raide [1] ?
— Euh… oui, je réponds avec le sourire.
La personne semble mal à l’aise.
— J’ai lu ton livre. Ça… ça va, maintenant ? Gêne. C’est quoi cette question ? J’ai l’air d’aller mal ? Les potes m’attendent derrière la librairie pour prendre l’apéro après une belle manif. J’ai passé une super aprèm. Je pétais la forme avant qu’on me renvoie en trois mots à un statut de condamnée au malheur. La petite boule de colère se dissipe rapidement quand j’imagine la bienveillance qui se cache derrière la question maladroite :
— Oui, ça va ! je lance rapidement, tentant tant bien que mal de ressusciter mon sourire. Là je vais boire des coups, à plus !
« Boire des coups », c’était une manière de dire sans passer par quatre chemins ce que je pensais avoir déjà mentionné dans le livre. Que la vie continue. Que ce ne sont pas quelques coups de reins non consentis qui vont me barrer pour toujours l’accès au bonheur. Ce n’était donc pas assez clair.
À ce moment-là, tout allait parfaitement bien.
À d’autres, je vais moins bien. Parfois, même, je vais terriblement mal. Ainsi va la vie pour toutes les personnes. Violées ou pas violées. Apitoiement, misérabilisme, personne n’en veut. Ceci dit, derrière la question, j’ai compris ce que beaucoup avaient envie de savoir – à juste titre –, et j’ai eu envie d’apporter quelques éléments de réponse. Après avoir décortiqué les séquelles laissées par ce viol, j’ai eu envie de raconter. Parce que souvent, on fait du déni. Parce qu’on ne sait même pas nous-mêmes ce que le choc nous a laissé. Parce qu’on se dit, oui, ça va, enfin ça dépend, je ne sais pas, quelle question étrange, parfois ça ne va pas, mais avant non plus, je n’allais pas toujours bien…
À cause de ce tabou persistant autour du viol, presque personne n’en parle. Ce tabou-là est criminel, parce que non content d’empêcher les victimes de se reconnaître en tant que telles, de parler, de dénoncer les coupables, il les empêche de se soigner, et donc de guérir. On dit qu’on ne guérit pas des séquelles d’un viol. C’est faux. On pourrait guérir de tout, si et seulement si la société acceptait et assumait matériellement qu’il y a une victime blessée à soigner, et non une coupable, honteuse, à cacher.
Ça fait sept ans qu’on m’a violée. Ça fait un an que j’ai vraiment réalisé l’ampleur des séquelles et que, terrifiée, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai décidé de les regarder en face. Au printemps 2022, j’ai mis un terme à une thérapie EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires), et aujourd’hui je constate avec joie que les conséquences physio logiques et psychiques de ce viol se sont atténuées au point de n’occuper qu’une place mineure dans mon existence.
Pourtant, je ne m’en suis pas « sortie ». Qu’est-ce que ça voudrait dire ? Vivre comme si ça ne s’était jamais passé ? Avaler une pilule et retrouver cette part de naïveté morte à jamais ? Je n’en ai pas envie. Non, je ne sortirai pas de la forteresse où se trouvent toutes les victimes, celles qui ont parlé, celles qui se sont tues, celles qui sont restées coincées pour toujours dans des névroses infernales, et même les fantômes de celles qui en sont mortes. Où se trouvent aussi celles et ceux qui ont eu la chance de trouver des béquilles voire, un beau jour, de ne plus en avoir besoin. J’y resterai et continuerai à être hantée par la colère qui y plane, à vouloir détruire ses murs, rageusement, méthodiquement, désespérément, ou joyeusement. À dévoiler encore et encore la banalité et la supercherie de ce mensonge trop bien ficelé du patriarcat, qui nous répète jusque dans nos cauchemars que nous sommes coupables et condamnées, tout en disant au monde que nous n’existons pas. C’est un crime où les victimes se sentent coupables. Un crime qu’on a omis de mentionner et d’interdire dans l’éducation de ceux [2] qui le commettent. Et que, en revanche, on met bien dans la tête des filles pour qu’elles continuent d’avoir peur et de rester chez elles où, bien trop souvent, on les violera quand même.
Il est compliqué de raconter ce qui s’est passé de douloureux depuis le viol, et de distinguer ce qui était dû à cet événement ou bien à ma personnalité forgée dans le royaume du patriarcat, à d’autres traumas de l’enfance, au cours infiniment complexe de la vie...
Un viol, qu’est-ce que ça fait ? C’est une question à laquelle il est difficile de répondre de façon univoque. Je prendrai quand même le risque d’affirmer que dans (presque) tous les cas, il vous brise d’une manière profonde et brutale.
Je vais tenter de raconter ce que je soupçonne avoir été provoqué par ce trauma, afin de participer à la construction d’une banque d’informations et de témoignages sur les séquelles qui peuvent survenir après une blessure aussi grave, et s’avérer destructrices si l’on ne fait rien.
Trois ans après le viol
Il ne m’a pas dit au revoir. Pourquoi il ne m’a pas dit au revoir ? Il se passait quoi, dans sa tête ? Je n’existais pas, c’est ça ? Je n’existe pas. Voilà. Je n’existe pas. Ça résonne en moi beaucoup trop violemment. Boule dans le ventre. La nausée. Je veux gerber. C’est pas possible... Hier, on se regardait dans les yeux, ils brillaient, hier il avait l’air de m’aimer et aujourd’hui je n’existe plus ?
Je suis en PLS dans ma chambre. Cette petite chambre au bout du long couloir du deuxième étage d’un squat. Combien de larmes ont coulé dans cette piaule où j’ai écrit Pente raide ? J’écrivais Pente raide quand j’allais bien. Écrire Pente raide, c’était joyeux, intense, je m’envolais loin de la piaule, loin de ces sentiments amoureux qui me donnaient des vertiges, loin de mes dépendances. Mais ce jour-là, j’avais mal. J’ai pleuré pendant des heures toutes les larmes de mon corps et de mon cœur, et mon cerveau commençait à se cogner contre ma boîte crânienne, épuisé par tant de larmes.
Mais arrête putain, bien sûr que t’existes, il est comme ça, lui, des fois, il ne dit pas au revoir, ça n’a rien à voir avec ton existence, c’est juste un gros malpoli ! Écris-lui pour qu’il te rassure ! Je ne veux pas lui écrire...
Si je lui écris, c’est que, encore une fois, la folie a gagné. Encore une fois, j’aurai failli. Si tu lui dis, il va fuir, il te prendra pour la tarée de service et ne voudra plus jamais de toi, et alors là, tu n’existeras vraiment plus... J’ai trop mal, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends rien, je ressens une tristesse et un désespoir sourd, lointain, je ne comprends pas d’où ça vient, je ne sais pas mettre de mots, c’est ultra violent et ça me dépasse. Je me retiens de hurler, la tête dans le coussin, pour que personne ne m’entende depuis la chambre voisine. Pour qui vais-je passer ? Une folle. Je suis folle. Voilà ce que je suis : complètement folle !
J’ai pleuré comme ça, le corps remué de violentes secousses, en me roulant dans la couette. À un moment, j’ai regardé l’heure. Ça fait sept heures que je pleure. Ça fait sept heures que je pleure... Ça fait sept putains d’heures que je pleure ! J’ai mal de savoir ça. Ces sept heures-là objectivent ce que je suis en train de ressasser : je suis folle à lier ! Je suis vraiment folle ! Personne ne pleure aussi longtemps pour un au revoir, personne ! Personne...
Et je pleure encore d’avoir pleuré trop longtemps.
Jusqu’à ce que mon corps lâche d’épuisement. Je suis vidée, rincée. C’est enfin terminé. La crise est passée. J’ai mal au crâne. Je descends les escaliers, ma tête tourne, je me sens comme ivre. Il y a du monde dans la cuisine du squat. Je raconte aux potes, désespérée, fatiguée :
— Je viens de pleurer pendant sept heures non-stop. Et après j’ai pleuré cinq heures de plus quand je me suis rendue compte que j’avais autant pleuré. Éclats de rire dans la pièce. On me taquine gentiment et alors je ris de soulagement, un rire nerveux et réconfortant. Je ris de moi-même.
— Mais Victoire, voyons ! Appelle-nous, la prochaine fois !
— Oui mais je peux pas appeler dans ces moments-là...
— Bon, on va t’installer un Babyphone, alors ! Il ne faut pas que tu restes des heures toute seule dans cet état. Rajoute-le sur la liste de courses : « Babyphone pour Victoire », suggère Lune brillamment, et ça fait rire la galerie de plus belle.
Personne ne me demande pourquoi j’ai pleuré. J’ai rencontré cette joyeuse bande de punks en rentrant de mon voyage, alors que j’allais régulièrement faire la fête au Rafiot, un grand hangar automobile squatté qu’elle avait ouvert à Gerland, entre une quatre-voies, un incinérateur et les camions des putes. La bande y organisait d’énormes teufs techno qui rameutaient tout Lyon et où j’adorais venir avaler des extas et danser jusqu’au petit matin. On habite ensemble maintenant, dans un grand prieuré de deux étages avec une vingtaine de piaules.
Et derrière leur franchise et leur cynisme, ces gens ont la délicatesse de sentir quand il faut demander ou pas : peu importe le nombre de larmes, personne ne semble me trouver bizarre, folle, nulle. Tout le monde en rit gentiment. Ici, tout le monde est un peu zinzin, je crois. Personne ne juge le mal-être des autres. Ce n’est pas de l’indifférence, au contraire, je n’ai jamais rencontré de gens avec une telle niaque pour s’entraider, se soutenir le cœur sur la main, s’organiser collectivement pour ça. Le mal-être, ici, est accueilli sans jugement – voire avec humour quand on en a envie. Moi, j’en ai toujours envie. Rire, ça fait taire les larmes. Tout paraît plus dérisoire, moins douloureux. Derrière chaque blague, je reçois cette tendresse, qui me fait sentir que j’existe....
Plus tard, j’ai appelé mon amoureux. Je lui ai dit que quand il partait du squat sans me dire au revoir, ça me mettait très mal. Je ne lui ai pas raconté en détail ; je n’assume pas. J’ai peur d’être flippante. J’ai peur qu’il ne comprenne pas. Je ne sais pas s’il doit savoir ça, ni à quel point il devrait le porter, je reste évasive. Il me dit qu’il fera attention à toujours me dire au revoir, que pour lui ce n’est pas un réflexe, mais que si moi j’en ai besoin, il le fera. À ce moment-là, je me sens ridicule. Complètement nulle. Lui, après m’avoir rassurée, il doit sûrement avoir l’impression d’être quelqu’un de bien et gagner en confiance. Alors que moi, j’en perds encore un peu plus, écrasée par ce sentiment de culpabilité inhérent à ma construction féminine. Et alors les écarts se creusent, et le patriarcat se renforce dans un système parfaitement ficelé jusqu’au sein de nos relations intimes. Dans lesquelles on se sent souvent coincées, à avoir besoin du réconfort de ceux-là mêmes qui nous malmènent et nous dominent par ailleurs [3] .
Le patriarcat, unique remède officiel aux maux du patriarcat…
La nuit, je me réveille très souvent pour pisser. Quand on dort ensemble et aussi quand je dors seule. C’est infernal. Ça dure depuis deux ans. Je ne comprends pas ce qui arrive à ma vessie, et à aucun moment je ne suppose que cela pourrait être relié au trauma. Quand je dors avec un garçon, j’ai toujours le sentiment de le déranger en allant aux toilettes. Et plus j’ai le sentiment de déranger, plus je suis stressée, et plus je me lève. Et, éducation genrée oblige, pas un n’a ne serait-ce que pensé à me rassurer, à me mettre à l’aise pour que je dorme mieux. Ce sont de petits pipis qui sortent par intermittence, comme un harcèlement perpétuel. Cinq, dix, vingt réveils par nuit. Plus de trêve. Ma vessie est devenue une ennemie. Elle me pourrit la vie et je me prends parfois à la haïr, tellement je n’en peux plus. J’en arrive même à fantasmer de me foutre des couteaux dans le bide pour l’éclater. C’est au moment où j’ai entamé l’écriture de Pente raide que j’ai voulu m’en occuper coûte que coûte. Je ne voulais pas passer ma vie comme ça.
J’ai d’abord cru que j’avais un problème physiologique. Ma généraliste m’a envoyée faire une échographie. Puis j’ai vu un urologue. On m’a prescrit les médicaments qu’on prescrit aux personnes âgées incontinentes. Un truc hyper fort qui m’asséchait tellement que je passais ma nuit à me lever pour boire de l’eau en même temps que j’allais pisser.
J’ai revu l’urologue. Il m’a redirigée vers une spécialiste pour réaliser une cystoscopie. Je me suis retrouvée sur une table, culotte baissée, les jambes écartées, et une docteure m’a enfoncé une sonde dans l’urètre. Il y avait une machine qui observait ce qu’il se passait tandis qu’on m’injectait de l’eau dans la vessie par l’extérieur et qu’on me demandait de pousser pour la vider.
— J’ai envie de vomir... Je me sens mal...
— Je ne vois pas pourquoi vous auriez envie de vomir, on est sur votre vessie, a froidement répondu la docteure sans me regarder, continuant son examen.
— Mais parce que ça me dégoûte, je ne supporte pas le tuyau.
Qu’on m’injecte du liquide par l’extérieur, ça me faisait tourner la tête et l’estomac.
— Ça ne devrait pas vous dégoûter mademoiselle, c’est votre corps ! Je vois que votre vessie a un comportement tout à fait normal. Elle se vide et se remplit parfaitement. Sur l’échographie, il n’y a rien non plus. Mademoiselle, je pense que c’est dans votre tête. Avez-vous essayé de vous retenir ?
Avez-vous essayé de vous retenir... Elle a étudié pendant dix ans pour me répondre ça ? C’est de la provoc’ ? Elle ose dire ça à quelqu’un qui lui dit ne plus dormir depuis des années ?
Cette scène m’a hantée quelque temps. Chaque nuit, pendant mes allées et venues entre les chiottes et le lit, le conseil avisé de la docteure ressurgissait et me remplissait d’amertume. Voilà ce que ça fait, un viol, ou d’autres chocs émotionnels : des séquelles physiologiques psychosomatiques, certes, mais tout de même réelles. On les connaît mal, on ne les prend pas au sérieux, on ne sait pas les soigner, et on vous en rend autant responsable que de l’agression elle-même [4].
La docteure m’a renvoyée vers l’urologue. En dernier recours, celui-ci m’a préconisé des injections de botox dans la vessie.
— Réfléchissez-y, et on se revoit.
Non. Je ne vais pas me foutre du botox dans la vessie. Je ne sais pas bien ce que c’est, mais ça m’évoque des visages refaits, un truc bien chimique, et ça me répugne d’avance. Elle est déjà complètement détraquée, je ne vais pas en rajouter une couche.
À ce moment-là, j’ai su qu’il fallait que je trouve autre chose pour me soigner. J’ai alors commencé l’acupuncture – en médecine chinoise, la vessie est liée à la peur. Ça n’a pas réglé le problème non plus, mais j’y ai glané quelques pistes. Sur la table de la docteure, ma vessie s’était vidée bien comme il faut. Dans le lit des garçons – et même seule –, c’était autre chose. Il suffisait d’une pauvre drague au bistrot, d’un bref regard de désir ou de n’importe quelle intention amoureuse ou sexuelle pour que ma vessie se réveille. Et j’en parlais de ce viol, j’écrivais même un livre dessus, mais je ne faisais pas le lien. Est-ce que c’est ça, le déni ?
Ça fait quoi, un viol ? Est-ce que ça produit tout ce que je vous raconte ? Les choses sont probablement plus complexes, mais je crois que ça y participe. Ce que je peux ajouter, ce sont les conséquences de ces problèmes physiologiques sur votre existence entière : ne pas dormir, être fatiguée, extrêmement fatiguée, péter des câbles plus facilement, voir nos émotions nous submerger, nos relations amoureuses déchirées, déchirantes, violentes.
Au travail aussi, c’est la galère. Une année après mon retour de Turquie, j’ai embauché dans une boîte d’aide à la personne. Se lever avant sept heures du matin sans avoir dormi de la nuit, c’est compliqué. Une ou deux fois par semaine, j’aurais pu encaisser, mais ça m’arrivait beaucoup plus souvent. Et dans ces métiers, tu ne peux pas te permettre d’être en retard : des gens malades comptent sur toi, sans parler de cette autre fille qui attend de pouvoir rentrer chez elle après une longue nuit de garde.
J’ai tenu six mois. Puis j’ai craqué : j’ai hurlé sur une patiente. C’était une patiente chiante, certes, mais elle ne méritait pas ce craquage dû à la fatigue. J’ai présenté des excuses qu’elle a refusées, ce qui m’a poussée à démissionner, honteuse et coupable. J’ai ressassé cette histoire pendant des mois. La confiance qui baisse encore.
En fait, c’est ça : ces problèmes de santé, physique, mentale, c’est la galère d’un cercle vicieux qui te vide petit à petit de toute confiance.
* * *
Mais je continuais à me penser en guerrière. À chaque démission, à chaque rupture, à chaque crise d’angoisse, alors que je me sentais désespérée, folle, nulle, incapable, je finissais par me relever et me répétais, inlassablement : tu vas y arriver, un jour tu vas te sortir de tout ça. Un jour tout sera plus léger, plus simple. Rien n’est figé, tout peut aller mieux. Garde la foi, ne la lâche pas, jamais, sinon tu n’avanceras plus.
J’en suis même venue à penser que je n’étais plus en mesure de travailler. Il fallait résoudre ce problème d’urine. Absolument. Une copine avait souvent des anxiolytiques sur elle. Quand je la voyais, je n’attendais qu’une chose, qu’elle m’en file. Ces trucs-là arrêtaient les crises de larmes, stoppaient les pétages de plomb, calmaient même la vessie et me faisaient dormir, c’était magique. Un jour, elle a mis un peu de temps à me les filer, alors que je venais de me disputer avec mon copain. L’impatience m’a rendue agressive. Elle m’a dit qu’elle ne m’avait jamais vue comme ça. Elle s’est inquiétée. Prendre des anxiolytiques, c’est toute une histoire, l’image que ça vous renvoie à vous-même, ce cap-là. J’ai mis longtemps à assumer que j’étais devenue dépendante d’une béquille, d’autant plus que celle-ci était produite par une industrie qui me répugnait et s’engraissait sur le malheur. Je me disais que ce n’était pas grave, que ce n’était pas un échec, que c’était juste un passage, et quand bien même ce passage durerait toujours, j’aurais fait de mon mieux avec les solutions qui m’étaient proposées.
Au début, je n’en prenais que de façon très ponctuelle, ne m’en procurant que quelques-uns quand je voyais ma copine. Trois ans plus tard, j’ai commencé à travailler avec des jeunes psychotiques, alors j’y ai eu accès à volonté. Dans ce taf, on faisait des nuits de garde, on bossait jusqu’à sept jours d’affilée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, et lors des quelques heures de repos qu’on avait, je n’arrivais pas à dormir, encore une fois à cause des allers-retours aux toilettes. J’ai commencé à piquer dans les placards, d’abord très rarement, puis c’est devenu une habitude. J’ai fini par démissionner au bout d’un an et demi. Le taf était stressant, certes, mais il n’y avait pas que ça : je ne m’en sentais pas les épaules, parce que psychologiquement j’avais trop de trucs à régler. De nouveau, j’en ai conclu que sans sommeil, travailler n’était pas une bonne idée.
À cette période, j’assumais : les cachetons me permettaient de dormir. Et même si je n’en prenais pas tous les soirs parce que j’avais trop peur des conséquences sur ma santé, d’un état d’addiction duquel je ne parviendrais jamais à revenir, je n’allais pas m’en priver pour quelques soirs par semaine. Je n’ai jamais passé le cap de m’en faire prescrire, je trouvais toujours le moyen de m’en procurer autrement. Mais j’étais à deux doigts de consulter un psychiatre pour avoir une ordonnance quand j’ai commencé une thérapie et que j’ai senti que les choses iraient de mieux en mieux.
* * *
Je me suis encore coincé le dos. Ça m’arrive plusieurs fois par an et ça m’handicape complètement. Apparemment, ce serait le nerf sciatique. Je ne peux plus marcher, et mon buste est incliné à quarante-cinq degrés vers l’avant – et un peu sur la droite. On me demande toujours si j’ai mal, mais non, pas vraiment, je suis seulement coincée ! Je ne peux pas me tenir droite, mes muscles refusent, ils sont tellement tendus que toute la mécanique est bloquée. Je marche difficilement, et évidement je ne peux pas aller bosser. Je vais voir une pote ostéopathe. Elle tente de me soulager, mais finit par me dire qu’elle ne peut rien pour moi. Depuis des mois que je viens, rien ne s’arrange. Il faut que je cherche ailleurs, ce n’est pas de son domaine de compétences. J’avais commencé par aller chez le docteur, qui m’avait prescrit des antidouleurs. Comme ça ne marchait pas, on m’avait filé quelque chose de plus fort : du Kétoprofène.
— Du Kétoprofène ? Mais on vous a vraiment prescrit ça ? s’étonne la pharmacienne. C’est un anti-inflammatoire très fort. Faites attention, il provoque des douleurs au ventre.
Mon dos était toujours autant coincé, mais en plus j’avais envie de gerber. Je me souviens d’un échange avec ce médecin :
— Vous avez essayé de vous muscler le dos ? La natation est préconisée pour les lumbagos chroniques.
— Je fais de la natation deux fois par semaine depuis deux ans. Ça ne change rien du tout.
— Eh bien je ne sais pas, faites-en plus ! a-t-il lâché nonchalamment.
Faites-en plus… Faites-en plus !
J’avais dû apprendre à nager le crawl, puisque la brasse n’est pas recommandée dans ces cas-là. Je ne savais pas en faire du tout, alors je buvais la tasse, ça me rappelait l’école où on nous forçait et où j’étais la plus nulle de la classe… Mais après maints efforts, j’ai fini par savoir laborieusement le nager. Et même par aimer ça. Mais sans effets sur mon dos.
* * *
Nouveau blocage. Ça se passe au travail, lors d’un séjour pour jeunes psychotiques. Je ne peux pas me permettre de partir. Les collègues sont compréhensifs. Une gamine se moque de moi, elle rit de me voir tordue comme ça, et quand elle comprend que j’en chie, elle devient hyper gentille alors que d’habitude c’est la pire des pestes, toujours le mot pour blesser. À la fin du séjour, c’est pire que tout, je peux à peine marcher. Une collègue me propose de me conduire chez un somatologue, qui serait selon elle un mec hyper fort. Elle lui passe un coup de fil et lui décrit ma situation.
— Amène-la-moi, je vais la décoincer.
Je suis assez cynique devant tant d’assurance. Ce type-là ne m’a jamais vue et il est sûr qu’il va me décoincer ? Il m’agace. Mais en même temps, ça me donne un peu d’espoir. Ce type se la pète grave. Il a tout inventé. C’est un grand professeur, me dit-il. Je m’allonge sur sa table de massage, habillée [5] . Il me touche à des endroits, légèrement, et me parle en même temps. Il me demande s’il s’est passé un truc en particulier dans ma vie. Comment je vais en ce moment. Ça ne va pas fort : je suis amoureuse d’un type, il n’est pas très clair, il ne me répond pas pendant des semaines. J’essaie de décrocher mais je n’y arrive pas, parce qu’à chaque fois que je le vois il y a trop de papillons dans nos yeux. En fait, je ne lui raconte pas tout ça, je reste évasive.
— Ce qui coince votre dos, c’est un sentiment d’abandon, conclut-il.
À ce mot, je fonds en larmes. Je ressens un soulagement immense. Il continue à me toucher dans le cou, sur la tête, les jambes… Il me balance aussi de grandes vérités :
— Vous avez un problème avec les hommes, ça vient de votre relation avec les hommes de votre famille.
— Oui, bon, comme toutes les femmes, non ? je réponds, énervée, me disant que de telles banalités auraient sonné juste à quatre-vingt-quinze pour cent des femmes. Ça s’appelle le patriarcat.
Il n’est pas d’accord. Il dit qu’il n’y a aucun rapport et qu’il faut arrêter avec ça. (C’est un homme riche de cinquante ans, il ne faut pas lui en vouloir.) À la fin de la séance, je descends de la table et je suis décoincée. C’est incroyable. Personne n’avait jamais réussi cette prouesse. Si je suis encore sceptique sur la plupart de ses analyses, je retiens une chose : le sentiment d’abandon à l’origine du blocage.
Je fais alors défiler les blocages de ces dernières années. Abandonnée seule dans le squat par une copine en colère. Ou bien le cœur brisé – c’était souvent quand j’avais le cœur brisé que ça arrivait. La douleur me transperçait parfois à la seule évocation du prénom du mec. Ou bien pendant un rapport sexuel, quand d’un coup je sentais que je n’étais plus présente, et que le type ne s’en rendait pas compte et prenait encore son pied. Je me sentais alors seule, pas considérée, et le bas de mon dos commençait à se tendre. Ça me permettait de mettre un terme au rapport. Le mal de dos, c’était la bonne excuse, bien plus facile à assumer que le simple fait de ne plus avoir envie. C’est aussi ça, la culture du viol : on nous apprend à dissimuler nos désirs (et cela même dans des relations de confiance, de complicité, d’amour), quand on ne les a pas carrément oubliés ou refoulés, et à simuler notre plaisir, dans l’unique but de servir celui de notre partenaire. Au point d’avoir besoin d’une excuse pour ne plus s’y soumettre. Ce mal de dos était pratique : peut-être que mon corps se révoltait, finalement ? Me criant : « Pas encore ! » On m’a déjà forcée, je ne m’en suis toujours pas remise, et il faudrait en plus que je me force moi-même maintenant ?
Par ailleurs, je n’ai jamais eu de problèmes liés au trauma dans ma vie sexuelle, quand celle-ci se passait dans mon plein consentement. Au contraire, c’était peut-être le seul point qui fonctionnait dans mes relations intimes : recevoir du plaisir, en donner, utiliser mon corps en pleine présence me faisait un bien fou et contribuait à me réparer, au même titre que la danse. Alors que la culture du viol vient flouter les frontières entre sexualité et viol, considérant ce dernier comme une pratique sexuelle et non comme un acte de destruction d’autrui, et posant les besoins sexuels des hommes – qui seraient, selon cette culture, naturellement plus importants que ceux des femmes – comme une circonstance atténuante, les victimes aussi se retrouvent potentiellement à ne plus y voir clair.
La conclusion du somatologue prenait tout son sens : tous les blocages contre lesquels je pestais parce qu’ils arrivaient toujours au moment où j’étais au plus mal, étaient justement liés à ces émotions violentes. Se sentir abandonnée et pas considérée dans sa souffrance. Ressentir un manque d’empathie de la part de l’autre. Mais je ne faisais toujours pas le lien avec le viol. Ou très vite, comme une pensée qui me traversait mais que je ne voulais pas prendre le temps d’écouter, parce que ce n’était pas le moment, que ça faisait trop peur ou que c’était trop compliqué.
* * *
J’ai aussi eu une grosse période d’évitement. J’évitais tout rapport sexuel et toute histoire d’amour. Je n’y arrivais pas toujours, parce que le désir me tombait parfois dessus et je me sentais coincée. Je me retrouvais très ponctuellement dans le lit d’un gars et pas loin d’avoir un crush amoureux, mais je suis parvenue à n’avoir aucune relation amoureuse concrète pendant trois années consécutives. J’avais pris cette décision radicale après une rupture très douloureuse, au cours de laquelle j’avais ressenti une haine et une envie de tuer comme jamais auparavant, au point de me faire peur. Une violence intérieure que j’ai gérée en ingurgitant des boulettes d’opium jusqu’à gerber. Sortie de cet enfer, c’était décidé : plus jamais ça. C’est trop ! Ça ne vaut pas le coup. Tu ne peux pas. Tu n’en es pas capable. Tu ne comprends pas ce qu’il se joue vraiment, mais le sentiment amoureux te fait vriller la caboche ! Ça te l’a toujours fait vriller, d’ailleurs, mais là, on atteint un point dangereux. Tout le monde te le dit : quand tu es célibataire, tu es rayonnante, joyeuse, tu fais plaisir à voir. Dès que tu as un mec, tu respires le mal-être.
Ça fait des années qu’on me renvoie ça, et c’est vrai. Alors j’arrête. C’est décidé, le sentiment amoureux et la sexualité qui l’insuffle ne sont plus des options viables pour moi. J’arrête six mois, pour voir.
Durant ces six mois, j’ai usé de discipline. Brider mes pulsions, mes envies, mes élans romantiques. Affronter les critiques, les jugements, qui s’ils ne me faisaient pas changer d’avis, ne m’aidaient pas non plus à tenir le cap : « Mais sans amour, la vie n’a aucune saveur. » « C’est absurde ton truc, tu te prives de la chose la plus belle de l’existence. » « T’as pas dû trouver le bon, essaie encore. »
Qui a dit que je vivais sans amour ? Ils n’entretiennent donc aucune amitié, les gens qui tiennent ces discours ? L’amour est partout ailleurs que dans ces histoires, et je ne suis pas bien sûre qu’il soit tellement logé dans la passion, bien au contraire. Et puis merde, je n’y arrive pas, s’ils savaient, s’ils comprenaient, s’ils entrevoyaient une seule seconde l’angoisse que c’est… Je les emmerde. Ils et elles sont peut-être jalouses que j’y arrive, moi, à vivre sans ça, et avec le sourire.
Et puis ces six mois passés, je me sentais bien, comme jamais, alors j’ai décidé de continuer ainsi. Je n’ai plus eu besoin de compter les mois. Je continuais par envie et non par nécessité. J’ai flanché une fois, ça a été le carnage. Puis, plus tard, j’ai eu une sincère envie de recommencer. C’était en janvier 2021. Six ans après le viol, donc. J’avais fait le lien, enfin. Toutes ces crises et mon incapacité à entretenir des relations intimes et sereines avec des hommes étaient sûrement liées au trauma. Il fallait que j’affronte ce souvenir, que la rage sorte de moi, qu’elle arrête de se diriger contre mes amants, que je me soigne.
* * *
Je suis tombée sur un livre de Giulia Foïs, Je suis une sur deux. Ça a été une grosse étape de la fin du déni. Alors que j’allais déposer des exemplaires de Pente raide aux Modernes, une petite librairie de Grenoble avec un rayon féministe important, à côté de mon livre il y avait celui-là, et le titre m’a interpellée. La quatrième de couverture me parlait en ces termes : « Je vais me permettre de te tutoyer, tu ne m’en veux pas ? On ne se connaît pas, c’est vrai. Mais vu ce qu’il vient de t’arriver, je crois qu’on a quelques points communs. Alors on va faire un truc, si tu veux bien : je t’écris maintenant, et toi, tu me lis quand tu veux. » Ces dernières années, je ne voulais pas trop lire de livres sur le viol. J’avais bien lu King Kong Théorie avant d’écrire Pente raide, mais le livre de Virginie Despentes n’est pas comme celui de Giulia Foïs, il aborde plein de sujets différents. Celui de Giulia Foïs raconte vraiment un viol et un procès. Et Giulia essaie de répondre à une question : ça fait quoi, un viol ?
Cette question, si elle me remuait tant, c’est peut-être que je ne me l’étais jamais posée sincèrement. Ou bien, qu’en prenant ce livre dans les mains et en sentant que c’était le moment pour moi de le lire, je décidais vraiment de sortir du déni. Enfin… « décider », c’est un bien grand mot. Ce moment où l’on se sent suffisamment forte pour regarder au fond de nous le volcan en sommeil, où l’on se dit que l’éruption est enfin possible, qu’on va pouvoir la gérer sans cramer de l’intérieur, et se libérer, enfin, est-ce qu’on le choisit vraiment ?
J’aurais tendance à dire qu’on ne choisit pas grand-chose… Que pour beaucoup de victimes, ce moment-là ne vient jamais. Et alors durant toute la vie, ça brûle à l’intérieur, à te rendre folle de chagrin et de colère. Peut-être que lire et entendre les autres, sentir qu’elles ont ouvert les vannes et n’en sont pas mortes, voire qu’elles y ont même trouvé de l’apaisement, donne le courage de l’affrontement ? Si le contexte social était propice à accueillir nos souffrances et à nous accompagner dans le combat, tout serait plus facile, n’est-ce pas ?
Car ce n’est pas le viol qui nous détruit en tant que femme, ce n’est pas lui qui absorbe notre confiance en nous-même, ce n’est pas lui non plus qui détruit notre sexualité, qui nous mène à l’autodestruction, à la folie, aux conduites addictives, à l’isolement social. C’est la culture du viol, intrinsèque au patriarcat, qui fait ça. C’est elle qui en est responsable. C’est ce contexte qui rend le viol incurable. En refusant la culture violente du patriarcat, en se battant contre cette construction genrée, hiérarchisée et imposée des identités, nous réduirons le nombre de viols et nous permettrons à celles et ceux qui en sont encore victimes d’y survivre dignement.
Alors voilà, c’était le moment. J’ai acheté le livre et je suis rentrée chez moi. J’ai mis quelques jours avant de l’ouvrir. Je voulais me sentir vraiment prête. Il était là, sur la table de chevet dans la caravane. Chaque soir je le regardais avec un mélange de désir et de peur. J’attendais que mon cœur dise : Vas-y, ouvre-le !
La lecture a été difficile. Elle a duré une semaine. J’en lisais chaque jour un peu, une heure, une demi-heure. Je pleurais beaucoup, parce que Giulia parlait trente ans après. Elle racontait les années de symptômes post-traumatiques, et puis à coups de chiffres et d’exemples, elle expliquait aussi comment était considéré le viol en France, ainsi que les victimes et les coupables. Le sien avait été acquitté, c’était un trop bon père de famille et trop français pour violer des jeunes filles, qu’ils ont dit. Alors le tribunal a conclu : l’homme arrêté est un sosie.
Comme elle parlait trente ans plus tard, et que moi je n’en étais qu’à cinq, je me suis dit : toi, tu n’en as pas fini. Tu croyais quoi ?
En lisant son témoignage, mes dernières années de galère mentale ont défilé. Nous n’avions pas du tout les mêmes symptômes, mais je me reconnaissais dans ce qu’elle écrivait. Ces torrents de larmes, ces crises de panique, ces envies de meurtre, ces chagrins d’amourettes vécus si forts – à en faire flipper tout mon entourage et fuir mes amants. C’était exactement ça ! Je comprenais enfin pourquoi le profil de mecs qui m’attiraient avait changé après le viol. Pourquoi j’étais autant attirée par ceux qui me filaient entre les doigts, qui n’étaient pas clairs, des séducteurs en puissance. Ces histoires me renvoyaient sans cesse à la violence d’être utilisée comme un objet de désir au lieu d’être aimée en profondeur. Me confronter à cette violence-là m’attirait inconsciemment et viscéralement. Elle me permettait de vivre ces émotions qui ne demandaient qu’à sortir. Le volcan que je ne laissais pas entrer en éruption s’exprimait dans le moindre interstice qui rappelait le souvenir trop douloureux.
Toutes ces émotions vécues trop vite, je les revivais dans chaque chagrin d’amour. Dans chaque mensonge. Dans chaque maladresse. Dans chaque minuscule comportement qui m’amenait à penser qu’on avait manqué d’empathie envers moi.
Après avoir terminé le livre de Giulia, j’ai relu Pente raide, avec du recul, pour le corriger et le présenter une énième fois à des maisons d’édition. Et aussi pour le plaisir, comme on lit le livre de quelqu’un d’autre. Une phrase a confirmé mes intuitions et encore plus éclairé mes tentatives de compréhension du traumatisme : « Qui me dit qu’ils me respecteraient, que leur maladresse ne ferait pas tout ressurgir ? […] Maintenant, j’ai l’impression qu’une fois toute nue je ne contrôlerai plus rien, comme je n’ai rien contrôlé dans cette cabane. »
Après avoir pensé ça consciemment dans cette chambre en Iran, j’ai rangé les mouchoirs et repris la route vers la Turquie. Puis j’ai oublié cette inquiétude. Comme si elle s’était bien tapie dans les tréfonds de mon inconscient pour mieux me pourrir la vie pendant des années depuis sa cachette. Est-ce que c’est ça, le déni ? Se dire que tout va bien, que la vie continue, que ce ne sont pas quatre coups de reins qui vont m’avoir fragilisée, que je suis plus forte que ça ?
* * *
Après ces deux lectures, je me suis décidée. Il fallait que je me soigne avec une professionnelle. Une copine m’avait dit que les violences sexuelles pouvaient déclencher des problèmes urinaires, elle avait lu une psy qui avait écrit là-dessus. Ça m’a mis la puce à l’oreille. J’ai commencé à explorer les sites des associations d’aide aux victimes de violences faites aux femmes ou des sites de psy spécialisés dans le domaine [6] . Les problèmes que j’avais étaient tous mentionnés. Ça m’avait donc pris cinq ans. Cinq ans pour aller consulter ces sites faits pour aider les victimes [7] .
Aujourd’hui, je crois comprendre un peu pourquoi aller consulter ces sites ne m’avait même pas traversé l’esprit. Il est compliqué de s’identifier à leurs destinataires. Je m’attendais probablement inconsciemment à des sites faits par des associations pour aider de « pauvres femmes battues, victimes, soumises ». Or, moi, je n’étais pas une victime, je n’étais pas battue, je n’étais pas soumise, je n’étais pas « elles ». Jusqu’à ce qu’un jour, tu te prennes une claque. Le « elles » de tes clichés n’existe pas. Dans ce « elles », il y a toi. Dans ce « elles », nous sommes toutes là. Aucune femme ne peut être réduite à une victime, aucune femme ne devrait subir de misérabilisme, aucune femme, aussi soumise se retrouve-t-elle à être, ne mérite de pitié. Nous sommes toutes « elles » dans des bateaux qui se ressemblent bien trop souvent, à naviguer comme nous pouvons sur cette mer déchaînée qui se déguise de calme, et sans avoir jamais appris à communiquer entre nous.
Sur ces sites très bien faits [8], j’ai trouvé plein d’informations sur les « symptômes de stress post-traumatique ». Ce concept me soulageait. Un nom scientifique était posé sur des années de souffrance et m’offrait une autre explication que celle de ma propre folie, de ma propre nullité. Les allers-retours aux toilettes, les insomnies, la peur, l’angoisse, les pétages de plomb… Je pouvais tout mettre dans le même panier et ça me faisait du bien. Ce n’était plus de ma faute, il existait des moyens connus pour soigner tout ça. Je pouvais donc espérer sortir du tunnel. Je devais trouver une personne pour m’accompagner dans ma démarche : regarder en face ce souvenir monstrueux, cauchemardesque. Rien que d’y penser, j’avais la boule au ventre. J’avais peur d’en mourir. Mourir d’une émotion trop intense ou de devenir folle pour toujours !
Je me suis rendue au Planning familial, où j’ai tout raconté à une femme qui m’a parlé de l’EMDR. Elle m’a expliqué que c’était une technique très efficace pour guérir des séquelles laissées par les traumatismes. Cette technique permet, par un mouvement des yeux de gauche à droite, de « ranger » les souvenirs traumatiques au bon endroit dans le cerveau : les retirer du rayon « émotions » pour les mettre au rayon « souvenirs » avec tous les autres. Lors d’un traumatisme, le cerveau « bugge » comme un ordi, en quelque sorte. Mais c’est un bug utile, c’est pour vous empêcher de mourir de peur, de malheur, ou de perdre la boule. C’est pour vous protéger. Néanmoins, l’émotion n’est pas vraiment vécue et n’est pas rangée comme il faut. Et alors elle laisse des traces, qui prennent une multitude de formes – les syndromes de stress post-traumatique. J’ai cherché une thérapeute EMDR. Une femme, parce que je ne faisais plus confiance aux hommes, et notamment aux soignants. J’ai eu de la chance : dès le premier rendez-vous, j’ai su que c’était la bonne.
Lors de la première séance d’EMDR, la thérapeute me demande :
— Quelle situation exactement voudriez-vous que l’on traite ? Quel moment précis ?
— Le viol.
J’ai peur. J’ai très peur. Mais cette femme-là me rassure. Elle va m’accompagner.
— Très bien. Il va falloir que vous pensiez à une sensation physique liée à ce moment-là. Ça peut être une vision, un son, une odeur, n’importe quoi… Qu’est-ce qui définirait le mieux ce moment pour vous ? J’hésite.
— Je ne sais pas… Je ne peux plus bouger. Oui, voilà, c’est ça.
— Maintenant concentrez-vous sur cette sensation et associez une phrase à cette situation. Une phrase qui parle de vous.
Ça sort tout seul, comme une évidence :
— « Je n’existe pas. »
— Et par quelle phrase voudriez-vous la remplacer ?
— C’est difficile, je n’en sais rien…
— « Je n’existais pas », ça vous irait ? me suggère-t-elle doucement.
C’est fort, ça, je me dis. Joli tour de langage. Coincée dans le passé, physiquement, émotionnellement, et même grammaticalement.
C’est ça, le traumatisme. Vos émotions restent coincées dans un autre espace-temps, et vous ne comprenez même pas ce qui vous arrive, votre mental se refuse à regarder les choses en face – le déni… Et au lieu de comprendre, vous vous accusez, vous vous détestez toujours un peu plus, vous revivez maintes fois des situations destructrices.
La séance commence.
J’en ressors complètement sonnée.
La semaine qui a suivi, ça a été horrible. Le lendemain matin, j’ai voulu soulever un parpaing, et j’ai senti le nerf sciatique traverser ma jambe des lombaires au pied tel une lame. Je savais que j’allais me coincer.
Une heure plus tard, j’étais bloquée comme jamais. Je ne pouvais plus bouger. Ou alors très difficilement, le corps plié en deux. Les mots de la séance étaient venus s’inscrire dans mon corps. J’ai fait cauchemars sur cauchemars, ceux-là mêmes, d’une violence extrême, qui s’étaient raréfiés au fil des ans avant de disparaître totalement. Ils revenaient.
C’était comme si je me retrouvais à nouveau en Iran, mais mes émotions étaient décuplées. Tout ce que j’avais refoulé refaisait surface sous la forme de rêves, de pensées, d’émotions, de douleurs physiques, et ça faisait mal, très mal. Une culpabilité insoupçonnée me dévorait. Je n’avais jamais voulu la regarder en face, me sentant au-dessus d’elle – j’étais trop féministe, trop éduquée pour ça ! Bien sûr que je me sentais coupable, moi aussi. La culture du viol, personne n’y échappe. Personne. Elle vient s’immiscer dans tous les esprits, y compris les plus informés, les plus conscients. Le sentiment de culpabilité se transformait en angoisse. Je pleurais beaucoup, écrasée par un sentiment de nullité jamais aussi intensément vécu.
Mais tu croyais quoi, je me disais, tu croyais quoi en allant voir cette psy ? Que tout irait mieux, que du jour au lendemain tu n’aurais plus de séquelles et ne paierais plus les conséquences de ce viol ? Mais qu’est-ce que tu crois ? On ne s’en remet jamais ! T’allais pas si mal, en fait, fallait juste que t’évites les mecs et t’étais bien. Petite princesse du bien-être. À vouloir tout, tout, à ne jamais te contenter d’un demi-bonheur. Mais non, tu vas en chier ! Regarde comme tu galères, là, t’es contente ? T’as voulu mieux, eh bien paie maintenant, tu auras moins...
La rage et l’envie de tuer cette voix intérieure me tiraillaient, comme si ce n’était pas moi. Un suppôt du patriarcat venu m’interdire l’espoir d’avancer vers le mieux se cacherait donc à l’intérieur de moi-même ? L’envie de tuer me reprend, mais cette fois c’est à une partie de moi que je souhaite la mort. Il y a ça en moi... Il y a ça en toi... Tais-toi, je te hais ! Je me hais... Ça me répugne... Je pleure.
Heureusement, j’étais bien entourée. Mes colocs, un copain et plusieurs copines étaient venues me rendre visite cette semaine-là. Ma psy me rassurait par texto : on y était allées un peu trop vite, ce n’était pas censé me mettre si mal, elle s’en excusait. Mais ça allait passer, le « retraitement » était en train de se faire. C’était comme une violente secousse. Une éruption, c’était l’éruption. Mais je n’en étais pas si sûre, et c’était bien ça le problème.
Ça a duré huit jours. Huit jours infernaux, coincée dans mon lit, le dos plié, le cerveau à mille à l’heure, l’angoisse permanente. Je me suis pas mal cachetonnée. J’ai appelé une copine au bout de cinq jours, parce que je n’étais jamais restée coincée aussi intensément et aussi longtemps, et je commençais sérieusement à baliser :
— J’ai peur… de rester comme ça pour toujours. Tu crois que c’est possible, à cause d’une séance de psy, de rester handicapée à vie ?
Mon amie avait étudié la psychologie. Elle devait savoir.
— Non. C’est pas possible. Tu ne vas pas rester comme ça à vie.
— T’es sûre ? J’étais complètement paniquée.
— Oui, je suis sûre, je ne sais pas combien de temps tu vas rester bloquée, mais en tout cas ça va passer, comme à chaque fois.
Ça m’a un peu rassurée. Au matin du huitième jour, je me suis réveillée. Mes amies n’étaient plus là. Les rayons du soleil de printemps pointaient à travers les vitres de la caravane et venaient me réchauffer le visage. Je me suis redressée facilement. Mon dos ne s’y opposait plus. Je me suis levée, j’étais droite. C’était incroyable, une belle surprise après un si long cauchemar. Et mon esprit lui-même était aussi calme que la clairière. Je me sentais légère, contente. J’ai fait bouillir de l’eau, et j’ai repensé à la semaine passée. Alors que ma tisane infusait, j’ai souri et j’ai songé, très fort :
— Bien sûr que j’existe. Je n’ai même jamais cessé.
Sept ans après le viol
J’ai rêvé de ce mec avec qui j’ai passé une belle nuit de tendresse il y a un mois. Il m’invitait à danser. Il me faisait tourner, tourner, et qu’est-ce que j’étais heureuse ! Et puis soudainement, il se transformait en un immense oiseau de nuit. Les tours étaient de plus en plus vifs, et à mesure que la vitesse et la force de ses ailes qui m’agrippaient augmentaient, je perdais le contrôle, et la joie se dissipait face à une peur grandissante... Finalement il n’y avait plus de danse, plus de type, plus de joie, rien qu’un monstre géant qui fracassait mon corps contre les murs.
Je me suis réveillée brutalement et j’ai fondu en larmes. Ça faisait longtemps que je n’avais pas fait un cauchemar aussi violent. Depuis la thérapie, il y a un an et demi, peut-être… Ça ne me donne pas envie de le revoir, ce mec. Encore une histoire vouée à foirer, ça me désespère…
Je suis en plein dans la relecture de Pente raide avant sa réédition. Il y a des moments où je trouve ça si glauque que ça me donne la nausée. C’est peut-être lié à ça, ce cauchemar. C’est comme si l’éruption n’était jamais finie, comme si une vie entière ne suffirait pas à tout recracher… La route est longue. Mais je lâche rien.
* * *
Quelques jours plus tard, je participe à une cérémonie pour boire de la jurema, un puissant psychédélique que je consomme à intervalles relativement espacés depuis quelques années parce qu’il me fait beaucoup de bien. Said, le facilitateur, me sert un verre. Je l’avale d’une traite et retourne m’asseoir dans le cercle. La semaine difficile défile dans mon esprit. Je prie pour que cette nuit m’apaise.
Les pensées s’espacent doucement ; Arthur m’apparaît. Il est là, je le vois, il est démoniaque. Ce n’est plus un homme, c’est un petit être rouge et perfide. Il est presque drôle. Je sais maintenant qu’il était là toutes ces années en moi, qu’il ne m’a jamais quitté, jamais laissée en paix. Au cours de ces nuits tendres dans les bras de ces hommes que j’essayais d’aimer, quand je tentais inlassablement de m’endormir, et que ça ne marchait pas, c’est parce qu’il était là. Mais alors que je le rencontre à nouveau en image, après toutes ces années, il ne me fait plus peur. Je suis avec la plante. Je suis dans le cercle. Entourée par les chants. Quoi qu’il m’arrive cette nuit, j’en sortirai vivante et heureuse.
Alors, rapidement, mon esprit me quitte et la plante occupe tout mon corps. Des tourbillons m’emmènent dans un autre espace-temps.
Des poils, des doigts épais venant attraper ma nuque me font sursauter. La peur se réveille soudainement, animale. Alors je tape. Mes bras tapent, mes jambes tapent, il y en a plusieurs, ils sont autour de moi, ils veulent m’attraper, je ne les laisse pas faire, tous mes membres s’agitent avec une puissance inouïe, la peur déploie la force. Librement, sauvagement, je tape, la force est grande, insoupçonnée, puis les coups s’espacent, des mains se risquent à se poser sur moi pour me caresser gentiment, si elles sont fines et douces je les retiens tendrement, quand elles sont épaisses et poilues, le corps se tend à nouveau et tape encore de toutes ses forces. Petit à petit, je me risque à laisser une main épaisse se poser un peu plus longtemps. Je tape de moins en moins. Je m’entends enfin respirer. Il y en a une qui parvient à se poser plus longuement. C’est la main de Said, je crois. Je la caresse brièvement, pour la repousser à nouveau violemment et compulsivement. Ce jeu-là se répète plusieurs fois, jusqu’à ce que la confiance me gagne et que tout s’apaise. Une de mes mains finit par se poser sur le pied de Said accroupi près de mon corps étendu et fatigué, encore agité de soubresauts nerveux. Il est chaud, ce pied. Il est stable, droit et je le comprends enfin, il ne me fera aucun mal. C’est fini.
Je suis épuisée.
Le sourire aux lèvres, je m’endors.
Je revois alors Arthur dans un songe. Je souris très fort. Je sens une âme enthousiaste et amusée m’habiter. Un peu cruelle aussi. Elle rit. Elle rit d’Arthur. Elle sautille d’impatience et de joie. Elle se prépare à lui jeter un sort. C’est une petite sorcière. Elle va se venger et elle sait d’avance qu’elle a gagné. Je sens sa force maléfique. Je n’en ai pas l’habitude, je me demande s’il est bon de la laisser me parcourir et d’en jouir. Je l’observe, cette sorcière, et malgré les réticences de ma raison, elle me plaît. Le viol n’est pour elle que le détail initiateur d’une histoire palpitante. Le début d’un jeu guerrier entre mauvais esprits vengeurs et enfantins. Une bonne raison pour se battre. Il n’y a pas à pardonner, il n’y a pas non plus à culpabiliser. C’est une guerre, et je suis en train de la gagner, sort après sort jetés à la face d’Arthur devenu inoffensif. Cette idée me fait gémir de plaisir. Je ris très fort intérieurement. Comme si je percevais pour la première fois le problème en dehors de tous les aspects moraux ou sociologiques que j’avais douloureusement posés dessus ces dernières années. Arthur, je vais me venger ! Tu m’as pourri la vie mais aujourd’hui j’en ris, et c’est toi qui vas avoir peur ! Je me sens plus proche de lui que je ne l’ai jamais été. Lui que je ne comprenais pas, lui que je plaignais, lui que je cherchais à pardonner...
La sorcière en moi se contente de rire, du haut de sa puissance… La joie déborde, elle vient tirailler mon corps de plaisir, il se contracte, je le sens fort, fort comme il ne l’a jamais été, je ris, j’ai la puissance, cette puissance qu’on nous a refusée à la naissance, déguisant un système politique écrasant en fait biologique avéré. Non, je le sais maintenant, la puissance n’est pas affaire de muscles, elle transcende la matière, et on nous a menti, à nous les femmes, en nous racontant que notre force, jamais offensive, ne se mesurerait qu’à la grandeur de notre amour et de nos sacrifices.
Je peux rugir. Je peux détruire. Je peux terrasser d’un seul regard celui qui cherche à exercer sa force sur moi. Ces visions me font frémir de satisfaction. Alors que mes poings serrés frappent ces ennemis imaginaires, ils se mettent à danser au rythme des percussions. Tout mon corps se détend, les chants résonnent fort dans la pièce et viennent vibrer dans ces membres en mouvement pour en faire émerger la beauté. Je suis invincible et cela me rend libre.
Libre d’attaquer, et libre d’aimer.
[1] Pente raide a fait l’objet d’une première édition en autoédition, en 2019. (NDÉ)
[2] Si les victimes sont aussi des hommes, une fois sur dix, le pourcentage de viols commis par des femmes est proche de zéro, selon l’enquête d’Elizabeth Brown et al., Violences et rapports de genre. Enquête sur les violences de genre en France, Aubervilliers, Institut national d’études démographiques, coll. « Grandes enquêtes », 2016.
[3] Voir la bande-dessinée de Liv Strömquist, Les Sentiments du prince Charles, trad. du suédois par Kirsi, Paris, Rackham, coll. « Le Signe noir », 2012, pour un développement plus complexe de cette analyse. Ou l’épisode « Romance et soumission » du podcast de Victoire Tuaillon, Le Cœur sur la table, Binge Audio, septembre 2021.
[4] Les associations d’aide aux victimes connaissent pourtant assez bien les conséquences d’un viol ou d’autres chocs émotionnels. Pourquoi le personnel médical n’est-il toujours pas formé ?
[5] Habituée depuis l’enfance à devoir me déshabiller dans les cabinets des docteurs, kinés, ostéo, j’ai mis beaucoup de temps à comprendre que cette situation de nudité face à des hommes que je ne connaissais pas me faisait violence, et participait à rendre impossible le déblocage de mon dos.
[6] Et notamment le site memoiretraumatique.org.
[7] En particulier sosfemmes.com.
[8] Merci à toutes les personnes qui contribuent à les faire exister.
)
Brochure réalisée avec le soutien de Marvic et des éditions Ici-bas.
www.editionsicibas.fr
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.2 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.1 Mo)