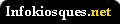A
Abandonner les fantasmes de la politique
Critiques anarchistes de quelques dérives de la méthode insurrectionnelle
mis en ligne le 4 mars 2023 - Alfredo Cospito , Fenrir
On a voulu publier ici en brochure trois articles issus de Fenrir, publication anarchiste écologiste en langue italienne.
Cela nos a paru important de traduire ces textes parce que, depuis des angles différents, ils portent une critique à un ensemble de positions théoriques qu’on pourrait appeler la forme « classique » de l’anarchisme insurrectionnaliste. En renouant avec le « débat avorté sur l’anonymat », mais aussi en soulignant ce qu’il y a de politique dans la recherche à tout prix d’une interaction avec les masses, ou encore en partant du constat que ces positions insurrectionnalistes « classiques » sont parfois carrément dépassées par la pratique de nombre de compas autour du monde, les rédactrices et rédacteurs de Fenrir, ainsi qu’Alfredo Cospito, nous rappellent que cette prétendue « méthode » n’est pas la vérité, mais une simple hypothèse. Un instrument théorisé dans une époque différente de celle d’aujourd’hui et dans un contexte qui ne peut pas être utilisé comme pierre de touche pour toute situation. Bref, un instrument parmi d’autres, existants ou à inventer, tous nécessaires, pour éviter que l’anarchisme s’embourbe dans un marécage de dogmes et d’apathie où l’on passe son temps à réciter des formules de plus en plus éloignées de la réalité.
Voilà donc l’intérêt à notre avis de cette édition en langue française. Pour que la discussion continue (recommence ?), aussi quand elle met en doute les certitudes qu’on pensait acquises une fois pour toutes.
Pour que l’anarchisme redevienne une menace !
mars 2019
attaque.noblogs.org
Sommaire :
- En lutte permanente contre la société et les fantasmes de la politique. Une critique anarchiste de quelques dérives de la méthode insurrectionnelle
(Fenrir, pubblicazione anarchica ecologista, n° 7 / octobre 2016, traduction française : octobre 2018, sur Attaque)
- Sur anonymat, revendication et reproductibilité des actions
(Fenrir, pubblicazione anarchica ecologista, n° 8 / septembre 2017, traduction française : février 2019, sur Attaque)
- L’autisme des insurgés
(Alfredo Cospito, dans Fenrir, pubblicazione anarchica ecologista, n° 9 / juin 2018, traduction française par Attaque : août 2018, corrections sur Infokiosques.net : février 2023)
En lutte permanente contre la société et les fantasmes de la politique. Une critique anarchiste de quelques dérives de la méthode insurrectionnelle
Fenrir, publication anarchiste écologiste, n°7 / octobre 2016
« Chacun est bien libre de se rapporter à l’existant comme bon lui semble, qu’il soit anarchiste ou pas. Mais il faut aussi que chaque anarchiste, précisément en tant que tel, se demande si on veut seulement frapper le pouvoir constitué ou bien si on veut le détruire pour de vrai, de façon définitive. Autour de cette question fondamentale tournent tout notre agir et notre attitude envers l’existant.
En effet, même anarchiste, un individu peut croire ou pas dans la possibilité d’un bouleversement social dans des termes libertaires et d’autodétermination. Mais si un anarchiste croit dans la possibilité révolutionnaire, l’affrontement avec le pouvoir constitué ne peut alors ne pas tenir compte de cette grande masse sociale subalternisée, qu’il faut impliquer dans la lutte, afin non seulement d’atteindre la force suffisante pour détruire l’existant, mais qu’il faut aussi encourager pour que, dépassant les délégations, délusions et passivité, elle s’approprie des pratiques de l’action directe, de l’autogestion de la vie elle-même, de l’autodétermination individuelle et collective.
Voilà pourquoi les actions individuelles qui font ouvertement face au pouvoir politique-économique, ses structures et ses hommes, si elles sont indubitablement positives car de toute façon elles empêchent la pacification sociale et démontrent la faiblesse de ce pouvoir de domination qui prétend (se prétend) être absolu et inattaquable, sont cependant complètement insuffisantes sur le plan de la révolution insurrectionnelle si elles ne se greffent pas systématiquement sur les façons de réagir contre l’exploitation et l’oppression des masses prolétaires. En d’autres termes, à mon avis la possibilité insurrectionnelle où l’anarchisme – c’est à dire la praxis anti-autoritaire – peut acquérir un rôle socio-politique fondamental s’ouvre seulement si on arrive à faire pénétrer réciproquement les instances individuelles de lutte et d’attaque avec les instances revendicatives et de protestation qui émergent à chaque fois des masses plus ou moins grandes issues des secteurs sociaux soumis. Si cette greffe, cette compénétration réciproque, n’est pas présente, notre action sera non seulement incompréhensible, mais aussi éloignée du ressenti commun, surtout à cause de l’œuvre de mystification terroriste que l’État-capital mettra en œuvre ».Extrait d’une lettre de Costantino Cavalleri à Luca Farris (Nihil, n° 3-4, pp. 36-37)
Cet extrait de Costantino Cavalleri exprime de façon claire les prémisses de base de la dite « méthode insurrectionnelle » (ou, pour le dire en d’autres termes, de l’approche « insurrectionnaliste » de l’anarchisme). L’aspiration à provoquer des tentatives insurrectionnelles ensemble avec les masses, déjà théorisée et expérimentée depuis la fin du XIXème siècle par de nombreux.ses anarchistes dont le plus connu est Errico Malatesta (qui nous a même laissé plusieurs écrits où il est question de ce qui devrait être l’approche anarchiste envers l’insurrection), a été reprise et revisitée entre la fin des années 1970 et le début des années 1980 dans les textes d’Alfredo Maria Bonanno, Pierleone Porcu, Costantino Cavalleri et d’autres compagnon.ne.s. Ils/elles en ont gardé inaltéré le corpus central, tout en voulant en revoir les structures organisationnelles.
Parmi les prémisses de base de l’approche insurrectionnelle il y a le vieux mythe de la Révolution Sociale, but idéal à travers lequel on peut atteindre la transformation radicale des structures de la société en un sens anarchiste, et sur la base de laquelle les anarchistes insurrectionnalistes évaluent toutes leurs interventions sur la réalité ; une vision romantique des classes les plus pauvres, selon laquelle leur position sociale marginalisée et leur familiarité avec la violence de la lutte quotidienne pour la survie leur donneraient un possible esprit de révolte et une complicité idéale avec celles/ceux qui combattent l’autorité ; et par conséquent, une foi dans le réveil des masses d’exclu.e.s et d’exploité.e.s, qui ne tient pas vraiment compte des changements qui ont transformé, ces dernières décennies les sociétés humaines occidentales en des sociétés de la consommation convulsive, toujours plus aliénées par le spectacle et par la technologie avancée et dans lesquelles les classes sociales (qui continuent à exister, à cause des différences économiques) partagent toujours plus les mêmes valeurs éthiques de défense du système dominant et l’aspiration à intégrer celui-ci de plus en plus, plutôt que de le détruire. Il en résulte que, par rapport au XIXème siècle, la situation a beaucoup changé et aujourd’hui les possibilités vraiment révolutionnaires paraissent toujours plus lointaines. Cette confiance dans la future révolution qui mènera un jour à l’anarchie – que Stirner décrirait comme la foi dans l’énième fantôme qui se superpose à la réalité – a mené quelques anarchistes à développer des méthodologies d’intervention dans le social qui voudraient accélérer le processus révolutionnaire ou, du moins, pousser des groupes de personnes qui se trouvent déjà dans un conflit contre l’autorité pour des raisons liées à leur survie quotidienne, à exprimer des moments impromptus de conflictualité et d’autogestion, dans l’espoir que le conflit s’élargisse par la suite jusqu’à aboutir à une insurrection généralisée.
Pour revenir à l’extrait de Cavalleri, il est inutile de se demander si « on veut détruire [le pouvoir] pour de vrai, de façon définitive » ou si on veut seulement le frapper : évidemment tout.e anarchiste veut abattre le pouvoir pour de vrai. Le problème est que la volonté peut bien pointer vers un horizon infini, mais il faut se confronter de façon honnête avec la situation réelle dans laquelle cette volonté s’inscrit. Dans une époque, comme la nôtre, de paix sociale diffuse, proposer des analyses de la réalité et des modalités d’intervention essentiellement inchangées par rapport à celles d’il y a plus d’un siècle, quand la situation sociale était complètement différente, signifie construire quelque chose qui se rapproche plus d’une religion que d’une pratique d’action crédible.
La critique que je veux proposer se focalise surtout sur certaines tentatives d’application concrète de la méthode insurrectionnelle, mises en place ces dernières années par des anarchistes sur la base d’une interprétation précise de l’insurrectionnalisme, qui a fait ressurgir un autre fantôme, celui de la politique. On verra plus dans le détail comment cela a pu se produire. Mais cette critique touche aussi à quelques-unes des prémisses de base inhérentes à cette approche ; des prémisses qui, à mon avis, sont problématiques depuis le début et rendent possibles des telles dérives.
Je saisis l’occasion de la publication récente d’un essai venant du territoire espagnol, « Cuando se señala la luna. A vueltas con el insurreccionalismo », écrit par des anarchistes, un livre qui voudrait tirer au clair une fois pour toutes la signification de la méthode insurrectionnelle et répondre aux critiques qui ont surgi à son égard au fil du temps, de divers côtés (notamment de gauche, en particulier marxistes-léninistes), mais qui, en ce qui me concerne, ne fait que confirmer une fois de plus certaines des perplexités que j’avais déjà.
Dans cet article, je fais référence à ce qui est vu comme la conception « classique » de l’insurrectionnalisme, telle qu’elle a été interprétée, presque au pied de la lettre de sa formulation initiale, par des anarchistes qui en ont même exacerbé certains des aspects les plus épineux, telle la recherche convulsive du consensus social, présupposé de toute tentative insurrectionnelle.
Je suis ben conscient, cependant, que l’insurrectionnalisme n’est pas un monolithe de concepts et de pratiques figés dans le temps et exempts de tout débat. Depuis la fin des années 1990, en effet, plusieurs groupes anarchistes d’action ont surgi, et même s’ils se rattachent théoriquement à l’insurrectionnalisme, ils en on donné une interprétation assez différente, remettant en cause certains des aspects que j’affronterai dans cet article : ces groupes et individus ont décidé de commencer leur insurrection armée à eux, sans attendre le consensus des masses. Je me demande si c’était indispensable, pour eux, de garder la définition d’« insurrectionnalisme », étant donné le changement radical qu’ils ont apporté à certaines des prémisses de base de cette approche. Il semble cependant que la tendance, de la part des nouveaux groupes d’action anarchistes informels, soit celle de s’éloigner progressivement de ce terme et de son héritage historique.
Il convient tout d’abord de préciser ce qu’on entend par approche insurrectionnelle. Il s’agit d’une approche à la lutte qui consiste à « partir d’une hypothèse d’intervention dans la conflictualité sociale, afin d’explorer et d’attaquer les différents rouages de la domination – structures, personnes et moyens – dans le but de partager un parcours auto-organisé et destructeur qui puisse favoriser l’insurrection » (Cuando se señala la luna, p. 140).
Il ne s’agit pas d’une idéologie, d’une théorie, insistent ses partisans, mais seulement d’une méthode organisationnelle ou d’intervention, qui doit forcément se confronter par son application pratique sur la réalité du terrain. Au vu de la rareté, là où on vit, d’émeutes populaires spontanées, la méthode « insurrectionnelle » est devenue, ces dernières années, une méthode anarchiste d’intervention dans des luttes sociales pré-existantes ou un critère pour en créer de nouvelles dans le but d’impliquer directement aussi ceux/celles qui n’ont pas un parcours politique antérieur, c.a.d. d’autres « exploité.e.s », « exclu.e.s », « prolétaires » ou « sous-prolétaires ». Bien entendu, tout cela dans l’intention de faciliter et appuyer la rébellion de ces personnes, ou bien de la stimuler, pour créer ensemble des moments insurrectionnels. Mais là où le manque d’esprit de rébellion chez les gens est palpable, ce qui est souvent le cas, l’intervention des anarchistes ne suffit pas pour stimuler un souffle de révolte qui manquait déjà auparavant et parfois il arrive que, à la fin, ce sont précisément les anarchistes qui réduisent leurs tons et leurs contenus, afin d’entrer en syntonie avec les gens.
Il ne s’agit donc pas seulement, comme le pensent certain.e.s, de saisir et de participer aux moments insurrectionnels spontanés avec une préparation technique spécifique et les bons instruments, préparés en avance, ni de s’engager dès à présent dans des actions de rupture (individuelles ou collectives) qui puissent inspirer autrui, tout en laissant la porte ouverte à d’autres esprits en affinité. La méthode insurrectionnelle envisage une projectualité à long terme et des structures complexes (qui sont pourtant décrites comme « fluides ») : d’un côté des groupes d’affinité, d’un autre côté des assemblées, des comités et des coordinations, dans la tentative de créer des projets de lutte visant à unir la minorité anarchiste avec d’autres catégories sociales.
La révision théorique apportée dans les années 1980 à la méthode insurrectionnelle naissait du refus des structures rigides organisationnelles formelles et de synthèse que beaucoup d’anarchistes se sont donnés, surtout par le passé, et qui survivent aujourd’hui dans une position toujours plus marginale, comme par exemple en Italie la Federazione Anarchica Italiana. Avec l’analyse des changements intervenus dans la production capitaliste entre la fin des années 1970 et le début des années 1980, les dissociations et les choix de « repenti » de nombreux.ses camarades qui avaient auparavant participé à la lutte collective contre l’État, et la sensation de défaite et de pacification des années 1980, des compagnons italiens ont proposé une modalité d’intervention dans la réalité des luttes qui se démarquait de l’anarchisme rassis des fédérations et grandes sigles.
En réponse à ces vieilles formes d’organisation sclérosée, l’approche insurrectionnelle de l’anarchie proposait de fonder les luttes sur quelques principes de base : l’auto-organisation, la conflictualité permanente, les groupes d’affinité et l’attaque, afin de créer les meilleures conditions de base pour une insurrection de masse. Mais l’auto-organisation, la conflictualité permanente, l’affinité et l’attaque sont depuis toujours les méthodes d’une certaine façon de vivre l’anarchie, qui a toujours existé aux marges des grandes organisations, et il y a d’innombrables exemples historiques de comment les ennemi.e.s de l’autorité se sont toujours organisé.e.s de cette manière pour conspirer contre le pouvoir, d’ailleurs sans besoin de support populaire ni de grandes théories sur le sujet. Ce sont tout au plus les grandes organisations, avec leur rigidité, qui sont intervenues à un certain moment de l’histoire pour canaliser et atténuer une partie de ce spontanéisme anarchiste. On pourrait donc se demander d’où sort le besoin d’écrire des pages et des pages de théorie sur la signification des groupes d’affinité et de l’organisation informelle (par ailleurs dans des termes souvent assez abstraites), quand en réalité cela n’a rien de nouveau et il suffirait de redécouvrir certaines expériences historiques de lutte du mouvement anarchiste mais aussi d’autres mouvements, pour rendre immédiatement compréhensible ce qu’on entend et ramener les termes du discours sur un terrain concret.
Il est vrai que ces concepts fondamentaux ont été mis de côté par les franges les plus bureaucratisées de l’anarchisme, qui ont crée des fédérations stables, semblables à des syndicats et à des partis freinant l’initiative des individus. D’où peut-être la nécessité, dans ce contexte historique particulier là, de redéfinir l’insurrectionnalisme, de façon à porter une rupture avec les anciennes méthodes et réaffirmer la possibilité d’autres façons de s’organiser, plus « informelles », précisément. Mais, comme on le verra, la méthode insurrectionnelle elle aussi, justement à cause des objectifs qu’elle se donne, n’est pas exempte du risque de mettre des limites et de donner des directives sur la bonne voie à parcourir.
Au delà des aspects cités (affinité, auto-organisation, attaque), qui ont toujours appartenu aussi à l’anarchisme individualiste, ce qui caractérise l’approche insurrectionnaliste est sa volonté d’interagir avec la société, à travers le projet insurrectionnel. Ayant comme horizon idéal la révolution sociale, un des fondements de l’insurrectionnalisme est en effet précisément la nécessité de lutter avec les « gens », c’est à dire avec des personnes avec lesquelles il n’y a pas d’affinité pré-existante, chose qui comporte toute une série de difficultés et de contradictions.
À une époque, comme aujourd’hui, de paix sociale diffuse, les personnes qui à un moment donné de leurs vies se mobilisent contre quelque chose, sans avoir une conscience plus élargie des rapports de domination, le font pour des raisons éminemment égoïstes et contingentes. Des personnes qui n’ont jamais bougé le petit doigt pour contrer les différentes « injustices » qui les entourent, sont tout à coup, dans certains cas, prêtes à se mettre en jeu si ces injustices touchent à quelque chose qui concerne leurs nécessités de base (salaire, maison, travail, etc.). Dans la plupart des cas, ces personnes sont intéressées seulement par la question spécifique qui les concerne et elles ne partagent pas notre analyse du monde, nos aspirations révolutionnaires ou nos méthodes, qu’elles considèrent comme trop extrémistes, contre-productives ou incompréhensibles, peu portées sur le dialogue et donc peu enclines à charrier des résultats immédiats.
D’habitude, ces contradictions sont gérées de deux façons par les anarchistes qui s’engagent dans des luttes sociales avec des personnes avec qui ils n’ont pas d’affinité. Je suis bien entendu obligé de schématiser, puisque les positions ne sont pas toujours aussi nettes : il peut aussi y avoir des positions intermédiaires.
Dans la première approche, la seule qui soit acceptable à mon avis, il y a une transparence totale dans l’explication de son point de vue et de ses intentions, lorsqu’on lance une nouvelle lutte. Avec des discussions, des textes, des tracts, etc., les anarchistes montrent clairement leur analyse du monde et des rapports de domination, dépassant la lutte spécifique dont ils sont en train de s’occuper, et leur proposition est claire : aucune médiation ni procuration, la seule chose à faire c’est d’attaquer les responsables directs de l’oppression, avec l’objectif de subvertir complètement cet état des choses. Je ne vois aucune contradiction dans une approche de ce type : il y a là la volonté de laisser la porte ouverte pour de possibles nouveaux complices, mais sans se compromettre soi-même et ses idées. Des exemples passés ou présents de ce type d’approche sont la lutte contre la construction de la maxi-prison de Bruxelles, la lutte contre le CRA « Regina Pacis » à Lecce, la lutte contre l’expulsion du « Banc Expropriat » à Barcelone, des exemples, par ailleurs, qui sont approfondis dans le livre « Cuando se señala la luna ».
Mais malheureusement, il arrive que si on arbore cette transparence, les tant désirées franges « opprimées » de la société, parfois même celles-là qui sont les plus frappées par les projets qu’on essaye de contrer, ne s’approchent même pas, à part quelques cas isolés, et au final la lutte est menée par le seul groupe d’affinité anarchiste qui l’a entamée. Les « gens » préféreront plutôt se presser en masse aux portes de ces comités et ces associations qui proposent des méthodes plus typiquement démocratiques et moins radicales, avec des recours en justice, des actions médiatiques ou fortement spectaculaires.
Si la proposition de lutte n’arrive pas des anarchistes, mais ce sont ces dernier.e.s qui essayent de s’insérer dans une lutte qui existe déjà, c’est probable qu’en choisissant l’approche de la transparence, naissent tôt ou tard des conflits et des divergences, parfois insurmontables, avec les autres personnes qui y participent. Les discussions à propos de visions du monde si différentes ou sur la nécessité d’accepter tel ou tel autre compromis seront toujours plus tendues, celui qui aura le dessus dans la confrontation sera celui qui a une meilleur maîtrise de l’art oratoire, ou, plus probablement, celui qui dira les choses les plus sensées (du point de vue de la pensée dominante) et avec l’entrain nécessaire. Les personnes les plus éminentes du village ou du quartier jouiront, cela va de soi, de plus d’autorité, et leurs opinions seront mieux considérées que celles de ceux/celles qui, comme les anarchistes, raisonnent comme des extrémistes ou, plus banalement, arrivent d’ailleurs ou s’habillent en noir. Comment sortir de l’impasse s’il n’y pas de consensus sur ce qu’il faut faire ? Dans certains cas, les anarchistes essayeront de s’engager pour faire passer leur idée, exerçant des pressions et risquant de passer pour des autoritaires, ou bien il déserteront l’assemblée et continueront à s’organiser en dehors de celle-ci. Dans d’autres cas, elles/ils finiront pour accepter certains compromis, qu’ils/elles justifieront à elles/eux-mêmes de différentes manières, certain.e.s que le temps leur donnera raison. Si une telle situation se prolonge pour un temps, ce qui l’emportera sera la frustration d’une des deux parties et bon nombre de personnes quitteront le groupe.
En ayant expérimenté dans la réalité à quel point cette approche ne marche souvent pas, ces dernières années des anarchistes insurrectionnalistes ont préféré adopter une approche gradualiste, d’édulcoration de ses idées. C’est sur ce type d’approche que se focalise ma critique.
L’objectif de certaines de ces tentatives, au delà de la question spécifique de départ, a été celui de construire le consensus et la confiance des gens sur la durée, afin de leur « apprendre » à adopter les méthodes anarchistes (auto-organisation, refus de la procuration, etc., comme si la liberté pouvait être enseignée) et les pousser graduellement vers une conflictualité plus forte. Cependant, là s’introduit le germe de la politique. Dans les faits, le gradualisme signifie cacher, au début, ses idées et intentions réelles et faire une série de compromis inacceptables, avaler cette potion amère dans l’attente de temps meilleurs. Cela signifie souvent l’adoption de certains moyens de la politique traditionnelle : le fait de brosser l’opinion collective dans le sens du poil ; cela signifie les demies-vérités, le populisme. Cela signifie de ne pas révéler ce qu’est son projet sur le long terme, mais de focaliser l’attention sur des revendications partielles que parfois on ne partage même pas, afin d’obtenir le consensus et la confiance des personnes présentes et arriver ainsi à son vrai objectif. Cela signifie souvent porter des jugements même sur celles/ceux qui n’adoptent pas sa méthode, puisque certaines pratiques (si elles ne sont pas réalisées aux moments et dans les lieux considérés comme appropriés) commencent à être vues comme contre-productives pour le lent travail de construction du consensus qu’on est en train d’accomplir dans un contexte donné.
Cette approche, adoptée dans les dernières années lors de nombreuses luttes sociales auxquelles ont participé des anarchistes, comporte des nombreuses critiques que je veux approfondir, à partir de la question de l’objectif final de la mise en pratique de cette méthode, l’horizon vers lequel on regarde : cette insurrection qui est le but plus élevé qui devrait justifier tous les compromis précédents.
Même si les principaux théoriciens de l’anarchisme insurrectionnel soulignent en permanence qu’on est là en train de parler d’une méthode et pas d’une théorie, la réalité est que l’insurrectionnalisme part de certains présupposés de base, de certaines hypothèses, d’objectifs de moyen et long terme, donc c’est une théorie.
L’objectif à moyen terme est de créer des moment de rupture et de diffuser une plus grande conflictualité. Les luttes spécifiques, même si on n’en partage pas jusqu’au bout les revendications, sont, pour les anarchistes insurrectionnalistes, un tremplin pour un objectif plus élevé : la création d’un réseau de relations, la diffusion de pratiques d’auto-organisation et de conflictualité contre le pouvoir, l’élévation du niveau de conflit, dans une perspective visant le futur. La méthode insurrectionnelle a, dans le moyen terme, l’objectif de voir la diffusion de cette méthode elle-même. « La chose importante d’une méthode, la possibilité que sa mise en œuvre ait un sens, c’est sa possibilité de généralisation » (Cuando se señala la luna).
À mon avis, dans les analyses et les pratiques insurrectionnalistes on donne une attention excessive à la méthode, au détriment des motivations qui poussent à lutter, de l’analyse de la réalité et de ses rapports de domination, de la tension qui nous pousse, de la prise de conscience. « Ce qui compte, c’est la méthode » (A.M. Bonanno). Mais qu’est ce que c’est une méthode si elle est séparée des motivations et des objectifs qui poussent les mains, le cœur et la tête à l’action ?
La centralité du projet insurrectionnel est ce qui pousse de nombreux.ses anarchistes à participer à des luttes partielles et spécifiques, pour entrer en contact avec d’autres secteurs de la société. Si l’objectif évident, explicite, contingent, d’une mobilisation donnée est celui partagé avec ces groupes, petits ou grands, de personnes avec lesquelles on s’organise (empêcher des expulsions locatives, empêcher la construction d’une ligne à Haute Vitesse, d’un incinérateur ou d’un autre projet nuisible, etc.), il y a d’autres objectifs à moyen et long terme, dont ces mêmes personnes avec lesquelles on est en train de lutter n’ont pas connaissance et qui sont le mobile réel du projet insurrectionnel.
Il est vrai que ces luttes peuvent amener à des moments conflictuels, mais ceux-ci restent éphémères si les personnes qu’y participent ne développent pas une critique plus large et plus approfondie de l’existant – et souvent cela ne se passe pas précisément à cause de la volonté des anarchistes de « se limiter aux choses pratiques » et de ne pas s’aliéner trop de sympathies. Se contenter de quelques « moments de rupture » occasionnels dans lesquels sont présents aussi des habitant.e.s du quartier ou du village (souvent une présence minoritaire et passive), face à des mois ou des années d’assemblées creuses et de compromis de toute sorte, signifie jouer une partie au rabais. Le moment conflictuel motivé par une contingence, si entre-temps il n’y a eu aucun développement de réflexion et de conscience dans l’esprit de celles/ceux qui y participent, retournera bientôt à la normale et ceux/celles qui y ont participé retourneront sans trop de questionnements à mener leur vie d’engrenage du système.
Cela est inévitable, par ailleurs, si l’accent est mis uniquement sur la méthode et non pas sur les motivations plus profondes pour lesquelles ça vaut la peine de lutter. On est confronté ici, dans toute sa splendeur, à l’héritage de la mentalité de gauche et du matérialisme historique, dans les luttes à aspiration insurrectionnelle, qui fonctionnent sur la recherche du consensus à tout prix. Le choix du terrain d’intervention porte souvent sur la satisfaction de besoins matériels fondamentaux des personnes les plus démunies, leur nécessité d’un toit, d’un travail, d’un permis de séjour. Des luttes qui peuvent facilement aboutir dans des positions ambiguës si elles ne sont pas accompagnées par un discours explicite de refus du travail, de l’État et de ses lois, des papiers d’identité, etc., du système dans son ensemble, un refus qui n’est sûrement pas partagé par toutes les personnes qui y participent. Cela paraît ne pas être perçu comme un problème insurmontable, avec le résultat d’une ambiguïté de fond dans les revendications, qui semblent souvent confirmer ou renforcer l’idée que le problème n’est pas tellement l’État, mais plutôt l’inefficacité de l’État à satisfaire les besoins fondamentaux des personnes. On finit ainsi par favoriser sans le vouloir une plus grande dépendance du système, au lieu de la nécessité de sa destruction pour la liberté de chacune/chacun.
Souvent, ces luttes sont centrées sur le rapport avec les personnes qui sont exclues des privilèges matériaux des riches sociétés occidentales, pas tellement et pas seulement parce qu’on partage les mêmes problématiques sociales qu’elles, ou qu’on les ressent avec empathie même si on ne le vit pas, mais parce que de par leur situation sociale et économique elles sont considérées comme de potentielles sujets révolutionnaires (ou « insurrectionnels ») et on veut donc obtenir leur confiance.
Par ailleurs, quel espace est laissé, dans ce genre de luttes, à la réflexion sur les désirs, les nécessités existentielles, l’envie d’une vie pleine et satisfaisante aussi à un niveau personnel et relationnel, au-delà de la satisfaction des besoins matériels ? Presque aucun.
Dans la pratique, cette façon de s’organiser prévoit des groupes plus restreints, constitués par peu de personnes liées par une profonde connaissance et confiance réciproque (groupes d’affinité) et des groupes plus élargis, où sont associés des anarchistes et d’« autres exploité.e.s » (noyaux de base, coordinations) et cela se déroule dans une série d’assemblées et réunions plus ou moins élargies qui souvent reproduisent les mécanismes néfastes typiques à l’assemblée : leaderisme, dynamiques de pouvoir, lenteur et perte de temps… À un point qu’on peut parfois se demander qu’est ce qu’il reste d’informel dans une structure de ce type.
L’objectif à long terme, implicite, sous-tendu, le rêve qui ne se réalisera peut-être jamais, c’est l’insurrection généralisée, qui, dans le meilleur des cas, pourrait porter à la tant désirée Révolution Sociale.
Provoquer l’insurrection des grandes ou petites masses, tous ensemble à un moment donné. Ou, en alternative, être prêt.e.s à les guider au cas où cela ait lieu indépendamment de notre volonté, pourvus à l’avance d’un « projet » – essayant ainsi de gagner la compétition avec d’autres factions politiques qui veulent s’emparer du contrôle des foules (et du pouvoir). La tension anarchiste devient ainsi une énième faction politique parmi les autres.
« Ces moments-là sont le puissant projecteur qui rend réalisable un projet révolutionnaire et anarchiste, mais ce projet, même si seulement dans ses lignes méthodologiques, doit exister à l’avance, il a fallu l’ avoir élaboré à l’avance, même si ce n’est pas dans tous ses détails, et il a fallu, dans la mesure du possible, l’avoir expérimenté » (A. M. Bonanno, « Anarchismo insurrezionalista »).
On lutte aujourd’hui, sans attentes inutiles, même sur des questions minoritaires par rapport aux nœuds stratégiques réels de la domination, mais projeté.e.s « vers une possible réalisation future ». « Il n’y a pas de projet sans une foi dans le futur ».
« L’insurrectionnalisme anarchiste comme projet et comme action qui n’est jamais accompli jusqu’au bout, puisqu’il s’adresse continuellement vers le futur ». (A. M. Bonanno).
Une méthode, une stratégie, n’ont pas de raison d’exister si ce n’est pas comme hypothèse pragmatique visant la réalisation d’un objectif. Dans ce cas, l’objectif est la réalisation de cette chère vieille Révolution Sociale, ou, du moins, l’Insurrection (laquelle, parfois, n’est pas imaginée comme prélude à une possible révolution, étant donné qu’il y a aussi de ceux/celles qui n’y croient plus, et on se contenterait d’un peu de saine destruction nihiliste). Mais ici on parle de l’insurrection de qui contre qui ? Dans quel but ? Avec quelles motivations ? Dans l’analyse insurrectionnaliste, cela semble importer peu. Les pages concernant l’Insurrection, dans de nombreux textes anarchistes, sont souvent des morceaux de pure poésie, des envolées lyriques de l’imagination à propos de comment tout moment d’insurrection signifie la rupture de tout rapport social préétabli, de toute barrière mentale, et c’est aussi un possibilité illimitée de revanche.
Nous ne voulons pas nier la joie de voir et de participer, ensemble avec des centaines d’autres personnes, à des affrontements avec la police ou à l’incendie de portions de la ville, même si ce n’était que pour une journée, mais se faire des illusions sur le fait que cela mène à un changement social dans le sens libertaire, c’est autre chose. Un bon nombre des moments insurrectionnels, d’ailleurs toujours plus rares, éclatés ces dernières années dans les métropoles occidentales, ont eu plutôt la fonction d’exutoire ponctuel pour des nombreuses personnes exclues, exploitées ou discriminées, avant leur retour complet à la quotidienneté des rapports de domination, suite aux premières doses de répression.
D’autre part, on ne peut pas séparer un événement des motivations l’ayant provoqué ; pourtant c’est l’erreur que beaucoup d’anarchistes font, en continuant à mettre l’accent seulement sur la méthode et pas sur les motivations qui poussent à l’action. Comment nous positionnerions-nous si l’insurrection contre le gouvernement éclatait parce que celui-ci est considéré comme n’étant pas assez présent (le postulat, par exemple, de celles/ceux qui réclament le « droit à une maison ») ? L’image de masses de sous-prolétaires qui pillent des magasins d’électronique pour s’approprier eux/elles aussi des ordinateurs et téléphones portables de dernière génération est-elle négative ou positive ? Et si ce qui pousse des groupes de personnes économiquement déshéritées vers l’insurrection était le refus raciste d’accueillir d’autres personnes, immigrées sur leur territoire, parce que perçues comme une menace dans la compétition pour le travail ? Quoi penser de l’insurrection contre le gouvernement qui a eu lieu il y a quelques années en Ukraine, poussée certes par une frustration sociale généralisée, mais aussi par des aspirations pro-UE sûrement pas partageables, en plus du fait qu’elle a été étroitement liée avec des groupes néonazis et d’extrême droite ? Pense-t-on vraiment que l’insurrection a nécessairement un esprit anarchiste ou qu’elle puisse facilement y être canalisée ?
Parfois, l’analyse insurrectionnaliste court le risque de tomber dans l’exaltation du geste rebelle en soi, au-delà de ses motivations ; notamment dans l’exaltation du geste rebelle accompli par de nombreuses personnes en même temps. Néanmoins, quand des émeutes violentes éclatent aujourd’hui dans le monde occidental, c’est souvent une réaction à une situation réitérée de violence, de discrimination et d’abus subie par une catégorie sociale donnée, ou bien par le désir frustré des exclu.e.s d’accéder au monde brillant de la marchandise, de l’argent et de la richesse matérielle, accessible à d’autres classes sociales. Bref, par le désir d’inclusion dans ce monde capitaliste pourri que nous voudrions au contraire détruire.
Comme nous le montrent plusieurs exemples historiques et aussi récents, les insurrections peuvent éclater pour des raisons complètement différentes et elle peuvent avoir une impulsion libertaire aussi bien que réactionnaire. En tout cas, il s’agit de mouvements normalement spontanés et imprévisibles et non pas crées à dessein par une minorité dans un moment dans lequel il n’y a aucune fermentation sociale réelle. Le projet de ne pas se retrouver sans préparation et avoir les idées claires sur quoi faire au cas où se déclenche, pour une raison quelconque, une émeute populaire sur son territoire, est correct et valide, mais ici on est en train de parler de quelque chose de diffèrent.
Le fait de décider d’investir toute son énergie dans des luttes d’un certain type, préférées à d’autres parce qu’on pense qu’elles pourraient impliquer plus de monde et ont plus de possibilités de provoquer dans un bref délai des situations locales de conflit avec les autorités et peut-être par le futur une insurrection élargie, reste souvent un sous-tendu qui n’est pas discuté ni problématisé. L’objectif idéal non explicité est celui d’arriver au Grand Soir avec une autorité reconnue parmi les « personnes exploitées », de façon à pouvoir être à la tête de l’insurrection grâce à la présence d’un milieu élargi de personnes qui nous connaissent et qui seront donc prêtes à suivre nos instructions.
Ces postulats comportent des choix. Dans la perspective insurrectionnelle, qui en gros est fondée sur une foi messianique dans le futur (c’est vraiment probable que ça sera vraiment nous qui donnerons vie à un mouvement insurrectionnel ? Ou que cela se produise précisément dans le quartier où nous avons développé nos relations pendant des années ?), le choix de comment utiliser au mieux son énergie se porte sur la décision de participer de façon continue à certains types de luttes avec des personnes avec qui on n’a pas d’affinité – des luttes qui, soit dit en passant, ne garantissent pas les résultats escomptés – au lieu d’employer son énergie dans un projet individuel d’attaque à la domination, ou dans son propre groupe d’affinité, dont l’importance est au contraire amoindrie :
« L’élément qui caractérise ce projet, au-delà des mots ou des motivations qui le rendent plus ou moins approfondi analytiquement et efficace pragmatiquement, est donné par la présence des exclus, c’est à dire des gens, bref des masses, plus ou moins importantes numériquement (…). La participation des masses est donc l’élément de base du projet insurrectionnel et, étant donné que celui-ci part de l’affinité de chaque diffèrent groupe anarchiste y participant, elle est aussi l’élément de base de cette même affinité, qui resterait de la pauvre camaraderie d’élite si circonscrite à la recherche réciproque d’une connaissance personnelle plus approfondie entre compagnons » (A. M. Bonanno).
Au delà de tout, pourquoi une ou deux journées d’affrontements généralisées, auxquelles on arrive (dans la meilleure des hypothèses) après des années de mobilisation croissante, devraient avoir plus de valeur que des centaines d’actions directes menées de façon diffuse par différents groupes d’affinité ? Les projets et les actions réalisés par des individus ou des groupes anarchistes ne pourraient-ils pas, en plus d’avoir de la valeur en eux-même, être eux aussi une source d’inspiration à l’action pour d’autres personnes à l’esprit rebelle ? Cela ne me paraît pas une hypothèse plus improbable que de penser qu’à partir d’une lutte de quartier puisse naître une insurrection qui mènera à l’anarchie.
On a parfois l’impression que beaucoup d’anarchistes souffrent d’un complexe d’infériorité qui les amène à évaluer avec différents paramètres la valeur d’une action directe, selon si celle-ci est réalisée par des anarchistes ou par des personnes « lambda », en donnant un poids énormément plus grand à ce dernier cas. Les mêmes pratiques conflictuelles qui sont déjà régulièrement appliquées, collectivement ou par petits groupes, par celles/ceux qui se définissent anarchistes, semblent acquérir une énorme plus-value si enrichie par la présence de quelque autre individu qui n’est pas définissable en ces termes. Encore une fois on tombe dans l’idéalisation de la classe sociale exploitée… Quand enfin ça arrive de trouver un.e complice inattendu.e, on le/la met sur un piédestal au lieu de la/le considérer au même niveau que nous, réitérant ainsi cette division parmi les rebelles qu’on voulait éliminer.
Un autre problème de fond, très important, de l’approche insurrectionnelle, touche précisément au rapport avec les personnes avec lesquelles on est en train de lutter, apparemment pour une quelconque question qui les concerne. La méthode insurrectionnelle considère en réalité ces personnes comme les pions d’un jeu plus grand. Mais est-ce que ces personnes savent qu’elles font partie d’un projet à nous qui est plus large et à plus long terme ? Est-ce qu’elle le partagent ? Ne serait-on pas en train d’instrumentaliser leurs besoins et leurs difficultés ? Ne serait-on pas en train de faire de la politique et d’agir comme des avant-gardes, si on a des arrières-pensées, même si on pense que c’est « pour le bien » du peuple ? Ne serait-on pas en train de se poser dans une position de supériorité par rapport à ces personnes, si on les considère trop ignorantes pour comprendre ce qui est réellement en jeu et en se comportant comme si on devait leur apprendre quelque chose (comment s’organiser, comment lutter, ce qui est mieux pour elles) ? On assiste ici à la séparation entre éthique et politique, et c’est la deuxième qui l’emporte nettement.
Pour moi, vivre l’anarchie signifie bien sûr aspirer à la subversion totale de ce monde et à la destruction de toute forme de domination, mais sans que les aspirations utopiques – les « fantômes » – prennent le dessus sur la réalité et sur mon intégrité individuelle. Ce qui est important c’est de commencer à mettre en pratique l’anarchie dès à présent, se reconnaître en tant qu’individus et reconnaître les autres en tant qu’individus, se libérer des entraves posées par les constrictions sociales, créer des relations différentes fondées sur la transparence et l’horizontalité, se donner les moyens de prendre des décisions en autonomie et arrêter de déléguer sa vie, commencer à couper sa dépendance du système, trouver des complices et attaquer le pouvoir avec tout moyen… Cela comprend le fait de se libérer soi-même de la politique, des relations fausses et hypocrites, du calcul sournois, faire de sa vie un terrain de lutte constante où il n’y a pas de séparation entre lutte et vie, exactement le contraire de la logique de la lutte comme spécialisation et comme politique.
Si les moyens que l’on se donne doivent correspondre à nos fins, alors fonder nos relations sur les non-dits, les faussetés et l’opportunisme ce n’est certes pas un jolie carte de visite pour illustrer notre idée d’anarchie. L’hypocrisie implicite dans un certain type d’intervention dans les luttes sociales, dictée par une arrière-pensée qui reste cachée aux « exploité.e.s » est évidente dans un passage comme celui-ci, qui confirme aussi quelques-unes des critiques précédentes :
« D’un autre côté, quand on intervient dans des luttes de masse, dans des affrontements pour des revendications intermédiaires, ne le faisons-nous pas presque exclusivement afin de suggérer notre patrimoine méthodologique ? Que des ouvrier d’une usine demandent du travail et cherchent d’empêcher des licenciements, qu’un groupe de sans-abris essaye de se faire donner un toit, que les détenus fassent grève pour une vie meilleure dans les institutions pénales, que les étudiants se rebellent contre une école sans culture, tout cela ne nous intéresse que jusqu’à un certain point. Quand nous participons à ces luttes en tant qu’anarchistes, nous savons très bien que, peu importe comment elles finissent, le retour en terme quantitatif, c’est-à-dire de croissance de notre mouvement, est très relatif. Souvent, les exclus oublient même ce que nous sommes, et il n’y a aucune raison de se souvenir de nous, encore moins si c’est basé sur la gratitude. En effet, à diverses reprises on s’est demandé ce qu’on fait nous, en tant qu’anarchistes et révolutionnaires, au beau milieu de ces luttes revendicatives, nous qui sommes contre le travail, contre l’école, contre toute concession de l’État, contre la propriété et même contre toute forme d’arrangement qui puisse octroyer une vie meilleure dans les prisons. La réponse est simple. Nous y sommes parce que nous y portons une méthode différente ». (A. M. Bonanno)
C’est une vaine illusion que de penser pouvoir libérer les masses en général. Certains individus ont un esprit indomptable et souffrent plus que les autres des chaînes que la domination leur a mis aux poignets. Ils convoitent la liberté et le sauvage. D’autres individus aiment leur chaînes et ne supportent pas de vivre sans quelqu’un.e qui les guide, qui leur donne sécurité, stabilité, certitudes, routine, même au prix de leur liberté. Ces personnes ne possèdent pas la volonté de changer leur condition, même quand elles peuvent le faire et elles préfèrent défendre le système qui les soumet, puisque pour elles une vie de servitude est préférable à l’incertitude de la révolte. Ces personnes, on le trouvera toujours en face de nous au moment de la rébellion. Ce qui nous pousse à nous mettre en jeu ce n’est pas un instinct philanthropique, mais avant tout le désir de nous libérer nous-même de nos chaînes. Pour cela nous revendiquons le fait d’être anti-sociaux et nihilistes contre la civilisation.
Quel espace est laissé à notre individualité dans un projet politique tel l’insurrectionnalisme, basé sur le calcul ? Vraiment peu. On devrait laisser de côté notre individualité pour devenir plus compréhensibles pour les personnes lambdas, puisqu’il faut faire les choses graduellement, nous dit-on, ou dans le cas contraire on ne nous comprendra pas. On devrait mettre de côté nos aspirations les plus élevées et retourner nous occuper exclusivement des besoins de l’estomac. Dans la perspective d’une lutte menée avec le reste de la société, des questions comme la domination technologico-militaire, la dévastation écologique et l’exploitation animale d’habitude sont laissées complètement de côté, peut-être parce que considérées comme des problématiques typiques de personnes privilégiées, face à la priorité de l’oppression économique et classiste, ou parce que considérées comme difficilement compréhensibles par la plèbe, jugée ignorante et insensible.
Comme si notre misère existentielle et matérielle n’était pas liée aussi à tout cela et comme si la sphère sociale humaine était suspendue dans une bulle au dessus de la planète où elle se trouve et aux relations avec les autres êtres vivants, dont elle dépend. On nous dit d’adapter nos discours à la désolation de la réalité actuelle et d’être réalistes, puisque c’est le seul moyen pour nous faire comprendre. Notre vrai « moi », nos vraies pensées, on peut toujours les vivre dans notre imagination, le soir, dans un état de demi-sommeil avant de nous endormir, après avoir terminé notre journée de « vraie » militance.
On devrait renoncer même à nos désirs les plus immédiats, l’attaque contre l’existant dictée par la volonté de satisfaire un désir intérieur et non pas par un calcul politique sur le long terme. Selon la théorie de l’attaque diffuse, l’action directe se doit d’être anonyme et menée avec des moyens simples, avec un objectif compréhensible par tout le monde, mieux si insérée dans une lutte sociale déjà en cours, parce que seulement de cette façon elle est « appropriable et reproductible » par « tous les exploités » (vain espoir). Certain.e.s anarchistes, qui ont transformé en un dogme ce qui n’était qu’une proposition de l’approche insurrectionnaliste avec le but d’avoir peut-être une meilleure efficacité dans l’action, en sont arrivés à penser qu’une action qui ne rentre pas dans ces critères, c’est-à-dire qui est trop en avant par rapport à l’époque, ou en dehors d’un contexte, ou non compréhensible pour les non-anarchistes, est même carrément contre-productive.
« Ces attaques doivent choisir des objectifs liés à l’oppression quotidienne, reconnaissables par tout le monde, et être comprises facilement. De là dérive une critique intéressante des communiqués de revendication et des choses de ce genre : si une attaque, un sabotage, une action quelconque doit être expliquée à travers de longs communiqués (qui en général ont l’effet contraire, parce que écrits dans un langage complètement incompréhensible même pour les compagnons et les compagnonnes), c’est parce que, visiblement, cet objectif n’a pas été bien choisi, puisque une action devrait parler par elle-même et de façon immédiate (c’est à dire, sans médiateur). On peut dire la même chose pour le fait que l’attaque doive être anonyme : elle n’appartient à personne, mais elle appartient à toutes ces personnes qui l’applaudissent, la partagent, la mèneraient ». (Cuando se se señala la luna)
Quel sens cela a-t-il de limiter, dans son agir, le choix des objectifs à attaquer, le moment de leur réalisation, la signification qu’on veut leur donner, pour que plus de monde puisse nous applaudir ? L’expression utilisée dans le livre cité est appropriée, puisqu’on a l’impression que souvent les grands résultats exhibés par certaines luttes sociales se réduisent précisément à ça – non pas à plus de personnes qui, sur une longue période, se radicalisent et se mettent en jeu par elles-mêmes dans des pratiques conflictuelles, mais à plus de personnes qui, sur une courte période, applaudissent ce que les anarchistes font, ce qu’elles/ils font depuis toujours et feraient de toute façon (et parfois ils/elle le font moins bien justement parce que limité.e.s par leur recherche du consensus) – et qui vont ensuite retourner voter et faire des démarches légales dans des tribunaux juste après. Le besoin d’avoir une légitimation sociale pour attaquer le pouvoir est peut-être un autre symptôme de ce manque de confiance en soi et de ce sentiment d’infériorité qui continue à toucher une partie du mouvement anarchiste et dont il est bien l’heure de se libérer, pour recommencer à être des épines dans le pied, et pour de vrai.
Sur anonymat, revendication et reproductibilité des actions
Fenrir, pubblicazione anarchica ecologista, n° 8 / septembre 2017
Je pense qu’il est important de revenir sur la question de l’anonymat ou de l’utilisation de revendications pour les actions, reprendre le fil d’un débat avorté non pas parce que peu intéressant, mais parce qu’il a pris dès le début des tons polémiques et offensants, de la part des partisans des deux positions. Une telle approche n’est nullement utile dans le but d’un débat fructueux, qui devrait avoir comme finalité l’enrichissement de la connaissance de chacun.e à travers le partage d’analyses critiques des différentes réflexions, au lieu de tomber dans une défense statique de sa position en discréditant « l’adversaire », parfois à l’aide de coups bas. Cela tout en gardant toujours à l’esprit que la pensée anarchiste est quelque chose qui n’est jamais figé, quelque chose de subjectif et en perpétuelle évolution ; c’est précisément à travers l’analyse et la confrontation qu’on peut éviter de se fossiliser dans des catégories dogmatiques et des divisions basées sur des simples différences d’approche pouvant tranquillement coexister.
Il convient d’ajouter qu’une approche dogmatique par rapport à cette question n’est même pas représentative de la réalité, puisqu’elle ne tient pas compte du fait que le même individu ou groupe d’action, dans son parcours d’attaque au pouvoir, peut décider, tour à tour ou dans des moments différentes, de revendiquer ou pas ses actions, de les signer ou pas, d’écrire des longs communiqués ou seulement deux lignes, d’utiliser un sigle ou un nom fixe pour sa cellule, d’en inventer un nouveau à chaque fois, tout comme les différents individus peuvent choisir de s’organiser toujours avec les mêmes personnes ou successivement avec des complices différents. La flexibilité et l’imprévisibilité ont toujours été des armes de choix dans l’arsenal anarchiste. Ce sont précisément ces caractéristiques qui compliquent pour l’État la tâche d’effacer complètement la conflictualité anarchiste et ses groupes d’action, du moment que ceux-ci ne se connaissent pas entre eux, souvent n’ont pas une structure fixe et changent dans le temps leur façon d’agir et leur composition. Le fait de créer des divisions tranchées entre les divers courants du mouvement anarchiste, d’un côté celui qui maintiendrait l’utilisation de sigles et revendications et de l’autre côté celui qui serait partisan de l’action anonyme ou de la revendication minimale, au delà de ne pas tenir compte des nuances existantes entre ces deux extrêmes, participe à exacerber les conflits entre anarchistes sur des question secondaires, aidant ainsi la répression dans sa tâche.
Je veux toujours mettre à la base de mon raisonnement le respect de l’autonomie individuelle, présupposé fondamental de l’idée anarchiste et point de référence incontournable pour éviter la reproduction d’attitudes idéologiques et donneuses de jugements. Mon souhait est que l’approfondissement de la question et le débat entre les différentes approches mènent à un enrichissement individuel et à une utilisation plus consciente des instruments que nous avons à notre disposition. Analysons donc quelles sont les implications du choix de revendiquer ou pas ses actions, et de quelle façon, et creusons la question si la revendication puisse être un instrument utile pour renforcer le potentiel d’une action directe.
Le choix de ne pas revendiquer, d’aucune manière, une action directe qu’on a réalisé, de rester donc dans le plus complet « anonymat » (un terme, celui-ci, que je vais continuer à utiliser parce qu’il fait désormais partie du débat, mais que je pense décidément inapproprié, parce qu’il est évident que aussi ceux/celles qui revendiquent leurs actions veulent rester anonymes !) peut dériver de différentes considérations sur l’individu ou le groupe d’affinité. Il peut s’agir d’une considération stratégique, selon laquelle il est préférable de ne pas fournir aux enquêteurs d’éléments en plus, comme ceux qu’ils peuvent déduire d’un communiqué de revendication, surtout si dans un certain territoire la présence anarchiste est petite et/ou particulièrement exposée ou encore si la conflictualité sociale est très faible : laisser planer le doute sur l’origine « politique » ou pas d’une action et sur les raisons qui ont motivé ceux/celles qui l’ont accomplie peut indubitablement servir à confondre les enquêteurs et à essayer de prolonger les hostilités le plus longtemps possible.
Dans d’autres cas, et plus simplement, le choix de ne pas revendiquer une action peut être dicté par le désintérêt envers la volonté de communiquer quoi que ce soit à la société ou aux représentants du pouvoir. Mener une action peut être une réponse à un désir purement égoïste d’auto-libération, un défi lancé à l’autorité par le Moi, qui n’a aucun intérêt à communiquer avec autrui et n’a pas besoin de fournir des explications.
Ces choix sont parfaitement valides et respectables. Même dans ces cas, l’action atteint l’un de ses objectifs primaires, c’est à dire infliger un dégât matériel et psychologique à l’ennemi. Le dégât matériel reste un résultat concret qu’on a obtenu, indépendamment des mots qui accompagnent ou pas l’action. D’un point de vue psychologique, dans certains cas la pression exercée peut même être plus forte si les responsables de l’exploitation qui ont été frappé.e.s ne savent pas précisément qui les a attaqué.e.s, ni pourquoi (même s’ils/elles peuvent facilement le deviner). Dans d’autres cas, au contraire, ce qui fait peur pourrait être précisément la « renommée » des anarchistes ou d’un certain sigle, ou les mots menaçants qui éventuellement accompagnent la revendication d’une action. Ces conséquences varient et il demeure difficile de les prévoir à l’avance et de les évaluer avec certitude.
L’inconvénient évident dans le choix de ne pas revendiquer une action se trouve au niveau de la communication. Si la finalité d’une attaque contre le pouvoir ne consiste pas seulement dans le préjudice matériel et psychologique porté dans l’immédiat, mais aussi dans le fait de montrer la possibilité elle-même de l’attaque contre le pouvoir, ainsi que certaines de ses possibles modalités, il est alors important que les informations à propos de ces attaques se diffusent le plus possible. On sait bien que les médias ont parfois la tendance à taire l’existence même de certaines attaques, parfois à en parler de façon spectaculaire, en les réduisant à des actes de vandalisme insensé. Le fait d’écrire ne fussent que deux lignes de revendication sert avant tout à répandre la nouvelle d’une attaque, au-delà de ce qu’ils en disent ou pas les médias, et qui sera connu seulement à un niveau local. De cette façon, la nouvelle se répand plus facilement à travers les canaux de contre-information, atteint d’autres personne hostiles à l’autorité et surtout elle arrive sans la médiation du pouvoir, mais avec les mots directs de celles/ceux qui ont réalisé l’attaque, et elle peut inspirer d’autres à passer à l’action. Cela est l’objectif minimal d’une revendication.
Un texte plus développé sur une action qu’on a mené peut servir aussi à d’autres finalités : approfondir les raisons du choix de l’objectif, de l’infrastructure ou de la personne qui a été frappée, son importance stratégique ou ses responsabilités spécifiques ; dévoiler des détails techniques sur la réalisation de l’attaque, comme les moyens employés ou la façon dont on a approché l’objectif, la présence d’obstacles (alarmes, caméras, etc.) et la manière employée pour les neutraliser, développer une analyse plus large du contexte social/politique dans lequel cette attaque s’insère, avancer des propositions de projectualité anarchiste.
Des parcours et des contextes différents ont porté les individus et les groupes qui réalisent des actions, à utiliser des revendications, en mettant en avant à chaque fois certains de ces aspects plutôt que d’autres. Par exemple, des nombreuses revendications non signées, ou signées avec des acronymes comme ALF [1] ou ELF [2], ont depuis toujours la tendance à être plus succinctes et à se focaliser sur le choix de l’objectif et les moyens employés, laissant peu d’espace à une analyse sociale/politique plus large et à une éventuelle proposition de projectualité. D’autres groupes d’action, surtout ceux qui, avec le temps, ont adopté une forme organisationnelle stable, avec leur nom (accompagné ou pas par une sigle déterminée) ont souvent utilisé les revendications principalement pour développer une analyse sociale/politique, avec laquelle les différentes actions sont insérées dans le cadre d’une évolution théorique et d’une projectualité à long terme propre au groupe. Ces dernière années, grâce à la contribution théorique de groupes comme la FAI [3] et la Conspiration des Cellules de Feu, s’est renforcée aussi la proposition d’utiliser les revendications comme un moyen pour communiquer entre groupes d’action, afin de renforcer le débat sur les analyses et les stratégies, en plus d’accroître la solidarité face aux attaques répressifs. La proposition initiale de la FAI – faite justement à travers les revendications des actions, reprise et relancée ensuite par les membres emprisonné.e.s de la CCF – d’étendre l’utilisation de ce sigle, de façon que d’autres anarchistes puissent l’utiliser pour revendiquer leurs actions, à condition qu’il y ait le partage de quelques points de base (internationalisme, informalité, solidarité avec les prisonnier.e.s, etc.) rentre justement dans cette perspective.
Une proposition de ce type, qui peut et veut être une possibilité en plus dans la boite à outils à disposition de l’individualité anarchiste qui tend vers l’action, n’a pas été bien comprise par les partisan.ne.s de l’« anonymat » à tout prix, qui ont interprété l’essor de longues revendications/analyses comme des exhibitions d’égocentrisme et d’auto-referentialité et non comme une nouvelle modalité de dialogue et de discussion entre groupes et individus ayant comme point commun l’action. Ces critiques en sont arrivé.e.s à maintenir que le choix de revendiquer ses actions et d’utiliser des telles revendication aussi comme un moyen pour dialoguer entre groupes d’action cacherait en réalité la volonté de se mettre en avant, d’être reconnu.e.s, d’imposer une hégémonie sur le mouvement, d’avoir des attitudes d’avant-gardes, d’être au centre du théâtre médiatique, ainsi que d’autres critiques de la même teneur. Au-delà du fait que ceux/celles qui revendiquent leurs actions continuent à être anonymes et elles/ils peuvent donc difficilement devenir célèbres, il est évident que si on pose les critiques à ce niveau aucun débat n’est possible. En lisant entre les lignes, ce qui semble être sous-jacent au conflit entre les deux méthodologies est une différente vision des possibles modalités d’intervention sur la réalité : d’un côté ce qui est considéré comme prioritaire c’est la recherche de complices et compagnon.ne.s et la solidarité envers ceux/celles-ci, de l’autre côté c’est la tentative d’impliquer d’autres « exploité.e.s et exclu.e.s ». Des approches qui semblent s’exclure l’une l’autre, mais pas nécessairement, si on garde à l’esprit que toute action directe agit, de quelque façon, et sur l’imaginaire collectif et sur celui individuel, donnant de l’inspiration à d’autres anarchistes et rebelles, obligeant les indifférent.e.s à prendre position et mettant en garde les complices de la domination.
A cette question-ci est liée celle de la reproductibilité, autre nœud important du débat. Ce concept, qui accompagne souvent celui d’anonymat, est devenu un des mots d’ordre de l’insurrectionnalisme « classique » ; pourtant il n’a que rarement été discuté et soumis à une réflexion critique, tout en devenant parfois un lieu commun aux tonalités prescriptives.
Le souhait que ces actions servent d’inspiration pour d’autres personnes et que la conflictualité s’étende est compréhensible. Le problème est dans l’affirmation que la reproductibilité serait possible seulement sous certaines conditions, c’est de dire que seulement les actions anonymes, non revendiquées et menées avec des modalités simples puissent appartenir à tout le monde et par conséquent être reproduites plus facilement. Selon cette conviction, il est préférable qu’on ne puisse pas relier une action à une « identité », comme celle anarchiste (ce qui devient évident dans le cas d’une revendication), de façon que toute personne qui se reconnaît dans cette attaque puisse y donner son propre sens et reproduire à son tour cette méthode contre ce qui l’opprime.
Ce postulat est problématique à plusieurs niveaux. Ce qui est proposé ici à l’individu qui attaque c’est d’annuler sa propre individualité et les motivations qui le poussent à agir, afin de se fondre dans la masse et d’être plus compréhensible par celle-ci. Il est en outre évident que ceux/celles qui répliquent certaines actions sont principalement d’autres anarchistes, ou en tout cas des personnes hostiles à ce monde, du coup la présence d’une revendication anarchiste pourrait au contraire être source d’inspiration pour elles/eux, bien plus que pour la grande masse des personnes exploitées qui jamais penseraient de lever leur tête et réagir face à l’exploitation de soi-même et d’autrui.
Mais on retrouve surtout, ici, cette exaltation du moyen au-dessus de la finalité qu’on a déjà critiqué ailleurs. Si l’objectif d’une action n’est en aucun cas de communiquer quelque chose, cet aspect peut ne pas intéresser ses auteur.e.s, puisqu’il y a quand-même et toujours le dommage matériel occasionné à un des tentacules de la domination. Mais si l’objectif d’une action est aussi (ou surtout) de type communicatif, le fait de viser à la reproductibilité d’une méthode en la détachant de la finalité qu’elle poursuit et qui la motive, rendant donc impersonnelle cette action, devient insensé ou même contre-productif. Je vais expliquer cela avec quelques exemples.
Entre février et avril 2016, quatre bombes ont explosé devant des églises et cathédrales de la ville de Fermo, dans la région des Marche. Peu de temps après, un site internet anarchiste [4] a parlé de ces faits divers, qui avaient trouvé peu d’attention au-delà du niveau local, en exaltant le geste et en faisant l’hypothèse d’un mobile iconoclaste (l’hypothèse que ces attaques auraient pu avoir été menés par des membres de l’extrême droite à été mise de côté comme peu probable). Dans le mois de juillet de la même année, deux personnes ont été arrêtées et accusées, sur la base de preuves irréfutables, d’avoir posé les quatre engins explosifs. Tout d’abord présentées comme anarchistes par les médias, les deux personnes arrêtées appartenaient à l’extrême droite ; elles étaient actives parmi les supporters de foot locaux et avaient des rapports amicaux avec Amedeo Mancini, hooligan néofasciste qui, quelques jours auparavant, toujours dans la même ville, avait tabassé à mort Emmanuel Chidi Namdi, demandeur d’asile originaire nigérienne, puisque celui-ci avait défendu sa copine d’insultes racistes. En cette occasion, sur les réseaux sociaux, les deux qui seront ensuite arrêtés pour les bombes devant les églises avaient exprimé leur totale solidarité et proximité avec l’assassin de Emmanuel, en plus de se laisser aller à leur tour à des commentaires et des déclarations lourdement racistes. Une des églises frappées à Fermo était d’ailleurs celle qui hébergeait Emmanuel et d’autres demandeur.se.s d’asile.
Ce cas me semble un bon exemple de la manière dont une même action et une même méthode peuvent avoir des significations complètement différentes, selon qui en est l’auteur et quel en est le but. Les actions dont il est question, n’ayant été accompagnées d’aucune explication qui exprimait clairement leurs motivations, laissaient planer l’ambiguïté, ne participant donc en aucune manière à l’avancée de la lutte contre la domination. Une explosion frappant une église peut être autant le geste d’un athée iconoclaste qui veut frapper l’Église en tant que telle ou le geste d’un fasciste indigné par les politiques d’accueil de cette église-là à l’encontre des réfugié.e.s. Deux mobiles évidemment aux antipodes et incompatibles.
Un autre exemple : le 8 juillet 2016 un grand incendie a presque complètement détruit la station de ski de Fossolo, dans la Val Brembana. Une action à l’allure écologiste, dans le pur style du Earth Liberation Front, ou bien une machination des politiciens locaux corrompus et des entreprises qui ont gagné l’appel d’offre pour la reconstruction, comme cela a été supposé par les enquêteurs ?
Certes, lire de faits divers de ce type peut au début susciter de la jubilation, mais au fond les doutes et l’incertitude sur les mobiles du geste restent. Un communiqué de revendication, ou même un simple tag, une sigle ou un symbole laissé sur les lieux auraient enlevé tout doute. Dans le cas contraire, ces actions anonymes, dont le sens reste inconnu, peuvent e trouver réappropriées vraiment par tout le monde, y compris fascistes et mafieux. Les anarchistes et les rebelles à l’autorité n’ont pas le monopole de la pratique de l’action directe. L’État, les groupes de droite, la criminalité organisée et les extrémistes religieux, juste pour donner quelques exemples, ont utilisé et parfois utilisent des moyens semblables aux nôtres pour attaquer leur cibles, avec des motivations très peu partageables.
La cible d’une attaque peut être la même – une église, un tribunal, une institution étatique, une banque – mais les motivations complètement différentes des nôtres, par exemple parce que l’une de ces institutions a une attitude trop « modérée », du point de vue de ceux/celles qui ont une idéologie réactionnaire.
Quelque chose de semblable peut se produire dans le cas que les cibles d’attaques et leurs revendications portent sur un aspect spécifique de l’exploitation, sans mentionner une critique plus large du système de la domination dans sa totalité. Certaines luttes spécifiques peuvent possiblement mettre ensemble des anarchistes/libertaires ainsi que des personnes de tendance opposée, si la façon dont cette lutte spécifique s’insère dans une lutte plus large pour la libération totale n’est pas claire. On se rappellera du cas des deux fascistes arrêtés en janvier 2013 pour quatre attaques incendiaires qui avaient été menés par l’ALF [5], contre l’industrie de la viande et des produits laitiers, des attaques revendiquées avec des textes très courts et généraux, focalisés uniquement sur l’aspect spécifique de l’exploitation animale.
Est-ce que cela a du sens de dire que seule l’action en soi compte, au-delà des motivations et de l’élan qui arment les mains de celui/celle qui l’a réalisée ? Cela signifierait tomber dans un fétichisme des moyens, le fétichisme de l’action violente en elle-même, le fétichisme de la bombe. Un des présupposés fondamentaux de l’anarchisme est justement le lien entre moyens et finalités ; si on parle donc de propagande par le fait ces deux aspects devraient être manifestes tous les deux, puisque la simple reproductibilité du moyen utilisé n’est pas suffisante pour une avancée qualitative de la lutte contre le système.
Quand les Weather Underground frappaient des objectifs politiques et militaires des États-Unis, ils avaient l’habitude d’expliquer très bien leurs actions, puisque leur but n’était pas seulement de se venger du gouvernement étasunien en réponse aux massacres au Vietnam, mais aussi d’encourager d’autres personnes à agir contre la guerre et l’impérialisme, « porter la guerre chez nous » dans un sens plus large. Du coup, les motivations politiques et les objectifs qui étaient choisis se voulaient d’être expliqués très clairement. Celles/ceux qui le partageaient en était inspiré.e.s et étaient encouragé.e.s à agir à leur tour.
Est-ce qu’aujourd’hui, dans un contexte médiatique hystérique qui crie au terrorisme islamique, le même effet serait produit par une explosion qui aurait lieu devant un bâtiment d’État, dans une capitale européenne, même si cela était réalisé par des anarchistes, mais non revendiqué ? Le fait de souligner le sens de ses actions peut être une stimulation à l’attaque pour d’autres compagnon.ne.s ou complices encore inconnu.e.s. Si une action est accomplie aussi avec le souhait qu’elle serve d’inspiration pour autrui, alors le fait de rendre ses motivations claires est d’importance fondamentale, tout comme le fait de diffuser les nouvelles à propos d’actions qui ont eu lieu et les mots qui éventuellement les accompagnent.
On parle ici, évidemment, d’actions qui sont extérieures à un contexte plus large de conflictualité sociale. La question de l’ambiguïté d’une action anonyme ne se pose pas dans les cas où une campagne d’actions ou de protestations contre cette cible est déjà en cours, quand il y a une lutte locale ou bien quand l’action s’insère dans le sillon d’autres actes similaires qui ont déjà été précédemment expliqués. Les exemples de cela sont innombrables, même si on regarde seulement à l’Italie ; des centaines de pylônes d’ENEL [6] abattus dans les années 1980, pendant la lutte contre le nucléaire, aux champs de OGM détruits, aux nombreux sabotages contre des lignes de train à haute vitesse qui ont eu lieu partout en parallèle avec une phase de la lutte No TAV en Val Susa. Dans ces cas on peut indubitablement parler d’actions relativement simples, reproductibles en tout lieu et dont le sens est clair, au-delà du fait qu’elles soient revendiquées ou pas (même si le problème du caractère spécifique de ces luttes persiste, du coup même une action qui vise des tels objectifs spécifiques pourrait être réalisée par des individus aux idées même très éloignées des celles anarchistes).
L’autre présupposé de l’insurrectionnalisme « classique » est que les actions, pour être reproductibles, doivent être, en plus qu’anonymes, aussi simples à réaliser et doivent frapper des tentacules périphériques du pouvoir. Des petites actions diffusées partout auraient donc plus de valeur que des actions plus complexes et plus ciblées, qu’on considère nécessiter une plus grande spécialisation.
Je ne trouve pas bon de fixer des paramètres qui mesurent l’intensité des moyens du conflit, tout en choisissant, en plus, de viser au rabais. Je ne trouve pas bon non plus de poser une hiérarchie entre des actions reproductibles et des actions non reproductibles, comme si cela était le seul critère qui compte et comme si des différentes modalités d’attaque ne pouvaient pas coexister. Bienvenue à la variété des formes d’action, à la multiplication et des attaques aux réseaux de la domination qui sont éparpillés partout, sont moins surveillés et donc plus faciles à atteindre (des attaques qui prennent plus de valeur justement si elles sont nombreuses et permanentes), et des attaques contre des centres importants du pouvoir, qui nécessitent parfois une préparation soignée et des moyens appropriés. Le souhait est que celles/ceux qui possèdent les capacités techniques et les moyens pour des actions plus destructives et plus complexes les utilisent au maximum de leur potentialité, plutôt que de baisser le niveau de leurs actions pour que celles-ci soient mieux « reproductibles » par autrui. Certaines actions bien ciblées et pas forcément simples à mener ne sont pas reproductibles, mais cela n’enlève rien à leur importance. La question de la reproductibilité ne peut pas contenir tout le spectre de l’action anarchiste.
Pour compliquer tout cela, la réalité participe à démonter la conviction que seul des actions simples et anonymes puissent être reproduites. Il arrive parfois que le conflit explose là où on ne l’attendait pas, tandis que des nombreuses tentatives de l’accélérer de manière volontaire échouent complètement. C’est presque impossible de tirer des règles ou des schémas fixes à ce propos. Le fait que des actions puissent tomber dans le vide ou bien être reproduites de façon virale dépend d’une infinité de facteurs qui ne touchent pas seulement au choix de la cible ou des moyens employés.
Il y a un exemple à ce propos, venant d’Italie, qui dément toute théorie préconçue, si on veut parler de consensus social et de reproductibilité. L’action qui, ces dernières années, a produit le plus de consensus social et qui a déclenché une série d’attaques aux modalités les plus disparates contre la même cible a été un colis piégé, signé par la FAI, qui a mutilé le directeur général d’Equitalia [7]. Les actions directes qui, suite à celle-ci, ont fait tâche d’huile partout en Italie n’ont pas été réalisées seulement par des anarchistes, mais aussi par des gens normaux, qui partageaient la haine à l’encontre de cette agence de l’État qui était en train de briser leurs vies. Pourtant, l’action initiale, qui en a déclenché une série d’autres, n’était ni anonyme ni facilement reproductible d’un point de vue technique. Dans ce cas, le choix avisé de la cible a été le facteur déterminant en vue de la reproductibilité de l’action, tandis que le haut niveau destructif et la spécialisation du moyen employé, au lieu de décourager à cause de leur difficile reproductibilité, ont participé à chauffer les esprits.
On a aussi les exemples des incendies de voitures, qui se sont diffusés dans des nombreuses villes d’Europe jusqu’à devenir difficilement maîtrisables de la part des autorités étatiques, qui ne savaient pas où donner de la tête pour en trouver les responsables. Des actions anonymes, que n’importe qui peut avoir mené, pour les raisons les plus disparates.
Cependant, même des actions revendiquées et signées avec un sigle précis ont eu une diffusion importante – souvent à un niveau international, plutôt que local – devenant une inspiration pour des très nombreuses personnes. C’est le cas des actions signées par l’ELF ou l’ALF, qui, depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, ont participé à diffuser largement la pratique de l’action directe, en démontrant que pour réaliser des attaques conséquentes il n’y avait pas forcément besoin d’une grande spécialisation ou de gros moyens.
On peut tirer une suggestion intéressante de l’expérience de ces groupes, qui avaient une autre opinion à propos de la façon d’encourager la reproductibilité des actions, par rapport à la proposition de l’anonymat. L’ALF et l’ELF ont participé à la transmission de leurs expériences avec la publication et la distribution des plusieurs brochures, manuels, comptes-rendus et articles sur les manières de former des groupes d’affinité, de réaliser des sabotages et des libérations d’animaux, avec des recettes pour construire des engins incendiaires simples et des conseils pour maintenir la sécurité du groupe et faire face à une éventuelle répression.
La distribution anonyme de tels écrits, en plus d’explications techniques sur le fonctionnement des structures de l’ennemi (par exemple les flux de transports, de données et d’énergie) et sur la façon de les saboter pourrait être une idée différente dans le but d’alimenter la reproductibilité des actions et élargir les possibilités d’attaquer, pour tout un tas d’individus désirant se mettre en jeux, mais exclus de certaines connaissances.
En général, je pense que la prolifération d’attaques contre les symboles du pouvoir ne peut qu’être salutaire, cela sans hiérarchies de modalités ou de moyens, mais à travers une multiplicité de formes d’attaque. Si la reproductibilité de ces actions est l’un des objectifs qu’on veut atteindre, au-delà du dégât immédiatement provoqué, à mon avis la seule pierre de touche devrait être la clarté des motivations qui nous poussent à attaquer une cible donnée. De façon à ce que la perspective dans laquelle se situent les différentes formes d’attaque, leurs raisons et finalités soient claires, visant une croissance de type qualitatif.
L’autisme des insurgés
Alfredo Cospito, dans Fenrir, publication anarchiste écologiste, n° 9 / juin 2018
Ces derniers temps, les anarchistes d’action ont mis au centre de leur pratique l’individu et son groupe, en laissant de fait de côté les assemblées pour se parler directement avec des revendications d’actions. Le concept même de « revendication » a subi une transformation radicale ; d’un instrument « ouvert vers l’extérieur » c’est devenu un instrument « renfermé sur soi-même », qui s’adresse en première instance à ses semblables, à sa propre communauté en guerre. Même si cela peut paraître paradoxal, dans ce « repli » il y a la mort de la politique ; la recherche du pouvoir et du consensus s’arrête là. On ne cherche pas de disciples, on ne veut pas opposer un « contre-pouvoir » à l’État. Dans cette perspective, la dichotomie que certain.e.s compagnon.ne.s font entre « action anonyme » et « revendication » se révèle être creuse, un faux problème. L’action anonyme et la revendication (signée avec des acronymes ou pas), si elles sont vues comme des pratiques opposées, deviennent toutes les deux, même si elle peuvent paraître lointaines, des symptômes d’une sorte d’« autisme » anarchiste. Si elles sont vécues de manière exclusive et dogmatique, elles sont simplement les deux faces de la même médaille, la médaille de la politique et de l’idéologie ; on n’y trouve pas une communauté en guerre, mais de l’endoctrinement et du prosélytisme. Il ne faudrait pas avoir d’idées préconçues à propos des différentes pratiques anarchistes (surtout lorsqu’on parle d’actions armées) : ceux/celles qui font des revendications avec un acronyme dans un certain contexte peuvent ne pas le faire dans un autre cas, parfois les actions parlent toutes seules, je n’y vois aucune contradiction.
Quelque chose a changé, nombreux sont les exemples concrets d’une vision moins dogmatique, plus dynamique, parfois plus éclatante, de l’insurrectionnalisme. Non pas un produit dérivé de celui-ci, mais une sorte d’« évolution » qui semble ne pas s’arrêter face aux condamnations, à l’isolement, aux excommunications. Un insurrectionnalisme certes plus désordonné, mais avec la grande qualité de ne pas s’appuyer sur des formules prémâchées, puisqu’il est absolument chaotique. Il produit peu de papier, peu de théorie, celles/ceux qui parlent le font en total anonymat à travers des revendications d’actions ; en dehors de l’anonymat il y a seulement ceux et celles qui, prisonnier.e.s, revendiquent avec fierté leur parcours. On parle d’une vision de la pratique anarchiste qui est plus dangereuse, puisque en continuelle expérimentation ; le pouvoir le perçoit et frappe là où ça fait mal. Voilà la raison des nombreuses représailles un peu partout dans le monde : Italie, Grèce, Chili, Argentine, Brésil, Espagne… On ne peut pas nier que, ces dernières années, la répression contre le mouvement anarchiste s’est intensifiée. Les différents États parlent de conspirations anarchistes internationales ; pour ce que cela peut vouloir dire, en Italie les services secrets continuent de désigner les anarchistes de la FAI/FRI comme le premier danger subversif interne au pays. Je crois qu’à ce niveau-là le moment est venu de se poser quelques questions. Est-ce que cette « nouvelle » anarchie dérange vraiment le pouvoir ? Et si c’est le cas, quel est l’aspect qui le dérange à un tel point qu’il effectue de si nombreuses représailles, lesquelles, à mon avis, sortent de la gestion normale de la répression dans ces pays ? En somme, à quoi est due toute cette attention ?
Parmi toutes les pratiques anarchistes, celle de l’action destructive est celle qui, dans l’immédiat, préoccupe le plus les gouvernements. Si cette pratique se diffuse à travers un « langage commun » (la communication à travers les revendications d’attaques) et tend à concentrer ses forces sur des cibles communes, concrètes, immédiates, alors l’attention du pouvoir, évidemment, augmente. Si cette discussion à travers les revendications d’attaques se diffuse au-delà des frontières, l’alarme retentit encore plus fort et le pouvoir se déchaîne avec des représailles à la chaîne. Ce « langage commun » a été testé par la Fédération Anarchiste Informelle en Italie et par la Conspiration des Cellules de Feu en Grèce, puis, avec la FAI-Front Révolutionnaire International, il a définitivement pris son envol à travers le monde, évoluant en quelque chose de plus « essentiel », de plus dynamique, qui ne tourne plus exclusivement autour d’un acronyme.
Ce qui a constitué ce « langage commun » ça n’a jamais été un acronyme (peu importe lequel), mais bien l’arme efficace des « campagnes internationales », lancées non pas par des comités, des organisations, des assemblées, mais par des actions, par des anarchistes de praxis, sans aucun intermédiaire. On l’a vu aussi ces derniers temps, avec les nombreuses actions qui se sont répondues après le G20, en Allemagne, France, Grèce… dans les actions de vengeance pour l’assassinat de Santiago Maldonado, au Chili, Argentine, Brésil, Italie, France, Allemagne ; en solidarité avec le prisonnier anarchiste en grève de la faim Konstantinos Giagtsoglou en Grèce ; en solidarité avec la compagnonne anarchiste Lisa, accusée d’une expropriation, en France, Allemagne… dans les attaques contre la Turquie en solidarité avec le peuple kurde qui lutte pour sa survie, ainsi que dans la continuation des actions signées FAI/FRI en Italie, Grèce, Espagne, Chili, Allemagne…
Voilà à mon avis la pratique anarchiste qui aujourd’hui dérange le plus le pouvoir. A quel point ? Nous ne pouvons pas le savoir, mais ces campagnes internationales créent sûrement quelque problème, même seulement en perspective. Ce qui est beau dans une pratique qui marche c’est que c’est contagieux, la répression ne peut rien y faire, ou peu, surtout quand l’anonymat enveloppe cette toile impalpable d’actions, tissées par des mains inconnues les unes aux autres.
Comme cela arrive toujours face à quelque chose de nouveau, ce n’est pas seulement l’adversaire qui est dérangé, mais aussi ceux et celles qui s’appuient sur la « tradition », sur la « pureté » idéologique des « livres sacrés ». Ça nous arrive aussi à nous les anarchistes de crier à l’hérésie. Des compagnons et des compagnonnes qui, par le passé, ont agi côte à côte rabaissent les hérétiques et les traitent d’imbéciles qui n’ont rien compris à la Parole, du « projet originel » de l’« authentique » projet insurrectionnel. Mais est-ce que cette opposition a un sens ? Et si on reconnaît une unité stratégique et méthodologique aux deux « tendances » informelles, quelles sont les différences entre la « vieille » et la « nouvelle » ? De telles différences paraissent exister, du moins aux yeux du pouvoir. Tant pour donner un exemple, dans le procès « Scripta manent », les textes des insurrectionnalistes « classiques » sont utilisés comme exemples d’un « anarchisme gentil », qui est mis en opposition avec celui des inculpés, défini comme « méchant ». Toujours le jeu bien connu des gentils et des méchants. Beaucoup d’eau est passée sous les ponts depuis que, lors du procès « Marini », le rôle, nécessaire au pouvoir, des « gentils », était attribué aux anarchistes de la Fédération Anarchiste Italienne. Ne vous méprenez pas : je reste de l’avis que, peu importe ce que peuvent dire juges, procureurs et autres ordures, les anarchistes sont tou.te.s indigestes pour le pouvoir, tout pouvoir. Je maintiens qu’il s’agit simplement d’instrumentalisations, mais qui nous disent bien quelque chose de ce que la répression essaye de faire, qui ne nous révèlent pas seulement la vraie essence du pouvoir, mais aussi et surtout, ce qu’il craint à un moment donné, tel une boussole qui nous indique la pratique la plus efficace, car plus crainte.
Il faut remarquer que la répression ne se limite pas à viser celles et ceux qui frappent concrètement, mais aussi ceux et celles qui, avec les mots et les idées, proposent une stratégie d’attaque différente, plus simple, plus dynamique et impalpable. Il suffit d’assister à quelques séances du « cirque tragique » qui se tient en ce moment à Turin [8] pour s’en rendre compte. Il est stupide de rédiger des classements, il est sage de se poser des questions.
Mais laissons maintenant de côté le point de vue de la répression et essayons de répondre à la question qui concerne les différences entre la « vieille » et la « nouvelle ».
La « coordination » est la première différence qui saute aux yeux, entre l’insurrectionnalisme « inclusif », « social », et ceux et celles qui, comme la FAI/FRI, se relationnent exclusivement à travers l’action, menant des campagnes d’attaque. Dans la stratégie insurrectionnaliste liée à une lutte intermédiaire dans un territoire restreint (par exemple la Val de Suse), la coordination est indispensable afin de garantir cette durée dans le temps qui permet de s’adapter aux mutations continuelles de la lutte « populaire ». De plus, cette coordination doit opérer « en sous-main », puisqu’elle doit « pousser » sans dévoiler ses objectifs insurrectionnels : le « mouvement réel » (les gens) ne comprendrait pas une perspective d’affrontement sans médiations, qu’il verrait comme un suicide. Les « pions », dans cette stratégie, peuvent avoir plein de noms : « ligues autogérées », « comités de base », « assemblées populaires »… Ils doivent être déplacés avec sagesse et prudence, comme dans une partie de Dames. Un « jeu » de stratégie qui risque de dériver dans la « politique » et dans la « médiation », mais qui, en cas de victoire, mènerait à une insurrection, bien que limitée à de petits territoires. La coordination partage un danger avec l’organisation spécifique : celui de produire une élite de professionnels de l’insurrection, qui, grâce à leurs capacité et volonté, décident et contrôlent tout (ou presque). Ce danger n’existe pas parmi les groupes, individus, organisations informelles qui participent à la soi-disant « nouvelle anarchie ». Dans cette « internationale anarchiste » il n’y a aucune « coordination » entre les groupes qui la composent… on se limite à concentrer ses forces sur des cibles semblables, avec les campagnes internationales lancées par des revendications d’attaques. On ne se donne pas d’échéances ou de structure commune, même minimale, en dehors de chaque groupe… L’archipel de la FAI/FRI est une des composantes de cette « internationale » et elle est à son tour également « déstructurée ».
Une autre différence évidente est la « revendication ». Les insurrectionnalistes (vieille école) en ont horreur, comme elles/ils ont horreur des sigles et des acronymes, car à leur avis cela sert seulement à affirmer sa propre existence, entraînant dans un mécanisme stérile d’auto-représentation et réduisant les « opprimés », les « exclus » au rôle de simples spectateurs. Ce discours pourrait aussi avoir un certain sens, si ce n’est que, dans notre cas, la « revendication » est un moyen de communiquer entre nous. Une critique de ce type est donc pour moi hors sujet, étant donné qu’on parle ici d’une communication interne au « mouvement », destinée donc aux forces qui sont déjà présentes, à des anarchistes et des rebelles conscients qui pratiquent déjà l’action destructrice. Cette sorte d’« internationale anarchiste » ne peut pas avoir l’objectif de « faire des disciples », et encore moins d’amener les opprimé.e.s à l’anarchie, comme s’ils/elles étaient des moutons à la recherche d’un berger. Nous sommes nous-mêmes des opprimé.e.s et nous utilisons les revendications d’actions pour nous simplifier la tâche et éviter des structures complexes et des coordinations tortueuses, qui pourraient étouffer notre action, nous ralentir. Cette façon de communiquer nous permet une plus grande efficacité ; après s’il y en a qui se limitent à frapper des mains, tant pis, au fond c’est leur problème et cela ne nous regarde pas.
En ce qui concerne les acronymes et les sigles, ils ne sont pas indispensables, mais quand ils sont là (par exemple FAI, CCF…), ils servent « seulement » a donner de la continuité à un discours, comme une manière de « relier » tout en restant séparés.
Les deux extraits suivants, tirés de deux revendications, une en italien et une en allemand, sont l’exemple concret de ce dialogue continuel, à travers des actions, qui dépassent les frontières des États et « relie » sans organiser. A mon avis un exemple réel, vivant, palpitant, d’une des nombreuses formes que l’« organisation informelle » peut se donner, maintenant et tout de suite.
– Rome. La Cellule Santiago Maldonado de la FAI/FRI revendique l’attaque à l’explosif contre une caserne des Carabinieri (7/12/2017) :
« […] Chaque individu et chaque groupe d’affinité développe et renforce ses expériences dans le lien fraternel. […] L’organisation anarchiste informelle est l’instrument que nous avons trouvé le plus approprié en ce moment, pour cette action spécifique, parce qu’elle nous permet de faire aller ensemble notre irréductible individualité, le dialogue avec d’autres rebelles à travers la revendication, et pour finir la propagande faite par l’écho de l’explosion. Cela n’est pas et ne veut pas être un instrument absolu ni définitif. Un groupe d’action naît et se développe sur la connaissance, sur la confiance. Mais d’autres groupes et individus peuvent partager, même de façon simplement temporaire, une projectualité, un débat, sans se connaître personnellement. On communique directement à travers l’action. […] Avec cette action nous lançons une campagne internationale d’attaque contre les hommes, les structures et les moyens de la répression. Chacun.e avec l’instrument qu’il/elle considère le plus approprié et, s’il/elle le désire, en participant au débat. […] »
– Berlin. La Cellule Minorité violente de la FAI revendique l’incendie de véhicules d’entreprises de sécurité privée (6/03/2018) :
« […] L’incendie de véhicules de sécurité privée à Berlin comme outil utile de communication. En citant d’autres communiqués de revendication, nous rejoignons la proposition de se mettre en relation les un.e.s aux autres, afin de développer une mobilisation plus large des groupes combatifs en Europe, ainsi que de développer notre base théorique.
Nous reconnaissons vos mots à propos de la solidarité et nous les partageons, quand le groupe Rouvikonas a écrit au sujet de l’attaque de l’ambassade de l’Arabie Saoudite à Athènes, le 19 décembre 2017 […]. Des personnes à Rome ont exprimé nos pensées quand ils ont revendiqué, en tant que cellule Santiago Maldonado de la FAI/FRI, l’attaque explosive contre une caserne des Carabinieri dans le quartier de San Giovanni […]. Parfois il est nécessaire de définir le cadre dans lequel nous agissons, comme l’ont fait des anarchistes à Bar-le-Duc, quand ils ont dépensé beaucoup de rage et quelques flammes dans un parking d’Enedis […]. Même quand nous sommes peu nombreu-x-ses, nous pouvons nous organiser, au lieu d’attendre qu’une opportunité nous soit offerte par les soit-disant « organisateurs du mouvement », ou au lieu de simplement réagir à l’énième attaque des autorités. Nous pouvons agir et choisir nos moments nous-mêmes. […] ».
Pour en finir avec les citations, un autre son de cloche : un texte « insurrectionaliste » tiré de « Avis de tempêtes. Bulletin anarchiste pour la guerre sociale », n°1 (15/01/2018) ; le titre de l’article est « Recommencer » : « […] organisation informelle, c’est-à-dire une auto-organisation sans nom, sans délégation, sans représentation. […] Et pour être clairs : les organisations informelles sont elles aussi multiples, en fonction des objectifs. La méthode informelle n’aspire pas à rassembler tous les anarchistes dans une même constellation, mais permet de multiplier les coordinations, les organisations informelles, les groupes affinitaires. Leur rencontre peut arriver sur le terrain d’une proposition concrète, d’une hypothèse ou d’une projectualité précise. C’est là toute la différence entre une organisation informelle, aux contours forcément « flous et souterrains » (c’est-à-dire sans quête de projecteurs vis-à-vis de quiconque), et d’autres types comme les organisations de combat, pour lesquelles l’important est presque toujours d’affirmer leur existence pour espérer peser sur les événements, donner des indications quant aux chemins à suivre, être une force qui rentre dans la balance des équilibres du pouvoir. L’organisation informelle se projette ailleurs : fuyant l’attention des chiens de la domination, elle n’existe que dans les faits qu’elle favorise. Bref, elle n’a pas de nom à défendre ou à affirmer, elle n’a qu’un projet à réaliser. Un projet insurrectionnel. […] ».
Les compagnon.ne.s qui, dans les années 1980-1990 en Italie ont vécu dans leur chair le soi-disant « projet insurrectionnel » devraient avoir bien compris que de jolis mots et des magnifiques théories ne suffisent pas à éviter « l’attention des chiens de la domination ». Le procès « Marini » nous l’a appris, avec ses décennies de prison et de vies brisées. L’absence de revendications et d’acronymes ne suffit pas pour être « flous et souterrains », quand on est « forcément » obligés, pour ne pas rester isolés du contexte « social », de participer à des assemblées où tout le monde tôt ou tard sait tout et où grégarisme, autorité et délégation apparaissent de façon régulière et inexorable. A mon avis, rien n’est plus éloigné de l’anonymat que le « projet insurrectionnel » conçu de manière inclusive, « sociale ». La volonté de ne pas chercher « de projecteurs vis-à-vis de quiconque » ne suffit pas, quand les luttes sociales auxquelles nous participons nous font devenir acteurs et comparses de phénomènes médiatiques comme le Val de Suse ou, encore plus en arrière dans le temps, Comiso, des « laboratoires » où cette projectualité a été expérimentée dans les faits, du moins ici en Italie. La perspective insurrectionnelle porte en soi des risques de ce type, et on peut y faire face ou pas, c’est une question de caractère et de perspective et peut-être aussi de résultats…
Je ne peux pas oublier les silences pendant les assemblées, quand c’était toujours les mêmes qui parlaient et, de fait, décidaient. C’était la faute de la grande majorité de silencieux, moi y compris. Trop influencé par l’autorité (certainement non recherchée) des compagnon.ne.s avec plus d’expérience, avec plus de connaissance, qui parlent mieux, qui s’expriment mieux, qui font mieux… peut-être…
Aujourd’hui, depuis ma cellule, je ne sais pas ce qu’il reste de cette perspective. Après la déception du Val de Susa, des nombreu.ses.x compagnon.ne.s devraient peut-être réfléchir à la nécessité de mieux calibrer leur action, non pas en visant vers le bas, mais en passant au niveau supérieur et en comprenant que suivre les gens coûte que coûte est contre-productif. La lutte « intermédiaire » risque de nous ramener en arrière plutôt qu’en avant, nous faisant perdre le sens de ce que nous sommes, un peu comme cela est arrivé le siècle dernier avec l’anarcho-syndicalisme. A celles et ceux qui n’étaient pas là pendant ces années-là, on peut raconter plein de contes de fée, mais le plus souvent on finit par se les raconter à nous-mêmes, pour garder en vie des illusions consolatrices ou notre jardin dans le mouvement. Et justement pour ne pas me raconter des contes de fée je dois être clair (surtout avec moi-même) : il n’existe pas de pratique « pure », qui n’implique aucun compromis, aucun risque. La « pureté » n’existe pas, d’autant moins quand il faut se jeter dans une lutte désespérée dans laquelle l’« ennemi » nous entoure de toute part. De même, il n’existe pas une affinité « indestructible », « absolue » (la déception peut toujours être là, au premier coin), ce n’est pas dit qu’elle survive à tous les obstacles que le pouvoir met devant nous. N’ayant pas recours à une organisation informelle, tout se base sur l’amitié, sur la loyauté, sur le respect de sa parole, sur l’affection, sur l’amour et le courage, des choses qu’il serait trompeur de penser comme données, « éternelles ». Bien plus que dans une organisation classique, dans l’informalité il faut toujours être prêt à rester seul.e. Notre destin tient entièrement entre nos mains, il n’y a aucun type de délégation. Le degré d’indépendance, d’autonomie, doit toujours être le maximum. Je pense qu’au fond cela est bien : « ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort » – on espère…
Pour conclure, je pense pouvoir affirmer qu’on a affaire à deux stratégies différentes, les deux basées sur l’informalité, mais qui agissent sur deux plans totalement différents : la première se rapporte au social, au « mouvement réel » et à l’objectif ambitieux de déclencher, sur des temps longs, une insurrection généralisée à partir de conflictualités limitées à un territoire circonscrit. L’autre a pour but, plus « modeste », de faire le plus de dégâts possible, sans attendre, avec les forces concrètes (même si « faibles ») qu’aujourd’hui même les anarchistes ont à leur disposition. Il ne doit pas y avoir d’opposition entre ces deux stratégies, elles peuvent aussi bien coexister, clairement séparées, dans un même moment, un même espace, une même lutte spécifique. Une autre chose que je crois pouvoir maintenir avec certitude est que toute pratique porte en soi des risques : l’organisation informelle « ouverte », qui cherche un rapport avec « le social », risque de nous édulcorer et de nous porter à la médiation de la politique. L’organisation informelle « instrument pour faire la guerre » (comme la FAI/FRI) risque de nous mener au « sectarisme », à une fermeture totale vis-à-vis du reste du monde. Avec le temps, on pourrait oublier qu’il s’agit d’un simple instrument parmi les autres et non pas d’une fin en soi ; on risquerait de se transformer en « supporteurs » d’un acronyme, n’étant plus des simples participants, par moments, d’un « instrument » commun. Pour éviter de tomber dans cette sorte d’« autisme » et répéter ainsi à l’infini les mêmes erreurs, il suffit de ne jamais se contenter des résultats obtenus, d’améliorer continuellement ses armes et surtout de ne pas oublier l’utilité de l’autocritique, puisque personne ne possède la « vérité », si tant est qu’une « vérité » existe.
Ces dernières années, avec cette « internationale » de l’action, de nombreux frères et sœurs ont commencé un nouveau parcours, ouvrant des perspectives impensables jusqu’à hier encore. Ne nous laissons pas submerger par l’« autisme des insurgés », cela serait impardonnable…
Longue vie aux campagnes internationales ! Longue vie à la CCF ! Vive la FAI/FRI ! Vive l’Anarchie !
Paola [9], Anna [10], que la terre vous soit légère…
[1] Note d’Attaque : Animal Liberation Front.
[2] Note d’Attaque : Earth Liberation Front.
[3] Note d’Attaque : Fédération Anarchiste Informelle.
[4] Note d’Attaque : Le texte dont il est question est « Nel nome degli spiritosi santi », sur le site Finimondo. On remarquera que l’hypothèse d’une origine fasciste de ces bombes a été formulée tout de suite, à cause de l’aide que l’église locale donnait aux migrants.
[5] Note d’Attaque : Le 31 décembre 2012, à Montelupo Fiorentino, 8 camions d’une entreprise de produits laitiers sont incendiés (un entrepôt subit aussi des dégâts) ; sur place est laissé le tag « ALF ». Les flics arrêtent trois gars, accusés également d’autres attaques antispécistes dans les deux mois précédents. Les trois, qui passent aux aveux, sont très proches de l’extrême droite locale.
[6] Note d’Attaque : L’EDF italien.
[7] Note d’Attaque : Equitalia était l’agence de perception des impôts et de recouvrement des crédits de l’État italien. Le 9 décembre 2011, son PDG, Marco Cuccagna, est blessé par un colis piégé qui contenait un écrit de revendication signé par une cellule de la Fédération Anarchiste Informelle.
[8] Note d’Attaque : le procès Scripta manent.
[9] Note d’Alfredo Cospito : Paola, compagnonne active dans les luttes animalistes, dans l’écologisme radical et contre toutes les prisons , « même dans l’affirmation d’une éthique qui est en train de se perdre ». Parmi mes regrets, il y a aussi celui de n’avoir jamais croisé ton chemin…
[10] Note d’Alfredo Cospito : Anna Campbell, compagnonne de l’Anarchist Black Cross de Bristol, tuée à Afrin en combattant avec les YPG.
)
Pour contacter les compas de Fenrir :
fenrir@@@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.2 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (5.5 Mo)