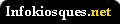M
Même pas sage... même pas mal !
mis en ligne le 27 mars 2009 - Collectif , Les Chemins de nulle part
« On les appelle enfants. Quand enfant devient trop ridicule, on parle des adolescents. La loi dit les mineurs. Des mots pour créer une séparation en fonction de l’âge. Des mots qui masquent et justifient l’oppression. »
À l’heure où la dernière loi sur la prévention de la délinquance mijote au parlement, la jeunesse est de plus en plus prise en étau. Elle est encadrée par des dispositifs sécuritaires, publicitaires, culturels, toujours plus visibles, qui viennent compléter / renforcer les vieux modes de contrôle comme le travail, la famille, l’école – ou s’y substituer parfois. Ces dispositifs sont portés par un même mouvement qui, tout en utilisant la jeunesse comme emblème idéal de la marchandise, présente une partie d’entre elle comme bouc émissaire. Ils servent à faire intégrer dès le berceau ce que la grande majorité a déjà accepté et, parallèlement, à former des citoyens finis infoutus de se révolter. Les mouvements récents, des lycéens contre la loi Fillon, des émeutiers de novembre 2005 et celui contre le CPE et son monde, ont montré que les pouvoirs ne sont pas arrivés à leurs fins.
Les textes rassemblés ici, certains anciens, d’autres récents, tous d’actualité, aimeraient mettre un peu d’air dans une atmosphère empuantie par la propagande.
Témoignage d’une collégienne
Exemple du collège de Poussan, dans l’Hérault, avec dans le rôle des prisonniers, les élèves ; dans le rôle des matons, les pions. Le directeur est joué par le principal. La salle des matons se situe à la
vie scolaire, la cour de promenade est nommée cour de récréation. Pour l’instant il est encore possible de s’en évader, et la principale sanction est l’exclusion et non le mitard.
Le collège est entouré de grilles (il est tout de même possible de les franchir). Les entrées et sorties sont surveillées systématiquement par des caméras de vidéosurveillance et deux pions à
chaque sortie vérifient les carnets de correspondance (il existe trois régimes de sortie). Il est bien sûr interdit de rester devant le collège, et si au bout d’un quart d’heure personne n’est venu cher-
cher les élèves, ils doivent se rendre à l’intérieur et aller à la « vie scolaire », centre de surveillance de l’établissement.
Les fouilles sont pratiquées assez couramment. Le principal et le principal adjoint pénètrent régulièrement en plein cours, sans explication, et exigent de fouiller les cartables et les trousses. Le
règlement spécifie que tous les casiers peuvent être fouillés à tout moment par l’administration. Au collège de La Salle à Montpellier, une journée de fouille a eu lieu afin de vérifier dans tous les agendas s’il n’y avait pas de photos érotiques (voire simplement dénudées) qui sont considérées comme une « incitation à la pornographie » et répréhensibles d’une exclusion.
Au self-service, il est interdit de circuler : une fois assis, plus le droit de se lever... Une fois dans la cour, entre midi et deux heures, les pions effectuent des rondes, ils circulent constamment pour surveiller les faits et gestes de tous les élèves.
Depuis des années, les élèves réclament l’installation de casiers. Ils seront bientôt installés mais le nombre prévu étant insuffisant, un système de liste d’attente va être mis en place.
L’élève-citoyen est bien sûr à l’ordre du jour, la délation est favorisée et si les casiers sont détériorés (tag, vol) et que le coupable n’est pas trouvé, cela entraîne systématiquement la perte du casier et le retour sur la liste d’attente. Si le coupable est trouvé, il subit une double peine : d’une part, il doit réparer (repeindre...) et il est définitivement privé de casier.
Les gendarmes peuvent entrer dans l’établissement pour cueillir un « jeune délinquant » en possession d’une petite boulette de shit.
Les méthodes de contrôles et de surveillance sont de type policier. Lors d’un incident dans la cour de récréation où un groupe d’élèves en menace un autre, les pions prennent les choses en main et incitent à la délation en mettant en avant le droit de se défendre face aux mauvais éléments et de répondre aux violences. Les fauteurs de trouble doivent être punis. Pour cela la victime est sommée, devant un registre contenant les photos de tous les collégiens de l’année, de reconnaître le coupable pour qu’il soit sanctionné.
avril 2002
Le Collectif Alertez les bébés, Dans le ventre de l’ogre, 2005, p. 59-60
On les appelle enfants
Quand enfant devient trop ridicule, on parle des adolescents. La loi dit les mineurs. Des mots pour créer une séparation en fonction de l’âge. Des mots qui masquent et justifient l’oppression.
Des millions de jeunes de zéro à dix-huit ans mènent une vie d’objet. Ils appartiennent à leurs parents, à l’État. Ils obéissent aux profs, aux juges, aux médecins, aux flics. La loi, l’autorité adulte parlent d’eux et pour eux.
Pour fabriquer des adultes soumis, il faut réprimer dès l’enfance la vie, l’autonomie, l’amour, qui agitent les petits d’hommes.
Les enfants sont des prisonniers de guerre. C’est la guerre tous les jours, pour sauver sa peau, survivre un peu, aimer un peu, reprendre un peu de temps à l’ennemi. Ça n’est pas une guerre pour de rire. Des milliers d’enfants sont tués chaque année par leurs parents, des milliers d’autres frappés, internés, contrôlés. Il y a des enfants dans les prisons, il y en a dans les hôpitaux psychiatriques, ils y meurent aussi.
Scolarité obligatoire, amours défendues, correspondance contrôlée, circulation interdite, domicile obligatoire, lectures censurées, idées interdites... Assez pour faire qualifier de totalitaire n’importe quel régime politique. Pour les enfants, les adultes disent : éducation, protection, et même amour ! C’est là que les cartes sont brouillées. Les pires ennemis des enfants sont souvent ceux qui, paraît-il, les aiment le mieux. L’amour « naturel » entre parents et enfants est un mythe qui permet aux adultes d’endormir la méfiance des opprimés. C’est peut- être le plus gros mensonge, ça n’est pas le seul. Les adultes en inventent sans cesse pour maquiller ou justifier leur pouvoir, car les idées sont des armes. Il peut s’avérer plus difficile mais plus important de résister à un mensonge qu’à une claque.
Yves Le Bonniec & Claude Guillon, Ni vieux ni maîtres. Guide à l’usage des 10/18 ans, Alain Moreau, 1983 [1980], p. 9
Le renforcement des technologies de discipline
En 1990, c’est le retour à une perception du/de la mineurE dans sa dangerosité sociale. Il s’agit de surveiller et contenir toute une partie de la population reléguée géographiquement, socialement et économiquement. Ces « classes dangereuses » sont au centre des nouveaux dispositifs de gestion des territoires urbains considérés comme problématiques et donc à canaliser. Naissent, ainsi, en 1993, les premiers Contrats Locaux de Sécurité (CLS), ayant comme objectif de coordonner les actions de la justice, la police, la municipalité et les institutions éducatives après avoir établi un diagnostic de la « délinquance locale ». Puis, sous « l’autorité » des procureurs de la République, sont créés les Groupes Locaux de Traitement de la Délinquance (GLTD). Bras armés des Contrats Locaux de Sécurité, ces groupes affinent le contrôle sur les territoires où, selon eux, le niveau d’insécurité mettrait en péril la cohésion sociale (ou pacification sociale, au choix). Au début des années 2000, les technologies de discipline alliant l’éducatif, le médical (via la psychologie et la psychiatrie) et le carcéral se renforcent avec la création de nouveaux établissements. Les premiers Centres Éducatifs Renforcés (CER) ouvrent en 1998, on en dénombre 57 en 2002 quand sont créés les Centres Éducatifs Fermés (CEF) avec comme objectif : un CEF par département. Toujours en 2002, le ministère de la Justice programme la construction de nouvelles prisons dont 7 EPM (Établissements Pénitentiaires pour Mineurs). Les mineurEs sont depuis longtemps incarcéréEs dans les quartiers qui leur sont « réservés » dans les taules (leur nombre est, d’ailleurs, en constante augmentation). Mais avec ces EPM, c’est la première fois dans toute l’histoire moderne que l’état associe le terme « prison » à la gestion des mineurs et leur enfermement. Cela participe au processus de banalisation des prisons. Ces EPM nous sont « vendus » comme des lieux éducatifs. En réalité, ce sont bien les 3 leviers de normalisation que sont l’éducatif, le médical et le carcéral, qui sont en jeu ici. Quant à l’outil médical et son versant psychologie, on assiste ces derniers temps, à un retour en grâce de courants de la psychologie issus du début du siècle dernier (notamment le comportementalisme) qui identifiaient des caractères innés dans les déviances et la délinquance. Nous présenter la délinquance comme une maladie est effectivement un des objectifs du récent rapport de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médical) sur le trouble des conduites chez l’enfant et l’adolescent. Ce rapport vient valider « scientifiquement » les derniers rapports parlementaires ayant trait à la prise en charge des mineurs et à la prévention de la délinquance (rapport Hermange, rapport Bénisti). Pour l’INSERM, le « terme de trouble des conduites exprime un comportement dans lequel sont transgressées les règles sociales. Ce trouble se situe donc à l’interface et à l’intersection de la psychiatrie, du domaine social et de la justice ». C’est là une tentative de faire passer la transgression des règles établies par le pouvoir comme étant intimement liée à la question de la santé mentale des êtres. Ainsi, toute attitude hors du cadre établi, ne renverrait pas à une remise en cause du système, mais à une inadaptation personnelle relevant du
domaine psychiatrique.
Fugue en si mineur, mars 2006.
http://nantes.indymedia.org/IMG/pdf...
Quand tu sors de là, t’es complètement conne
– C’est pas avec leur manière que ça va changer. Eux, y croivent, y croivent... Là, je suis gentille et tout, mais c’est pas pour leur faire plaisir à eux, c’est pour obtenir ce que je veux moi, tu vois. Y sont fous, y sont fous ! Y veulent faire de moi quelque chose que je serai jamais. En fait, toute ma personnalité elle change à cause d’eux, tu vois. Je suis plus moi-même et j’ai l’impression, même quand je sors sans eux, qu’ils ont réussi ce qu’ils voulaient. Tu sais quoi, j’ai peur, j’ai l’impression d’avoir peur de tout, de la vie. Quand je suis dans un magasin, j’ai toujours l’envie de voler, même si j’ai peur de le faire, j’ai toujours l’envie.
– Donc, en fait, ce qui a changé c’est qu’on t’a foutu la peur ?
– Voilà, voilà le mot exact. Et en plus de la peur, le doute aussi, tu vois, je sais pas t’expliquer... Quand tu sors de là, t’es complètement conne. Si, c’est vrai ! Si tu ressors d’ici en ayant écouté tout ce qu’ils veulent faire de toi, tu ressors conne, saisie. T’es dans la rue, tu marches, t’as peur de tout. J’te jure, ça marche comme ça.
Témoignage d’une jeune fille dans un centre éducatif fermé (Belgique) .
On vous laisse espérer
– Comment tu vois ta sortie d’ici ?
– Ben, je ne la vois pas, ça ne m’inspire plus rien, de toute manière... On dit « l’espoir fait vivre » mais il nuit plus qu’autre chose dans ce cas-ci. On vous laisse espérer, on me laisse espérer 3 mois puis on m’a laissé espérer 6 mois. J’ai fait 9 mois, je n’espère pas. Si je sors dans 3 mois c’est bien, si je sors plus tard, tant pis. Au fond de moi, j’aimerais bien partir plus vite mais s’ils ne veulent pas je m’en fous parce que je sais que c’est pas eux qui vont me faire changer. Ça, ils ne le comprendront jamais.
Témoignage d’un jeune garçon.
Petite scène au tribunal
Le garçon : On exagère un peu trop. J’ai simplement « rien fait ».
Le juge : Vous ne comprenez pas pourquoi on vous embête à partir du moment où vous ne faites rien ?
Le garçon : Mais non ! C’est tout à fait logique. Je serais un autre qui n’aurait pas commis ces délits-là, on me laisserait en paix. Des milliers de personnes ne font rien, on ne leur dit rien, mais quand c’est un petit délinquant, là, on met le doigt dessus, c’est vrai. Faut comprendre, moi, je ne fais rien. Pourquoi je ne fais rien ? Ben, parce que je m’amuse à ne rien faire, je me sens bien en ne faisant rien.
Ces témoignages sont extraits du film de Bénédicte Liénard, La tête au mur, (Belgique, Les films du Tournesol,1997). Adoptant le point de vue de quatre adolescents en centre fermé, ce film montre clairement le fossé entre leur parole et le discours des institutions qui les encadrent.
Des instances répressives nécessaires au maintien de l’ordre établi
Parce que la famille et autres institutions échouent encore parfois à faire intérioriser la discipline et les normes sociales, les instances répressives sont encore nécessaires au maintien de l’ordre établi pour les adultes comme pour les enfants. La psychiatrie et la prison sont de celles-là. À l’expression d’une colère, d’une inadaptation au système dans lequel nous vivons, on répond hospitalisation et enfermement.
En effet, la psychiatrie s’est posée, ces dernières années, comme un pilier répressif. En dix ans, le nombre d’hospitalisations d’office ou à la demande d’un tiers a augmenté de 86 %.Tout écart à la norme relève désormais du domaine de la maladie et ce, dès le plus jeune âge. La psychiatrie joue entre deux types d’enfermement : l’enfermement physique et/ou la camisole chimique, prenant en charge des personnes en réelle difficulté psychique mais aussi qui « simplement » dérangent. La « pilule de l’obéissance », comme la Ritaline, dont les ventes ont explosé ces dernières années en particulier pour faciliter la scolarisation, en est une illustration parfaite. Cela mène ainsi de plus en plus de personnes à perdre le droit et la capacité à décider de leur propre existence. Pour les proches, cela traduit aussi un abaissement du seuil du « supportable » et un manque d’espace communautaire, en capacité de prendre en charge ou de soulager les difficultés de la personne, en dehors des institutions.
La prison, y compris les EPM, est le second pilier de cette répression. De nouveaux délits apparaissent, des délits deviennent des crimes, les peines sont de plus en plus importantes... et il faut construire, construire de nouvelles places de prison, opération qui constitue une « merveilleuse » manne financière. La prison est une instance qui sert à faire peur. Cette institution a aussi et surtout pour but de soumettre de force les corps et les esprits à un degré toujours plus élevé. C’est ce qu’on appelle « donner l’exemple ». Il s’agit de « devenir adulte » – entendons « être adulte » comme « être ayant acquis norme et discipline ».
La composition de la population carcérale ne doit rien au hasard. On ne se soumet pas aisément à un système qui humilie et qui rabaisse, qui ne laisse que très peu de perspectives.
Ces deux formes de réponse, l’enfermement psychiatrique et carcéral, marquent le refus de cette société d’être remise en cause. Elles permettent de ne jamais lire la violence de l’enfant à la lumière de la violence de l’autorité, ni son hyperactivité à celle de son manque d’espace et de dépense d’énergie. Comment aborder la question des déviances sexuelles, sans interroger l’image véhiculée des hommes et des femmes et les frustrations affectives ? Autant de questions que nous avons envie de nous poser et de poser. Réveillons nos colères d’enfant...
Fugue en si mineur, mars 2006 .
[tract publié à l’occasion de l’occupation du chantier de l’EPM de Nantes par un collectif d’opposant-e-s]
Écoles prisons, profs matons !
Il faut aussi relever l’importante recrudescence des méthodes de contrôle et de surveillance recourant aux nouvelles technologies, si bien que l’école n’a jamais autant ressemblé à une prison. Vidéosurveillance et dispositifs biométriques en tout genre tendent en effet à faire du contrôle permanent et du répressif à tout va la norme en matière d’éducation.
À Angers, dans une école primaire et un collège c’est l’empreinte digitale qui donne accès à la cantine, ailleurs comme à Marseille, les élèves introduisent leur main dans une machine qui en reconnaît le contour. Au lycée Jean Rostand de Mantes- la-Jolie, on relève 104 caméras de vidéosurveillance associées à un dispositif de gestion des absences par codes barres et stylos
optiques. Ce genre de dispositifs n’est évidemment pas neutre et formate une génération entière à l’acceptation et à l’intériorisation des méthodes de contrôle social pré-existant en milieu carcéral. Basés sur un discours xénophobe et une diabolisation de l’extérieur, ils éduquent les enfants à la suspicion de l’Autre et à ce qu’ils renoncent définitivement à la découverte des rapports humains... bienvenue dans le monde d’Orwell !
Gardons-nous de nous méprendre, en considérant que ces exemples trop lointains ne sont que des réalités incertaines. Dans le Nord, la faculté de Lille 3 a été dotée l’année dernière d’un système de vidéosurveillance, cette année dans les lycées Montebello et Baggio, c’est à une « pointeuse » que les élèves retardataires auront à faire dans le traitement de leurs retards... Ces mêmes retards étant enregistrés sur un fichier national qui subordonne les futures entrées dans les écoles nationales... Un pas de plus dans la progression des logiques policières à tous les niveaux de la société !
Lille, septembre 2006, zerodeconduite@no-log.org.
L’évasion
385 Les garçons marchent vers le terrain de jeu. Ils sont gardés des deux côtés par un surveillant.
386 Les garçons sont en train de jouer sur le terrain de jeux.
387 Antoine prend le ballon, l’envoie mais un garçon de l’équipe adverse intercepte le ballon et l’envoie à l’arrière du terrain. Tout le monde avec Antoine court après le ballon.
388 Les deux équipes poursuivent le ballon. Un des garçons envoie le ballon hors des limites. Antoine se précipite et récupère le ballon.
Il court vers la ligne « out » et la dépasse.
Il jette un rapide regard autour de lui et soudain s’élance hors du terrain de jeu vers la clôture.
Il se faufile par un trou sous la clôture, jette de nouveau un rapide coup d’œil autour de lui et part.
La caméra retourne au terrain de jeux : sifflets et cris des poursuivants.
L’un des surveillants court après Antoine pendant que l’autre retient les garçons sur le terrain. On suit le premier surveillant au moment où il passe sous la clôture avec beaucoup de difficultés.
Il essaie de rejoindre Antoine.
389 Le surveillant traverse en courant un petit pont.
Antoine s’est caché en bas du petit pont.
Il attend que le surveillant soit de l’autre côté du pont pour sortir de sa cachette et disparaître à travers une haie.
390 Antoine court le long d’une route.
Il dépasse, toujours en courant, des haies, des champs découverts, des clôtures faites avec du fil de fer barbelé, des plaques indicatrices, des vergers, un camion en stationnement...
Fondu.
391 C’est le crépuscule. Antoine descend une colline.
392 Antoine descend une dune en courant, et va vers la mer. C’est la marée basse et la plage est longue et plate. Il est seul. Il atteint l’eau et y entre ; ses chaussures sont couvertes par l’eau et il les regarde. Il tourne et marche dans l’eau le long de la plage. Jetant un regard vers la mer, il revient sur ses pas et va vers la terre ferme. La caméra s’approche d’Antoine et son image s’immobilise.
FIN
François Truffaut, Les 400 coups [1959], Ramsay, 1987, p. 119-120
À l’âge de neuf ans, j’avais foutu le feu à l’école
Je m’étais barré. En haut de la colline, je m’étais assis par terre et je l’avais regardée brûler. Les fenêtres dégorgeaient une fumée noire, le ciel était plein de flammes et d’étincelles. J’entendais déjà les sirènes. Les flics, les pompiers, toute une foule de gens regardaient crouler la baraque. Je m’étais assis par terre et je l’avais regardée brûler, cette putain, en fumant mes Lucky Strike avec un large sourire – je m’étais bien éclaté.
Je suppose que j’étais un sale voyou depuis le début. C’est en regardant crouler cette sale école que j’avais pour la première fois compris combien j’avais de haine en moi, et comme c’était bon de la laisser s’exprimer.
James Carr, Crève, Ivréa, 1994, p. 29-30
Une école des valeurs bourgeoises
En France, l’école dite laïque, dite obligatoire, dite gratuite est mise en place par la bourgeoisie à un moment de reconstitution du mouvement ouvrier, après l’écrasement sanglant de la Commune. La bourgeoisie a le cœur encore soulevé de frayeur d’avoir vu le peuple insurgé auto-organisant les rouages sociaux, économiques et symboliques. [...] La fin du 19e siècle est marquée par la conscience internationale des opprimés, l’avènement du syndicalisme, la poussée vers les Bourses du travail. C’est toute une contre-société qui se met en place, avec ses propres canaux de diffusion, ses journaux, sa propre littérature. [...]
L’institution de l’école des années 1880 relève de cette même volonté de canalisation du peuple dans les voies culturelles de la bourgeoisie. C’est le principal fondement des discours de Jules Ferry argumentant, devant des parterres de sa classe, en faveur de son projet d’école primaire. Il s’agit de casser les espaces d’autonomie prolétarienne pour mieux enchaîner le peuple à la reproduction de l’ordre bourgeois. C’est pourquoi, contrairement à ce que les débats contemporains sur l’école peuvent laisser entendre, l’école de Jules Ferry n’est pas une école des savoirs, mêmes élémentaires, mais une école des valeurs bourgeoises ; ce n’est pas une école de l’instruction, c’est une école
de l’éducation : « Cette éducation n’a pas pour but de faire savoir, mais de faire vouloir », dit l’article « Politique » du Dictionnaire de pédagogie et d’instruction primaire dû à Ferdinand Buisson, un des plus proches collaborateurs de Jules Ferry. Et il ajoute : « L’instituteur est un instrument d’éducation, et même, si on y réfléchit bien, d’éducation politique. »
[...] Mais comment faire ravaler au peuple ses espaces d’autonomie culturelle ? En brisant ses sources linguistiques (les langues locales), en installant l’individu comme valeur sociale de base en lieu et place du collectif et de sa classe d’appartenance. Cette mission est confiée à l’idéologie de l’égalité des chances alors même que le système scolaire est divisé selon l’origine sociale des élèves (le primaire et primaire supérieur pour le peuple, le secondaire – lycées et collèges incluent des classes primaires payantes en leur sein – pour les enfants de la bourgeoisie).
Philippe Geneste, « Ordre scolaire bourgeois contre culture prolétarienne », Marginales n° 2, automne 2003, « Le refus de parvenir. Misère de l’école, utopies éducatives », p. 139-140
L’école n’est pas un monde à part de la société
Elle n’échappe ni aux lois du marché ni aux besoins de l’entreprise. La fonction de l’école, dans une société capitaliste, est de former des travailleurs. Cela n’a jamais changé, même si pendant les années soixante-dix, le taux de chômage extrêmement faible aidant, la fonction économique de l’école a été partiellement remise en cause (tentatives d’expériences pédagogiques échappant à la logique de l’État, Dolto dans chaque foyer, remise en question de la supériorité du travail intellectuel sur le travail manuel, etc.). Cette critique, par son ampleur, a été capable momentanément de ralentir les réformes utilitaristes de l’État en mettant en avant l’autonomie des élèves (foyers gérés collectivement par les lycéens), l’expérience des débats critiques (assemblées générales fréquentes dans les lycées et débats à l’ordre du jour dans les classes). Assez rapidement, l’État, sur la défaite de ce mouvement, a, pour le rendre inoffensif, détourné les idées qu’il contenait ; par exemple, l’autonomie, pourtant indissociable du collectif, s’est transformée en valorisation de l’individu qui réussit non plus avec, mais au détriment des autres.
Même si ces luttes ont pu ralentir la logique de l’État, celui-ci n’a jamais cessé de poursuivre au sein de l’institution scolaire son but initial. Contrairement aux idées largement répandues par l’ensemble de la classe politique, ce n’est pas le « laxisme post-soixante- huitard » qui serait à l’origine de la crise que connaît aujourd’hui l’école, ce sont bien les nouvelles contraintes imposées par le marché qui dictent les orientations du système scolaire : chômage croissant, précarité des emplois et des statuts, développement du travail intérimaire, délocalisation, déqualification. L’école doit gérer aujourd’hui une génération dont l’avenir est de dériver entre RMA, emplois précaires, chômage : adaptabilité, polyvalence. L’école n’a pas comme fonction de dispenser un savoir général qui permettrait à chacun de choisir entre différents emplois stables (le grand mythe de l’éducation démocratique et républicaine) mais d’apprendre à chacun à accepter de se conformer aux nouvelles règles qui définissent le comportement d’un bon citoyen, qu’il soit chômeur, travailleur ou précaire. _ Et comme cette réalité n’est pas facile à imposer, et pour cause, la tendance est plutôt à la répression.
Collectif Alertez les bébés, Dans le ventre de l’ogre, 2005, p. 43-44
Encore en retard
Début des années 90.
Prendre la rue qui descend. Arrivée vers le gymnase, derrière un peu plus loin, le collège. La putain de moi, qu’est-ce que j’en ai marre de faire ce chemin à la con. Tous les soirs, depuis que je suis tout petit. En fait depuis le CP, quoi. Tous les soirs je me dis : « J’ai pas envie d’aller à l’école demain ! » Chaque soir cette phrase. Une pensée pour le devoir que je devais faire et que j’ai pas fait. « On verra ça demain. » Un rituel comme ils disent dans les documentaires animaliers. Trente millions d’amis, mon cul ouais, avec un chien au nom d’Arabe. Tellement que même pendant les vacances, avant de me coucher, je me dis ça. Pour me dire ensuite : « Mais non, demain pas d’école, c’est les kancevas ! » Pour les devoirs y pourront se pogner. Même les deux mois d’été, ça me poursuit. Si je quittais cet asphalte où j’ai l’impression d’être né ; peut-être cette phrase me lâcherait ? Je parle même pas de télétransportation...
Je suis sur le terrain de basket, la sonnerie retentit. On l’entend d’ici. Je suis encore loin de l’entrée du collège. Encore en retard. Et puis merde, rien à foutre.
Boris Lamine, « Juste un gamin qui grandit... »
in C7H16, pas même t’y crois production, 2006, p. 17,
http://c7h16.internetdown.org
On voudrait nous apprendre a marcher en nous coupant les pieds.
Ce monde, c’est de la merde. C’est pas la première ni la dernière fois qu’on le dira.
A bas l’État, le travail, le citoyennisme, le spectacle, l’abrutissement de masse, la vigilisation des espaces et des esprits, l’uniformisation de tout, des comportements, des relations, les enfermements, la généralisation des moyens de contrôle, de surveillance, de répression (etc., etc...). Si on en est là, c’est qu’existe, parmi tant d’autres horreurs étatiques, l’ÉCOLE, l’éducation nationale, l’institution scolaire. L’école, avec la famille, le ciment de notre meilleur des mondes.
[...] Les écoles, matrices à hordes de citoyens névrotiques et dévoués qui, comme ceux d’avant, assureront et défendront avec passion et conviction la survie et la pérennité de (ceux qui ont fait ce qu’il est de) ce monde.
L’école mâche le travail aux keufs, publicitaires et autres crapules cyniques.
L’école fabrique keufs, publicitaires et autres cyniques crapules.
Les valeurs de l’école sont celles de la société haïe : travail, compétition, performance, fierté, ambition, soumission, obéissance, collaboration, délation ... (etc., etc.)
[...] A l’école, on travaille pour que dalle, tout le temps. [...]
L’école apprend la peur. À la matérialiser en soi. Peur de sortir du moule, désobéir. Peur de se faire punir, de décevoir les référents (profs et parents). Peur, une fois intégrée, indélébile, inscrite pour toujours au fond de chacun de nous.
Peur du flic, de voler, de désobéir, de franchir les limites établies.
Peur comme emprise.
Peur puis tout accepter car désarmé, désamorcé.
Craindre et plébisciter ceux qui en sont à l’origine et qui disent en avoir l’antidote.
L’école fabrique en chacun l’illusion de la démocratie en apprenant aux gens à voter, élire des délégués sensés les défendre et les représenter auprès des instances. Soit disant la seule façon de se faire "entendre". La mascarade habituelle, pour mieux te faire intégrer docilement ta condition pourrave : tu sais rien, tu n’es rien, rien qu’un élément d’une cargaison de gosses du même âge. "Et t’as de la chance de n’être rien, t’as de la chance d’aller à l’école".
L’arbitraire comme principe.
La résistance un composant électronique. [...]
Tu trouves normal de répondre à l’appel en début de chaque cours, d’être constamment surveillé-e, de ne pas être sensé-e circuler à tel endroit à tel moment, d’avoir obligatoirement sur toi ce carnet de liaison.
Tu te retrouves à faire la liaison entre deux pôles d’autorité, l’administration scolaire et la famille.
T’es contraint-e d’informer ta famille des conneries que t’as pu faire la veille et des sanctions dont t’as hérité.
On te met dans la situation de t’autodénoncer...
Anonyme, juin 2005,
http://www.infokiosques.net/spip.ph...
On a voulu nous rendre cons... ... c’est raté
Nous avons commencé à débrayer quand le bruit du mouvement étudiant est parvenu jusqu’à nous. Tout d’abord nous n’avons pas bien saisi. Contre quoi se battaient les étudiants ? Nous ne le savions pas. Mais ils se battaient contre... quelque chose et ça nous plaisait bien.
Nous sommes descendus dans la rue pour rompre la monotonie de l’école et parce que nous aussi nous étions violemment contre... quelque chose ! Mais quoi ? Ça, ça restait à préciser.
Quand nous sommes descendus dans la rue, nous y avons amené tout ce que nous aimions dans notre bahut, nos amis, nos copains, la rigolade, la joie et l’amitié. Nous nous sommes parlé comme jamais nous ne nous étions parlé, et ça nous a vachement plu. Le lycée, ça n’était donc pas les murs, ça n’était pas le programme ? C’ÉTAIT NOUS ! TOUS ENSEMBLE !
En parlant, en courant, en réfléchissant, en discutant vite, très vite, nous avons compris beaucoup de choses.
Les étudiants se battent contre la loi Devaquet qui aggrave la sélection à l’université où nous n’irons jamais ! Mais la sélection on connaît ! On a déjà donné, très tôt, des gens « intelligents » nous ont orientés vers des filiales courtes, les LEP. En nous faisant bien sentir qu’on était incapables de faire autre chose et qu’après l’école ce serait (si nous trouvions du travail) encore pire. Il paraît que nous, c’est la loi Monory qui nous « concerne » et qu’elle aussi elle sera pire.
Pire que quoi ? Comment ? On voit pas très bien !
De toute façon, cette loi, on n’a pas besoin de la connaître pour la refuser ! Car nous ne voulons plus ce qu’on a qui est misérable, et c’est pas pour en demander plus, ni moins. Plus de quoi, moins de quoi ! Qu’est-ce que ça change ? Être plus rentable pour ceux qui nous ferons trimer ? Merci bien !
ÇA NOUS INTÉRESSE PAS. TROUVEZ AUTRE CHOSE !
Nos professeurs nous entretenaient (sans conviction) dans l’illusion que nos diplômes, à condition que nous soyons travailleurs, ponctuels, attentifs, consciencieux, nous donneraient une place, oh ! pas merveilleuse, mais enfin une place tout de même : que nos études conditionneraient notre place dans le monde du travail. Il nous semble plutôt que c’est notre travail futur qui conditionne (déjà) nos études.
ÇA PROMET !
Nous, on pensait s’en tirer autrement, par la musique, les voyages, le théâtre, l’amitié, tout ça... qu’on se débrouillerait, sans trop savoir comment, pour y échapper, en attendant on se taisait pour pas les vexer, les contrarier..., mais aussi parce qu’on voyait bien, au fond, qu’on était coincés, seuls, isolés.
Maintenant on sait : ça n’était pas un problème personnel, individuel.
C’est notre problème à tous !
En refusant passivement hier, activement aujourd’hui, l’école, c’est le travail et la vie de con qu’on nous a gentiment préparée que nous refusons ! Nous discutons, nous réfléchissons, nous rigolons bien, MAIS NOUS SOMMES TRÈS SÉRIEUX !
Vous avez failli nous avoir, c’est raté !
On a entrevu autre chose. On va foncer. Ça va chier !
un tract des lascars du LEP électronique, 1986.
C’est pendant le cours de français du mardi après-midi que les choses ont commencé à tourner mal
Des cours de français pour des apprentis mécaniciens, ça peut sembler bizarre, mais c’est la loi qui l’exige, vu que des fois, dans la vie, on est obligé de savoir la langue afin de répondre à des questionnaires, faire des demandes ou s’excuser d’un crime. Seulement, pour lire et écrire, il faut rester assis, ça c’est une loi de la nature, et nous, si on s’était échoués dans la mécanique, c’est qu’être assis on en avait vite plein les fesses. On était pas plus bête que les autres mais impossible de domestiquer notre derrière.
Voilà pourquoi on avait du mal à apprendre. Pour monter haut il faut être un as de la posture assise. Nous on préférait remuer. On était des kazapars. [...]
Pour élever nos pensées il aurait fallu des cocotiers avec des filles sur les branches. On rêvait de plages tropicales et de femmes fleuries, certains fumaient des pétards en douce, d’autres sniffaient de la colle à rustines (je ne citerai pas la marque pour ne pas faire de publicité) en regardant par la fenêtre un morceau de mer au bout d’une ruelle sombre, ou une mouette encore humide d’écume, perchée sur une gouttière. C’était le printemps, il paraît. Le ciel était d’un bleu vertigineux, la chair
des filles devait déjà sentir la mer. Et nous, comme des vieux, on attendait que le temps passe.
Tandis que le prof s’agitait comme un possédé pour nous faire apprécier la beauté de la liberté, on ruminait notre vie d’apprentis esclaves, avec le CAP à l’horizon, soi-disant la clef du paradis mais en fait un simple bout de papier avec quoi on aurait du mal à trouver même un job de ramasse-miettes dans un garage de Plan-de-Cuques. Le mieux qu’on pouvait espérer de la vie, si on suivait le mode d’emploi, c’était de devenir de bons consommateurs bien sages et bien gras, des Bidochons certifiés conformes qui regardent la télé pour oublier ce qu’ils voient à la télé. Notre destin c’était de ramer jusqu’au bout de nos forces, ramer, ramer sous les publicités pleines d’autos scintillantes, de pays exotiques et de femmes de luxe. Tristes de désirs inassouvis, on se sentait déjà finis, emballés, étiquetés, condamnés par les statistiques et les calculs des experts en avenir. Entre la vie flamboyante et cousue d’or qui s’affichait partout et notre existence au goût de cambouis, il y avait trop de décalage.
Henri-Frédéric Blanc, Jeu de massacre, Actes Sud, 1991, p. 9-13
La deuxième occupation du rectorat de Paris, 7 avril 2005
Il y a eu une action lycéenne d’occupation du rectorat, elle devait exister en plus du blocage national prévu aujourd’hui. Pour l’instant, on sait que 370 lycées (plus de 1 sur 10) sont bloqués ou occupés en France. Alors, action réussie. On a réussi à entrer ; au début les CRS n’étaient pas encore là quand on est arrivés, on a réussi à déjouer leurs écoutes en pipotant au téléphone sur d’autres objectifs, ce qui veut dire qu’on peut être plus rapides, plus mobiles, plus malins qu’eux. Mais quand ils arrivent, ils sont plus forts que nous. Maintenant il y a 500 lycéens dans le rectorat et autant de CRS qui attendent pour intervenir. Ce qu’on espère, c’est qu’il n’y ait pas d’arrestation au moment de la sortie.
Car en fait, il y a déjà une répression assez forte, avec des inculpations, sans oublier les répressions administratives au sein des lycées. Là ça peut être plus grave car nous savons que c’est une action illégale pour le pouvoir, mais légitime pour nous. On espère juste que la police fera preuve d’un peu de maturité aujourd’hui ; en tout cas on ne partira pas tant que des potes restent bloqués à l’intérieur. D’autant plus qu’on sait qu’il y a d’autres lycéens au rectorat de Créteil, c’est une action bien coordonnée.
Il y a des comités d’action collégiens qui nous ont rejoints aujourd’hui. C’est eux qui vont vraiment subir la réforme Fillon. Les voir entrer dans le mouvement, c’est signe d’une maturité chez les plus jeunes. Ils reprennent les mêmes bases que nous, assemblées générales... Commencer à militer au collège sur ces bases de démocratie directe et de lutte active est très prometteur et réjouissant ; on aime nos petits frères et sœurs.
Tous les CRS sont rentrés dans le rectorat. Nous on était assis, on avait fait des chaînes pour nous protéger. Ils nous ont sortis violemment un par un.
Il y a déjà un poignet cassé, un bras déboîté, une crise de tétanie, des coups de poing et de pied, des doigts tordus.
Le gouvernement ne respecte pas les lois qu’il impose à tout le monde.
Les CRS, c’est comme des Playmobil, 2 bras, 2 jambes, sans pensées et sans paroles, ils foncent, ils ne servent qu’à ça, c’est honteux. Qu’est-ce que c’est que cet État qui nous inculpe d’outrage et rébellion quand on se fait frapper et insulter ?
Ça fait des années qu’on entend que les jeunes sont des branleurs, qu’ils ne savent rien faire, et aujourd’hui, quand on s’intéresse à nos vies, à la politique, là on nous dit qu’on est une minorité. On fait rien, on est critiqués. On fait quelque chose, on est réprimés.
À tous ceux qui veulent fliquer les lycéens, les lycéens répondent : résistance !, L’insomniaque, 2005, p. 17-19
Insoumission à l’école obligatoire
Je ne pense pas, enfant très chérie, jamais avoir utilisé en ce qui te concerne les mots « liberté », « indépendance » ni même « autonomie ». Mais sans doute ai-je rêvé pour nous de largeur et même de largesse où me plaît que murmure le sens d’une munificence. La vie est tellement plus vaste que nous, Marie. Tellement.
Tu as quatorze ans et j’ai pris la responsabilité de ne pas t’avoir mise à l’école. Depuis trois années à peu près, j’estime que mon rôle de tutrice est accompli et je te dois des comptes. [...]
Je n’ai pas voulu de la crèche, ni de la maternelle. Ni de l’école paternelle. D’abord parce que, de fait, en dépit de la loi, elle est quasiment obligatoire. Raison suffisante.
Ensuite parce qu’elle est inutile.
Enfin parce qu’elle est nuisible.
Mon propos n’est pas de le démontrer. Un grand nombre de pédagogues y sont très bien parvenus. Je ne suis pas théoricienne et revendique d’aussi déraisonnables raisons que de nous lever à l’heure que nous voulons, pour ne citer qu’un des multiples exemples qui m’ont si souvent fait traiter de « mère irresponsable ». Je ne répondrai que devant toi de mon insoumission. Non par devoir mais par reconnaissance pour tout ce que tu m’as donné.
Catherine Baker, Insoumission à l’école obligatoire, Barrault, 1985, p. 9 – réédition tahin party, 2006
Pour imposer le « six politique »
Pour imposer le « six politique pour tous parce que l’école est une merde », des commandos casqués et armés ont répandu le chaos dans le système éducatif de l’Italie. Les proviseurs, directeurs, enseignants qui refusaient de donner automatiquement au moins six à toutes les copies furent injuriés, passés à tabac, séquestrés, menacés de mort, parfois leurs voitures furent incendiées et leurs bien détruits. [...]
À la suite d’un ras-le-bol, les enseignants de plusieurs lycées ferment leurs établissements. L’enquête révèle que, depuis des années, leurs élèves font régner la terreur par des moyens
contestataires que voici : poser une bombe devant l’appartement d’un professeur et tirer sa sonnette pour qu’il vienne ouvrir et que la bombe lui éclate au nez ; cogner les enseignants et les menacer de les jeter par la fenêtre ; incendier les copies d’examen.
En janvier 1978, après avoir subi au cours des deux dernières années l’incendie de la salle des professeurs, puis la mise à feu des voitures de certains enseignants, puis deux attentats au plastic, puis le spectacle de leur proviseur giflé à deux reprises et roués de coups de bâton, puis un autodafé fait avec les compositions de mathématiques, puis une tentative d’incendie de l’appartement du vice-proviseur, les soixante pédagogues du lycée scientifique Polo Scarpi de Rome ont enfin rendu leur serviette.
Suzanne Labin (La Violence politique, 1978) citée par Noël Godin, Anthologie de la subversion carabinée, L’Âge d’homme, 1989, p. 267-268
Mesures
Pour estimer à peu près ce qui a été retranché au niveau corporel il n’est que de comparer l’acuité des sens d’un enfant de 3 ans, sa vitalité permanente, l’intensité de ses désirs, son regard, son émerveillement, sa tendresse, sa souplesse de chat et jusqu’à son sommeil avec ceux d’un adulte moyen. C’est comme une lampe qui s’est éteinte. On voit à l’œil nu sur quels points cet adulte réussi modèle conforme, se rendant à son bureau par exemple, a été opéré : il n’utilise qu’une faible
partie de son équipement sensoriel ; sa musculature est plus ou moins atrophiée, sa colonne vertébrale est soudée ou menacée d’effondrement, sa capacité respiratoire est réduite, son système nerveux autonome est bloqué, ses plexus sont noués, son énergie ne circule pas, il est dérythmé, son corps est au point qu’il doit le préparer dans un « club » avant d’aller en vacances (s’il peut lui payer ça) ; sa sexualité est misérable, il est plein de maladies psychosomatiques et de dépressions ainsi que de drogues diverses, son cerveau est un magnétophone, ses récepteurs sont saturés, il n’a pas de regard, il dort mal. Ses émotions négatives le dominent ; quant aux positives : il ne connaît pratiquement plus la JOIE. Ne parlons pas de l’émerveillement ce serait trop triste. Sa faculté de relation est rabattue jusqu’à la rétractation totale : l’Autre lui fait peur ! Et tout ça, qu’il n’a pas, il redoute de le perdre. Les adultes ont fini par croire que c’est « naturel », de dégringoler à ce point-là. Sinon ils se flingueraient. Mais ça ne l’est pas : c’est une mutilation. Accomplie durant les cinq premières années de la vie. Et si profonde qu’ils aspirent encore à la transmettre. Le mort tire le vif.
L’oppression des enfants est première, et fondamentale. Elle est le moule de toutes les autres.
Christiane Rochefort, Les enfants d’abord, Grasset, 1976, p. 40-41
Ce ne sont pas des contes de fées qu’on me racontait pour m’endormir
Mon enfance a été complètement libre, toujours mêlée aux hommes et aux femmes de la route. Il n’y avait guère de poupées et de jouets dans ma vie, mais les émotions ne manquaient pas. Il nous arrivait d’être débarqués sur le ballast au beau milieu d’une zone montagneuse ou au bord d’un ravin. Nous nous lavions et nagions dans les fleuves. C’est en comptant les wagons de marchandises et en lisant les inscriptions qui les ornaient que j’ai appris les chiffres et l’alphabet.
Pendant toute mon enfance, ce ne sont pas des contes de fées qu’on me racontait pour m’endormir, mais des histoires de pirates du rail et de trimardeurs, de boulots dans les champs de blé du Minnesota, de combines pour resquiller. Les longs et palpitants récits de voyages en traîneau
en Alaska, d’arrestations à San Francisco ou de virées d’ivrognes dans les tripots de La Nouvelle-
Orléans me tenaient en haleine et je m’en souviens encore aujourd’hui.
[...] Nos jouets, nous les tirions du bric-à-brac qui encombre un dépôt ferroviaire.
Nous construisions des cabanes avec des traverses si lourdes qu’il fallait être quatre pour les installer. Nous inventions des jeux de piste le long de la voie ferrée. Nous posions des épingles en croix sur les rails des grandes voies afin que les grandes locomotives, en les écrasant, les transforment en ciseaux minuscules. Nous jouions avec les pelles et les pioches des cheminots et apprenions à nous en servir. Et nous ne manquions pas de saluer cérémonieusement les trains des voyageurs qui filaient sur la voie.
Nous les filles, nous étions vêtues exactement comme les garçons, essentiellement de vieilles salopettes que nous héritions de nos aînés. On ne se souciait guère de nous. Les adultes veillaient à ce que nous ayons de quoi manger et un toit, et aussi à ce que nous accomplissions de petites corvées. Mais les hommes ne songeaient jamais à changer de conversation en notre présence.
Ben Reitman, Boxcar Bertha, L’Insomniaque, 1994 [1937], p.11-12
Le secret de la haine discrète que te vouent les grands
La différence, ce qui fait l’adulte, il est si sérieux et il veut toujours te commander, c’est que, dans la vie, lui, il a un rôle à jouer ! Un seul... Alors que toi, t’en as tant que tu veux... Quand tu joues, tu peux être le matin l’infirmière qui prend la fièvre ou le malade à qui on met un bâton dans le cul, et l’après-midi Mesrine qui tue les méchants flics ou le gendarme à qui on vole son képi. Voilà le secret de la haine discrète que te vouent les grands : TU AS UN POUVOIR QUE LES ADULTES N’ONT PAS. C’est pour essayer de t’enlever ce pouvoir, ou plutôt de le rendre tout riquiqui, que les adultes ont inventé des jeux qui te font grésiller la cervelle : tu as dans ton crâne deux cent mille
millions de vies dont tu es le héros, et les jeux vidéos ont tout juste quelques centaines d’aventures possibles, toujours pareilles, avec des bons gros karatékas à battre (alors que tu pourrais aussi jouer à celui qui fait le plus gros caca de karatéka ou t’allier avec les superéros pour maraver le concepteur du jeu). Ce qui les énerve, les adultes, c’est que, avec ton pouvoir, tu peux voyager dans le temps, t’introduire la nuit dans ton école pour recouvrir les murs de jolis dessins et de pertinentes
remarques sur le gros cul de la maîtresse, tu sais être un bon petit enfant bien sage quand y’a du fric à gratter dans le sac de mamie, tu sais te transformer en superman quand tes parents ils croient que tu dors, tu peux même jouer la petite fille à la vanille quand t’es un garçon tête de citron, ou le contraire.
Tandis que les adultes, les pauvres, ils ont une espèce de maladie qui les oblige à choisir d’être toujours la même chose. Ça s’appelle un rôle.
« Apprends à reconnaître le rôle de ta maman et de ton papa », Mordicus n° 10, été 1993, p. 5
L’étoile filante
J’avais douze ans quand les Tsiganes, tard dans le printemps, passèrent par ma ville. Je décidai d’aller voir ces gens merveilleux dont mon père m’avait si souvent parlé. Depuis la veille, ils campaient dans un terrain vague. Demain sans doute ils seraient partis, ne laissant comme trace de leur passage que quelques foyers noirs, des déchets et de l’herbe foulée. Et il ne subsisterait sur eux que rumeurs.
Quittant la route pavée, j’écartai les hautes herbes et pénétrai dans le camp. J’eus tout de suite l’impression de marcher sur un sol étranger mais n’en éprouvai aucune angoisse. Les adultes ne firent pas attention à moi, mais quelques garçons de mon âge vinrent me rejoindre à l’endroit où l’herbe avait été foulée : la ligne séparant deux mondes. [...] Des heures passèrent. L’humidité montait du sol, mais personne ne semblait s’en apercevoir. Quand les Tsiganes allèrent sur leurs grands lits de plumes, il était trop tard pour que je rentre à la maison. J’acceptai avec reconnaissance l’invitation que me fit Nanosh de coucher avec lui et ses nombreux petits frères. Je me glissai tout habillé sous l’un des édredons. Couchés sur le dos, nous regardions le ciel. Je vis une étoile filante et montrai du doigt à Nanosh l’endroit où elle avait disparu. D’une voix étouffée, il me dit de ne jamais faire cela, parce que chaque étoile dans le ciel est un homme sur la terre. Une étoile filante signifie qu’un voleur s’est enfui et il y a beaucoup de chances pour qu’on le rattrape si on la désigne à quelqu’un. « Mon cousin Kore, poursuivit Nanosh, est sorti ce soir avec le fils de Kalia et il n’est pas encore rentré... » Nanosh me tourna le dos et quelques minutes plus tard je l’entendis respirer doucement dans son sommeil. Au loin, un chien aboyait. Je pensais à l’étoile filante et à l’homme qu’elle représentait. C’était la première fois que je couchais en plein air et j’étais trop ému pour dormir.
Jan Yoors, Tsiganes, Phébus, 1990 [1967], p. 33
Devenir adulte, c’est tuer l’enfant
Étymologiquement, l’enfant est celui qui ne parle pas (In-Fans), donc ne prévoit pas, ne peut pas promettre, n’a pas de conscience du temps : par définition, l’enfant est un être antiéconomique. La réalité est très éloignée de la théorie : sur les 3/4 de la planète, les enfants travaillent et produisent très tôt, et dans les pays dits développés les enfants sont une des cibles, actives et passives de la consommation, et en tant que tels, même sans travailler, ils participent de la production.
L’exemple des Indiens Baruyas de Nouvelle-Guinée démontre qu’il peut en être autrement : ils voient dans chaque naissance une participation à la nature et à la communauté, l’enfant n’appartient pas à ses géniteurs et c’est de ne pas être conçu comme une propriété qui le protège des valeurs adultes. On dit que l’enfance devrait être cette période faite de jeux et de découvertes, période de constructions désordonnées, de rencontres, de plaisirs et de sentiments, période de la vie qui pose les fondements d’un être en devenir. L’idée ne devrait pas être de tuer ou de faire disparaître l’enfance, mais bien au contraire de continuer à la faire exister jusqu’à la fin : concevoir toute la vie comme un terrain d’aventures. L’enfance serait alors au moins le moment privilégié du rêve et du carpe diem (« cueille les jours ») où les potentialités physiques et cérébrales sont intenses.
Bien au contraire, l’enfance est dans nos contrées une période d’apprentissage de la rentabilité, de la compétition, de la hiérarchie et de l’ordre. Avec l’entrée dans l’âge adulte c’est le début d’un temps économique où il faut faire des choix imposant des compromis, des calculs nécessitant l’abandon de pans entiers de son enfance. Pour devenir un être responsable, il faut tuer l’enfant en soi. Et à en croire les derniers textes de lois [...], il semblerait que le projet de cette société capitaliste soit de tuer l’enfant dès le plus jeune âge, sinon dans l’œuf.
L’Envolée n° 16, 02/06, dossier « mineurs », http://lejournalenvolee.free.fr
La première fois, j’avais huit ans, je crois...
Il s’appelait Aaron. Je crois que je l’adorais. Tout le monde adorait Aaron...
Au parc. Nous étions au parc. Milieu décembre, un truc comme ça... Seuls dans le bac à sable, rebaptisé bac à neige pour l’occasion. On s’emmerdait sûrement, lui avec son ballon Goldorak, et moi avec mon seau Barbie. Il m’a dit que si je lui montrais ma culotte, il me montrait sa zezette. Des bites, j’en avais déjà vu pas mal, de toutes sortes, je m’en foutais un peu de sa « zezette » !
Mais on s’emmerdait, comme je vous disais... J’ai fait oui avec ma tête, sans rien dire. C’était pas la peine de parler. Y avait rien à dire. Avec les garçons, c’est toujours pareil : ils aiment bien quand t’ouvres la bouche, mais pas si c’est pour parler.
J’ai baissé mes collants en tenant ma jupe sous le menton. Il a soulevé l’élastique de ma culotte pour voir. Le contact de ses doigts gelés sur mon ventre... Je frémis encore quand j’y pense aujourd’hui. De plaisir. Et d’envie aussi.
Il a jeté un coup d’œil très rapide. Ça devait être la première fois qu’il matait une fille, il était tout rouge et sa timidité gênait mon plaisir. Il a relâché mon élastique qui a claqué bruyamment sous mon nombril.
À mon tour. Quand je me suis approchée, il s’est défilé en éclatant d’un rire moqueur. Je me suis avancée vers lui. Il riait, riait. Peut-être que s’il n’y avait pas eu ce rire... Pourtant je l’aimais... je crois. Je l’ai attrapé. Je ne disais rien. Il n’y avait rien à dire. Son rire prenait toute la place.
Je le tenais par les bras, il n’essayait même pas de se dégager. Trop occupé à rire. J’ai ramassé une bûche.
Sandrine Lamoureux, La première fois j’avais huit ans, Intervista, 2004, p.11
Sur les toits
Raymond Callemin grandissait le plus possible dans la rue, pour fuir l’arrière-chambre étouffante où l’on rentrait par l’échoppe de cordonnier où son père, du matin à la nuit tombée, rafistolait les chaussures du quartier. Son père était un brave ivrogne résigné, vieux socialiste, déçu du socialisme. Dès 13 ans, je vécus seul dans des chambres meublées, par suite des voyages et des mésententes de mes parents ; Raymond vint souvent se réfugier chez moi. Ensemble, nous apprîmes à préférer aux romans de Fenimore Cooper la grande Histoire de la Révolution française de Louis Blanc, dont les illustrations nous montraient des rues tout à fait pareilles à celles que nous fréquentions, parcourues par les sans-culottes armés de piques... Notre bonheur était de nous partager deux sous de chocolat en lisant ces récits bouleversants. Ils m’émouvaient surtout parce qu’ils réalisaient dans la légende du passé l’attente des hommes que j’avais connus depuis les premiers éveils de mon intelligence.
Ensemble, nous devions plus tard découvrir l’écrasant Paris de Zola et, voulant revivre le désespoir et la colère de Salvat traqué au Bois de Boulogne, nous errâmes longtemps dans la pluie d’automne à travers le bois de la Cambre.
Les toits du palais de Justice de Bruxelles devinrent notre lieu de prédilection. Nous nous faufilions par de sombres escaliers, nous laissions derrière nous, pleins d’un joyeux mépris, les salles des tribunaux, les poussiéreux dédales vides des étages et nous arrivions au grand air, à la lumière, dans un pays de fer, de zinc et de pierre, géométriquement accidenté, aux pentes dangereuses, d’où l’on apercevait toute la ville et tout le ciel. En bas, sur la place marquetée de minuscules pavés carrés, quelque fiacre de Lilliput amenait un minuscule avocat pénétré de son importance, porteur d’une minuscule serviette bourrée de papiers qui signifiaient des lois et des crimes. Nous éclations d’un grand rire : « ah ! quelle misère, quelle misère, cette existence ! Tu te rends compte, il viendra ici tous les jours de sa vie et jamais, jamais, l’idée de grimper sur les toits pour y respirer largement ne lui viendra. Toutes les “défenses de passer”, il les connaît par cœur, il s’en délecte, elles lui font gagner de l’argent ! »
Victor Serge, Mémoires d’un révolutionnaire. 1901-1941, Seuil, 1978, p.13
Je n’ai pas demandé la vie
Je n’en veux plus. Maintenant j’ai le droit de choisir. Je n’y peux rien si ma mère n’a pas utilisé les contraceptifs. C’est normal que je détruise ce que mon « père » et ma « mère » ont créé. Ils disent l’avoir fait pour moi, alors, pourquoi ne me laissent-ils pas choisir maintenant ? Ils s’en foutent pas mal de ce que je pense, ils veulent garder leur « chose » et puis ils ne voudraient pas avoir à feindre un chagrin qu’ils n’éprouveraient pas. On accusera les circonstances, l’ingratitude des adolescents, l’inconscience propre à cet âge, mais personne ne croira qu’un parent quel qu’il soit puisse ne rien éprouver envers son enfant.
« T’en fais pas, ça passera ! » C’est bien ce qu’ils disent ? Une prise de conscience ça ne cesse jamais. La mienne ne cessera pas, je ne veux pas devenir comme vous, passifs, idiots, butés. Moi aussi, je suis passive, idiote, butée, terriblement butée, mais dans un autre registre que le vôtre. Je n’ai pas peur de vos phrases, je n’ai pas peur de cette mort que vous redoutez tellement ! Regardez-vous trembler devant la menace de cette évidence !
Oui, je sais, vous me méprisez : « Regardez-la, une vraie furie, et dire qu’elle a treize ans seulement ! Je ne voudrais pas avoir une fille comme elle ! Une vraie garce, elle fait souffrir tout le monde et se révolte en plus ! Voilà comment on est récompensé par ses enfants ! »
Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous, Stock / Le livre de poche, 1982, p.19-20
à l’âge de 13 ans, Valérie Valère est hospitalisée pour « anorexie mentale ». Deux ans après, elle écrit ce roman puis Malika, l’histoire d’un frère et d’une sœur livrés à eux-mêmes et enfin Obsession blanche.
Fais attention...
Tu vas tomber Mets pas ça à la bouche c’est sale Ne marche pas dans les flaques d’eau Ne te salis pas tu es tout propre Ne l’touche pas c’est sale, ne l’touche il va tomber, ne l’touche pas ou j’t’attache les mains Ne mets pas les doigts dans ton nez Lave-toi les mains avant de manger Ne mange pas avec les doigts Ne cours pas si vite, tu vas tomber, c’est bien fait le bon dieu t’a puni Tu es plus grand maintenant, tu devrais comprendre Si tu n’es pas sage maman va tomber malade Si tu désobéis je le dis à papa Crie moins fort ton père est fatigué Ne pleure pas maman dort Tu dois toujours dire la vérité Tu me fais beaucoup de peine Tu me causes énormément de chagrin Va au lit maintenant c’est l’heure Dis bonjour, merci à la dame Embrasse ta grand-maman, ton grand-papa Tu aimes ton papa, ta maman, fais plaisir à papa, fais plaisir à maman, tu aimes ta maman, dis que tu l’aimes Tu te comportes comme un bébé Le monsieur va te gronder, qu’est-ce qu’il va dire le monsieur Ne joue pas au ballon, c’est interdit Ne fais pas pipi n’importe où, remonte ton pantalon Tu vois quand tu veux tu peux Tu regrettes, dis que tu regrettes Ne pleure pas c’est bon pour les filles C’est les fous qui pleurent C’est pas pour toi c’est un jeu de garçon Tu te comportes comme un garçon manqué Tu dois toujours obéir aux grandes personnes Si tu fais la méchante je téléphone à la police Si tu n’es pas sage je te mets à la cave Fais ta prière, tu as fait ta prière ? Tu dois toujours respecter tes parents Tu ne dois pas répondre à tes supérieurs Les jeunes doivent obéissance aux vieux Tu dois prendre tes responsabilités La paresse est la mère de tous les vices Il faut savoir réfréner tes désirs Un homme doit dominer ses instincts Une fille doit sauvegarder son honneur On est toujours puni par là où on a joui C’est pour ton bien que je te dis ça Après tout ce qu’on a fait pour toi Qu’est-ce que les voisins doivent penser ? Qu’est-ce que la famille va croire ? Qu’est-ce que les gens vont dire ? Parle moins fort, ne dis jamais ça, parle comme il faut Tu n’arriveras jamais à rien comme ça Tu as de mauvaises fréquentations Ne fais pas ce que tu aimes, aime ce que tu fais Tu ne dois pas désirer ce que tu ne peux obtenir Le paradis n’est pas sur cette terre Contente-toi de ce que tu as !
chanson de Yvette Théraulaz, 1978.
La pulsion de l’infanticide
Quand un langoure prend le contrôle d’un harem après avoir vaincu celui qui en était le maître, son premier souci est de tuer tous les petits du groupe. Il les arrache au ventre de leurs mères, et les déchiquette de ses canines acérées. Voyant cela, les femelles apeurées se retrouvent bien vite fécondes et donc propices à se faire engrosser par leur nouveau et séduisant seigneur et maître. Il leur fait des petits, plein, et peut enfin régner sur un monde équilibré et apaisé.
texte déchiqueté d’un anonyme
Parents : surveillés et surveillants
Les parents, après des années de propagande les désignant comme responsables du comportement de leurs enfants dans la société, sont désormais assujettis par la loi, qui les oblige à être des agents de contrôle social prévenant tout écart de conduite de leurs bambins, faute de quoi ils en deviennent les complices.
Depuis le colloque de Villepinte, en 1997, un large consensus politique entérine l’échec de la prévention pour axer les efforts gouvernementaux sur le tout-sécuritaire et l’idéologie qui l’accompagne : individualisation, psychiatrisation, criminalisation ; ce ne sont plus les choix politiques, économiques qui sont à remettre en question quand l’échec est patent mais l’individu archaïque incapable de s’adapter à la « modernité ». Ce n’est pas son environnement social qu’on interroge mais plutôt son entourage familial, qui est désigné comme l’origine du dysfonctionnement. Par exemple, dans le cas de l’absentéisme de l’enfant, tout un dispositif se referme sur le parent « démissionnaire », aussi infantilisant que culpabilisant. De l’école pour parents, faite pour éduquer, à la suppression ou la mise sous tutelle des allocations, à l’assistance éducative de la famille, tout ceci permet à l’État de s’immiscer dans de nombreux foyers et de déposséder partiellement ou totalement de l’autorité parentale des familles qui sont le plus souvent les plus démunies. L’amende reste une sanction forte, prétendument égalitaire (même si le législateur a omis de la calculer sur la base du quotient familial). Les mesures de suspension d’allocations n’ont pas été retenues par le gouvernement pour pénaliser l’absentéisme, il est réconfortant de constater que seulement dix-sept caisses d’allocations familiales sur cent vingt-trois avaient accepté de collaborer à cette besogne. L’exemple phare anglo-saxon va plus loin. Les parents peuvent devenir de véritables matons chargés de garder leurs enfants assignés à résidence avec ou sans bracelet électronique, de contrôler leurs fréquentations, sous peine d’emprisonnement.
L’absentéisme est décrit en France comme un véritable fléau alors qu’il faut en relativiser l’ampleur. Il devient un délit majeur, désignant les enfants et les parents comme des délinquants qu’il s’agit de redresser. Un dispositif humiliant « propose aux parents désemparés par les événements de suivre un module de soutien qui les aidera à restaurer leur autorité », explique-t-on au ministère de la Famille. Si cet accompagnement créé par le préfet de chaque département ne permet pas de redresser la barre, les psychologues, éducateurs, conseillers conjugaux ou délégués de parents d’élèves pourront visiter les familles jusque dans leur domicile. Si l’absentéisme persiste, l’État aura alors fait le maximum et passera à l’amende (750 euros). Si les parents refusent de se plier aux injonctions, les textes permettent de les poursuivre pour défaut d’éducation et de les condamner à deux ans de prison et à 30 000 euros d’amende. Un enfant est considéré comme absent s’il a manqué la classe sans motifs « légitimes » ni excuses « valables » au moins quatre demi-journées dans le mois. Alors, l’inspecteur d’académie pourra activer le dispositif.
Collectif Alertez les bébés, Dans le ventre de l’ogre, 2005, p. 46-47
La brochure Dans le ventre de l’ogre est le fruit d’un travail de lecture, d’analyse et de synthèse de diverses sources officielles. Il s’en dégage un saisissant tableau de la manière dont les pouvoirs entendent gérer les enfants et les adolescents. alertezlesbébés@yahoo.fr
Exploitation de la condition parentale
Le patriarche dépossédé
Les parents actuels sont encore propriétaires de leurs descendants mineurs, et en particulier responsables de leurs méfaits et casses.
Mais à mesure que le pouvoir est plus centralisé, il tend à prendre le contrôle de tout. C’est dans ce mouvement de mainmise, qui porte pavillon de « Progrès de la Démocratie », que le chef de famille a été progressivement dépouillé de ses droits absolus. Ce « progrès » est un déplacement du pouvoir : mutation au sommet. [...]
Les parents seraient donc plutôt aujourd’hui des sortes de dépositaires provisoires, et des agents techniques, à pouvoirs restreints. Leur tâche peut être définie comme un service d’élevage super-qualifié.
Exploitation
Et non rétribué : les parents ne vendent pas leurs petits comme les autres éleveurs à l’Entreprise de ramassage. Ils les donnent. Rien ne leur revient en fait de l’énergie investie dans les enfants : ceux-ci sont pratiquement dispensés d’entretenir leurs ascendants en retour du service reçu, et souvent n’en ont pas les moyens – car l’Entreprise s’approprie la totalité de leur force de travail pour en tirer la plus-value. De là une ambiguïté tragique pour les parents : les structures mentales ne suivant pas les réalités économiques galopantes, les parents restés dans l’illusion patriarcale, et mesurant les peines endurées, croient que leurs enfants leur doivent quelque chose, et souffrent une intolérable frustration à cause de leur « ingratitude ». Une analyse correcte des dites réalités économiques permettrait seule de désigner la vraie source de tous ces malheurs – que l’on croit privés parce qu’ils sont vécus dans l’isolement, mais qui sont de nature sociale.
[...] Les parents sont les pigeons de l’Entreprise. Leur énergie leur est volée. On se sert d’eux pour rendre les jeunes exploitables et contrôlables.
Après ça on les balance. En société de consommation on jette tout après usage.
Christiane Rochefort, Les enfants d’abord, Grasset, 1976, p. 23-26
« De grands enfants »
Il est intéressant de noter que, chaque fois qu’il sera question de faire violence à un groupe, le qualificatif d’enfant lui sera accolé. Pour le colonisateur, les Noirs ou les Arabes étaient « de grands enfants ». Et, au siècle dernier, les ouvriers étaient considérés comme des enfants que leur patron devait gouverner pour leur bien avec paternalisme. Les fidèles catholiques ne sont-ils pas les enfants de « Notre Sainte Mère l’Église » et de « Notre Saint Père le Pape », le colonel est dit : « le Père du régiment », et le Tsar était « le petit Père des peuples ».
Gérard Mendel, Pour décoloniser l’enfant. Sociopsychanalyse de l’autorité, Payot, 1971, p. 71
Le landau
– C’est pas exactement de ça dont je rêvais, dit Grâce, poussant un landau de poupée, mais enfin c’est du butin.
– Faut prendre tout ce que le hasard nous offre. Sinon il ne donnera plus rien, dit Régina.
– Elle va chialer la môme, quand elle le retrouvera plus son carrosse.
– Elle avait qu’à le grimper, au lieu de monter son baigneur à bras pour faire comme sa maman. Merde les gosses qui jouent à la poupée.
– Si on la rencontre et qu’elle le reconnaît, qu’est-ce qu’on fait ?
– Mais non, elle est en haut, forcément.
– Pardon, j’oubliais d’être logique. Dis donc ça nous donne une sacrée contenance ce truc-là. Moi madame je lui file le biberon chaque fois qu’il pleure, c’est la nouvelle méthode moderne.
– Mais non c’est dépassé madame, maintenant on leur donne du steak tartare, ça fait pousser les dents.
– Merci, je ne veux pas me faire mordre.
– Une mère doit se sacrifier pour son enfant, dis donc t’as vu la gueule de ces deux connards ?
– C’était des flics c’est sûr. Ils cherchent des mômes pas dirigés dans le bon sens.
– On les a bien eus. Le coup du landau dans le fond c’est un camouflage de première : qui se taillerait avec un landau ? Oh mais dis donc voilà le truc pour être invisibles ! Merde j’aurais jamais pensé à ça toute seule.
– Moi non plus. Heureusement le hasard pense pour nous. [...]
– Au fait je me demande où a disparu la fille en blouson bleu qui était devant nous à la papeterie... J’espère qu’elle a passé. Tu sais ce qu’elle a piqué ? Je l’ai vue. Une boussole. Elle a vu que j’ai vu et on s’est fait comme un signe de reconnaissance tu vois ?
– Dis donc, elle prépare peut-être une excursion elle aussi !
– Qu’est-ce que ce serait chouette. On la rencontrerait : s’il te plait, pourrais-tu nous dire où est le sud ?
– À propos, si on y allait ? Faudrait peut-être pas s’incruster dans le coin. Tiens, qu’est-ce que je
disais ?
– Do, do, l’enfant do, couina Grâce en balançant le carrosse, maman est en haut, qui fait du bateau...
– Pas du bateau, du chapeau, vous allez lui donner mal au cœur Madame si vous le secouez comme ça, ce n’est pas un prunier, laissez-moi vous montrer.
– Non, c’est à moi !
– Prête-le moi un peu !
– Non, c’est à moi ! Merde ce qu’il faut avoir l’air con pour qu’ils nous trouvent normales ! dit Grâce quand le fourgon fut passé. À douze ans, se disputer nos jouets, et ils y croient !
Merci landau, dit-elle, lui caressant le toit, tu nous as encore sauvées.
– Allons-nous-en d’ici, le climat est malsain.
Elles s’éloignèrent de la ville, poussant le landau salvateur. Pique-niquèrent dans un bosquet. Au soir tombant trouvèrent un hangar de scierie, et y dormirent, sur un tas de sciure.
Christiane Rochefort, Encore heureux qu’on va vers l’été, Grasset /Le livre de poche, 1977 [1975], p. 28-29 & 43-44
Les droits spécifiques
La question des droits spécifiques – qu’il s ‘agisse de ceux des femmes ou ceux des enfants – est souvent liée à celle des « capacités naturelles » : « capacité naturelle » des femmes à mettre au monde et à élever des enfants, « incapacité naturelle » des enfants à s’occuper d’eux-mêmes.
Par définition, les droits spécifiques sont opposés au droit dit « commun » en France, c’est-à-dire au droit censé s’appliquer à tout le monde. Ce sont en majorité des droits qui s’appliquent à des populations ou à des situations définies par référence à l’institution de la famille. C’est en fait le droit lui-même qui fonde et construit des droits spécifiques, par exception à la loi commune. Les droits spécifiques, exception au droit de tous, sont préjudiciables aux catégories qu’ils prétendent « protéger ». [...]
Le débat sur le droit de garde des enfants qui fait rage en ce moment dans le monde occidental et oppose les mères aux pères se résume le plus souvent, de façon significative, à la question : « Qui possède légitimement les enfants ? » ; sans qu’on se demande s’il est légitime que les enfants soient possédés. Et dans ce débat, les arguments employés font appel, sans le dire, à une conception du droit qui ressortit de la théorie du droit naturel selon laquelle les droits et devoirs reconnus aux êtres humains devraient dériver de droits naturels.
d’après Christine Delphy, « L’état d’exception : la dérogation au droit commun comme fondement de la sphère privée », in L’ennemi principal, t. 2 Penser le genre, Syllepse, 2002, p. 183
Le cœur de la cible
Dans les pays développés, la phénoménale offensive marchande en direction de ce « cœur de cible » qu’est la jeunesse poursuit un projet réajusté aux critères modernes de la rentabilité, assoiffés de matériaux humains manipulables. Un des principaux spécialistes de l’intoxication publicitaire, « packageant » son cynisme dans un mot d’esprit, définit ainsi sa conception : « La jeunesse est une maladie mentale dont on guérit quelquefois avec l’âge. Ne guérissons jamais. » Il ne s’agit pas là de célébrer l’énergie, l’imagination, la révolte et l’audace, mais plutôt de bloquer le devenir dans un processus d’infantilisation généralisé. Car « la jeunesse » regardée comme naïve et capillaire, en quête de « reconnaissance », fragile et égarée, mais dangereuse aussi, est une véritable mine d’or. Marchands, publicitaires, producteurs et financiers se pressent pour la maîtriser et la rentabiliser : modes, marques, télévisions, clips, cosmétiques, jeux électroniques, signes de la révolte et de l’esprit d’aventure transformés en gadgets. Denis Marsacq, responsable d’un laboratoire du CEA sous-traitant de Nokia, ne se paie pas de mots à propos du surcoût qu’entraînerait l’emploi des piles à combustible pour les portables : « ... Nous ciblons les adolescents, qui sont immatures et moins rationnels... » (Cité dans : Pourquoi il n’y a plus de gorille dans le Grésivaudan, édité par PMO, Grenoble, 2005) Et ces méthodes modernes de contention viennent se compléter de surenchères menaçantes et répressives. Policiers, hommes politiques, experts, psychologues se bousculent : projet de fichage dès la petite enfance, pénalisation des « incivilités », défiance au nom de la « sécurité », mise au travail, prisons pour mineurs, harcèlements policiers, confinement à domicile, interdictions multiples, surveillance... L’enfance dont ils rêvent est une enfance de cauchemar. Vidée de toute imagination et agitée de la seule soif compulsive de consommation, sinon de cocooning, elle doit être faite d’obéissance et de déférence à l’égard de toutes les autorités. L’infantilisation de tous doit commencer très tôt pour faire accepter la suite. Ce n’est même plus la seule jeunesse contre laquelle les coups ont été portés pour s’assurer de sa discipline, mais la plus grande partie assujettie de la société. Dès 1958, l’Organisation mondiale de la santé, toute préoccupée du bien-être de l’humanité, esquissait, dans son rapport technique n° 151, une perspective vouée à la plus grande réussite : « La solution la plus satisfaisante pour l’avenir des utilisations pacifiques de l’énergie atomique serait de voir monter une nouvelle génération qui aurait appris à s’accommoder de l’ignorance et de l’incertitude. »
Gilles Lucas, « préface » in Jacques Vaché, Jean Bellemère, Pierre Bissérié, Eugène Hublet, En route mauvaise troupe ! [1913], Le chien rouge, 2006
On occupe les enfants comme on occupe un pays
Il ne t’a pas fallu douze ans pour comprendre qu’ordinairement qui dit enfant dit « futur adulte » : l’enfant n’est rien dans son présent qu’un devenir. On admet alors sans peine que c’est par la force qu’il faille préparer un être au servage huit heures par jour (sept heures et demi si on croit aux lendemains qui...), cinq jours par semaine, onze mois par an et quarante ans de sa vie.
En attendant, le mépris évident que les adultes nourrissent à leur égard vient de ce que les enfants sont matériellement à leur merci, n’ayant aucun moyen d’acquérir leur indépendance financière ; ils sont dits adultes lorsqu’ils deviennent productifs.
Cependant, il faut bien rentabiliser ce temps perdu, d’où l’instruction (militaire, scolaire, religieuse) qui suit l’éducation comme son ombre. [...]
Et pourquoi cet enfermement ? Pour la même raison qu’on enferme les délinquants. Parce que, pendant ce temps-là, « ils ne font pas de bêtises ». Interroge une dizaine d’adultes, tu verras. Neuf sur dix (je suis bonne) te diront que si les jeunes n’avaient « rien à faire », ils s’ennuieraient. Un gosse qui s’ennuie, ça va de soi, ne peut rien faire d’autre que d’enquiquiner le pauvre monde. Et on occupe les enfants comme on occupe un pays.
Catherine Baker, Insoumission à l’école obligatoire, Barrault, 1985, p.14-15
L’invasion de l’enfance
Aujourd’hui notre société dépend, et sait qu’elle dépend, du succès de son système d’éducation. Elle a un système d’éducation, une conception de l’éducation, une conscience de son importance. Des sciences nouvelles, comme la psychanalyse, la pédiatrie, la psychologie, se consacrent aux problèmes de l’enfance et leurs consignes atteignent les parents à travers une vaste littérature de vulgarisation. Notre monde est obsédé par les problèmes physiques, moraux, sexuels, de l’enfance. Cette préoccupation, la civilisation médiévale ne la connaissait pas, parce que, pour elle, il n’y avait pas de problème, l’enfant dès son sevrage, ou peu après, devenait le compagnon naturel de l’adulte.
[...]
Le grand événement fut donc, au début des temps modernes, la réapparition du souci éducatif. Celui-ci anima un certain nombre d’hommes d’église, de loi, d’étude, encore rares au 15e siècle, de plus en plus nombreux et influents au 16e et au 17e siècles où ils se confondirent avec les partisans de la réforme religieuse. Car c’étaient surtout des moralistes, plutôt que des humanistes : les humanistes restaient attachés à une culture d’homme, étalée sur toute la vie, et se préoccupaient peu d’une formation réservée aux enfants. [...] On admet désormais que l’enfant n’est pas mûr pour la vie, qu’il faut se soumettre à un régime spécial, à une quarantaine, avant de le laisser rejoindre les adultes.
Ce souci nouveau de l’éducation va s’installer peu à peu au cœur de la société et la transformer de fond en comble. La famille cesse d’être seulement une institution de droit privé pour la transmission des biens et du nom, elle assume une fonction morale et spirituelle, elle forme les corps et les âmes.
Entre la génération physique et l’institution juridique, il existait un hiatus, que l’éducation va combler. [...] Les parents ne se contentent plus de mettre au monde des enfants, d’établir quelques-uns seulement d’entre eux, de se désintéresser des autres. La morale du temps leur impose de donner à tous leurs enfants, et pas seulement l’aîné, et même à la fin du 17e siècle aux filles, une préparation à la vie. Cette préparation, il est entendu que l’école l’assure. On substitue l’école à l’apprentissage traditionnel, une école transformée, instrument de discipline sévère, que protègent les cours de justice et de police. [...] La famille et l’école ont ensemble retiré l’enfant de la société des adultes. L’école a enfermé une enfance autrefois libre dans un régime disciplinaire de plus en plus strict, qui aboutit aux 18e et 19e siècles à la claustration totale de l’internat. La sollicitude de la famille, de l’Église, des moralistes et des administrateurs a privé l’enfant de la liberté dont il jouissait parmi les adultes. Elle lui a infligé le fouet, la prison, les corrections réservées aux condamnés des plus basses conditions. Mais cette rigueur traduisait un autre sentiment que l’ancienne indifférence : un amour obsédant qui devait dominer la société à partir du 18e siècle. On conçoit sans peine que cette invasion de l’enfance dans les sensibilités ait provoqué les phénomènes maintenant mieux connus du malthusianisme, du contrôle des naissances. Celui-ci a apparu au 18e siècle au moment où la famille achevait de se réorganiser autour de l’enfant, et dressait entre elle et la société le mur de la vie privée.
Philippe Ariès, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Seuil, « Points histoire », 1973, p. 311-314
Demande-toi si tes enfants ont choisi de se faire avoir
Révolutionnaire ou marginal, on t’accuse de fouler aux pieds les traditions. Il en est au moins une que tu perpétues vigoureusement : la procréation. Tout au plus, femelle, tu revendiques dans le meilleur des cas le libre choix du lieu et de l’heure.
Tu parles d’octroyer à tes enfants la direction de leur existence, mais c’est le projet même de leur conception qui leur est irrémédiablement extérieur. Tu ne peux donner la vie, tu l’imposes. Tu vis et à peine né, on t’emporte pour t’apprendre à vivre.
Tu t’es persuadé peu à peu que c’est ton droit de choisir quand tu veux avoir des enfants ; maintenant demande-toi si tes enfants ont choisi de se faire avoir.
Tout ça n’aurait guère d’importance bien sûr si nous vivions au paradis. Mais le paradis n’existe pas. Que tes motivations pour faire des enfants soient « naturelles » ou non importe peu ; « naturel », notre monde ne l’est pas. Tes enfants te le vomiront à la gueule ; et s’ils l’acceptaient... !
Tu continues à procréer au nom de la révolution ou de l’espoir comme d’autres le font au nom de la race ou de la religion. Occupé à remettre péniblement en cause ton misérable confort sexuel, tu ne peux supporter de réfléchir à la signification actuelle de ce que tu considères toujours au fond comme son aboutissement, sa justification.
L’enfant te sert de panacée. Il cimente ton couple qui s’effondre. Il remplit le vide de ton existence. Il est le remède à ta solitude. Il est le futur où tu projettes tes projets avortés, tes espoirs déçus. Il est ta propriété exclusive. Tu en obtiens facilement admiration et reconnaissance.
Il est temps de t’habituer à jouir pour le plaisir. Femelle, il est temps d’assumer ta sexualité sans sublimer tes désirs atrophiés dans la ponte de petits pantins chauds et braillards. Tu n’est pas chargé(e) de l’avenir de l’espèce.
Si ton combat ne mène nulle part, ne t’en prends qu’à toi-même. Si ta soif de donner l’amour est véritable, prends avec toi les enfants que les autres ont fait par hasard.
Tu parles de pessimisme, mais le pessimisme comme l’espoir sont deux masques de la foi. Cesse de te mentir ; tu ne sais rien, sinon que tu existes. Tu as le choix : crève ou continue. Tu ne dois plus croire en rien.
Tu confonds la procréation et la course aux armements ; tu veux continuer à faire des petits révolutionnaires (!) parce que les autres font des petits conformistes. Tu dis (Margaret Mead)
que c’est une grande aventure du temps présent de faire des enfants pour un monde inconnu. Mais tu fais courir l’aventure aux autres.
Claude Guillon, « Écoute petit homme » [1974] in Pièces à convictions, Noêsis, 2001, p. 44,
http://claudeguillon.internetdown.o...
Quelques livres de « fiction »...
Thomas Bernhard, Un enfant, Gallimard, 1984
Edward Bunker, La bête au ventre, Rivages, 1993
Howard Buten, Quand j’avais cinq ans, je m’ai tué, Points virgule, 1981
Michelle Courbou, Les chapacans, Gallimard, « Série noire », 1994
Gilles Dauvé, Banlieue molle, HB éd., 1999
George Du Maurier, Peter Ibbetson, préface de Raoul Vaneigem, L’or des fous, 2005
Tony Duvert, L’île atlantique, Minuit, 2005 [1979]
Romain Gary, La vie devant soi, Gallimard, 1975 [rééd. Folio]
Jan Guillou, La fabrique de violence, Agone, 2001 [1990]
Christophe Honoré, La douceur, L’Olivier, 1999 [rééd. Points]
Elfriede Jelinek, Les exclus, Jacqueline Chambon, 1989 [rééd. Points]
Agota Kristof, Le grand cahier, Seuil, 1986
Violette Leduc, Thérèse et Isabelle, Gallimard, 1966
Laurie Lee, Un beau matin d’été, Phébus, 1987
Robert Musil, Les désarrois de l’élève Törless, Seuil, 1960 [1906]
Jonathan Swift, Modeste proposition pour empêcher les enfants pauvres..., Mille et une nuits, 1998
Alexandre Vialatte, Les fruits du Congo, Gallimard, 1951
Monique Wittig, L’opoponax, Minuit, 1964
... de non-fiction
Elena Gianini Belotti, Du côté des petites filles, des femmes, 1992 [1974]
Marie-José Chombart de Lauwe, Un monde autre : l’enfance, Payot, 1979
Tony Duvert, L’enfant au masculin, Minuit, 1980
Shulamith Firestone, Pour l’abolition de l’enfance, tahin party, 2002 [1970]
Michel Foucault, « Cours du 5 mars 1975 », in Les anormaux, Gallimard/Seuil, 1999
Charles Fourier, Vers une enfance majeure. Textes sur l’éducation, La Fabrique, 2006 [1821]
Claude Guillon, À la vie à la mort, Noêsis, 1997
Ivan Illich, Une société sans école, Seuil, 1971
Jean-Michel Mension, La tribu, Allia, 1998
A. S. Neill, Libres enfants de Summerhill, Gallimard, « Folio », 2000 [1960]
Offensive n°8, « libérez les enfants », décembre 2005, http://offensive.samizdat.net
Abel Paz, Barcelone 1936. Un adolescent au cœur de la révolution espagnole, La Digitale, 2001
Recherches n°28, « Disciplines à domicile. L’édification de la famille », 1977
Marie Rouanet, Les enfants du bagne, Pocket, 2001
Carole Sandrel, La société contre l’enfant, Stock 2, « Lutter », 1977
Demetrius Zambaco, Onanisme avec troubles nerveux chez deux petites filles, Solin, 2001 [1882]
Un peu (très peu) de bandes dessinées
Kiniko Nananan, Blue, Casterman, 2004
Riad Sattouf, Ma circoncision, Bréal jeunesse, 2004
Craig Thompson, Blankets, Casterman, « écritures », 2004
Daniel Clowes, Ghost world, Vertige graphic, 1999
et tout Bob et Bobette, Fifi Brindacier et Zora la rousse
Quelques films (fictions, documentaires)
Lindsay Anderson, If..., 1968
Asia Argento, Le livre de Jérémie, 2004
Jean-Claude Brisseau, De bruit et de fureur, 1987
Jules Celma, L’école est finie, 1975
Jacques Doillon, Le petit criminel, 1990
Kinji Fukasaku, Battle royale, 2000
Jean-Luc Godard & Anne-Marie Miéville, France tour détour 2 enfants, 1979
Werner Jacobs, Hurrah : L’école est en feu, 1969 ; L’école est supprimée demain, 1971
Charles Laughton, La nuit du chasseur, 1955
Agnès Merlet, Le fils du requin, 1993
Maurice Pialat, L’enfance nue, 1968
Christophe Ruggia, Les diables, 2002
Volker Schlöndorff, Le tambour, 1979
Jean Vigo, Zéro de conduite, 1933
Quelques sites internet apportant des infos complémentaires :
– http://ecolesdifferentes.free.fr [publie un annuaire des écoles différentes]
– http://www.pasde0deconduite.ras.eu.org [analyses contre le rapport Inserm]
– et pas mal de textes sur http://infokiosques.net, thème « éducation »
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.8 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (3.7 Mo)