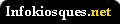C
Contre le manque à vivre
mis en ligne le 2 juin 2017 - Catherine Baker
Introduction
Le texte qui suit constitue le chapitre 9 du livre Insoumission à l’école obligatoire (publié en 1985), dans lequel Catherine Baker explique à Marie, sa fille de 14 ans, pourquoi elle n’a pas souhaité la mettre à l’école et aussi, de manière plus générale, son point de vue sur l’oppression des enfants...
Dans ce passage, Catherine Baker développe la problématique du temps et de l’organisation de la vie, deux choses copieusement dévorées par l’institution scolaire, qui sait, bien entendu, beaucoup mieux que les enfants ce qui est bon pour elleux...
Par ailleurs, les questions et pistes évoquées sont largement transposables à d’autres contextes que celui de l’oppression des adultes sur les enfants.
Sur ce, bonne lecture, et si vous souhaitez dégoter l’intégralité de ce livre grandiose, il est disponible en téléchargement libre sur le site des éditions Tahin Party (vous pouvez aussi le commander en version papier sur le site) et sinon, baladez vous dans les librairies alternatives ou sur les tables de presse de vos villes et villages et avec un peu de chance, il y sera...
Comme d’habitude, pour me contacter, me dire que vous m’aimez ou m’insulter : la-diarrhee-du-capitalisme[at]herbesfolles[point]org
Votre éditeur dévoué.
Juin 2008,
Éditions La Diarrhée du Capitalisme
CONTRE LE MANQUE A VIVRE
C’est la vie qui est dangereuse pour ce qui est institué. La vie, force pure contre tout enfermement. Aussitôt que possible, on vole aux enfants leur plaisir. Toutes les activités vitales sont soumises à des contrôles extérieurs ; dès lors apparaît le Droit, on a le droit de manger, d’aller et de venir, de jouer, etc. Il y a un vide juridique, nous devons réclamer le droit de respirer. Quand nous l’aurons conquis, nous serons fier-e-s de défendre cette noble victoire de l’humain-e démocrate.
Soyons jalouses de nos plaisirs, Marie. Rends-toi compte du nombre de gens qui passent des journées entières sans en recevoir une fois le sourire des choses.
Vie mortelle.
Tous les moyens sont bons pour investir les forces radieuses des enfants dans la soumission à de mesquins travaux. Les énergies sont canalisées dans une gymnastique de l’esprit aussi impersonnelle que celle du corps. Fumer, manger, aimer, écrire, rire, rêver sont interdits pendant les heures de classe. C’est la puissance des enfants, leur volonté de s’approprier le monde qui est combattue pied à pied.
L’enfant ne doit pas être « livré-e à ellui-même ». Ille doit être livré-e à d’autres.
Il est indéniable que de plus en plus de parents cherchent pour les loisirs de leurs mômes des « animations culturelles » de tous ordres. Nous sommes tou-te-s animé-e-s comme des fou-olle-s par des gens de métier. Mais les enfants, à l’heure actuelle, en sont incontestablement les plus nombreuses victimes. On a si peu de temps. Non seulement on nous l’arrache pour faire tourner la folle machine, mais ce qu’il en reste est reconverti par l’industrie animatrice en un énorme dégoûtant hamburger.
Quoi de plus personnel que le temps ? Disposer de mon temps, c’est disposer de ma vie. Dans le langage le plus commun, être libre, c’est avoir du temps à soi.
Le temps de l’enfant est un temps magique ou plutôt un temps sorcier dont l’adulte n’a plus la moindre notion s’ille n’a pas la curiosité par exemple de prendre parfois des substances dites hallucinogènes. Je suis persuadée quant à moi que lae tout-e petit-e enfant est dans un état de conscience très proche de l’état psychédélique, très proche par ailleurs du rêve. Rien ne me dit que notre approche habituelle si réductrice de la réalité soit plus près d’une quelconque vérité. Mais il est inutile ici de parler aux pierres.
Je veux dire simplement qu’il y a chez lae petit-e une amplitude du temps qui ne peut se comparer à la nôtre, déjà bien trop marquée par l’approche de notre mort. J’ai cru longtemps que le temps de l’enfant était plus lent que le nôtre et que trois jours valaient pour ellui une éternité, mais j’ai constaté près de toi et près des enfants déscolarisé-e-s « qui jouent tout le temps » que ce n’était pas si simple. Toute petite tu me disais que les jours passaient « très vite » ; à chacun de tes anniversaires jamais tu n’as manqué de t’exclamer « déjà ! ». Quand un-e enfant joue, tout le monde sait qu’ille laisse facilement « passer l’heure » de s’arrêter…
Le souvenir du long temps de notre enfance, c’est tout bêtement le souvenir de notre long ennui.
Des spécialistes ont été amené-es à étudier le degré de tolérance de l’enfant au… travail ! Certain-e-s pédiatres en effet ont commencé à s’affoler de ce que 20% de leur clientèle souffrît de « problèmes dûs à la scolarité ». Responsable du service de pédiatrie de l’hôpital d’Orsay, le Dr Guy Vermeil a souligné à plusieurs reprises l’urgence d’une réforme des rythmes scolaires : « Sur trente élèves, plus de la moitié sont en état de surtension ou de marginalisation, ou travaillent dans la morosité, la mélancolie ou l’ennui. » Des tests biologiques fondés sur l’étude de l’élimination de certaines hormones selon l’état de fatigue ont fait l’objet de plusieurs analyses concordantes. En janvier 1979, le Conseil économique et social a examiné le problème de la réforme des rythmes scolaires. Deux questions seulement ont été jugées essentielles : « Peut-on procéder à un étalement des vacances scolaires ? Quelles seront les incidences sur la production industrielle, sur le tourisme et le transport ? » Tu vois que la problématique n’était pas trop anarchisante… Le rapport Magnin donne les résultats de cette étude. Nous retiendrons ici qu’entre six et huit ans, un-e enfant ne peut pas travailler en classe plus de dix heures par semaine (« maximum tolérable : douze heures ») ; un-e enfant de huit à dix ans ne saurait guère dépasser quatre heures de travail en classe par jour mais est capable de travailler encore une demi-heure chez ellui.
Un-e enfant de sept ans ne peut soutenir son attention que pour une durée de vingt à trente minutes (trente à quarante pour les dix, onze ans). Qui s’en soucie ?
Non contents de forcer les mômes à travailler jusqu’à les abrutir, on veut encore les forcer à dormir. Tu m’imagines avec des amies et je dirais soudain à l’une d’entre elles : « Bon maintenant, toi, va te coucher » ? Depuis que tu sais marcher (huit mois) tu t’es pratiquement toujours couchée après moi, c’est-à-dire après minuit. Le matin tu roupilles comme une bienheureuse. Vincent, quand il était dans ce lieu de vie que j’ai bien aimé, Jonas, m’avait dit qu’il avait remarqué aussi qu’il y avait des enfants diurnes et des enfants nocturnes. Bien sûr…
Si les parents envoient les gosses au lit, c’est pour être tranquilles. Parfois aussi c’est « à cause de l’école ». Mais jamais on ne se préoccupe de savoir si le rythme personnel de l’enfant s’accommode mieux du soir ou du matin. « Dors », ça veut dire « meurs ».
Les enfants sont un petit peu trop vivant-e-s. Par définition, l’éducation est contre nature. La fabrication des monstres correspond très littéralement à la volonté de pouvoir montrer l’enfant en société. De toutes les pressions exercées en ce sens, la plus formidable, la plus écrasante, c’est l’ennui.
Oh l’incommensurable ennui de l’école ! Tu ne peux pas imaginer ; c’est impossible.
Je me souviens du goût des buvards. Buvards roses qu’on nous distribuait à l’école primaire puis ceux de toutes les couleurs qu’on achetait soi-même ensuite. Petits morceaux mâchouillés roulés sous la langue qui devenaient impossibles à sectionner ; nos incisives s’y appliquaient pourtant ; nous eussions, sans les buvards, grincé des dents.
Les chewing-gums sont encore souvent interdits en classe. Mais on continue à « mâcher ». Parce que mâcher, c’est quand même faire quelque chose. Il est impossible de décrire ce tragique agacement de ne rien pouvoir faire. Qui saurait se représenter ce qu’est d’être assis-e des heures et des heures et de subir sans sourciller des discours ? Il suffit de s’intéresser disent les diseureuses.
Il suffirait, oui. Mais justement… C’est bien là le problème. Sur une année scolaire, combien peut-il y avoir de cours intéressants ? Et dans la mesure où la présence y est obligatoire, combien d’élèves intéressé-e-s ?
L’éducation, c’est la falsification. Edmond Gilliard que j’ai déjà cité écrivait dans son Journal, alors qu’il était professeur de latin depuis quinze ans : « Il y a des écoles pour les enfants arriéré-e-s dont on s’efforce de faire des humain-e-s normaux-ales.
« Nous, dans l’enseignement classique, nous recevons des enfants normaux-ales dont nous nous efforçons de faire des humain-e arriéré-e-s. »
Avec la publicité, l’école est la plus magistrale entreprise d’imbécillisation. Bien sûr, il est facile d’analyser le contenu des cours, mais ce n’est pas le plus important. L’imbécillisation consiste à ôter à l’enfant toute envie d’entrer dans la compréhension du monde. Au sens étymologique du mot, l’enfant refuse de com-prendre ça. Ça ? Ce qui l’entoure. Les professeur-e-s mais aussi la laideur imposée. Je ne dirai jamais assez les profonds ravages causés par le simple aspect sinistre des salles de classes (aussi bien les « modernes » que les « anciennes », cela s’entend). Un rapport américain avait fait quelque bruit à l’époque. C’était une étude approfondie des écoles publiques aux États-Unis demandée par la Fondation Carnegie au Dr Charles Silberman, un homme tout à fait modéré. L’auteur du rapport soulignait qu’il fallait vraiment considérer l’école comme « allant de soi » pour ne pas s’apercevoir que tout dans l’aspect extérieur de l’école comme dans les relations entre maîtres et élèves « menait immanquablement à la stérilisation des esprits ». C’est John Holt qui fait remarquer que si ce rapport a d’abord provoqué un certain scandale pour tomber très vite dans un « à quoi bon », c’est que c’est cela, cette école grise et terne et pénible que souhaite le public, en l’occurrence, les électeurices qui, dans leur majorité, veulent une école menaçante, punitive, sombre.
Les victimes de cette volonté adulte de malheur, de laideur ne savent pas forcément exprimer les raisons de leur souffrance. De l’école, illes ne savent qu’une chose, les enfants, c’est qu’illes s’y font scier le dos.
Marie, je t’assure que j’ai connu des enfants tétanisé-e-s d’ennui. Et je ne sais pas si on se remet jamais d’une chose pareille.
Comme si cela les justifiait d’enquiquiner le petit monde, les profs en chœur me jurent qu’illes se morfondent tout autant que leurs élèves. Ce n’est vraiment pas de chance… Je les plains beaucoup.
Illes m’ont appris à faire des dissertations. Il y avait le pour, le contre et l’on montrait qu’on avait tout compris en développant ensuite le moyen terme. Cette sagesse enseignée me donne de l’acné. Je ne veux plus trouver le juste milieu, me donner le mal d’être pleinement médiocre. J’ai longtemps cru que ce qu’on me demandait dans les travaux scolaires, c’était d’être originale sans jamais être personnelle. Il y avait malentendu ; ce qu’on attendait de moi était pire : être personnelle sans jamais être originale.
Il est assez symptomatique que certain professeur se soit fait radier à vie de l’enseignement après avoir fait paraître un livre de rédactions qu’il avait voulues réellement « libres ». De l’écriture même des enfants (reproduite en offset) ces lignes par exemple : « Le jour que je suis rentré de l’école, je me suis demandé si c’était vraiment une école car l’usine de mon père est plus propre que le C.E.T. » Ou encore cette phrase d’une densité de plomb et qui a donné son titre au livre : « Si j’avais de l’argent, beaucoup d’argent, je quitterais l’école [1]. »
Ce prodigieux ennui scolaire s’étale, immense et muet.
Il faut être Le Monde de l’éducation pour avoir l’idée absurde que le mal vient d’une inadaptation au malheur. Si ça t’intéresse, lis donc cette page risible : titre « La phobie scolaire » ; sous-titre « Un cas d’inadaptation ». D’abord, « le fait » : « Jacques, quatorze ans, vient de passer avec succès son examen d’entrée en troisième moderne. “Le jour de la rentrée, expliquent au médecin ses parents qui l’ont amené en consultation, il est allé normalement en classe. Le lendemain matin aussi, mais il a refusé obstinément d’y retourner l’après-midi ; ‘J’ai peur sans savoir de quoi’, répète-t-il. Depuis il refuse d’aller au lycée, même accompagné.”
« Un entretien précis sur les circonstances qui ont pu déclencher cette réaction ne fera rien apparaître d’alarmant, si ce n’est une phrase prononcée par l’un des professeurs le matin même : “Cela m’étonne beaucoup que vous ayez réussi l’examen d’entrée en troisième.”
« L’entretien avec les parents nous apprend que Jacques avait eu des difficultés scolaires du même ordre au jardin d’enfants.
« Le premier essai de scolarité eut lieu à cinq ans, “pour essayer de le rendre moins sauvage”, dit la mère. Dès le lendemain du premier contact avec l’école, il opposa un refus rageur de s’y laisser conduire. Jacques n’acceptait d’aller à l’école qu’à condition que sa mère restât en classe avec lui. Plusieurs tentatives pour le laisser seul échouèrent : l’enfant pleurait pendant toute la durée de la classe et ne voulait pas y retourner le lendemain. Ce refus s’accompagnait de douleurs abdominales et de vomissements à chaque tentative de départ pour l’école.
« De six à quatorze ans, les troubles disparurent et Jacques fut un élève intelligent, réussissant normalement jusqu’à l’épisode récent qui provoqua la consultation. »
Puis le commentaire du Dr Pierre Ferrari, directeur de la consultation à l’École des parents et des éducateurices : « L’angoisse de la séparation : Jacques nous offre un exemple très caractéristique de ce qu’il est convenu d’appeler une “phobie scolaire” : c’est-à-dire, bien plus qu’une peur de l’école, une angoisse déclenchée par la situation scolaire, hors de proportion avec ce que l’on pourrait redouter de l’école.
« L’enfant présente des réactions d’anxiété très vives, voire de panique, lorsqu’on le contraint à aller à l’école. Cette anxiété peut se traduire par des manifestations somatiques diverses (vomissements et douleurs abdominales dans le cas de Jacques).
« C’est au nom de son angoisse que l’enfant refuse d’aller à l’école.
« On a longtemps confondu le cas de ces enfants avec celui des enfants “qui font l’école buissonnière”, alors qu’il est, en fait, très différent. Ces dernier-e-s n’aiment pas l’école et lui préfèrent le spectacle de la rue. Il n’en est pas de même des petit-e-s phobiques qui, généralement, aiment l’école, même si celle-ci suscite en elleux l’anxiété. S’il leur arrive parfois aussi de fuguer et d’errer dans la rue, c’est pour échapper à leur angoisse.
« La phobie scolaire, qui est en augmentation depuis quelques années, pose de multiples problèmes. [Sic !]
« – Sa nature : Il s’agit d’un trouble névrotique dont les causes psychologiques sont complexes mais où l’on retrouve très souvent un élément commun qui est l’angoisse de séparation d’avec la mère.
« On pense généralement que la phobie est le reflet d’une situation de dépendance mal résolue entre la mère et l’enfant. Dans cette situation, la mère a souvent un rôle très important ; très ambivalente envers le symptôme, elle trouve inconsciemment dans ce refus scolaire une preuve de l’attachement de son enfant pour elle. On oppose classiquement les phobies spectaculaires de l’enfant jeune, survenant lors du premier départ pour la maternelle, à la phobie souvent plus insidieuse de l’enfant plus âgé, adolescent ou pré-adolescent.
« – Le retentissement sur la scolarité. Le refus scolaire peut être tellement intense qu’aucun retour en classe ne soit possible avant la guérison ; celle-ci peut demander plusieurs mois, voire plusieurs années ; la famille est, dans ces cas, contrainte à une scolarisation à domicile.
« D’autres fois, l’enfant accepte de retourner à l’école, mais c’est au prix d’une chute de son rendement scolaire.
« – Problème thérapeutique. Si certain-e-s insistent sur la nécessité d’obtenir de l’enfant un retour rapide à l’école, alors que d’autres seraient plus tolérant-e-s à l’égard du refus scolaire, tous s’accordent à considérer la phobie scolaire comme un symptôme de troubles névrotiques de la personnalité de l’enfant, qui demandent un traitement psychothérapique de la “névrose totale” de l’enfant mais aussi souvent de la mère, tant est grande, dans l’entretien du trouble, l’attitude de celle-ci. »
Il y a de quoi hurler. Que l’enseignement soit une agression n’effleure pas le bon docteur !
C’est sans doute par gourmandise que les jeunes s’adonnent à l’alcoolisme (bien plus qu’ils ne se droguent d’ailleurs) et n’importe qui vous expliquera que si les lycéen-ne-s tentent de se suicider, c’est qu’illes ne savent vraiment plus quoi inventer pour embêter les adultes. En 1979, dans presque un collège « à problèmes » sur deux (46,3 %), des tentatives de suicide d’enfant ont été rapportées [2]. Mais cela touche moins les médias que les agressions contre les profs signalées dans 43,9 % de ces collèges. On ne compte plus les violences entre élèves (racket 58,5 %, affaires sexuelles, 26,8 %, etc.). Au collège Henri-Wallon, à Garges-lès-Gonesse, un tiers des vitres ont été remplacées par des panneaux de bois et celles qui restent, m’apprend Le Nouvel Obs du 3 février 1984, sont à l’épreuve des balles (coût : un million de francs). Dans la nuit du 1er au 2 août, deux collégiens de douze et treize ans avaient déjà incendié ce bahut. On dirait que l’ennui a passé la mesure. Très peu d’enfants cependant, jusqu’ici, tuent des adultes. Ce qui est franchement curieux.
Les mômes vampirisé-e-s doivent dire merci. On s’insurge contre celui qui fout une baffe au professeur horripilant, réaction pourtant moins désastreuse que celle qui consiste à se laisser désagréger par l’impression de vide ressentie dans les travaux scolaires.
Les gens engourdi-e-s par l’ennui ne peuvent que devenir idiot-e-s.
Contre lui, une seule solution, la fuite. L’absentéisme reste LA réponse adéquate de qui veut échapper au massacre. N’est sauvé-e que cellui, de la maternelle à Polytechnique, qui se sauve, qui s’échappe. L’absentéisme en commun s’appelle parfois une grève, mais, aussi bien chez les élèves que chez les enseignant-e-s, celle-ci n’aurait d’intérêt qu’illimitée.
Il arrive aussi que la colère l’emporte. Autant les colères organisées par les militant-e-s sont misérables, autant de vraies grandes fureurs spontanées, même collectives, peuvent avoir de la gueule.
L’une d’entre elles vaut la peine d’être remise en mémoire. Les résistances au système scolaire sont monnaie courante, mais quel trésor que de voir de loin en loin des élèves qui pensent leur insubordination et nous laissent une réflexion écrite en héritage !
J’ai précieusement gardé celle des dix-sept élèves du lycée agricole de Brie-Comte-Robert, en Seine-et-Marne, qui, en mai 1974, furent traduit-e-s en conseil de discipline et lurent chacun-e le texte que voici. Ces élèves étaient accusé-e-s de « vandalisme » ; les faits qu’on leur reprochait ressemblaient beaucoup à des actes de sabotage (détérioration des machines). Lors de ce conseil de discipline, six élèves sur dix-sept furent exclu-e-s de l’établissement. C’est alors que pendant trois semaines eut lieu un « saccage » mémorable. Aucune revendication. La destruction exprimant seule l’indignation absolue. Le lycée fut fermé. Y a-t-il quelqu’un-e qui me soutiendra qu’illes y ont peut-être perdu quelque chose ?
Voici le texte lu par chacun-e des rebelles. Je n’en partage pas toutes les idées, loin de là, mais j’estime que les élèves qui l’ont écrit ont compris pas mal de choses :
« Je vous remercie de me demander mon avis.
« J’espère que vous serez à même d’en tenir compte.
« J’ai bon espoir qu’il concorde tellement avec celui de mes camarades également mis-es en cause que cela prenne enfin un sens.
« Je reconnais en effet, en gros, les griefs qui ont été énoncés sur ma personne et qui font que je suis ici ; je les accepte volontiers parce que, s’ils mettent effectivement ma scolarité en péril, ils sont aussi susceptibles de dénoncer enfin la nature de leurs causes véritables.
« – Premièrement, je demande que soit considérée sérieusement la réalité chiffrée de cette affaire : nous sommes dix-sept élèves mis-es en cause, et nous serions le double si plusieurs d’entre nous n’avaient pris le parti de partir il y a huit jours ; mais nous sommes dix-sept, sur deux cents ; je me réjouis que nous ne soyons pas trois, mais je suis surpris que nous ne soyons pas cinquante, inculpé-e-s ; parce que je sais, moi, et vous savez bien, vous, qu’il y a dans notre lycée cent cinquante élèves qui s’absentent à volonté des cours, et au moins cent cinquante élèves qui ont manqué, comme vous dites, au règlement intérieur.
« – Deuxièmement, donc, j’accuse, en mon nom, et au nom de cent cinquante élèves, et au nom de mes parents, qui n’y ont peut-être pas songé, et au nom des parents des cent cinquante élèves, qui ne semblent pas y avoir songé, puisque c’est nous qui sommes ici accusé-e-s, et non le directeur du lycée, et non le personnel de surveillance, et non le corps enseignant.
« J’accuse le directeur, le personnel de surveillance et le corps enseignant d’avoir autorisé mes absences, et je les accuse d’avoir toléré l’absence régulière de plus de la moitié de leurs effectifs.
« – Troisièmement, j’accuse tou-te-s celleux qui ont provoqué ces absences, j’accuse tou-te-s les professeur-e-s qui, légalement ou non, mais pas légitimement, n’ont pas été présent-e-s quand nous étions présent-e-s. Je demande que cette dose-là d’absentéisme soit aussi publiée.
« – Quatrièmement, j’accuse l’administration et le corps professoral de nous avoir trompé-e-s : le lycée n’est pas un lycée agricole.
« J’accuse tout ce qui nous a empêchés de participer aux travaux agricoles.
« J’accuse pourtant moins l’administration centrale, lointaine et absurde, qui a livré un lycée sans matériel agricole suffisant, que le corps professoral qui a capitulé devant notre mécontentement, les ingénieur-e-s et les technicien-ne-s qui ont fait du domaine leur ferme ou celle de quelques privilégié-e-s et qui ont trouvé dans ces formes de fuite la permission du directeur ; je les accuse par-dessus tout d’avoir été incapables de comprendre ce que nous désirions et demande qu’illes soient puni-e-s pour avoir méprisé ce que nous désirions.
« – Enfin, le lycée a été abîmé, des objets ont été détruits, des machines endommagées.
« D’abord, bien sûr, j’annonce que ces dégradations ne sont pas le fait de trois ou quatre élèves – tout le monde le sait : j’accuse donc l’administration de n’accuser que trois ou quatre élèves. Je l’accuse de mentir et de mentir sciemment.
« Mais un lycée, ce n’est pas, de toute façon, un musée, alors que c’est un conservatoire, un lieu où passent des adolescent-e-s, et il ne sera possible de répondre du matériel cassé que lorsqu’on répondra des élèves qui ont été vidé-e-s sous prétexte final de réorientation ; il ne sera possible de répondre du matériel cassé que lorsqu’on répondra des élèves dégoûté-e-s de leur vocation première ; il ne sera sérieusement intéressant de rendre compte du matériel cassé tant qu’on n’aura pas mesuré l’étendue du désastre scolaire.
« Et même, on se moquera encore de nous tant qu’on n’aura pas mesuré l’étendue de tout ce qui était possible, grâce à nous, dans ce lycée.
« En termes juridiques, j’énonce, moi que l’on accuse, qu’il n’y a pas “non-lieu” ; j’énonce que celleux qui nous accusent préfèrent le mensonge de ce simulacre soudain de conseil de discipline à la reconnaissance de leurs responsabilités.
« J’espère, disais-je en commençant, que vous serez à même d’en tenir compte.
« Quant à moi, je m’en tiens là, c’est-à-dire beaucoup plus loin que vous. »
Je connais des cyniques qui ne manquent jamais de répéter que c’est à l’école qu’on apprend à utiliser les mots propres à la critique. C’est manifestement faux. On peut apprendre à réfléchir, c’est vrai, et les élèves de Brie-Comte-Robert ont sans doute fait ensemble ce travail. Peut-être même qu’illes se sont trouvé des professeur-e-s comme allié-e-s. Mais pas dans le cadre scolaire. Illes se sont associé-e-s librement, dans la marge.
Ce qui fait le « charme de la vie étudiante », c’est qu’on a le temps de réaliser plein de choses à côté. Quand on dit d’une ville universitaire qu’elle est une ville « vivante », on constate, simplement, qu’elle semble très animée parce que beaucoup de jeunes circulent dans les rues, que les cafés sont ouverts tard le soir, qu’il y a plus de cinémas ou théâtres que dans les cités voisines, bref qu’on s’y distrait des études.
Curieux ce préjugé qui veuille non seulement qu’on apprenne quelque chose à l’école mais surtout qu’on n’apprenne que là. Parce que l’Éducation nationale, malgré ses efforts poussifs, est toujours anachronique, on n’enseigne pas encore aux enfants à « regarder la télévision ». Ça viendra. Comme viendra le temps – on scolarise les petit-e-s de plus en plus tôt, et ce dans le monde entier – où on nous jurera qu’on ne peut savoir marcher si on ne l’a appris à l’école. « C’est parce que tu es allée à l’école que tu écris des livres » relève de cette même niaiserie. Anecdote qui ne manque pas de sel : après dix mois de lutte, les ouvrier-e-s de Lip [3] se sont vu offrir… de retourner à l’école. Oui, on leur a proposé de suivre des cours sur la « vie économique de l’entreprise » et l’« histoire de la montre à travers les âges » ; je ne sais ce qui remporte le pompon dans le ridicule entre « techniques d’expression écrite et orale » (elleux qui avaient tant et tant parlé ou écrit !) ou « perfectionnement à l’encadrement ». Mais on ne pouvait admettre qu’illes se fussent formé-e-s mutuellement hors des institutions scolaires.
Toute une armée de psys, magnifiquement soutenue par les médias, impose aux enfants le mode de fonctionnement des adultes. Et ce n’est pas sans mal. Car l’enfant a envie de vivre. Aucun-e être vivant-e ne se trouve naturellement porté-e vers l’abnégation, la modération, le formalisme.
Quand la vie scintille dans la pensée de l’enfant, constamment elle se heurte à la volonté de bienséance des adultes. Les humain-e-s s’imaginent qu’illes ne peuvent vivre que les un-e-s sur les autres et les un-e-s par les autres et, en même temps, ces rapports sociaux les terrorisent tellement qu’illes s’inventent mille rituels d’évitement pour se permettre de glisser d’isolement en isolement sans risquer de se trouver désarmé-e-s face à quelqu’un-e. Prisonnier-e-s de ces rapports forcenés, les enfants ont du mal à se plier aux règles : à coup de punitions (y compris le simple chagrin des « parents sympas ») illes apprennent les bonnes manières. S’illes jouent avec des adultes, illes savent très bien que celleux-ci ne seront jamais des copaines comme les autres. Il faut faire attention à ce qu’on fait quand on est avec les grand-e-s. On ne doit pas réclamer un câlin puis, satisfait-e au bout de vingt secondes, se précipiter pour jouer avec les autres à chat perché ! Il y a des formes de l’amour à respecter. Ce n’est malheureusement pas pour rire qu’on aime quand on est grand-e. Chaque chose à sa place. S’amuser n’est pas sérieux. Et pourtant il faut bien que les enfants « récupèrent » sous peine de folie.
Alors, quand on lâche les enfants en récréation, on les entend hurler. « Illes jouent. » Illes jouent ? Il n’est pas requis de qualité hors du commun pour discerner la différence de cris entre des enfants qui jouent de bon cœur et des enfants qui jouent des nerfs. La plupart des adultes voudraient que l’enfant fasse joujou « pour » se détendre. La récréation est par excellence la « reconstitution d’une force de travail ». Les classes où l’on se divertit pendant les cours ont mauvaise presse auprès des parents ; les éducateurices qui bossent dans certains centres médico-psycho-pédagogiques n’en peuvent plus de se faire houspiller par les parents : « C’est pour rattraper son retard que notre enfant est là, pas pour danser ou shooter dans un ballon ! »
Toujours la police et les juristes ont été les allié-e-s efficaces des enseignant-e-s. Et notamment pour empêcher les enfants de s’amuser. (Ça ne date vraiment pas d’aujourd’hui : on peut voir au musée des Arts et Traditions populaires une affiche du 27 mars 1752 qui porte cette ordonnance : « Défense aux maîtres des jeux de paume et de billard de donner à jouer pendant les heures de classe… »)
Le jeu est suspect. Dans le même ordre d’idée, il est inquiétant de voir comme on rogne les grandes vacances des élèves. On se méfie de ce temps libre. Le temps qu’on ne passe pas à travailler est dangereux.
Étrangement, le jeu est assimilé à l’oisiveté. Il va de pair avec le vice, tout le monde sait ça. Les jeux admis par les adultes apparaissent passablement louches.
Dans la confusion générale actuelle, on aura noté la tendance aux « jeux éducatifs » dont le moindre n’est pas, dans les « écoles de pointe », cette vogue des « conseils d’enfants » où des mômes autogèrent ce qui peut s’autogérer de leur triste condition scolaire. Pourtant Dieu sait comme les mômes ont horreur des « réunions » !
La modernité voudrait que le travail soit un jeu et le jeu un travail. Les jeunes loup-ve-s d’aujourd’hui s’amusent comme des fou-lle-s à gagner beaucoup d’argent qu’illes dépensent, sinistres, pour occuper leurs assommants loisirs.
Les contestataires de l’école ont pas mal disserté sur le jeu. Neill estime que si les enfants le préfèrent au travail, c’est qu’illes peuvent y faire intervenir leur imagination. Mais je suppose que les chercheureuses, en science comme ailleurs, ont besoin de leur imagination aussi pour travailler. À l’opposé, Kameneff [4] ne voit dans le jeu que la pilule qui permet de « faire passer le temps », un succédané donné aux enfants « pour qu’illes trompent leur faim de participer réellement à la vie ». Il estime qu’à l’École en bateau, l’enfant créateurice remplace l’enfant joueureuse ; n’ayant plus besoin de hochets, cellui-ci a envie de prendre en mains son existence, de travailler à la réalisation de ses projets.
Dans tout cela, sans doute y a-t-il une part de vérité. Incontestablement, le jeu distrait d’une réalité insupportable ; et il n’est pas moins certain qu’ordinairement le travail se déroule dans le plus tragique ennui. Mais le jeu, cette luxueuse inutilité, ce rêve qu’on peut faire à plusieurs, est aussi le plaisir de la poésie, de la liberté de voir autrement le monde et d’en faire jaillir par l’idée créatrice une émotion profonde.
Ce qu’il est pour l’enfant nous est devenu réellement étranger. Une seule fois, j’ai pu m’en approcher. Tu te souviens ? J’avais pris de l’acide, ta présence m’était exquise ; tu devais avoir cinq ou six ans et nous avons joué à la dînette. J’ai compris alors qu’en l’enfant ludique l’unité entre l’imaginaire et le réel était totale. Pas de personnage ni de double. (Les seuls jeux de l’adulte qui souffriraient peut-être encore la comparaison seraient les multiples variantes de celui qu’on appelle « de la vérité » ou encore la roulette russe.) Au cours de l’adolescence, se produit une série de ruptures. Tu ne joues plus à, tu te joues de. Tu prends tes distances ; c’est cela sans doute « devenir grande ». Et tout ton rapport au monde sera contenu désormais dans cette question de la distance…
« Maturité de l’humain-e : retrouver le sérieux qu’ilel mettait au jeu étant enfant. » Nietzsche (Par-delà le bien et le mal).
La conception ordinaire de l’adulte, c’est que l’humain-e fait partie du monde alors que l’enfant a les meilleures raisons de croire que le monde fait partie d’ellui : ille le transforme, le crée, le pense. Son monde est fantasque, libre. La force des choses ne sera toujours que notre manque d’imagination.
Les enfants non scolarisé-e-s que nous connaissons toi et moi ne sont jamais mou-lle-s et mornes comme ces malheureux-ses élèves écrasé-e-s par leur impuissance dans le train scolaire qui les emmène au front. Le front, la « vie active ». On ne cesse, sous diverses formes, d’exprimer devant moi cette idée qu’il faut bien, « malheureusement », que les enfants s’ennuient à l’école pour « s’habituer ». Tu t’es, toi aussi, laissé dire que j’avais eu tort de ne pas te scolariser parce que plus tard tu ne pourrais « jamais supporter les contraintes du travail », par ce dernier euphémisme, ils entendent la tristesse du servage.
Il ne fait aucun doute – contrairement à une idée très répandue – que les humain-e-s se donnent un mal fou pour s’accoutumer à mourir. Illes vivent comme des mourant-e-s, à l’économie.
À l’école, les mômes deviennent très rapidement aussi standardisé-e-s que des adultes, aussi ternes et insipides. Un auteur américain, Lewis Mumfort, a dit que les jeunes vivaient d’ores et déjà le lugubre après-guerre d’une Troisième Guerre mondiale.
Quand j’oppose aux enfants du système scolaire ceux qui n’en ont jamais été victimes, je ne prône pas je ne sais quelle éducation anti-autoritaire qui donnerait aux enfants la liberté.
D’abord je n’ai jamais vu d’enfant libre.
Ensuite, je ne veux pas plus d’une éducation libertaire que d’une autre.
Celleux qui ont voulu épargner l’école aux enfants, dans des lieux communautaires ou non, ont souvent fait leur la devise « Fais ce que tu voudras. » Mais le cher moine et prêtre qui imagina l’abbaye de Thélème ne l’avait conçue que pour des êtres raffiné-e-s qui, parce qu’affranchi-e-s des obligations sociales, trouvaient leur bonheur dans l’invention de relations libres.
Or, a priori, nul n’a jamais prétendu que des êtres adultes et enfants qui se retrouvent en France à la fin du XXe siècle puissent d’emblée établir entre elleux des rapports dégagés des pressions sociales. Ce n’est pas en soufflant dessus que nous abolirons les contraintes. Les tout-e-petit-e-s sont évidemment aussi coincé-e-s que leurs aîné-e-s par les interdits.
Bien des lieux libertaires ont réintroduit le droit et la morale dans leur fonctionnement, recréant par là même une société. Comme de bien entendu, c’est alors « ensemble » qu’on se choisit ses règles. Ce qui est mauvais est ce qui va contre le bon fonctionnement de la communauté. En ce sens, rien de nouveau sous le soleil ; nos sociétés actuelles sont toutes fondées sur ce même principe.
Pour grand-e-s et petit-e-s, prendre conscience que c’est en se singularisant contre tout groupe donné qu’on peut, même au sein de ce groupe, nouer des rapports d’amour n’est jamais facile. Peu de communautés ont su éviter le passage d’une réunion d’individu-e-s associé-e-s à un groupe formant société.
Les journalistes qui visitaient les lieux anti-scolaires n’ont cessé de clamer que les enfants y étaient libres, voulant dire simplement que ceux-ci avaient le droit de faire ce qui leur était interdit à l’école. Mais avoir le droit est déjà une oppression.
Certains de ces lieux ont poussé leur logique jusqu’au bout. Ainsi Korczak raconte comment fonctionnait dans sa Maison des orphelin-e-s le fameux « tribunal ». Les enfants pouvaient bien sûr citer les membres adultes du personnel aussi bien que celleux de leur âge. Korczak lui-même dit y avoir été jugé cinq fois (pour avoir tiré les oreilles d’un garçon, mis à la porte du dortoir un chahuteur, envoyé un autre au coin, insulté un juge, soupçonné une petite fille d’avoir volé) ; quatre condamnations, un acquittement. L’équité des juges, le respect des droits de la défense et l’aspect sensé des punitions ont fait, entre les deux guerres, d’admiration de tous les visiteureuses de l’époque.
J’ai déjà dit l’estime que j’ai pour Korczak ; je ne partage néanmoins pas toutes ses vues. Je ne peux pour ma part refuser l’institution scolaire et accepter une institution judiciaire quelle qu’elle soit. Je refuse ce qui est obligatoire, c’est-à-dire les lois.
Si j’ai participé – passionnément – à la Barque, c’est que nous y avions chacun-e des idées différentes sur l’« éducation » et que notre seule cohérence reposait sur la volonté individuelle de tous de refuser les « lois de groupe ».
Peu l’ont compris, pas seulement parmi les pourvoyeureuses d’articles en tout genre pour journaux chics mais aussi chez les penseureuses professionnel-le-s. Guy Avanzini (professeur des sciences de l’éducation à l’université Lyon II) reprochait à ces lieux anti-scolaires, entre autres, de se vouloir anti-autoritaires et de méconnaître que ce choix était lui-même une contrainte : « Ne faudrait-il même pas se demander tout spécialement si la décision de placer les enfants en dehors de la société globale n’émane pas de familles fort “autoritaires”, en ce sens précis qu’elles limitent la liberté ultérieure et les possibilités réelles de choix de leurs enfants ? » (Autrement, n°13, avril 1978.)
Je n’ai jamais senti que les enfants fussent déconcerté-e-s des différences de comportements entre les adultes présents à la Barque. Telle mère était connue pour ses colères alors qu’une autre se les interdisait, celui-ci n’a jamais su respecter les feux tricolores et celle-là passait sous les tourniquets du métro, alors que son amie veillait scrupuleusement à ce que chacun soit en situation régulière. Selon qu’illes se trouvaient avec tel ou tel adulte « de permanence », les mômes savaient que les habitudes des uns et des autres étaient différentes et qu’illes pouvaient faire avec cellui-ci ce qui aurait été fort pénible à cellui-là.
Nous nous faisions confiance. Jamais un-e gosse ne nous aurait dit : « Pourquoi peut-on jouer avec les allumettes avec Pierre et pas avec Paul ? », simplement parce qu’ille savait que chacun-e, enfant et adulte, réagissait selon ce qu’ille trouvait tolérable ou non pour ellui et qu’aucune loi générale, aucun Droit n’en découlait.
Souvent nous discutions par exemple de l’interventionnisme, certain-e-s parents se déclarant incapables de supporter les bagarres entre enfants, d’autres au contraire observant toujours la plus stricte neutralité, la plupart volant au secours de qui appelait au secours ; chacun-e réagissait comme bon lui semblait, sans se soucier du « qu’en-dira-t-on ». Aucune indifférence cependant, nous nous intéressions à ce qui motivait nos réactions, nous en parlions entre nous longuement.
Et tu te souviens, Marie, qu’il n’y avait pas plus de violence à la Barque qu’ailleurs. Se plaçant en dehors du Droit, chacun-e avait intérêt à vivre agréablement. C’est ainsi que certains actes étaient refusé-e-s par tou-te-s (boucher les chiottes en jetant des objets dedans) sans que cet accord ne prenne valeur de règlement. Certes, j’étais la première à me fâcher quand un-e petit-e expérimentait la chasse d’eau en essayant méthodiquement d’évacuer de la farine, des papiers, des outils, etc. Mais personne jamais n’a puni qui que ce soit. Car il n’était pas « interdit » de faire ceci ou cela ; simplement, cellui qui nous emmerdait devait bien s’attendre à ce que nous lui disions : « Ça me gêne », et quand je dis nous, je dis bien « nous qui étions directement concerné-e-s ». Nous aurions trouvé bien étrange que quelqu’un-e de passage s’en prît au-à la garnement-e- « boucheureuse » alors qu’ille n’aurait pas eu à utiliser ces lieux qu’on dit d’aisance.
Il n’était pas exigé des adultes ni des enfants de la Barque qu’illes aient les mêmes façons de vivre. Mais la confiance qui se créait au fur et à mesure que chacun-e osait être ellui-même et rien qu’ellui face aux autres a rendu possible ces quelques années de vie ensemble contre l’école.
Ainsi la question d’Avanzini sur autorité et liberté me semble déplacée. Il est certain que nous avions volontairement opté pour un autre mode de relation entre nous et que cela nous engageait nous et nos enfants dans une grande aventure. Mais il est faux que nous ayons choisi autoritairement d’imposer je ne sais quelle liberté. Nous cherchions simplement chacun-e à être soi et aucun principe – fût-il d’autonomie – ne régla notre recherche commune. Un-e enfant désirant aller à l’école n’avait de permission à réclamer à personne.
Nous savions, quel que fût notre âge, que nous ne vivions pas dans un monde libertaire. Personne, y compris les moins de quatre ans, n’a jamais été chez nous assez idiot pour nier l’existence de la société. Chacun-e suivant ses capacités de bravoure, de fuite, de cynisme, de paresse, d’habileté, se débrouillait pour vivre sa vie sans se faire écraser par les voitures ou la police.
De temps en temps, l’un-e ou l’autre des enfants tentait de faire dehors ce qu’ille pouvait faire chez ellui ou à la Barque sans risque : par exemple, à la piscine, des enfants de sept ans avaient décidé de nager nu-e-s contre tous les règlements, parfaitement conscient-e-s que les maîtres-ses nageureuses pouvaient les rappeler à l’ordre. Ce que celleux-ci ne firent pas. Par contre, les mômes et adultes qui marchaient sur les pelouses des jardins savaient que les gardien-ne-s interviendraient. Certain-e-s n’auraient jamais resquillé pour entrer au cinéma et personne ne se serait scandalisé de leur vertu, pas plus qu’à l’inverse on ne se serait autorisé une remarque sur quelqu’un-e qui aurait pu, en fraudant, « nuire à la réputation du groupe ». Parce que nous n’estimions nullement utile d’être perçu-e-s comme un groupe.
Nous nous aimions bien. Tout n’était pas simple mais au moins notre volonté de vivre toujours chaque situation comme nouvelle nous a permis d’éviter l’insupportable standardisation des rapports. Nous nous parlions et notre pensée n’a jamais été « arrêtée ». La vie vivait. Chaque événement était singulier.
Je ne sais pas si le mot « liberté » a un sens, mais je désire l’immensité du possible. La création de cet espace n’est jamais accomplie, elle ne s’effectue que pour autant qu’elle est un mouvement vers plus loin que la réalité. Je puis vouloir ce que je veux. Face aux contraintes biologiques ou sociales, j’accepte, ou refuse, ou compose, ou adopte n’importe quelle attitude. C’est moi le sujet de ma vie. Aussi simple que ça.
Que serait l’amour sous les lois et règlements ? Que seraient des amantes ou amants soumis à la société ? Ma vivante, puisses-tu t’entourer de gens dont tu tires comme moi joie et fierté. C’est la meilleure des choses que d’aimer, dans un monde non codifié, des êtres de tranquille insoumission.
[1] Si j’avais de l’argent, beaucoup d’argent, je quitterais l’école, M. Jakubowicz et C. Pougny, Maspero, 1971.
[2] Rapport 1979 de l’Inspection générale de l’Éducation nationale (Étude faite à partir de quarante et un collèges urbains en « situation difficile ».
[3] Cette manufacture horlogère de Besançon, que ses actionnaires suisses voulaient fermer, fut en 1973 le théâtre d’une grève puis d’une occupation d’usine qui eut un énorme
retentissement. Les salarié-es s’approprièrent l’outil de travail sur le principe : « on travaille, on vend, on se paie », au grand dam de presque tous les syndicats. Toute une génération a
défilé chez « les Lip ». L’usine a fonctionné ainsi en autogestion jusqu’en 1977.
[4] Note de i (2017) : Même si on déteste la justice, il nous semble important de
signaler que Léonide Kameneff, le fondateur de l’École en bateau (1969), a été condamné en mars 2013, à 12 ans de taule, par la
cour d’assises des mineurs de Paris, qui l’a reconnu coupable de viols
et agressions sexuelles de cinq enfants dans les années 1980 et 1990...
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.1 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.1 Mo)