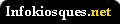C
Contre l’antifascisme, contre l’État
mis en ligne le 26 octobre 2005 - Collectif
Contre l’antifascisme
édito de SINmesura
Cela peu paraître un peu fort d’affirmer ouvertement et ainsi, d’entrée, notre opposition à cet artifice qui unit - de manière fictive, dans un monde d’apparence - tant de personnes autour de lui : l’antifascisme. Cela sonne fort, mais il nous faut parler clairement. Continuer à se taire face à la farce que quelques abusé-e-s, idéologues, popes, crétin-e-s et autres canailles qualifient de "mouvement antifasciste" serait, arrivés à ce point, soutenir tacitement ce "mouvement" et ce qu’il soutient : la Démocratie et le Capitalisme.
Nous ne voulons pas détruire le fascisme. Nous voulons détruire tout ce qui nous fait vivre une vie invivable. Nous ne jouons pas ; la lutte, l’intervention directe dans tous les aspects de la vie, l’attaque contre nos ennemi-e-s, ne sont pas des passe-temps destinés à remplir le temps "libre" que nous laissent le système et les obligations quotidiennes. Nous désirons ardemment changer la vie. Nous voulons être libres. Nous savons bien que changer la vie sans s’attaquer à une profonde et radicale transformation sociale, à une immense tâche de démolition, est impossible. Nous voulons, en définitive, la révolution sociale.
Et cela peut certainement paraître, en ces temps de tolérance et de consensus démocratique, une chose d’halluciné-e-s que de penser et de parler de révolution. Or, nous l’avons déjà dit : nous ne jouons pas. Qui se résigne à la misère quotidienne peut se permettre le luxe de continuer à faire l’imbécile en collaborant au maintient de ce monde de merde. Qui ne se résigne pas, qui ne se conforme pas avec cela, peut seulement faire une chose : penser, parler, faire la révolution.
L’antifascisme, dans tout cela, joue un rôle qui historiquement a été, et continue aujourd’hui à être, essentiel : faire combattre les exploité-e-s pour des intérêts qui ne sont pas les leurs, en les utilisant comme chair à canon entre les mains des différentes factions du pouvoir. Combattre l’antifascisme est essentiel si nous voulons lutter pour nos intérêts, nos nécessités, nos désirs et non pour les intérêts de nos exploiteur-euse-s.
Cette collection de textes ne prétend évidemment pas être une quelconque "vérité" ; il ne s’agit pas d’une "bible" à vendre ou à adorer. Ces textes existent pour être lus, pensés, discutés. Entre nous autres qui voulons tout changer, le débat est essentiel pour surmonter les nombreux obstacles - aujourd’hui plus nombreux que jamais - que le pouvoir place en travers de notre chemin, de notre lutte. Mais nous ne voulons pas d’un débat sans conséquences, d’une discussion de couloir pour rentrer chez soi "en y voyant plus clair". Si l’on n’est pas disposé-e à aller jusqu’au bout mieux vaut ne pas commencer. Si la réflexion ne se transforme pas en action ce n’est qu’une simple pirouette mentale, inoffensive, innocente, stupide. Nous voulons de la réflexion et de la discussion pour avancer dans la lutte, écartant les obstacles du milieu et identifiant l’ennemi avec chaque fois plus de précision. Nous nous retrouverons dans le processus de libération que chacun entreprendra. Nous cherchons des compagne-on-s, pas des troupeaux.
Une dernière clarification : ceci n’est pas un pamphlet "anarchiste". Nous sommes toutes et tous, pas seulement les anarchistes, coincé-e-s, soumis-es à l’exploitation et à la domination. La tâche de liquidation sociale est l’affaire de tout le monde et de chacun-e, et non pas de quelque minorité consciente que ce soit. L’émancipation des travailleur-euse-s sera l’oeuvre des travailleur-euse-s même ou, de fait, ne sera pas.
Sans plus, portez-vous bien.
Communisme ou Barbarie
mort à l’État, vive l’Anarchie
Ediciones SINmesura
L’antifascisme comme forme d’adhésion au système
Dire d’entrée que le fascisme autant que l’antifascisme ont joué historiquement un rôle contre-révolutionnaire et que les deux ont constitué et constituent une forme d’adhésion au capitalisme peut paraître un peu fort ou pour le moins étrange.
L’intention de cet article est d’essayer d’argumenter de telles affirmations ou au moins de provoquer un débat sur ce thème à la mode qu’est l’antifascisme.
Réexaminer l’histoire
Pour certain-e-s, l’histoire est la charogne des sociétés et les historiens leurs médecins légistes. Il s’agit peut-être là de l’histoire avec un grand "H", celle des facultés et des bibliothèques ; l’histoire que nous revendiquons n’est pas - ou ne devrait pas être - prétentieusement objective, elle est - ou devrait être - un outil critique pour comprendre le présent et le transformer.
À plusieurs reprises dans l’histoire les minorités aisées ont utilisé en moment de crise des mouvements folkloriques pour maintenir leurs privilèges, allant jusqu’à céder à ces groupes de pression le pouvoir politique. C’est le cas du fascisme pendant la période de l’entre-deux guerres. [1]
Après la guerre de 14-18 le capitalisme ne jouait déjà plus un rôle progressif, il ne développait plus les forces productives autrement qu’en provoquant des crises et des guerres. C’est dans ce contexte que surgira le fascisme, mais aussi l’antifascisme, tous deux poursuivant un but identique, bien qu’il puisse paraître contraire : sauvegarder les intérêts du capital impérialiste et écraser le prolétariat international.
La Guerre Civile espagnole illustre à la perfection le rôle contre-révolutionnaire de l’antifascisme.
Le 19 juillet 1936, dans plusieurs villes d’Espagne, les ouvrier-e-s ont barré la route à la rébellion militaire et ont lancé une dynamique d’expropriation de type clairement révolutionnaire. L’apogée de ce processus sera de courte durée, la constitution même du Comité de Milices Antifascistes (organisme interclassiste qui déplace le protagonisme des masses vers la direction des organisations) met en évidence l’attaque de la bourgeoisie antifasciste contre le prolétariat.
Le conclave de Burgos [2] et le gouvernement républicain de Madrid forment l’axe d’une même pince qui se referme sur la classe ouvrière.
L’Espagne ne sera pas le théâtre d’une guerre révolutionnaire, ni même d’une guerre civile, sinon celui d’une guerre impérialiste.
La bourgeoisie tant nationale qu’internationale, impliquée des deux côtés, règle ses comptes aux dépens du prolétariat.
Depuis la République, le message s’axe sur une politique de guerre. La guerre comme forme de restructuration du modèle capitaliste en crise et d’écrasement de la classe ouvrière. La guerre en Espagne servira de banc d’essai ; ce sera un avant-goût du même phénomène de restructuration qui sera vécu au niveau mondial (Seconde Guerre Mondiale). Un modèle capitaliste dictatorial s’imposera en Espagne (avec la complicité des démocraties occidentales et de l’URSS), tandis qu’après la Seconde Guerre Mondiale, dans le reste du monde, s’imposera un modèle capitaliste démocratique faussement opposé à un soit-disant bloc "socialiste" antagoniste. Le modèle dictatorial comme le modèle démocratique poursuivent un but identique : réajuster et maintenir le système d’exploitation. L’Espagne n’entrera évidemment pas dans le conflit mondial puisque le réajustement (via le triomphe dictatorial) a eu lieu avec anticipation.
Il est donc tout aussi logique, selon ce raisonnement, que les démocraties occidentales qui disaient lutter contre de le fascisme n’aient pas remis en cause le système politique (fasciste) espagnol après la Seconde Guerre Mondiale.
Durant la guerre d’Espagne, l’idéologie qui s’imposera, comme prétendue nécessité inéluctable, sera l’antifascisme : le frontisme et la collaboration de classe - incluant la chefferie (on ne peut pas les appeler autrement) de la CNT-FAI et les opportunistes du POUM se démarquant ainsi d’une politique réellement révolutionnaire et se pliant au pragmatisme d’une politique de guerre.
L’unité antifasciste n’est rien d’autre que la collaboration de classe. Le prolétariat, au lieu d’affronter ses ennemis (la bourgeoisie fasciste et antifasciste) dans une véritable guerre de classe, se verra obligé de servir de chair à canon pour les deux bourgeoisies avec la complicité de quelques un-e-s de ses "dirigeant-e-s les plus avancé-e-s".
Les événements de mai [3] à Barcelone se présentent clairement comme l’épilogue d’un désir frustré de communisme [4] d’une partie du prolétariat. C’est à partir de mai que l’on peut dire que la bourgeoisie (par la main de ses alliés staliniens) l’a emporté sur une révolution inachevée (les banques ne furent pas touchées, l’argent ne fut pas aboli, et surtout l’État ne fut pas détruit, bien au contraire : au lieu de ça quelques anarchistes allèrent jusqu’à se convertir en ministres). Le cadavre de Camilo Berneri [5] sera l’étendard d’un des crimes de l’antifascisme les plus évidents.
Les ouvrier-e-s espagnol-e-s furent massacré-e-s sous la bannière de l’antifascisme et luttèrent en définitive (sans le vouloir) pour le triomphe du capitalisme.
Le prolétariat international uni sous la même bannière ébaucha seulement le tracé d’une solidarité médiatisée. Sa seule manière de soutenir les ouvrier-e-s espagnol-e-s fut d’effectuer des actions de classe dirigées contre l’appareil économique et politique du capital. C’est pour cela que l’aide effective à l’Espagne révolutionnaire résida uniquement dans le changement radical des relations de classe au niveau mondial. [6]
Le fascisme aujourd’hui
Pour déterminer la fonction que remplit de nos jours le fascisme il faut déterminer quelle est la réalité dans laquelle il se déroule, qui n’est évidemment pas la même que celle des années 30.
La nécessité constante du développement des forces productives du capitalisme a mené celui-ci à une crise permanente.
La crise du modèle keynésien depuis le début des années 70 conduit à un dépassement graduel de ce modèle (l’État Providence) et, petit à petit, à l’extension d’un nouveau (vieux) modèle de libéralisme.
Actuellement les deux modèles cohabitent et/ou rivalisent entre eux dans le cadre mondialisé de l’économie de marché.
Cet état d’instabilité est susceptible de générer de graves dysfonctionnements. La substitution d’un modèle décadent par un autre à son apogée crée une situation de dérégulation et une forte résistance dans plusieurs couches de la société. À cela s’ajoute la supposée immigration massive comme cause de dysfonctionnement supplémentaire fruit de la mondialisation de l’économie et l’augmentation de l’exploitation dans les pays de la périphérie [7], ainsi que la marginalisation de grandes aires géographiques du marché-monde.
En fin de compte c’est là le cadre dans lequel situer le fascisme aujourd’hui. Sa mission y serait de faciliter la transition d’un modèle à l’autre, développant des politiques visant non à prendre le pouvoir (pas pour maintenant) mais plutôt à le fortifier et à le rendre totalitaire par le biais de lois répressives, sécuritaires, anti-immigration, etc. qui empêchent ou neutralisent les dysfonctionnements possibles (qui se traduiraient en révoltes cycliques ou en mouvements de résistance) [8] en conservant et en maintenant des formes de gouvernements formellement démocratiques mais en accentuant le rôle répressif de l’État capitaliste.
Le fascisme essaiera donc de "droitiser" la société en même temps qu’il la déstabilise pour justifier des mesures d’urgence de la part de l’État.
D’un autre côté surgit à nouveau la dichotomie démocratie ou fascisme (deux visages du même capitalisme) qui pousse à renforcer l’alternative démocratique face à l’éventualité fasciste, le capital sortant victorieux de ce faux affrontement. [cf. plus loin "Ni honte ni F-Haine !"]
L’antifascisme aujourd’hui
Ayant compris quel rôle joue le fascisme dans le cadre des relations sociales et économiques, nous pouvons comprendre la fonction que remplit son anti.
L’antifascisme adopte aujourd’hui (consciemment ou non) différentes facettes et fonctions :
L’antifascisme comme attitude esthétique
L’antifascisme n’est pas loin d’être une mode. Le manque d’analyse, de débat et de critique est manifeste. Au lieu de s’attaquer au problème de manière globale on essaie d’en bloquer les effets les plus palpables (violence de rue fasciste) en reproduisant, dans la plupart des cas, la même chose (violence de rue antifasciste).
Autour de l’antifascisme se crée et se recrée une esthétique de bande et de contenu limité menée par une violence stérile et grossière.
Il y a prolifération de groupes, collectifs, plateformes, etc., qui tentent de répondre à un phénomène sans en analyser les causes ou tout du moins sans les attaquer. Les actions a contra ou de caractère purement anecdotique comme les manifs du 20-N [jour anniversaire de la mort de Franco, le 20 novembre 1975, qui donne lieu tous les ans en Espagne à des manifs fascistes et des contre-manifs antifascistes, ndt] sont monnaie courante.
Au-delà il faut encore repérer l’image pathétique du mata-nazi [littéralement tueur-de-nazi, ndt] comme figure folklorique du mouvement qui trop souvent copie les attitudes et les schémas mentaux de ses victimes présumées, dans une tendance clairement militariste qui peut finir par prévaloir et entraîner tout le mouvement.
L’antifascisme comme lutte de distraction
Le fait de concentrer nos efforts dans la lutte antifasciste à un niveau partiel nous éloigne inéluctablement du point central de la lutte de classes : travailler à la conscience et l’auto-organisation de classe. L’antifascisme détournerait les volontés vers un problème concret fruit d’une situation globale.
On tombe vite dans des dynamiques de repression-action (difficiles à éviter) qui amènent le mouvement à concentrer son travail pour répondre à des agressions de groupes fascistes ou de l’appareil répressif de l’État lorsque les antifascistes sont réprimés.
L’antifascisme comme collaboration de classe
Le slogan "tou-te-s contre le fascisme" peut illustrer une tendance à la collaboration de classe. L’alliance, en plateformes et autres, avec les forces contre-révolutionnaires de la gauche capitaliste est évidente dans la plupart des cas. Un slogan si général peut être assumé par tous, de la gauche collaborationniste à la droite libérale (n’oublions pas qu’Antenne 3 s’est convertie en paladin antifasciste [9]) en passant par des groupuscules opportunistes (les restes du léninisme qui combattent le fascisme ici et qui soutiennent des alliances entre fascistes et "communistes" dans l’ancienne URSS).
L’histoire se répète à nouveau avec un scénario différent tandis que se développent des politiques frontistes qui entraînent un renforcement du modèle capitaliste sous des formes démocratiques parlementaires. On collabore à nouveau avec nos ennemis de classe, torpillant nos propres intérêts, pour défendre tou-te-s ensemble nos ennemis apparemment les plus directs et les plus atroces : les fascistes. [10]
Il en résulte qu’au lieu de faire la révolution quotidiennement nous nous allions avec ses ennemis.
L’antifascisme comme manière de renforcer l’État
Certains groupes antifascistes réclament des mesures étatiques et légales pour réprimer le fascisme : lois contre les groupes nazis, augmentation des moyens policiers, hautes peines de prison, etc. [11]
L’application de telles mesures joueraient difficilement en notre faveur, bien au contraire. De cette manière le rôle de l’État se renforce au niveau de la répression et son pouvoir se fortifie. Il est surprenant et alarmant que depuis nos rangs on donne des armes à notre ennemi le plus notoire : l’État. Il en est de même du fait de considérer que leurs lois puissent être notre sauvegarde contre ceux qui ne sont ni plus ni moins que leurs complices : les fascistes. [cf. plus loin "Censure et violence contre le FN : principes ou stratégie ?"]
Derniers mots
Cet article ne prétend pas faire une critique sanguinaire et sans nuances de tous les groupes antifascistes. On ne peut pas penser que ce mouvement soit homogène et également critiquable, mais il est nécessaire de commencer à critiquer, à analyser et en définitive à réfléchir à la réalité.
Globaliser les situations pour intervenir dans la réalité et la transformer est la tâche de tout-e révolutionnaire. Dans le cas contraire nous pouvons tomber (même sans le vouloir) dans le rôle de complices ou compagnons de route du système même qui nous opprime.
Cet article ne veut pas non plus dire que nous ne devons pas affronter le fascisme, mais bien éclaircir le fait que cette lutte est une partie (et pas fondamentale) de l’affrontement quotidien au Capital-État et non une manière de justifier son existence.
Salud y anarquía.
El Último de Filipinas, Alacant, 1996.
Pour en finir avec le fascisme et l’antifascisme : lutte de classes
1. L’essence de l’antifascisme consiste à renforcer la démocratie, dans une tentative de l’opposer au fascisme : une lutte qui ne serait pas dirigée contre le capitalisme mais qui aurait pour finalité d’empêcher qu’il ne devienne totalitaire. En diffusant cette utopie l’antifascisme tente d’occulter l’existence des antagonismes de classe. Dans la stratégie antifasciste il n’existe pas deux classes qui s’affrontent l’une à l’autre - le prolétariat et la bourgeoisie. Il n’existe pas non plus deux projets opposés : le communisme et le capitalisme ; l’abolition de la société de classes et l’imposition du travail sous la dictature capitaliste. Bien au contraire, la polarisation bourgeoise prévaut : "démocratie" contre "fascisme", "état légal" contre "état policier", "citoyenneté" contre "militarisation", "parlementarisme" contre "régime dictatorial". Le fascisme, dans la majorité des cas, est identifié à l’État Totalitaire. Les campagnes antifascistes (tout comme les campagnes fascistes) prétendent reconstruire l’unité nationale autour de l’État, comme une adhésion des prolétaires à la reproduction des relations sociales capitalistes. Aujourd’hui, comme hier, les idéologues du Capital tentent de recréer la polarisation entre fascisme et antifascisme, avec pour objectif de provoquer une guerre totale qui stimulera l’émergence d’un nouveau cycle d’accumulation capitaliste.
2. Le problème n’est pas que la démocratie offre une exploitation plus douce que la dictature, de telle sorte qu’il serait préférable d’être exploité à la manière suédoise plutôt qu’à la manière brésilienne. Le problème est que nous ayons à faire ce choix. Dans la plupart des cas tout ce que nous offre le capitalisme est choisir de quelle manière nous voulons être exploités ! Comme l’État est un organe dont la fonction est de s’adapter aux nécessités du capital, la démocratie se convertira en dictature si une telle chose est nécessaire.
3. Le fascisme tire ses origines de la situation qui l’a précédé : l’écrasement du processus révolutionnaire entre 1917 et 1921 par la social-démocratie européenne (Révolution russe, allemande, italienne, hongroise, bulgare...). C’est tout d’abord la social-démocratie qui désarme le prolétariat, idéologiquement et matériellement, et qui réprime militairement ses insurrections. En Allemagne les corps francs dirigés par le socialiste Noske rétablirent l’ordre bourgeois. Le fascisme, tout comme le stalinisme, se contenta de poursuivre le travail de la contre-révolution en massacrant le prolétariat précédemment défait ! La dictature apparaît toujours après que les prolétaires aient étés défaits par la démocratie. L’antifascisme occulte cette réalité en identifiant le fascisme comme "forces maléfiques" et en le réduisant à une "réaction irrationnelle" sans fondement historique venue d’on ne sait où. La crédibilité du fascisme des années trente peut être expliqué parce qu’il défendait en partie le programme de la social-démocratie : amélioration du niveau de vie, fin du chômage, ouvrages publics importants, etc.
4. La tactique essentielle de tous les fronts antifascistes est d’accuser de fascisme tous les partis politiques gouvernants. Ils substituent ainsi la critique de l’État par la dénonciation de ceux et celles qui le dirigent. L’antifascisme est la promotion et le renforcement de la démocratie et par conséquent de l’État !
5. L’antifascisme prend comme argument les massacres fascistes pour justifier la guerre. Il camoufle ainsi la réalité de la guerre qui est une nécessité du capital qui lui permet de détruire à court terme les forces productives existantes. Mais toute guerre nécessite une justification pour enrôler les prolétaires sous sa bannière. La lutte contre le fascisme servit pour justifier le massacre de 50 millions de prolétaires. Pourtant, même selon une analyse "impartiale" on est forcé de reconnaître que les camps de concentration nazis ne furent pas les uniques horreurs de la guerre : les bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagazaki, les bombardements assassins massifs sur les villes allemandes, le massacre de Sétif en Algérie en mai 1945, le même jour que "l’armistice".
6. L’accumulation du capital est nécessairement accompagnée de deux conditions principales : l’obéissance des travailleur-euse-s, qui sous-entend la destruction du mouvement révolutionnaire, et la concurrence avec les autres capitaux nationaux, en d’autre termes, la guerre. Chaque État produit son propre nationalisme, en compétition avec les nationalismes des autres États. Chaque nation prétend monopoliser des parties intégrantes du marché de la nation voisine. Tout nationalisme est impérialiste et par conséquent cause de guerres.
7. Le capital atteint la plupart de ses victoires quand les travailleur-euse-s se mobilisent en sa faveur en croyant qu’illes peuvent ainsi "changer leur vie". La différence entre dictature et démocratie consiste en la méthode utilisée pour subjuguer le prolétariat. La première recourt prioritairement à la force brute ; la seconde utilise le véhicule des organisations "propres" au prolétariat : syndicats, partis, associations...
8. Pour tous les réformistes, antifascistes inclus, la démocratie est considérée comme un élément du socialisme. Le socialisme serait la démocratie totale et la lutte pour le socialisme consisterait en un gain croissant de droits démocratiques à l’intérieur du capitalisme. Ainsi, contrairement à ce qu’il affirme, l’antifascisme renforce le totalitarisme qu’il dit combattre : sa lutte pour la démocratie revient à consolider l’État ! Pour les révolutionnaires, socialisme, communisme, et anarchie signifient la destruction totale des relations sociales capitalistes et par conséquent de leurs classes, de leur État, de leur démocratie. Notre lutte est dirigée contre le fascisme et l’antifascisme, ces deux faces de la même monnaie, cette double camisole avec laquelle le capitalisme nous emprisonne.
9. Les prolétaires, une fois qu’illes se laissent tromper volontairement et sous forme militante par le camp de la démocratie, de l’antifascisme et de l’État, perdent toute capacité à lutter de manière autonome pour leurs intérêts de classe. Illes cessent alors d’appartenir à la classe révolutionnaire en se transformant en chair à canon de l’État. Le mouvement autonome du prolétariat cesse d’exister à partir du moment où il s’intègre à l’État.
10. Le communisme est un mouvement qui s’étend et se radicalise si les prolétaires vont au-delà de la simple révolte (fut-elle armée) et détruisent les fondements du système capitaliste.
11. La guerre espagnole de 1936-39 fut utilisée pour polariser les prolétaires du monde entier derrière la fausse opposition fascisme/antifascisme préparant l’Union Sacrée antifasciste de 1939 à 1945. La bourgeoisie essaye tout le temps de former des alliances, polarisant intérieurement son propre camp et faisant en sorte que les prolétaires empoignent les drapeaux impérialistes avec un objectif unique : résoudre leurs problèmes avec la guerre !
12. En soutenant l’État démocratique pour éviter qu’il devienne dictatorial, l’antifascisme désarme les prolétaires idéologiquement et matériellement. Occultant et niant les antagonismes qui opposent le prolétariat à l’État, l’antifascisme manipule les prolétaires, les convaincant d’abandonner la lutte de classes ; mais l’ennemi, la bourgeoisie elle-même, décide de son côté de la mener jusqu’au bout. C’est ce qui s’est passé en Espagne lors des sanglantes batailles de Barcelone, en mai 1937. En dernière instance, c’est l’absence d’une rupture des révolutionnaires prolétaires avec l’antifascisme - et plus généralement avec la social-démocratie - qui les mènent à la défaite et à la mort.
13. Les révolutionnaires prolétaires ont compris que la guerre d’Espagne ne fut pas autre chose que la répétition générale et la justification de la guerre mondiale de 1939 à 1945. Lorsqu’ils ont accepté l’Union Sacrée contre l’Allemagne nazie, les prolétaires finirent en remorque des démocraties impérialistes voyant en cela un moindre mal en comparaison d’une éventuelle victoire fasciste. Une des fonctions idéologiques très importante de la guerre d’Espagne fut de polariser tout le monde autour de l’alternative "démocratie" ou "fascisme", qui correspondait à chacune des bandes d’assassins capitalistes, la présentant comme étant l’unique alternative possible. En 1936, comme en 1940 et avant cela en 1914, c’est la social-démocratie qui a mobilisé les prolétaires pour la guerre.
Dictature et démocratie
Contrairement à la répandue mythologie de gauche, les formes politiques démocratiques et dictatoriales se succèdent et se génèrent réciproquement, sans intervention directe du prolétariat. Les dictatures n’arrivent pas au pouvoir après avoir vaincu les exploité-e-s insurgé-e-s au cours de luttes de rue : ce sont les démocraties et tout le mouvement réformiste (politique et social) qui battent les révolutionnaires, avec les armes et l’escroquerie électorale. Cell-ui qui fait de la réaction militaire le croque-mitaine, comme si c’était l’unique forme de contre-révolution, doit réfléchir au fait qu’on ne met pas le prolétariat en déroute avec l’action militaire seule. C’est lorsque le prolétariat est déjà vaincu socialement que la contre-révolution devient militaire et par conséquent violente. Le fascisme italien s’est heurté aux travailleur-euse-s agricoles et industriel-le-s, mais il n’a triomphé qu’après que les travailleur-euse-s aient été divisé-e-s par les votations, par les tentatives de conciliation des socialistes et par l’intervention matérielle de l’État démocratique.
Les dictatures ne tombent pas sous les coups des masses enfin insurgées contre la tyrannie. Elles cèdent d’elles-mêmes leur place à la démocratie. En Italie ce fut le régime lui-même qui retira les pouvoirs du "dictateur" Mussolini, ce fut le régime qui décida un retour progressif à la démocratie, prenant à cette fin contact avec les partis de l’opposition jusqu’alors proscrits et ouvrant des négociations avec les Alliés pour préparer le changement. En 1945, en Allemagne, ce fut la défaite militaire qui fit tomber le régime, que les Alliés remplacèrent par leurs propres dirigeants, aussi bien à l’Est qu’à l’Ouest, avant que les dirigeants "nationaux" ne reprennent les rênes du pouvoir. En 1975, en Grèce, la chute de Chypre et la pression américaine obligèrent les Colonels à laisser la place aux démocrates (ceux-ci étant par ailleurs bien de droite) qui attendaient leur tour en exil et qui allèrent, naturellement, occuper leur nouvelle place. Quelque chose de similaire eut lieu au Portugal et en Espagne. Plus récemment, quelques factions du pouvoir dans des pays comme le Chili, les Philippines, ou l’Afrique du Sud ont compris que la vielle formule politique n’était plus soutenable et ils ont pris l’initiative d’un changement de régime pour le rendre plus "doux", processus toujours en cours. Malgré, et grâce à quelques oppositions encore présentes, la mise en marche d’une démocratisation progressive, contrôlée et plus raisonnable peut déjà être considérée comme étant inévitable dans différents pays.
Il y a une logique aussi rigoureuse dans les "suicides de la démocratie" que dans les conséquents "retours" à la démocratie. Il ne s’agit de rien de plus que d’une répartition des tâches et d’une concentration dans le temps de la violence nécessaire pour liquider l’opposition qui fait obstacle à la bonne marche du système. La politique, entendue dans le sens classique de "l’art de gouverner", a toujours considéré la dictature comme un moyen exceptionnel adopté par l’État en cas d’urgence extrême, comme une guerre civile ou une grave crise économique et sociale. Dans de telles circonstances le pluralisme démocratique, le parlementarisme, les partis de masse et les syndicats - qui à d’autres moments sont eux-mêmes efficaces pour contenir une poussée révolutionnaire - peuvent créer une situation de confusion, qui ne soit pas réellement révolutionnaire, mais qui empêcherait une réinstauration rapide et adéquate de l’ordre. La dictature devient donc fondamentale pour discipliner la société, développer l’économie, apaiser les antagonismes engendrés, imposer la paix sociale. L’un des caractères essentiels de la dictature est la concentration de tous les pouvoirs - politique, militaire, économique, administratif - entre les mains d’un seul individu ou d’un petit groupe à l’arbitrage duquel on laisse entièrement le contrôle et la gestion de la nation.
Sans contrôle ni contrat de type légal, la dictature n’a rien à craindre des situations embarrassantes pendant son activité de gouvernement et peut user d’une main de fer pour sortir de la crise.
Le fascisme fut un exemple de cette concentration forcée dans des pays - comme l’Italie et l’Allemagne - où l’unité politique était fragile, dont la "question nationale" était mal résolue, et où le mouvement ouvrier réformiste avait pris trop d’importance à la suite des moments révolutionnaires qu’il avait freinés (l’occupation des usines en Italie et le mouvement des conseils en Allemagne).
L’antifascisme veut pousser le pouvoir, selon le cas, à devenir ou à demeurer démocratique, pour se débarrasser de sa forme dictatoriale. Mais les formes politiques de l’État dépendent des nécessités du moment : les partis réformistes, les travailleur-euse-s, les masses ne peuvent rien y faire, en supposant qu’illes veuillent faire quelque chose. Il n’existe pas un "choix" vers lequel les travailleur-euse-s pourraient se diriger ou être dirigé-e-s par la force. À certains moments, l’organisation étatique ne peut pas continuer à être pluraliste, elle doit centraliser par la force les composants de la société, les faire converger sous une direction unique. Mais cet excès de pouvoir des gouvernements dictatoriaux détermine leur caractère provisoire. Un pouvoir excessif et sans contrôle, étant particulièrement influencé par les qualités des individus qui l’incarnent, est beaucoup plus sujet à commettre des erreurs qui le condamnent à mort. De plus, avec le temps qui passe, la dictature se crée beaucoup d’ennemi-e-s y compris au sein des classes les plus aisées, lesquelles - une fois passé le péril qui rendit nécessaire l’instauration de la dictature - ressentent la nécessité de se libérer de l’absolutisme, afin de profiter des privilèges et du pouvoir.
C’est alors que la démocratie reprend les rênes de l’État. Voilà pourquoi dans ce jeu d’alternances la dictature apparaît simplement comme une espèce de "cure" pour une démocratie malade, une terrible suée pour calmer la fièvre.
Le secret du passage de la démocratie au fascisme, et vice-versa, peut se résumer facilement dans la formule : "changer de régime pour sauver l’État". De fait c’est exactement ce que font en alternance l’avènement des dictatures et le retour des démocraties à la tête de l’État - qui même ainsi sont présentées à chaque fois comme une "victoire de la classe laborieuse". Cette imposture est devenue possible du fait que toutes deux, dictature et démocratie, sont présentées comme dépassement d’une situation sociale déjà insupportable : "mieux vaut la dictature que le désordre social et mieux vaut la démocratie que la tyrannie".
Ces deux formes de gouvernement ne sont pas seulement similaires parce qu’elles correspondent toutes deux à une nécessité contingente de l’État, elles ont davantage de choses en commun. Par exemple tous les régimes organisent, à plus ou moins long terme, un simulacre de vie parlementaire. Méprisant envers le "parlementarisme pourri", Hitler maintient jusqu’au moment de la guerre une fiction de Reichstag souverain. En 1939, il lui fait voter la déclaration de guerre, non sans d’ailleurs recourir à un subterfuge ridicule : trop de députés étant absents, il fait occuper les places vides par des fonctionnaires du parti. Staline - et plus tard les démocraties populaires - ont dû reproduire les formes électorales, vidées de leur sens. Le parti unique n’était pas le seul en lice, il y avait des candidats "sans parti" et, dans les démocraties populaires, des partis satellites différents du PC - tout cela pour obtenir un résultat positif quasi-unanime.
La force-nécessité du régime ne consiste pas seulement à trouver les chefs ou une majorité, mais aussi une opposition, de se doter d’un lieu où mettre ses incertitudes en scène. La vie politique dans son ensemble est modelée selon cette nécessité. Dans les pays démocratiques est en vigueur l’alternance de partis dont les actions sont peu s’en faut identiques, mais qui ont la valeur non dédaignable de représenter des solutions différentes. Le pluralisme démocratique tant vanté n’empêche de toute manière pas la présence de personnalisme qui ne sont pas par hasard considérés comme de "petites dictatures". Le cas de politiciens comme Andreoti [12] ou Craxi [13] en Italie est exemplaire, et on doit remarquer comment la critique de leurs agissements est précisément menée au nom de la démocratie.
Que l’on puisse profiter de ces "évolutions" pour manifester sur un terrain subversif ou simplement pour mettre en difficulté les rationalisations du pouvoir politique et économique ne doit pas être exclu, mais cela n’assure pas une perspective révolutionnaire dans la mesure où rien n’est proposé au-delà de l’opposition démocratie/dictature. Le pouvoir n’est jamais aussi fort que lorsqu’il réussit à mobiliser les masses en sa faveur, en les convaincant qu’elles combattent pour elles-mêmes.
La tension sociale présente aujourd’hui en Italie peut-être considérée comme un exemple clair. Si la forte "crise" économique, toujours en cours, qui a provoqué des licenciements massifs, des grèves, des affrontements plus ou moins violents - au moins en apparence - paraît d’un côté troubler les doux rêves du Ministre de l’Intérieur, elle montre d’un autre côté son inoffensivité à partir du moment où est revendiqué le droit au travail, exactement ce sur quoi se basent le Capital, l’État, l’exploitation. Moyen de gagner sa survie dans une relative indifférence au "que-faire pour ça", l’état de salarié nécessite une organisation externe au travail, une organisation qui soit un encadrement contre la fuite en avant qui laisserait le travail derrière. Un organe externe est nécessaire pour recomposer l’unité de la production et en assurer l’exécution, et cet organe est l’État. Demander du travail signifie demander la présence de l’État.
Sans la revendication de l’abolition de l’État, l’anticapitalisme c’est du pipeau !
Il y a belle lurette que l’anti-étatisme ne fait plus recette. Dans les États développés, il faut remonter autour de 1968 (en France, Allemagne, ... et surtout en Italie) pour assister au dernier assaut contre cette pieuvre à deux têtes (État/Capital) aux cerveaux complémentaires et inter-dépendants. Et encore, d’autres analystes remontent avant 1939, c’est à dire avant la seconde guerre mondiale ! Aujourd’hui, les "anticapitalistes" se ramassent à la pelle, mais cet anti-capitalisme ne montre du doigt que le libéralisme (comme il a évolué au cours du dernier siècle, on ajoute le préfixe "néo" afin de faire plus "branché" !), c’est-à-dire les formes privées prises par le capitalisme en particulier les multinationales qui, soit dit en passant, ont quasiment toutes leurs centres (cerveau et moelle épinière) dans un seul État développé (États-Unis ou États européens ou Japon). Quant aux anti-étatistes, existent-ils encore ?
L’ État ? Qui le conteste aujourd’hui ?
Formellement, aujourd’hui, aucun mouvement social ne le conteste puisque quasiment tous ces mouvements s’adressent à l’État en tant que super médiateur dont ils ont intégré la soi-disant indépendance entre le travail et le capital. Ils demandent à L’État, aux "pouvoirs publics" comme aiment l’appeler les syndicats représentatifs (dont la représentativité a été donnée par qui à votre avis ?), de garantir des plans sociaux, de pallier aux "carences" d’un patronat que l’État désignera dans certains cas flagrants de "voyou" alors que c’est un magnifique pléonasme... Ils demandent même à l’État de subventionner le patronat privé afin que celui-ci crée des emplois quitte ensuite à dénoncer ce même patronat subventionné quand celui-ci décide, après en avoir largement profité, de mettre la clé sous la porte, de délocaliser géographiquement la production ou de chasser sous d’autres terres de nouvelles subventions. En répertoriant les entreprises qui se présentent pour reprendre telle ou telle entreprise en difficulté (et ceci au niveau mondial), on s’aperçoit qu’une fraction du patronat est spécialisée dans ce type de sport, comme ce fut hier, en France, le cas d’un certain Bernard Tapie. C’est un créneau comme un autre ! Comme nous allons le voir plus loin, l’État ne peut pas être neutre car c’est déjà à lui seul une entreprise capitaliste en tant que telle, une structure dont la fonction principale est de valoriser le capital, d’accompagner le capital, de le cadrer par un appareil judiciaire afin que celui-ci ne soit pas amené, dans sa logique perpétuelle de croissance et de développement, à détruire fondamentalement toute forme de vie dans notre galaxie et surtout à maintenir sur les rails les conditions de sa propre reproduction.
L’État, ce sont les allocations diverses et multiples qui permettent aux personnes les plus pauvres de nos pays de survivre via les organisations caritatives (secours populaire et catholique, restos du coeur, ...) mais aussi et surtout de consommer car le capital a besoin d’écouler ses marchandises afin de toucher les dividendes de la plus value créée par le travail humain et réalisé par la contribution directe (comme tout le secteur des transports) ou indirecte (formation, éducation, ...) d’un certain nombre de travailleurs qui peuvent avoir le statut public (travailleurs de l’entreprise État, dit "fonctionnaires") ou privé suivant les intérêts fondamentaux du capitalisme qui sont : faire du fric, posséder, dominer... Cette survie donnée aux plus pauvres a une contrepartie terrible :le contrôle social qui permet à l’État, pour le bien être du capital, de contrôler cette masse dont la fonction n’était hier que de produire et qui est aujourd’hui "délaissée" au profit d’autres populations exploitées, souvent, mais pas seulement (voir le travail au noir dans nos sociétés dites développées), sous d’autres latitudes. Ce contrôle social pour se faire accepter par les "clients" et les travailleurs sociaux se justifie toujours en référence à la citoyenneté où les "droits" (manger, se vêtir, se loger) ne peuvent exister qu’en contre partie de "devoirs" (chercher et accepter n’importe quel travail, tenue propre de son logis, savoir s’occuper de ses enfants suivant des normes idéologiques prédéterminées, ...) dûment contrôlés avec rapports écrits à l’appui ! C’est ainsi que des travailleurs sociaux communaux ont les clés des appartements alloués par la mairie à des familles en difficultés sociales afin de contrôler le contenu de leur frigo, la tenue de leur linge, le ménage, la vaisselle, les lits, ...
Que l’État soit sollicité sur des questions liées à la propriété donc à un capital, à des rapports entre individus et institutions étatiques ou para-étatiques, cela se comprend puisqu’il est directement concerné. Le problème est que dans ce cas les dés sont pipés dés le départ puisque c’est l’État qui a fixé les règles même s’il a dû, dans certains cas (non fondamentaux, on élimine ainsi les grandes décisions de l’aménagement du territoire, le nucléaire, les OGM, l’industrie militaire, ...) et dans un temps qui restera limité, tenir compte d’un rapport de forces issu d’une lutte collective. Dans nombre de luttes où des individus concernés se sont regroupés dans une collectivité, au niveau social mais aussi au niveau de l’écologie, de la remise en cause du patriarcat, ...ces recours à l’État sont bien souvent synonymes de délégation de pouvoir (donné à des élus fantoches qui seront dénoncés plus tard mais trop tard !), de renoncement à l’action directe - c’est à dire à l’affrontement direct -, de capitulation.
L’État c’est aussi et surtout cette super-médiation entre individus ! Dès qu’un problème surgit, la justice est saisie afin "d’arbitrer" tel divorce, garde d’enfants, rapports de voisinage, ... Cela concerne tous les rapports privés entre individus ! C’est peut-être là que sa légitimité est le plus reconnue car aucune autre force extérieure aux conflits inter-individuels, médiatrice, a su s’imposer hormis certains pouvoirs comme par exemple le pouvoir médical ou paramédical qui d’ailleurs sont sous contrat, d’une façon ou d’une autre, avec l’État. On ne peut que constater que l’État pallie aux replis d’autres médiations comme la famille, la communauté ethnique, religieuse ou sociale. Ces replis s’expliquent, ici, par l’évolution de l’exploitation capitaliste qui insinue toujours plus profondément sa logique dans tous les aspects de l’existence de l’individu et du collectif mais ces médiations de l’État n’ont jamais été satisfaisantes, c’est le moins que l’on puisse en dire, car liées aux développements des forces productives, au patriarcat, au colonialisme, ...soit plus globalement à l’aliénation et à la domination ! Dans une société communiste libertaire, se posera ce problème de gestion des conflits inter-individuels non nécessairement uniquement dépendants du mode de production, de la répartition des richesses, de l’abolition des classes, de l’abolition du patriarcat (ou de leurs avancées !) et les solutions, même avec l’apport de la psycho... quelque chose, ne seront pas évidentes à trouver et à mettre en place même si cela sera plus palpitant que ce que nous vivons actuellement....
L’État totalitaire
Disons le tout de suite, il n’est pas totalitaire seulement parce qu’il assume des fonctions répressives au niveau policier et juridique. L’État n’est d’ailleurs pas le seul à assumer ces fonctions de répression pour le capital quand nous connaissons le nombre de milices privées et leurs rôles dans maintes et maintes luttes ouvrières du 19ième siècle à nos jours !
"État policier" est un pléonasme mais son niveau répressif dépend toujours de plusieurs facteurs :
– De ses gestionnaires à un moment donné qui tiennent à garder le pouvoir politique de gestion des affaires de l’État, des Régions, des Cantons et des Municipalités qui ne l’oublions pas, pour plus de 3000 d’entre elles en France, ont leur propre police privée. Dans ce cadre la recherche d’un bouc émissaire joue un très grand rôle et dans tous les cas ce sont toujours les exclus directs de la citoyenneté, c’est-à—dire ceux et celles qui n’ont pas la nationalité, ou indirects pour ceux et celles qui n’ont pas les moyens économiques, sociaux, culturels d’exercer cette citoyenneté formelle au moyen de lobbies influents qui sont utilisés.
– De l’état de délabrement de certaines parties de la société civile par rapport à la situation antérieure.
– Du degré des luttes sociales, de leur intensité, des revendications avancées par celles-ci intégrables ou non, à court terme, par le capitalisme où l’État pourrait servir de médiateur, de financeur, de force paritaire, ...
Ces fonctions répressives sont très loin d’être les seules car si l’État est total c’est aussi dans le sens où il est devenu l’agent principal instantané et bien souvent unique de la socialisation des individus.
Comme nous l’avons dit plus haut, il encadre quasiment toute notre vie individuelle ou collective au niveau social, politique et même culturel. Il absorbe toutes nos relations jadis privées pour les institutionnaliser en organes de l’État ou dépendant de celui-ci (syndicats, associations, Organisations Non Gouvernementales). Ce totalitarisme est passé dans les moeurs à tel point que plus les gens sont dépouillés par le système capitaliste plus ils attendent de l’État et font appel à lui.
Les étatistes
Dans ce cadre on peut se demander pourquoi des mouvements politiques, associatifs, syndicaux, ... les plus divers mais toujours globalement de gauche, constatent le désengagement de l’État, en appellent à son renforcement et fondent leur stratégie électorale de lobbying là-dessus alors qu’il est évident que l’État n’est jamais autant intervenu socialement ? Bien sûr, on est passé de prestations sociales d’assurance (assurance chômage, assurance maladie) à des prestations sociales dites universelles (RMI, CMU, etc.), ce qui fait dire à certains que l’État n’est plus ce qu’il était. En fait ce qui a changé ce sont,ici, les formes d’exploitation non plus seulement liées à la production directe d’objets. On s’aperçoit que l’État n’est plus ce qu’il était que par rapport à la période antérieure où il était surnommé "l’État providence". Notons que cet "État providence" n’a duré qu’une trentaine d’années maximum ("les trente glorieuses"), une période donc très courte qui ne sera plus bientôt qu’un lointain souvenir pour les anciens. Cette période constituait l’application des méthodes américaines du New Deal et du Keynésianisme (pour sortir les USA de la crise de 29) à l’Europe occidentale de l’après-guerre, pour dégager un marché de consommateurs face à une Europe de l’Est sous la botte stalinienne mais censée représenter le paradis des Prolétaires. Il n’a touché que les États où le capitalisme était développé et n’aurait pas existé sans l’accaparement impérialiste des richesses mondiales, tout particulièrement des matières premières. Dans cette période l’État a développé le capital financier, notamment par la dette publique payée par les impôts. La bureaucratie a enflé et la fiscalité est devenue écrasante. L’État fut très actif par rapport au capital financier au niveau organisationnel mais il n’est jamais maître de la monnaie (voir les taux annuels d’inflation difficilement maîtrisables par les gestionnaires de l’État même s’ils étaient des économistes de renommée mondiale comme un certain Raymond Barre en France), ni d’ailleurs de l’accroissement de la dette publique. L’État providence fut marqué par un élargissement de la consommation dans les métropoles centrales du capitalisme qui est une nécessité pour le capital car l’extension du machinisme décuple la production beaucoup plus vite que le nombre de consommateurs. Cette période peut paraître à certains idyllique mais l’État a organisé, encadré le consensus social minimum afin que se reproduise cette société capitaliste. On oublie bien souvent de dire que même dans les États capitalistes concernés par cette "providence" capitaliste (Europe de l’Ouest, Amérique du Nord) il y a une fraction non négligeable de la population qui en restera toujours exclue ! Cette période, une parenthèse dans l’histoire du capitalisme, ne pouvait pas durer car l’augmentation de la productivité (le machinisme) diminuera sans cesse le travail vivant dans ces métropoles sapant ainsi la base fondamentale de la production de la plus value.
En fait tous ces étatistes de gauche en sont restés à l’idée d’un État indépendant (avec l’avènement du suffrage universel très progressif puisqu’il a duré près d’un siècle, de la moitié du XIXe siècle à la moitié du XXe siècle pour la plupart des États des métropoles capitalistes) au-dessus des classes, n’ayant plus rien à voir avec son image précédente d’État bourgeois. Il suffit donc d’en prendre "démocratiquement" le pouvoir (comme l’ont théorisé très tôt les sociaux-démocrates allemands) ; ils y arrivent d’ailleurs périodiquement depuis plus d’un siècle avec les résultats fondamentaux que nous savons. Leur dernière invention aura été de reprendre l’idée d’un économiste américain, un certain Tobin, de taxation des opérations financières effectuées sur le marché des changes proportionnelle au montant de l’opération effectuée. Cette proposition étatique de Tobin avait pour but de limiter la casse en cas de dérive du capital afin de sauver celui-ci. Ce prof d’économie, profondément pro-capitaliste, s’est toujours demandé, de son vivant, pourquoi la gauche française voire européenne s’était emparée de son idée. Cette proposition, qui d’ailleurs sera peut-être adoptée un jour par les États, entre dans le cadre d’une des fonctions des États qui est de limiter les excès du marché car le capital est capable dans sa logique de détruire complètement la société !
Ces étatistes entretiennent l’idée que l’État aurait en charge "l’intérêt général", mais que dépossédé de son pouvoir de décision par ce libéralisme débridé dans le cadre de la "mondialisation" il serait acculé à une course éperdue en faveur des gros investisseurs.
En fait, il y a méprise sur la marchandise depuis l’éclosion des États Nations ! Cette méprise ne peut plus s’expliquer par des choix stratégiques afin d’arriver au communisme intégral, datant de la moitié du XIXème siècle, entre ceux qui pensaient avec Marx qu’on pouvait utiliser l’État qui dépérirait ensuite et ceux qui avec Bakounine pensaient qu’on ne pouvait utiliser un outil dont la fonction primaire était déjà à cette époque la sauvegarde du capital et qui ne pouvait que se renforcer. L’Histoire aura donné raison aux seconds mais cela ne suffit pas !
Au fait, l’État c’est quoi ?
C’est au départ un pouvoir extérieur à la société civile constitué d’individus isolés mais propriétaires ou de privilégiés comme les aristocrates de cour en rupture avec les anciens nobles qui guerroyaient mais ne travaillaient pas sous peine de déchoir. Sa fonction primaire fut d’organiser les conditions du marché, l’unité des individus/bourgeois séparés. Cette force politique, au sens premier du terme, a eu pour fonction, dès sa naissance, de créer les conditions afin que le capital puisse se développer sans entraves. Au départ et jusqu’en 1848 au moins il ne peut être aux mains que des bourgeois puisque les "gueux" n’ont pas le droit de vote (suffrage censitaire, réservé aux riches). Jusqu’à la Commune de Paris (1871) l’État n’a qu’un rôle coercitif vis-à-vis des ouvriers qui oeuvrent, non pour en changer son personnel dirigeant, mais pour tout simplement l’abolir. Puis son rôle va se diversifier, il va légiférer des droits comme celui du travail, sociaux, etc. afin de calmer, d’intégrer, de canaliser puis d’assimiler les exploité/e/s. Mais sa principale fonction a été et est toujours la reproduction du capitalisme, la valorisation de celui-ci. Bref, comme le dit si bien Tom Thomas dans son livre "L’État et le Capital, l’exemple français" [14] : "Il n’y a pas deux politiques de l’État, l’une dite libérale en faveur du capital et de la création des richesses, l’autre dite sociale et droit de l’hommiste en faveur du travail et des individus. Mais une seule politique globale de valorisation du capital qui intègre le social, la réforme, comme moyen pacifique de soumission du travail au capital mais tenant bon sur l’essentiel : La division sociale du travail (la propriété), l’argent, le salariat, l’État.". "... L’aliénation des individus lui permet de se donner des apparences démocratiques. Démocratie purement formelle puisque le peuple est dépouillé de toute puissance et de tous moyens qui lui soient propres dans sa vie réelle, son double politique, le citoyen, ne peut être alors qu’une vraie potiche".
L’État moderne est aussi une entreprise capitaliste gérée par une bureaucratie et une technocratie inamovibles sans oublier la classe politique. Tout ce beau monde en retirant des avantages substantiels. Le capital de cette entreprise est essentiellement son territoire qu’il fait fructifier, ses infrastructures de circulation même s’il en donne de plus en plus l’entretien quotidien au secteur privé. Il vend au privé leur utilisation. Quant à ses marchandises ce sont les aides financières, techniques, scientifiques, administratives, que les capitalistes privés lui achètent en payant ces services et bien entendu des impôts.
Le fric investi par l’État revient dans ses caisses multiplié x fois même si ces profits sont longs à apparaître. La privatisation de ses services publics ne change rien à ce processus car l’État reste maître du territoire, des infrastructures de distribution (principaux axes routiers, chemin de fer, de distribution de toute l’énergie...). Ainsi, l’entreprise État a des liens constants d’échange capitaliste avec le privé [15].
L’État est lié à la société civile, il en est même indissociable, il en est même un produit, à tel point que sa prise de contrôle par le suffrage universel a été et sera toujours vaine quant à aboutir à un réel changement de société. Si on veut changer ce monde, l’État ne sera jamais un moyen, et l’anticapitalisme n’a de sens que s’il est aussi anti-étatique (la réciproque étant évidemment vraie).
L’anti-étatisme a peut-être un avenir...
La dépendance de l’immense majorité des gens vis-à-vis de l’État implique de fait une adhésion à l’État qui a rendu caduque pendant des décennies une opposition entre État et "société civile".
Mais nous assistons aujourd’hui à des phénomènes qui doivent nous faire réfléchir. Au niveau électoral, il y a de plus en plus de candidats, représentant un échiquier de plus en plus large au niveau idéologique et qui ne se cantonnent pas dans ce domaine car on peut y trouver tous les corporatismes que la société engendre. Et pourtant il y a de moins en moins de votants ! Beaucoup d’analystes pensaient que ce phénomène abstentionniste serait limité dans le temps, rien n’indique que cela sera le cas quand on sait qu’aux dernières présidentielles, un pseudo danger fasciste, bien orchestré, manipulé, médiatisé à l’extrême (qui a fait voter pour Chirac nombre de militants au label révolutionnaire, il est toujours bon de le rappeler !) n’a pas fait descendre le taux d’abstention à moins de 20%, un record pour ce type d’élections. Et pourtant il y aurait eu paraît-il un "sursaut républicain"... qui a fait plouf quelques semaines plus tard aux législatives ! Décidément, une forte proportion de citoyens formels ne croit plus à cette démocratie représentative car tout simplement ils ne se sentent plus représentés (contrairement à une époque où le PCF faisait 25 % !).
L’immense majorité des gens qui ne votent plus est constituée d’exclus de la "citoyenneté" réelle. Bien sûr l’adhésion à l’État ne se limite pas à la participation aux élections de son personnel gestionnaire. Bien sûr on peut arriver à un système électoral avec seulement 50 % de votants comme aux États-Unis. Mais néanmoins, l’idée que, quels que soient ses gestionnaires, l’État sera toujours du côté des possédants et l’idée que changer le personnel de l’État ne peut changer quoique ce soit, progresse ! Bien sûr on en est à un stade où une masse grandissante de gens ressent l’État comme étant simplement impuissant et le fait que l’État soit l’organisateur du capital est encore loin d’être ressenti. Une majorité, afin de résoudre ses misères, demande encore et toujours un État plus fort, plus répressif sans se rendre compte qu’elle va en être la victime, que l’État va de plus en plus cogner, enfermer, ... sans contre partie sociale hormis le minimum de survie, le tout étant lié aux difficultés croissantes de la valorisation du capital.
Le réel changement de société avec comme moyen la révolution peut devenir ou revenir de plus en plus à l’ordre du jour. En toute modestie, nous devons nous y employer tout en sachant que la masse des prolétaires devra rester maître de son destin tout en prenant en compte tous les aspects de la domination (patriarcal, économique, colonial, ...) si nous voulons nous libérer de toutes les formes de domination et d’aliénation.
Denis (OCL Reims), article paru dans le hors-série n°9 de Courant Alternatif, 2ème trimestre 2003.
Censure et violence contre le FN : principes ou stratégie ?
L’expulsion par la force, puis la mise à sac (partielle) du stand du Front national lors du dernier salon du livre, a provoqué un débat sur lequel il n’est pas inutile de revenir. La situation se représentera en effet à de nombreuses reprises dans les temps qui viennent. Les questions posées sont de deux ordres. Du point de vue des principes, tout d’abord, est-il "démocratique" ou moralement défendable de demander ou d’imposer "l’interdiction" des livres ou des journaux fascistes ? N’est-ce pas utiliser les mêmes méthodes que l’adversaire ? D’un point de vue tactique, ensuite, est-ce faire le jeu du Front ?
Je suis absolument hostile, j’ai eu l’occasion de le répéter à maintes reprises, à toute espèce de censure d’État, sans aucune exception possible. Ni Mein Kampf ni les livres pédophiles ou pornographiques, ni la Bible ni Suicide, mode d’emploi, pour prendre quelques-uns des exemples qui viennent à l’esprit des censeurs démocrates. Mais il s’agit bien de savoir pourquoi !
La première raison est que je me refuse de déléguer mes colères ou mes dégoûts à mes ennemis. Si je peux être amené à porter plainte contre les militants FN ou des policiers agresseurs, ou contre tel écrivain ou journaliste diffamateur, je n’entends pas confier aux tribunaux le soin de trancher des débats théoriques, historiques ou moraux ou celui de décréter une vérité officielle, dont je suis adversaire par principe.
Je ne me place pas du point de vue d’un droit naturel abstrait à la libre expression de toute entité vivante dans la galaxie (ce qui devrait en effet inclure M. Le Pen), mais du point de vue de la stratégie révolutionnaire. Il serait naïf et dangereux de venir réclamer au ministre de l’Intérieur des mesures coercitives contre tel de nos adversaires, alors que l’expérience historique montre qu’une loi votée contre les fascistes servira immanquablement demain contre les révolutionnaires. Dans les années soixante-dix, la Ligue communiste a ainsi été dissoute en application d’une loi votée dans les années trente contre les ligues fascistes... Aujourd’hui, le summum de l’imbécillité "démocratique-radicale" est de réclamer l’interdiction du Front national, d’ailleurs pure rodomontade puisqu’elle est impossible à envisager juridiquement. Exemple limite, la pétition lancée par Charlie Hebdo est ainsi rédigée : "Nous vous demandons de dissoudre le Front national, cette ligue dont le but politique est de faire disparaître la République." Je rappelle que le mouvement anarchiste est né sous et contre la République, et que la logique de cet appel suppose de réclamer également l’interdiction de tous les groupes libertaires et révolutionnaires, la saisie de leurs journaux et la fermeture de leurs radios !
Dans un texte précisément distribué aux alentours du stand FN au Salon du livre par Pierre Guillaume, révisionniste bien connu, le libraire qui diffuse le dernier livre de Roger Garaudy fait remarquer que la librairie La-Vielle-Taupe (du même Guillaume) a été contrainte de fermer à la suite de nombreuses agressions, alors que les livres qu’elle vendait n’étaient pas interdits. L’argument rencontre un certain écho. Dans Libération (17 mars dernier), Laurent Joffrin écrit à propos du FN : "L’emploi de moyens violents, coercitifs, contre la propagande frontiste n’est pas aujourd’hui opportun. [...] Seuls ses propos ou écrits illégaux peuvent être sanctionnés." Les militants révolutionnaires se trouveraient donc dans une impasse : soit ils recourent à la censure d’État, avec pour conséquence de la renforcer jusqu’à ce qu’elle les frappe, soit ils emploient des moyens violents, jugés illégitimes ou maladroits en ce qu’ils servent un adversaire prompt à jouer les martyrs.
Je pense que nous pouvons sortir de ce dilemme en combinant refus de toute censure d’État et actions spectaculaires, qu’elles soient à caractère "militaire" ou non. Pour prendre un autre exemple, je suis à la fois hostile à l’interdiction policière des manifestations intégristes devant les cliniques qui pratiquent les avortements et favorable à des contre-manifestations violentes. Il peut s’agir de violences symboliques (jet d’oeufs, de peinture, dégradation du matériel de l’ennemi) et non uniquement de violences contre les personnes, dans le genre "manche de pioche".
Le risque de tels incidents ne réside pas tant dans l’usage immédiat (et inévitable) qu’en fait la propagande de l’adversaire, que dans une polarisation progressive, et excessive, sur des affrontements militaires, dont on sait par expérience qu’ils sont propices aux fixations machistes et élitistes, et finissent par transformer aux yeux de la population l’agitation révolutionnaire en une espèce de rivalité extrême gauche et extrême droite, match arbitré - sans aucun esprit sportif - par la police. La poursuite du débat sur ces questions de stratégie, la diversification des formes d’actions violentes (par le recours à la dérision), un soin particulier mis à expliquer publiquement ce type d’actions, devraient permettre de limiter ce risque.
Claude Guillon
Ni honte ni F-Haine !
Sur le danger néo-nazi
Depuis le début des années 1980, grâce à la stratégie de Mitterrand qui institua la proportionnelle pour jeter un FN-peau de banane sous les pieds de la droite, le néo-nazi Le Pen a pu multiplier par quinze les scores confidentiels de l’extrême droite. Il obtient ainsi 11% aux européennes de 1984, et 14,5% lors de la présidentielle de 1988. Si le FN abandonne aujourd’hui ses habits d’épouvantail pour endosser le costume d’arbitre électoral, son ascension, beau résultat « socialiste », ne date donc pas d’hier.
Que des collégiens, qui n’étaient pas nés à l’époque, prennent conscience de l’implantation électorale du FN et s’en alarment, c’est compréhensible et encourageant. Que des militants associatifs et syndicaux expérimentés, voire d’anciens révolutionnaires, feignent de découvrir la chose, et l’exagèrent à plaisir pour vendre leur soupe démocratique et nationale ; qu’ils se lamentent, comme tel « réseau » spécialisé dans la dénonciation des violences policières, sur une « France couverte de honte aux yeux de l’histoire [sic] et du monde » qui « flirterait » avec l’élection d’un Le Pen, voilà qui donne envie de vomir son p’tit dèj !
La France ? Quès aco ? La « France éternelle » dont se gargarise Le Pen ? S’agit-il plutôt de « l’ensemble des Français » ? Mais Le Pen a obtenu 16,95% des suffrages exprimés. Rapporté au nombre des électeurs inscrits, ce score tombe à 11,8%. Le chiffre des inscrits doit être majoré de 7 à 10% de non-inscrits. Ce sont donc au maximum entre 10,5 et 11% de la population adulte qui ont voté Le Pen. Ce chiffre brut ne prend pas en compte les jeunes qui ne sont pas en âge légal de voter. Ne parlons pas des crétins qui ont déposé un bulletin Le Pen dans l’urne sans approuver ses positions...
On peut certes dire que « 11%, c’est 11 de trop ! », mais c’est le genre de platitude qui n’aide pas à penser. Au-delà de l’impact symbolique indéniable de la présence d’un Le Pen au second tour de l’élection présidentielle, et de l’encouragement qu’il représente pour les nazillons et autres racistes, il n’y a pas de péril nazi immédiat en France. Affirmer le contraire est un mensonge démagogique et contre-productif. Recourir pour le faire à des catégories idéologiques comme la « France », « être Français » (...et en avoir honte) participe finalement de la « lepénisation » des esprits que l’on dénonce chez les autres.
À propos de la honte
Ce ne sont en eux-mêmes ni l’abstention ni les votes d’extrême gauche qui ont créé la visibilité renouvelée de Le Pen, mais bien l’effondrement de la gauche gestionnaire.
Or, heureux événement, cette déroute est logique. Trop sûr de lui, Jospin a avoué d’emblée ce que tout le monde pouvait voir : son programme de modernisation capitaliste (concocté par Fabius et Strauss-Kahn) ne méritait même plus un déguisement « socialiste ». À force de répéter qu’il n’y a plus de classe ouvrière, ces ordures avaient fini par oublier l’existence de plus de six millions d’ouvriers et d’ouvrières. Lesquel[le]s, en grand nombre, se sont abstenu[e]s, ont voté LO ou Le Pen...
Ni la peur ni la honte ne sont des armes de résistance. Ce sont au contraire les moyens favoris des maîtres. C’est par la honte que les tortionnaires, les pères incestueux, les violeurs, imposent silence à leurs victimes et les persuadent qu’elles sont responsables des violences qu’elles subissent.
VIVENT LA COLÈRE ET L’ESPOIR !
Nous n’avons pas à sauver la république avec le flic Chevènement, la patrie en danger avec Juppé-la-hache et Chirac-matraque, pas plus qu’à fraterniser avec les supporteurs des 35 heures d’exploitation salariée.
Ceux qui se passionnent pour le Monopoly électoral n’avaient qu’à voter Chirac au premier tour. Il était déjà la meilleure digue (même pleine de trous) contre l’extrême droite. Comparé à Jospin, qui a privatisé davantage que la droite, c’est un serviteur maladroit et archaïque du capitalisme !
Trêve d’illusions, parlons de guerre sociale ! Passés ou non par les bureaux de vote, défendons dans la rue et par les luttes le projet d’un autre futur, sans « races » ni frontières, sans « président » ni patrie, une société égalitaire et libertaire où l’on ne verra d’épouvantails que plantés dans les champs.
Maintenons les politiciens dans l’insécurité !
À bas la France !
« Buvons à l’indépendance du monde ! »
Claude Guillon
Paris, le 26 avril 2002
[1] Les similitudes entre le fascisme-nazi des années 30 et la prise de pouvoir de Bonaparte le 18 Brumaire sont évidentes. De même qu’entre l’organisation politique du fascisme-nazi et la "Société du 10 septembre" qui supportait Bonaparte et la fonction politique donnée à celle-ci dans le cadre des intérêts de la bourgeoisie.
[2] Burgos était la capitale de guerre de Franco, où l’on pouvait aussi rencontrer les fondateurs de l’Opus Dei, organisation toujours active et de sinistre réputation, ndt.
[3] Mai barcelonais : le 3 mai 1937 à Barcelone, le central téléphonique conquis par les anars de la CNT depuis le début de la révolution est attaqué par divers groupes de police et de sécurité commandés par les communistes staliniens ; mais les anarchistes ripostent et descendent en armes dans les rues qui se couvrent de barricades. Les combats dureront jusqu’au 7 mai, opposant les anarchistes et les combattants du POUM aux staliniens. Les anarchistes et les poumistes, pourtant supérieurs en nombre, seront trahis par certains dirigeants de la CNT, membres du gouvernement. 6 000 gardes d’assaut seront envoyés pour rétablir "l’ordre" ; ils désarmeront les derniers combattants. Bilan : 500 morts, un millier de blessés et une révolution de perdue. (inspiré de l’éphéméride anarchiste, http://www.ytak.club.fr, lire aussi Hommage à la Catalogne de George Orwell), ndt.
[4] Le communisme compris non pas du point de vue des stratégies léninistes mais bien depuis sa forme intégrale. Ce que nous autres anarchistes appelons le communisme libertaire.
[5] Camilio Berneri : propagandiste et combattant anarchiste italien. Il organise la première colonne de volontaires italiens, participe à plusieurs combats ainsi qu’aux émissions de radio de la CNT-FAI. Il fonde la revue "Guerra di classe" dans la quelle il se montre très critique sur l’évolution de la révolution, la participation des anarchistes au gouvernement et la part belle laissée aux communiste staliniens. Le 5 mai 1937, durant les journées sanglantes de Barcelone, Camilio Berneri et Francisco Barbieri - un activiste anarchiste italien - sont arrêtés à leur domicile par la police aux ordres des staliniens. Ils seront retrouvés morts le lendemain, le corps criblé de balles. (source : éphéméride anarchiste), ndt.
[6] Seulement quelques-uns (Durruti et son groupe "Nosotros", entre autres) proposèrent de manière théorique d’étendre la révolution à un niveau international et de créer un "effet domino".
[7] J’ai traduit littéralement "pays de la périphérie", bien que cette expression me paraisse étonnamment géocentrique. On lui préfère souvent ces derniers temps "pays du Sud", bien qu’il s’agisse là encore d’une simplification, ndt.
[8] Des révoltes comme celles de Caracas, de la Poll Tax et de Los Angeles. Dans celles-ci est mis en évidence un background plus profond, de mal-être général, au-delà des faits concrets qui servirent de détonateur.
[9] Antena 3 est une chaîne privée espagnole, style télé-poubelle gorgée de pub, et qui ne cachait pas sa sympathie au gouvernement Aznar, ndt.
[10] Cela s’est produit dans le cas allemand (et ce n’est pas le seul). Les groupes autonomes sont allés jusqu’à chercher du soutien dans le Parti Social-démocrate en fomentant une espèce d’unité antifasciste et interclassiste.
[11] Ce type de mesures étaient réclamées récemment sur la couverture du bulletin "No Pasarán" du collectif "Al enemigo ni agua" de Barna. Ou dans le cas Guillem Agulló où différents groupes réclament de hautes peines de prison et l’application intégrale des peines. Il y en avait évidemment qui étaient en désaccord, comme l’Assemblée Antifasciste de Valence.
[12] Un des grands chefs de la Démocratie Chrétienne depuis les années 40, un "grand homme d’État".
[13] Grand chef du Parti Socialiste, fut pendant toutes les années 80 président du conseil des ministres, aujourd’hui réfugié en Tunisie suite au scandale de l’opération Mains Propres, qui de fait a supposé une certaine régénération des pouvoirs politiques à travers l’action judiciaire.
[14] Éditions l’ALBATROZ, B.P. 404, 75969 Paris cedex 20. Ce livre a largement contribué au présent article.
[15] Lire à ce propos l’article de Nicolas du cercle social publié dans la revue La Griffe N° 21- Automne 2001. La griffe, c/o librairie la Gryffe, 5 rue Sébastien Gryphe, 69007 Lyon.
)
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (287.9 ko)