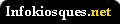D
De la culture du viol et des généralités abusives
Une critique de la brochure « Nous sommes touTEs des survivantEs, nous sommes touTEs des agresseurSEs »
mis en ligne le 23 septembre 2022 - dcaius
[Avertissement de contenu : cet article traite de culture du viol et des discours entourant la gestion de crise après des agressions ou viols]
Note préalable de vocabulaire : plusieurs fois dans cet article, je parle de trauma. Si vous ne connaissez pas particulièrement le reste du blog et que le terme de “trauma” est un peu flou, peut-être est-il utile de faire un léger résumé : le stress post-traumatique représente certaines séquelles possibles d’évènements traumatisants (c’est-à-dire des évènements qui ont dépassé les limites de l’organisme à réagir de manière fonctionnelle). Tout évènement traumatisant ne provoque pas un stress post-traumatique, et les évènements (re)traumatisants ne sont pas forcément “spectaculaires”. Le stress post-traumatique provoque un certain nombre de symptômes qui peuvent impacter considérablement la qualité de vie. J’ai inclus davantage d’informations à ce sujet à la fin de l’article.
J’ai pris connaissance du texte “Nous sommes touTEs des survivantEs, nous sommes touTEs des agresseurSEs” qui a été partagé plusieurs fois lors de conflits concernant des agressions sexuelles ou viols. Il y a des critiques à faire au texte en lui-même, mais aussi à la manière dont ce texte peut être (et a été) instrumentalisé pour esquiver des responsabilités.
J’ai déjà un gros problème avec le titre du texte : “Nous sommes touTEs des survivantEs, nous sommes touTEs des agresseurSEs”. Le moins qu’on puisse dire c’est que ça part mal, parce que les titres provoc’ et pseudo-universalisants de ce genre, je ne suis pas fan. Mettre tout le monde sur le même plan quand on parle de traumatismes n’est pas du tout une bonne idée. Le sujet est trop délicat pour que l’on fasse des punchlines pour le style. Mais j’y reviendrai ; admettons que l’on accorde le bénéfice du doute, et que l’on se dise que le titre est nul mais n’est pas représentatif… Voyons ce que dit le texte en lui-même :
Dans nos relations, nous mettons souvent en place des limites et parfois même nous demandons à l’autre son consentement. Dans la plupart des relations, ces limites ne sont pas verbalisées, elles sont supposées : je ne m’assiérai pas sur les genoux de l_ partenaire de mon amiE. Je ne prendrai cetTE amiE dans mes bras que pour lui dire bonjour ou au revoir. Dans les relations sexo-affectives, nous tendons à définir ces limites plus explicitement avec nos partenaires : je ne partagerai pas de sexe non protégé. Je ne suis pas d’accord pour que m_ partenaire m’embrasse devant mes parents. Dans tous types de relation, de platoniques à sexuelles, nous pouvons dépasser les limites des autres, les blesser ou les mettre mal à l’aise. Cela arrive souvent, particulièrement dans les relations dont les limites sont seulement implicites.
Cette première phrase… Je suis perplexe. “Parfois même nous demandons à l’autre son consentement.” C’est donc là le point de départ ? Le standard est celui-là ? “Parfois on a des limites et PARFOIS MÊME (!!!) on demande à l’autre son consentement (!!!)”. J’ai dû aller regarder le texte en anglais pour m’assurer qu’il ne s’agissait pas d’un contresens de traduction, mais non, la traduction est parfaitement correcte. On a un sérieux problème.
Bien sûr que les normes sociales dominantes se fichent du consentement, mais pour autant je ne dirais pas “Dans mes relations je pose souvent des limites et parfois même je demande à l’autre son consentement.” J’ai amorcé une réflexion sur le consentement il y a un moment maintenant, quand j’ai compris que j’avais subi un viol plus jeune, et j’ai réfléchi à comment prioriser le respect du consentement dans tous les aspects de ma vie. Oui, même en dehors de relations amoureuses. Je demande à mes proches avant de les prendre dans mes bras ou de leur faire la bise par exemple, et je respecte un refus. Je comprendrais que quelqu’un formule les choses ainsi si cette personne n’a absolument pas réfléchi aux conditionnements de la culture du viol, mais j’ai vraiment du mal à comprendre que quelqu’un qui se fend d’un long texte sur les problèmes de consentement présente cela comme ça.
“Dans la plupart des relations, ces limites ne sont pas verbalisées, elles sont supposées”. Eh bien… Parlez pour vous ? Il arrive que certaines limites me paraissent suffisamment évidentes pour ne pas être verbalisées, mais je verbalise explicitement la plupart des choses, et c’est la norme chez la plupart de mes proches aussi. Ce qui me paraît bizarre ou gênant ne l’est peut-être pas pour une autre personne, et vice-versa. Et le fait d’être une personne handicapée oblige littéralement à verbaliser un certain nombre de besoins et limites. Je déteste qu’on me touche sans me demander, je n’aime pas faire la bise à des inconnu·es, je ne supporte pas les lumières directes dans mon champ de vision, la station debout m’est pénible, je fatigue rapidement surtout s’il y a beaucoup de bruit de fond, etc. Ce sont des choses que j’ai souvent besoin de dire le plus clairement possible quand je rencontre des gens, et je demande également si la personne a des besoins spécifiques.
Franchement, ça rend les interactions sociales tellement plus fonctionnelles que ça me stupéfie que des gens ayant pris conscience des problèmes de consentement et de trauma d’une part, du validisme d’autre part, continuent à agir comme si demander le consentement était une option Deluxe qu’on choisit de temps en temps. Je suis vraiment perplexe. On se doute que la personne qui a écrit le texte s’apprête à critiquer le manque de réflexion sur le consentement, mais je trouve ces premières formulations vraiment bancales, quelle que soit la suite.
Voici un deuxième passage que je trouve quelque peu gênant :
Quand une agression sexuelle a lieu, la personne qui outrepasse la limite est appeléE l’agresseurSE et la personne dont la limite a été dépassée est appelée l_ survivantE, un terme qui donne plus de force que le mot victime. C’est une terminologie de poids, et cela peut être vraiment utile pour aider l_ survivantE à nommer et assimiler une expérience.
Mais qui est-on pour décider quel terme donne plus de force à quelqu’un qui a vécu une agression sexuelle dans ce cas précis ? J’avais parlé des termes “survivant·e” et “victime” dans un article dédié [1]]. Bien qu’à titre personnel je préfère me désigner par le premier terme (pour les raisons que j’ai expliquées dans l’article), ce n’est pas le choix de tout le monde, et je respecte cela et apporte mon soutien aux personnes qui ne souhaitent pas s’approprier le terme “survivant·e” mais continuer à utiliser “victime”. Oui, “survivant·e” est une terminologie de poids ; et tout le monde n’a pas le même rapport à ce poids-là. Ce qui est libérateur et empouvoirant pour personne A peut être écrasant et stressant pour personne B. Je trouve extrêmement dérangeant de prétendre ériger une norme sur ce point, parce que respecter le rythme des personnes qui ont subi des agressions sexuelles est un point clé de leur rétablissement [2]].
Le texte critique ensuite le fait qu’utiliser “survivant·e” et “agresseu·r·se” seulement dans des cas d’agressions sexuelles ou viols met ces interactions à part et sous-entend que les autres possibles interactions non-consenties seraient moins graves. Je trouve cette critique bizarre au mieux, car il y a un bon nombre d’autres mots qui peuvent être utilisés pour désigner ces situations : exploitation, coercition, rapport de pouvoir, déséquilibre, malaise, etc. Je ne vois pas en quoi le fait d’avoir un vocabulaire spécifique aux agressions sexuelles et viols devrait poser problème. Il est vrai que “survivant·e” sous-entend généralement “survivant·e de viol”, mais c’est aussi un terme utilisé pour d’autres traumatismes (par exemple, “survivant·e d’un génocide”). En fait, la spécificité de “survivant·e” me semble plutôt être que cela désigne quelqu’un qui est encore impacté·e au quotidien par ce à quoi iel a survécu. Le plus souvent, on utilise “survivant·e” parce que c’est plus court que “personne avec un stress post-traumatique (complexe)”. Il n’y a pas de règle explicite à ce sujet bien sûr, mais il me paraît évident que c’est le plus souvent un terme que l’on utilise parce que l’on a besoin de souligner le caractère durable des conséquences du trauma. Sinon, le terme “victime” utilisé au passé peut souvent suffire.
Décrire les agressions sexuelles (et avec elles les survivantEs et les agresseurSEs) comme des expériences sexuelles distinctes de celles supposément « normales », donne la fausse représentation que toute expérience qui ne serait pas nommée agression sexuelle serait libre de toute contrainte. Au contraire, dans notre société autoritaire, la domination s’insinue partout, ce qui fait que même nos relations les plus intimes et précieuses sont subtilement – et parfois pas si subtilement – teintées de dynamiques de pouvoir inégalitaires. Une division entre « agression sexuelle » et « tout le reste » permet à toute personne qui n’a pas été nomméE unE agresseurSE sexuelLE d’être tiréE d’affaire, ce qui détourne l’attention des moyens que nous pouvons touTEs mettre en place pour améliorer nos relations et notre sensibilité les unEs vis à vis des autres.
Le raccourci fait ici est complètement aberrant. Décrire les agressions sexuelles et viols en tant que tels ne signifie pas nier les rapports de force qui peuvent exister par ailleurs. Décrire l’impact de la violence d’une situation précise ne signifie pas nier la violence qui peut exister dans une autre situation. Parce que la société est parcourue de rapports de force qui s’insinuent partout dans nos relations, on devrait se taire quant aux situations où cela résulte en des traumatismes sexuels ? Cet argument n’a ni queue ni tête. Il est possible de parler des dynamiques de domination dans la société sans enlever leur vocabulaire aux personnes qui ont survécu à des violences sexuelles, des séquestrations au long terme, des génocides (entre autres), ou minimiser leurs expériences de manière floue comme c’est fait ici.
Mon intention n’est pas de faire un gatekeeping strict sur le terme de “survivant·e”, certainement pas. Mais j’aimerais bien que les gens se rendent compte d’elleux-même qu’il faut comparer ce qui est comparable, et que prétendre que “Nous sommes tou·tes des survivant·es” parce que la société est violente dans son ensemble, c’est justement nier les rapports de force en jeu plutôt que les souligner. Nous ne sommes pas tou·te·s exposé·es aux abus de la même manière.
L’une des conséquences les plus problématiques du manque de vocabulaire approprié est que les gens ont souvent des réticences à seulement commencer à aborder des expériences d’outrepassement de limites plus subtiles ou plus complexes.
Je suis d’accord avec cela, mais je trouve que cela manque de considérer un point crucial : la plupart des personnes qui vivent des expériences traumatisantes ont tendance à les minimiser et ont des réticences à en parler. Il est bien connu que les personnes ayant vécu un viol se sentent souvent coupables, se disant “Ah, certaines personnes ont vécu pire, je ne devrais pas en faire toute une histoire” et ce quel que soit leur vécu, “Au fond ça devait être un peu de ma faute, est-ce que je ne me suis pas mis·e en danger”, etc. Ces réticences sont donc tout à fait logiques, font partie du processus post-traumatique, et ne sont pas juste une conséquence d’un manque de vocabulaire approprié, même si développer un vocabulaire plus pointu pour parler des différentes expériences traumatisantes est évidemment important.
Il semble aussi que, autant les mots agresseurSE / survivantE sont utiles quand le dialogue est impossible, autant leur usage peut arrêter le dialogue lorsque cela aurait pu être possible autrement. Ce vocabulaire crée des catégorisations de gens plutôt que des descriptions de leurs comportements, réduisant un individu à une action. Du coup, cela a tendance à mettre les gens sur la défensive, ce qui fait que ça devient plus difficile pour elleux d’entendre les critiques qui leur sont adressées. Les implications définitives et le ton accusateur de ce vocabulaire peuvent précipiter une situation dans laquelle, au lieu de réconcilier des vécus différents de la réalité, les gens de chaque côté luttent pour prouver que leur interprétation de la réalité est la « vraie ».
Diaboliser les personnes qui ont violé ne rend pas service aux victimes, car le viol est, hélas, banal. Ce n’est pas l’œuvre de monstres sortis d’un bois obscur, un viol peut être commis par une personne proche en qui on avait confiance et qui par ailleurs faisait preuve de bienveillance, disait nous aimer, nous soutenait dans certains domaines de notre vie, etc. Diaboliser nous pousse souvent dans le déni, la minimisation de nos expériences, car nous ne pouvons pas nous résoudre à pousser ce·tte proche qui nous a fait du mal dans cette catégorie des diabolisé·es, cela semble souvent trop réducteur et injuste sur le coup. Et cela étant dit, il arrive que les personnes ayant vécu un viol aient besoin de s’autoriser à diaboliser les personnes qui ont abusé d’elleux, afin d’arriver à se détacher de leur empathie pour elleux, prendre des distances nécessaires, et prioriser leur propre bien-être pour leur rétablissement. Cela n’a d’ailleurs pas forcément de conséquences graves pour la personne diabolisée. Il arrive qu’une personne ayant vécu différents traumas relationnels oscille entre idéalisation et diabolisation. Je pense que le réel problème à cela est : est-ce que la personne en est consciente ? Comment limiter les problèmes qui peuvent inévitablement émerger, et dépasser ces schémas réducteurs sans se mettre en danger ? Comment apporter de la nuance dans ses considérations d’autrui quand jusqu’ici on a dû vivre dans les extrêmes (idéalisation / diabolisation) pour survivre ? Ce sont évidemment des questions épineuses, il n’y a pas de réponse facile et rapide.
Tout cela étant dit, je trouve les priorités présentées dans le texte pour le moins… intrigantes. Cela part du principe que le dialogue avec une personne qui a agressé ou violé est souhaitable et aura de bonnes conséquences. Parfois, cela est vrai. Il arrive qu’il y ait malentendu, et que la personne qui a agressé ou violé n’en ait absolument pas eu conscience, puisse être confrontée, se rendre compte de ses actes, présenter ses excuses et se remettre en question. Mais il me semble que prétendre que cela représente la majorité des cas d’agressions et viols, c’est faire preuve d’une mauvaise foi insurmontable… Je ne veux pas paraître défaitiste, mais un certain nombre de personnes abusent d’autrui en toute connaissance de cause et sans aucun regret. D’autres sont partagé·es, mais ne sont pas pour autant prêt·es à changer. Exposer les personnes qui ont été abusées à un “dialogue” est souvent extrêmement dangereux, notamment dans les cas d’emprise. Le fait que cela ne soit pas abordé dans le texte me semble ahurissant, au mieux de naïveté et d’ignorance, au pire de franche malveillance.
Si nous pouvions développer une façon d’aborder ces situations qui se concentre sur l’amélioration de la communication et de la compréhension plutôt que de chercher à établir qui est en tort, il serait alors plus facile pour les personnes qui outrepassent des limites d’écouter et d’apprendre des critiques qui leur sont adressées ; et moins stressant pour les personnes dont les limites ont été dépassées de parler de ces expériences. Quand une personne sent que ses désirs n’ont pas été respectés, indépendamment de si un tribunal de justice trouverait qu’il y a assez d’éléments pour justifier des accusations d’agression sexuelle ou pas, il est nécessaire que toutes les personnes impliquées dans la situation soient responsables pour elles-mêmes des manières dont iels n’ont pas communiqué avec ou respecté l’autre, et travaillent à s’assurer que ça n’arrive plus jamais.
Je pense que c’est une réflexion qui n’est pas complètement inintéressante. Effectivement, dans certains cas le dialogue peut aider à comprendre ce qui a mené à une action mal vécue et corriger le tir. Il peut parfois s’agir d’un malentendu, d’un manque de connaissances, etc. Mais je m’inquiète du fait que cette réflexion puisse être instrumentalisée pour forcer au dialogue alors que souvent, la personne traumatisée a besoin de prioriser sa sécurité en se soustrayant à toute influence de la personne qui lui a fait du mal. Et ce dialogue est parfois un gaslighting [3] de la personne traumatisée et donc une violence supplémentaire. Il est fortement idéaliste de penser que toutes les personnes ayant outrepassé le consentement de quelqu’un d’autre, de manière ambiguë ou non, sont prêtes à se remettre en question, pleines de bonne volonté. La réalité est tout autre. Et oui, cela est en partie dû à la diabolisation, mais pas seulement.
Les mots que nous avons à notre disposition actuellement pour décrire ces situations créent une fausse division du monde entre agresseurSEs et survivantEs, alors que, comme c’est le cas pour les catégories d’oppresseurSEs et d’oppresséEs, la plupart des gens vivent les deux expériences à un moment ou à un autre.
Je comprends le pourquoi de ce paragraphe mais je trouve qu’il y a quelque chose d’extrêmement douteux en filigrane. Les personnes ayant vécu de graves maltraitances relationnelles durant leur enfance ont souvent très peur de reproduire les mêmes schémas plus tard. Cela peut être quelqu’un qui a grandi dans une famille violente et qui craint de faire preuve de violence envers ses propres enfants. C’est parfois le cas, mais nous n’y sommes pas condamné·es. Et un certain nombre de personnes qui ont été violées durant leur jeune âge ne violeront aucun·e enfant·e une fois adultes, par exemple. Je comprends le désir de ne pas hiérarchiser les différentes expériences afin de ne pas minimiser ce qu’a pu vivre quelqu’un à la suite d’une interaction non-consentie qui ne rentrerait pas dans les définitions légales d’un crime sexuel, mais mettre sur le même plan toutes les expériences relationnelles traumatisantes ne nous rend pas service non plus.
Nous avons besoin d’une nouvelle façon de conceptualiser et de communiquer sur nos interactions. Elle prendrait en compte nos différentes limites – sexuelles, affectives, et platoniques – et toutes les façons dont elles peuvent être outrepassées. Pratiquer le consentement et respecter les limites des autres est important à la fois dans les interactions sexuelles comme dans tous les autres aspects de nos vies : s’organiser ensemble, vivre en collectif, planifier des actions directes en confiance. Les relations non-hiérarchiques et consenties sont l’essence de l’anarchie, et nous devons mettre la priorité sur la recherche et la promotion du consentement dans toutes nos interactions.
Je suis d’accord avec ça, et je pense que le premier pas pour viser cela n’est certainement pas d’écrire un texte avec un titre qui minimise complètement les expériences de survivant·es / victimes de violences en les mettant sur le même plan que les personnes qui ont abusé d’elleux dans un titre provocateur qui sera probablement réactivant pour un certain nombre de ces personnes. C’est un peu le pompon d’écrire ça dans un texte qui a un titre aussi atroce.
Astuce : envoyer ce texte “Nous sommes touTEs des survivantEs, nous sommes toutTEs des agresseurSEs” à la personne que vous avez agressée n’est pas une bonne idée. Partager ce texte pour vous dédouaner de vos responsabilités en tant qu’agresseu·r·se n’est pas une bonne idée. Instrumentaliser ce texte pour minimiser une agression qui a eu lieu dans votre entourage n’est pas une bonne idée.
Autres astuces : ne pas se réfugier derrière des discours flous sur la justice réparatrice pour esquiver ses responsabilités quand on s’en rendu coupable d’agressions ou viols. Ne pas instrumentaliser les (très bons) arguments anti-carcéraux pour faire taire les victimes et leur imposer de continuer à vous côtoyer. Ne pas crier aux méthodes fascistes si les conséquences de vos actions déplorables vous retombent dessus et qu’un certain nombre de personnes souhaite prendre des distances car vous n’avez pas pris les mesures nécessaires pour ne pas être des dangers publics.
Ressources recommandées par dcaius :
– Jour après jour… [https://infokiosques.net/spip.php?article1300]
La brochure est composée de six textes de fiction, une fiche outil, un compte-rendu de synthèse, une bibliographie et un lexique. Nous vous en recommandons très vivement la lecture.
– Manuel pour les violeurs et les agresseurs féministes [https://queer-chretien-ne.blogspot.com/p/blog-page.html]
« Ce manuel a été rédigé juste après une agression sexuelle dans le milieu militant et la confrontation de mon agresseur trois mois plus tard. Il a été écrit avec ma colère et la rage de savoir que toutes les femmes que je connais ont eu cette expérience au moins une fois dans leur vie si ce n’est pas plusieurs fois. »
dcaius recommande ce manuel. Nous l’avons lu et l’avons trouvé pertinent, ce qui n’est pas le cas des autres textes de ce blog.
Enfin, si vous voulez en savoir plus sur le processus de rétablissement pour les personnes ayant un stress post-traumatique, dcaius a écrit et traduit plusieurs textes à ce sujet sur son blog Survivre & s’épanouir [https://dcaius.fr/blog/] :
• Les étapes du rétablissement, traduction d’un texte de Judith L. Herman
• Victime ou survivant·e ?
• Rappel à propos du rétablissement, un texte d’encouragement
• Trauma et pardon, partie 1 & 2
• Fiche d’information sur le trauma, collaboration avec Igor Thiriez
• 13 étapes pour gérer les flashbacks, traduction d’un texte de Pete Walker
• 7 conseils pour se soigner d’un stress post-traumatique complexe
• Symptômes du stress post-traumatique au quotidien
• Les avertissements de contenu
• Si vous rencontrez une personne traumatisée…
• La résolution de conflits, traduction d’un texte de Pete Walker à destination des couples
Ressources autres :
– Accounting for ourselves [https://infokiosques.net/spip.php?article1545]
« Les abus et agressions sexuelles continuent à pourrir les espaces anarchistes. En réponse, nous avons développé des processus pour que chacun.e se responsabilise en dehors de la sphère de l’État. Mais pourquoi semblons-nous échouer dans leur application ? »
– Apprendre le consentement en 3 semaines [https://infokiosques.net/spip.php?article1121]
– Soutenir un-e survivant-e d’agression sexuelle [https://infokiosques.net/spip.php?article793]
– Retour sur le questionnaire et les témoignages : l’identification de violences sexuelles encore mal connues, les interactions sexuelles à coercition graduelle [https://antisexisme.net/2017/10/27/coercition-graduelle/]
Retour et analyses de témoignages sur le sujet des « actes de domination non consentis durant des interactions sexuelles désirées et consenties ». L’autrice est une TERF mais le propos développé dans cet article ne nous semble pas l’être. Et l’analyse qui est produite nous semble assez pertinente et rare pour inciter à dépasser ce fait.
[1] Victime ou survivant·e ? [https://dcaius.fr/blog/2019/02/victime-survivante/
[2] Les étapes du rétablissement [https://dcaius.fr/blog/2019/06/recovery-steps/
[3] Qu’est-ce que le gaslighting ? [https://dcaius.fr/blog/2017/09/quest-ce-que-le-gaslighting/] : « Le terme de gaslighting est utilisé depuis les années 60 pour décrire les manipulations visant à mettre en doute la réalité des perceptions d’autrui. »
)
Mis en page par la distro pouet : distropouet@@@riseup.netLe texte qui suit a été publié en juillet 2020 sur le blog de dcaius :
Survivre & s’épanouir [https://dcaius.fr/blog/]
Nous avons trouvé qu’il s’agissait d’une critique pertinente d’une brochure très largement diffusée dans les milieux militants.
Les seules changements que nous avons effectués sont ceux nécessaires à la compréhension du texte sous format brochure.
Mis en page par la distro pouet : distropouet@@@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (367.9 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (333.4 ko)