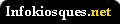M
Mettre les mains dans sa merde
Ici, on parle (encore) de viol
mis en ligne le 4 janvier 2021 - key_editions[@@@]riseup.net
Sommaire
« Victimes de viol, on vous croit »
- Pas de reconnaissance, pas de paix
- « Le violeur, c’est toi ! »
- Qui parle ? Pour qui ?
- Ecriture inclusive
- Contenu
Viol, justice : quelles postures ?
- De mémoire
- Eléments de contexte
- La justice dans « nos milieux » : critique et sortie
Ecueils
- Dessine-moi la vérité
- Des mots et des idées
- S’il faut dire « agression », « viol », faut-il dire « victime » ? « violeur » ?
- Par delà l’agression et le viol ; réagir
- Degrés de conscience
- L’agression comme prétexte à règlements de comptes [inter]personnels
- Réguler la vie collective : les règles sociales, implicites et explicites, ne sont pas les mêmes que celles du couple
- Epilogue : une dernière histoire…
In fine
- Éléments de synthèse
- Comment réagir, de quels outils disposons-nous ?
- Conséquences directes
- Au bout du chemin…
Bibliographie sélective
« Car qu’est-ce que le viol sinon cela ? C’est une énorme erreur que de le confondre avec le sexe. Il s’agit d’un spasme de rage, d’une invasion violente, d’un désir de dominer et de détruire. Tel un missile détecteur de chaleur, il cherche la partie la plus vulnérable du corps de la victime afin de provoquer le plus de dégâts possible. C’est une punition, c’est une domination. C’est l’éradication de la menace, la démolition volontaire de toutes les limites qui font de nous des êtres humains. » (pp. 63-64)
Eve Ensler, Pardon, Denoël & d’ailleurs, 2020, [2019, Bloomsbury], 139 pages.
« VICTIMES DE VIOL, ON VOUS CROIT »
Pas de reconnaissance, pas de paix
La première étape lorsqu’il y a déclaration d’une agression est de reconnaître qu’une agression a été vécue. De la part de la personne agressée, ce qui ne va pas systématiquement de soi, et de l’agresseur.
Sans cette reconnaissance, le processus de reconstruction, de réparation et d’éventuel pardon de la part de la personne agressée est sensiblement plus difficile.
Sociétalement parlant, en matière de viol, d’agression sexuelle et de domination masculine en France, nous en sommes encore à cette première étape : la reconnaissance.
La justice, le gouvernement, les médias ne reconnaissent pas la responsabilité d’agresseur à DSK, ni à Baupin, ni à Polanski, ni… La cérémonie des Césars du 29 février 2020 le prouve encore.
Et de même, nos violeurs – parents, amis, conjoints, connaissances – ne reconnaissent pas leur culpabilité.
C’est ce qui explique la rage des femmes.
C’est ce qui explique #balancetonporc, #metoo, #moiaussi, #noustoutes, les témoignages de Lola Lafon et d’Adèle Haenel et les bandes de filles qui vont coller de grandes phrases en noir et blanc dans les centres-villes :
VICTIMES DE VIOL, ON VOUS CROIT
C’est ce qui explique la nécessité de l’ouvrage de Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la Française, paru en 2019, et la tribune de Virginie Despentes publiée dans Libération le 1er mars 2020, Césars : « on se lève et on se barre ».
C’est ce qui explique que des milliers de femmes se rassemblent pour scander ensemble, les yeux bandés de noir, « ¡El violador, eres tu ! », du Chili au Trocadéro (à Paris).
C’est ce qui explique la nécessité de ce préambule, sans lequel mes ami.es jugent ce texte irrecevable.
Ce texte concerne l’étape qui pourrait suivre la reconnaissance ; il s’adresse à des personnes qui se questionnent pour se reconstruire.
Ce texte répond a fortiori aux préoccupations de celles et ceux qui connaissent des violeurs et /ou agresseurs, et qui souhaitent avancer avec eux s’il y a constat d’un dialogue possible. De nombreuses.x ami.es ont témoigné de viols et d’agressions – toutes le fait d’hommes, agressant autant des hommes que des femmes et personnes lgbtqi+. Des témoignages d’agressé.es, autant que des témoignages d’agresseurs. Or, non seulement, tourner le dos ou exclure systématiquement mes amis agresseurs de ma vie ne m’apporte pas satisfaction. Mais parler avec eux m’apprend.
Il faut insister sur ce point : la non reconnaissance, la minimisation ou le déni des faits de la part de l’agresseur empêche le dialogue et prive la personne agressée d’outils pour surmonter son agression.
La négation est une manifestation supplémentaire de la domination.
Par ailleurs, la reconnaissance des faits n’est pas nécessairement suffisante pour permettre à la personne agressée de se reconstruire. Tout dépend de la nature de l’agression, et du caractère de la personne agressée.
(...)
Qui parle ? Pour qui ?
Une femme,
hétéro,
blanche,
trentenaire,
pourvue d’un capital intellectuel lié à sa formation universitaire et sa fréquentation de milieux militants divers.
Qui s’appuie sur des discussions et échanges essentiellement avec d’autres femmes,
hétéros,
blanches,
pourvues d’un capital intellectuel lié à leur formation universitaire et / ou leur fréquentation de milieux militants divers. Mais pas que.
Pas que des femmes.
Pas que des hétéros.
Pas que des blanches.
Et qui produit un texte qui sera probablement lu essentiellement par
des femmes
et des hommes,
hétéros,
blanc.hes,
pourvu.es d’un capital intellectuel lié à leur formation universitaire et /ou leur fréquentation de milieux militants divers.
Et plus ? En tous les cas, ce texte ne se base pas que sur les expériences propres au milieu militant actif sur le territoire français, et n’adresse pas que les situations qu’il traverse.Ecriture inclusive
Le choix a ici été fait d’employer l’écriture inclusive et le point médian ;
Le terme « agressé.e » relève autant du féminin que du masculin, parce que les hommes, cis et non cis, sont largement touchés par les agressions genrées et sexuelles, même s’ils sont numériquement moins touchés que les femmes.
En revanche, le terme « agresseur » n’a pas été féminisé. Cela ne signifie bien sûr pas qu’il n’existe pas de femme agresseuse, y compris sexuellement. Mais ces cas de figure mériteraient un écrit à part entière, et sortent du contexte qui est ici adressé : en traitant des agressions genrées ou /et sexuelles, ce texte veut être un outil facilitant la dénonciation et de déconstruction des dominations de genre, domination des hommes sur les femmes, domination d’hommes sur tout être humain.Contenu
Juin 2018 : un ami est accusé de viol.
Comment réagir de manière constructive ?
Constructive à la fois pour l’agressée, à la fois pour l’agresseur ?
Pourquoi viols et agressions sont-ils des sujets si difficiles à aborder ?Dans un premier temps, restituer au mieux la situation qui a déclenché ces écrits, pour planter le décor. Puis préciser les contextes personnels et structurels, sociétaux et de ‘milieux’ qui forment la matrice de ces réflexions. Enfin, étayer diverses réflexions concernant l’idée de « justice », d’une volonté de « jugement » dans le contexte donné.
Dans un second temps, proposer des pistes de réflexions émanant du postulat suivant : complexifier des systèmes de représentations, idées reçues et a priori qui découlent du cadre de pensée issus de la société normée, c’est essayer d’adresser autrement les questions d’agressions et de viols qui marquent quotidiennement nos vies.
VIOL, JUSTICE, QUELLES POSTURES ?
De mémoire
- "Tu connais bien Cactus [1] toi... J’ai appris... enfin, la fille avec qui il était m’a dit que... enfin voilà, il l’a frappée et séquestrée. Ils étaient ensemble, c’était il y a un moment, plusieurs années.
- ...
- Tu savais ?
- ... non."
Comment réagir de manière constructive face à cette situation ?
Comment se responsabiliser en réfléchissant collectivement à la situation ?
Dans le cas présent, une situation où un individu dénonce le comportement dominant, vécu de manière agressive /violente /destructrice, d’un autre individu.
Aucune prétention à apporter des réponses.
Seulement une volonté de contribuer à une réflexion commune et de partager quelques expériences et vécus, alors qu’il existe encore peu de retours d’expériences en France [2].
Nos vies suivent leur cours ; ces faits y occupent une place mineure, noyés dans le flot du quotidien. Seule l’amitié que je porte à Cactus explique une vague préoccupation pour la situation. Quant à la personne qui a décidé de partager des mots sur un vécu, presque aucun.e de nous ne la connait.
Quelques semaines plus tard, lors d’une soirée dans un lieu de vie collectif, alcool et drogue ont embrumé la plupart des esprits, l’heure avoisine minuit, nous sommes une centaine.
Un petit groupe de personnes trouve Cactus, le frappe (Gifles ? Coups ? Rien de trop violent physiquement), l’insulte, puis quitte les lieux. Un shaming : révéler publiquement qu’untel est agresseur.
L’histoire se répand instantanément et les conversations s’orientent progressivement sur ce seul sujet pendant un temps de la soirée : tu as entendu que... mais tu savais que... tu étais au courant que...
Il ne s’agit plus de coups et séquestration, mais de viol.
La majorité des personnes poursuit les festivités.
Parce qu’elles ne se sentent pas concernées ?
Parce qu’elles n’ont pas pris la mesure de ce qui s’est passé ?
Parce qu’elles ne sont pas dans un état de prise de conscience et de réflexions immédiates...
Un peu tout cela peut-être.
Un ami et co-habitant est donc publiquement accusé de viol lors d’une soirée organisée sur notre lieu d’habitation.
Ces faits sont fréquents.
Ils traversent tous les milieux.
Parfois, ils font beaucoup de bruit.
Parfois, ils restent sous silence.
Dans un cas comme dans l’autre, ils peuvent hanter et détruire les personnes qui ont fait les frais de ces violences.
Parfois, ces faits peuvent aussi hanter et détruire les personnes autrices de violence.
Affirmer que ni l’un ni l’autre ne mentent : deux vécus différents d’un même évènement.
La croire parce que comme toute femme, j’ai mes expériences propres du machisme, des violences et des expressions de dominations masculines, donc du non consentement, ce qui me conduit à éprouver une empathie immédiate pour elle.
Le croire parce que c’est un ami ; vouloir au moins entendre, écouter, comprendre sa version des faits.
Plus intimement, comment ne pas se sentir concerné.e par des faits singuliers, opérés par des individus singuliers, lorsque, comme tant d’autres, nous nous sommes pris l’expression d’une violence genrée en pleine face – en plein corps – à de multiples reprises au cours de nos vies ? Ces histoires nous touchent d’autant plus que la personne concernée est un ami proche et aimé, un membre de notre famille, de notre entourage, une personne avec qui nous avons un lien affectif préalable.
Et que le lieu d’accusation est un lieu qui nous est familier, voir notre propre lieu d’habitation.
Eléments de contexte
Causes et conséquences : la fabrique des agresseurs et de leurs victimes
Deux perspectives aident à comprendre comment se construisent et se reproduisent les phénomènes sociétaux, dont les agressions sexuelles.
Une perspective plutôt déterministe : l’échelle sociétale large, où les structures sociales sont élaborées et reproduites par le biais, dans notre société française, de l’Etat et de ses institutions – appareils judiciaires, policiers, scolaires, médicaux, représentants d’Etat… – de notre culture (cinéma, photographie, peinture, littérature et autres formes d’expression artistique), des médias, ou encore de l’Eglise et des appareils religieux en général. Cette échelle a un impact déterminant sur la « masse » sociale que nous formons.
Il y a des raisons d’ordre structurel qui aboutissent à l’usage de la violence de la part d’un être sur un autre ; des volontés politiques de subordination, d’exploitation et d’aliénation. Des schémas véhiculant tacitement l’autorisation de faire usage d’une domination via une expression de la masculinité dans ce qu’elle peut avoir de violente, (très majoritairement l’apanage des hommes cis, très majoritairement sur toute personne n’étant pas un homme cis [3]).
Cette domination [masculine] revêt bien des formes sur des aspects relativement différents en fonction des classes concernées, des cultures, des âges, des (alter)genres, de l’époque prise en compte...
Cette perspective croise des trajectoires individuelles, marquées par un passé singulier, qui font qu’une personne donnée utilise à un instant T de sa vie cette violence (genrée, sexuée) comme expression d’un pouvoir /éventuellement d’un mal être.
Cette seconde perspective relève des parcours familiaux, personnels, individuels, de faits et phénomènes attachés au vécu personnel ; elle détermine ce que nous sommes en tant qu’individus singuliers.
A l’extérieur autant que dans nos espaces intimes, nous subissons donc les conséquences de cette organisation sociale patriarcale, machiste et misogyne – toute forme de relation à une autorité patriarcale par exemple : institutions publiques, justice, police, médias, corps soignant, corps enseignant, employeurs, chefs de famille etc.
Nous participons également inévitablement à la reproduction de ce système ; nous en sommes les exécutant.es, tant que nous ne travaillons pas à déconstruire ce qu’il a inséminé en nous tout au long de notre vie.
Que nous soyons en position d’agresseur ou de victime, nous sommes construit.es et traversé.es par ces deux dimensions. Nos actes sont le produit d’un fonctionnement social, déterminés par une structure sociale, croisé à des situations d’ordre interpersonnel, individuel, singuliers. En tant qu’individu membre de la masse, nous sommes pris entre ces deux échelles, toutes deux agissent sur nous, nous agissons sur elles deux.
Quelle posture adopter ?
_ - Ce qui fait consensus
D’une part, dénoncer les violence et les dominations structurelles : comment les décisions étatiques et institutionnelles, comment les textes de loi, comment les appareils judiciaires et répressifs, comment les discours médiatiques, comment les programmes scolaires et la hiérarchie universitaire, comment les interprétations théologiques diverses, comment médecins, gynécologues, psychologues et consorts, comment notre héritage culturel, artistique et littéraire et j’en passe, sont des outils de maintien et de reproduction de la domination masculine au service d’humains débordant de pouvoir et d’argent, ouvrant toute grande la porte et légitimant les violences sexuelles en tous genres, et ayant un impact qui, encore une fois, « détermine la masse sociale que nous formons ». Il s’agit ici de prévenir les actes de violence et les manifestations de pouvoir exprimant une domination.
D’autre part, apporter un soutien aux personnes qui ont subi l’expression d’une forme de domination, une agression, une agression sexuelle. Ecouter ; aménager des espaces de discussions ; comprendre ; accompagner au besoin la démarche de reconstruction ; accompagner au besoin dans le contexte judiciaire. C’est une des manières de lutter contre les dominations de genre, les agressions, les agressions sexuelles. Il s’agit aussi de solidarité, d’empathie.
Dénoncer les violences et les postures de dominations structurellement construites et reproduites, et afficher un soutien aux victimes, ces deux postures font consensus – au moins dans le discours ; moins dans les faits, sachant que la parole des personnes agressées est systématiquement mise en doute.
_ - Ce qui ne fait pas consensus
Ce qui fait moins consensus, c’est la position à adopter face aux personnes qui dominent, qui agressent, qui violent. Mon expérience personnelle, des lectures /émissions et quelques discussions amènent sans surprise à ce constat : dans la hiérarchie des luttes à mener, la préoccupation du pourquoi et du sort des agresseurs n’est pas prioritaire.
Elle peut toutefois le devenir s’il existe un lien affectif préalable avec la personne concernée (voir Pardon d’Eve Ensler à propos de son père et L’Empreinte d’Alexandria Marzano-Lesnevich à propos de son grand-père).
Par ailleurs, tout agresseur étant capable de remise en question [4] ne mérite-t-il pas accompagnement ? A fortiori dans un contexte de refus des outils répressifs d’Etat ?
A fortiori également face au constat que l’agresseur, comme l’agressée, est comprimé par les déterminismes sociaux qui expliquent en partie les comportements individuels ?
A fortiori enfin lorsqu’on sait qu’il existe très peu de structures d’accompagnement, qu’elles soient institutionnelles ou communautaires, pour les agresseurs.
Tout est question de priorité dans un temps contraint.
La justice dans « nos milieux » : critique et sortie
Réinventer ce que justice peut être
Ces faits sont trop rarement traités de manière constructive, même dans nos milieux dits "activistes", "militants", "alternatifs’, "marginaux", "autonomes" & co.
Moins qu’ailleurs (pour ce que je connais de ces « ailleurs »), ces faits restent sous silence. Mais ces dénonciations peuvent aboutir au pugilat, à la destruction d’une réputation, au choix de l’exclusion d’une personne soit un bannissement pur et simple, sans compter le lot de ragots qui accompagnent les décisions punitives prises plus ou moins collectivement.
Il y a sûrement des actes irréparables commis par des êtres irrécupérables.
Sur quels critères définir l’irréparable ?
La douleur physique, la torture ? La violence gratuite, la perte de la dignité ? La mise à mort ? Quoi ?
Evidemment, l’indifférence ou l’oubli ne sont pas non plus des options.
Lesdits milieux activistes et militants dénoncent les violences d’État, de ses institutions, de sa police et de sa justice. Nous contestons cette justice d’État telle que nous la connaissons aujourd’hui, qui est un système punitif encadré par un système législatif – des textes de lois. Nous contestons donc l’idée de nous poser en juge pour autrui et de punir.
Nous devons alors nous poser la question de la manière dont nous voulons résoudre une situation de violence sans utiliser les mêmes outils que notre opposant, notamment le recours à la punition, à l’exclusion ou encore au bannissement.
D’autant plus si ces faits se passent dans le cadre d’un réseau d’interconnaissance et dans des lieux familiers mobilisant intrinsèquement le collectif qui fait corps avec la personne autrice ou victime des faits.
Néanmoins, deux éléments peuvent être pris en compte en matière de jugement, délation publique, punition, exclusion, bannissement :
1/ la mise en danger immédiate d’autrui ;
2/ des écarts entre les mots et le comportement de la personne accusée, le refus et l’absence absolue de remise en question, le refus et l’absence de possibilité de dialoguer.
Il faut aussi prendre en compte la temporalité plus ou moins longue pouvant être nécessaire à une personne agressée pour se reconstruire /à un agresseur pour reconnaître l’agression, et son état d’agresseur.
Des collectifs ont pu faire le choix de refuser la fréquentation d’espaces et de lieux collectifs amis de la personne agressée, à des personnes accusées d’agressions, tant que ces dernier.es n’étaient pas prêt.es à se remettre en question.
Replacée dans des temporalités et des localités ajustables, l’exclusion peut être un outil envisageable. Condamner, punir, bannir restent autrement des recours extrêmes qui ne font que déplacer le problème.
Il s’agit plutôt d’entendre la souffrance affichée d’un.e individu.e qui décide de ne pas taire une situation de domination et de violence qu’il.elle subit ou a subit, et d’accompagner la personne qui a agressé dans une réflexion visant à comprendre comment elle s’est retrouvée non seulement dans une position de dominant.e, mais a pris le rôle d’agresseur.euse, de cheminer avec elle, si besoin, pour déconstruire le rôle qu’elle a pu /peut /pourrait endosser. Comment se protéger les un.es les autres, des un.es des autres, tient de notre responsabilité collective.
Un exemple intéressant est celui mis en place par le collectif de V., suite à la prise de parole de plusieurs femmes qui ont dénoncé les agissements d’un individu. Après de nombreuses discussions collectives, un protocole a été expérimenté :
1. la personne accusée de viol devait quitter les lieux ;
2. verser une indemnité financière aux victimes
3. abandonner ses activités et ses projets immédiats (en l’occurrence ses études universitaires) ;
4. et prendre soin d’une personne (car jugé peu apte à prendre soin des personnes autour de lui) sans que cela ne lui apporte trop de valorisation sociale – en l’occurrence sa voisine.
Le collectif ne s’est pas arrêté à un simple bannissement, il a imposé un suivi des agissements de l’agresseur suite à son départ du collectif – ce qui implique que l’agresseur a accepté de coopérer (?).
La culpabilité et la responsabilité de l’agresseur ne se manifestent toutefois pas systématiquement avec évidence, et la part entre responsabilité individuelle et conséquence systémique est bien souvent inégale et difficile à départager. C’est ce que peuvent montrer les témoignages ci-dessous, illustrant ainsi les difficultés auxquelles on peut se heurter en voulant « rendre justice ».
Pourquoi faut-il punir ? Témoignages
- 1. Le consent-quoi ?
Tulipe, placé en centre de détention, a 31 ans. Il est incarcéré depuis ses 24 ans. Il n’a traversé que la moitié de sa peine, et il compte plus de dix ans d’incarcération en tout ; plus d’un tiers de sa vie. C’est sa troisième peine de prison. La première fois, il a pris trois ans fermes pour viol. Il avait 14 ans. Il est donc sorti à 17 ans. La seconde fois, il écope d’une peine de quelques mois pour vol en bande organisée. La troisième fois, il tombe une seconde fois pour viol, avec récidive donc. Il prend 14 ans fermes.
Tulipe raconte ses souvenirs de la vie d’ « avant ». Avant les murs et les grilles et le temps chronométré. Il raconte un nouvel an à Paris.
« On était sur les Champs, en boite, y’avait des filles, on danse, y’en a une qui me chauffe, puis bon, on sort, on continue la soirée ensemble, on prend le métro, et là elle voulait qu’on … qu’on le fasse dans le métro… Mais… c’est pas bien ça, non ? Ça se fait pas !
• _ - « Heu… ben, c’est-à-dire… c’est sûr que ça se fait pas de faire du sexe dans l’espace public, mais bon, si elle en avait envie et que toi aussi, c’est okay… »
Du haut de ses 31 ans et de ses dix ans d’expériences carcérales, la notion de « bien » et de « mal » en matière de sexualité était tout ce qu’il y a de confuse pour Tulipe. Il semblait qu’il n’avait jamais eu l’occasion de s’interroger sur le sens, la nature du consentement, sur ce qui est grave et ce qui ne l’est pas.
Les discussions avec Tulipe m’ont fait prendre conscience de l’évidence : nous n’avons pas intégré les mêmes règles ni les mêmes codes sociaux. Au sein de sa famille, la sexualité est reléguée au domaine du tabou ; son éducation sexuelle s’est faite avec les copains de cité et le porno conventionnel. L’école et les associations de quartier n’ont pas permis l’accès à des outils alternatifs pour parler et comprendre les enjeux autour de la sexualité et du consentement.
- 2. L’exilé
Une fois encore, les questions de sexualité, de viol, de consentement sont au cœur de la discussion. Muguet nous écoute exposer nos convictions et garde le silence. Une pause se fait dans la discussion. Il prend alors la parole : « Quand j’avais dix-sept ans, j’ai violé ma sœur. »
Sa famille est au courant. Sa sœur refuse de le voir. Il décide de partir loin et longtemps pour fuir ce passé, comprendre ses actes, se réparer. Il s’exile. Cela fait plus de dix ans maintenant. Il a cherché à revoir sa sœur, mais elle n’a jamais voulu, et il ne peut que respecter sa volonté. Il se sent démuni, par rapport à elle. Lui a fait son chemin, même s’il sait bien qu’il restera hanté par ces faits, et vulnérable face à ce passé.
- 3. Le loup qui cache la meute
Rosier participe à un viol collectif à 22 ans. Arrêté avec un autre accusé sept ans après les faits, il passe en cour d’assises deux ans après son arrestation. Tous deux prennent treize ans fermes, dont sept ans de peine plancher.
Cette condamnation amène à quatre remarques, étayées dans un article paru en 2017 sur Lundi Matin [5].
1/ Quel sens a la condamnation, si vue comme vengeance en réponse à un crime ? Punir ne signifie pas que l’auteur du crime comprenne pourquoi il est puni, et puisse changer. Punir n’implique pas non plus nécessairement d’apporter à la victime du crime satisfaction : « cesser de prendre les violeurs pour des montres absolus, et s’émanciper de sa peur, est-ce compatible avec la volonté de vengeance ? À ce jour, la haine n’a jamais reconstruit personne. »
2/ « Notre justice française semble incapable de reconnaître que les crimes commis par une personne à un moment T. de sa vie ne la définissent pas intégralement et pour toujours ; sujet de philosophie du bac 2015 : Suis-je ce que mon passé a fait de moi ? »
3/ « Le fait de punir les violeurs ne répond en rien au problème sociétal de la domination masculine et de la misogynie établie, qui est à la source du problème », comme cela a été discuté précédemment.
4/ Pendant que des Polanski reçoivent Césars et honneurs, « deux hommes à gueule d’arabes se prennent treize ans fermes. La justice n’est donc décidément pas la même pour tous. […] Quelle aurait été l’issue du procès, si la victime avait été une jeune femme arabe ou noire, et le coupable, un homme d’affaire blanc ? Penser à la pertinence de l’intersectionnalité – corréler les discriminations de genre, de classe et de race. » Angela Davis écrivait en 1981, « Aux Etats-Unis et dans d’autres pays capitalistes, les lois sur le viol en tant que règles ont été d’abord pensées pour la protection des hommes des classes aisées, dont les filles et les épouses pouvaient être attaquées. Ce qui arrivait aux femmes des classes ouvrières importait peu à la justice ; c’est ainsi que très peu d’hommes blancs ont été inculpés pour les crimes sexuels qu’ils ont infligés à ces femmes. » (Women Race and Class, cité par Despentes [6]). Dans ce tribunal, avant de rendre justice aux personnes violées ;
… on condamne des arabes de classe populaire, pour mieux épargner les violeurs français /blancs issus des classes moyennes et aisées.
… on épargne à la société française de réfléchir aux causes structurelles du viol, de remettre en question les causes du machisme, et le machisme latent. »
- 4. Le déni
« Je dis que je l’ai pas violée. Je l’ai pas violée. »
Bleuet fait habituellement preuve de sensibilité. Il sait écouter. Il est habile à comprendre les autres, leurs joies et leurs détresses. Maintenant, il est comme fou. Il parle avec rage, il n’écoute ni n’entend rien, il marche en rond d’un pas saccadé en prenant son auditoire à partie.
Il a fallu du temps pour comprendre le pourquoi de ce déni brutal, empêchant toute remise en question de sa part. Ce n’était pas toujours le cas, le déni, mais systématiquement ça revenait, ça le reprenait. « Je l’ai pas violée. C’est n’importe quoi, c’est un mensonge. Elle dit n’importe quoi, elle ment. »
Une amie de Bleuet a été violée par un membre de sa famille quand elle était fillette, fait devenu tabou familial gardé sous silence. Le violeur continue d’occuper une place de patriarche respectée. Lorsqu’il apprend les faits, adolescent, tout le système de valeurs de Bleuet, au fondement de sa manière d’être au monde, bascule. Ça l’avait rendu fou, le silence, le déni, l’hypocrisie, et l’effondrement d’un modèle.
Se voir accusé de viol, c’est incarner cet homme. L’homme qui a violé cette amie initialement présenté comme un modèle à suivre, et qui revêt désormais des allures de monstre. Il est impossible à Bleuet d’entendre cette accusation. Et il m’est impossible de comprendre le déni de Bleuet concernant ses propres actes sans avoir connaissance de ce passé.
Ce cas particulier renvoie aussi à ce que le vocabulaire employé pour parler de viol et d’agressions a de limitant.
- et donc…
Ces courts témoignages visent à illustrer la complexité de la réalité du viol, depuis la place des personnes accusées de viol.
On peut demander à un Etat, un gouvernement, des institutions, une société, une communauté de reconnaître la réalité statistique, donc effective, du viol.
Ceci étant dit, « ce ne sont pas des structures qui violent, mais bien des personnes. »1
Or, exiger la reconnaissance du viol de la part d’individus est de moindre évidence.
D’autre part, en quoi la punition, la prison leur est utile ?
Le procès, la publicisation de l’histoire peut parfois faire sens pour la personne agressée, dans un but de réparation, comme ce fut le cas pour la femme violée par Rosier, présente lors du procès.
La pertinence de la punition via l’enfermement ou le bannissement est plus questionnante.
Despentes – « J’pense qu’il y a très peu d’aide, si t’es pédophile ça doit être pareil. Un mec violent, où tu vas ? […] Si t’es un violeur, où tu vas ? Si t’es un pédophile, où tu vas ? Quels sont les espaces dans lesquels tu peux et exposer ton mécanisme et trouver quelqu’un qui va t’[apprendre] à travailler ? Où est-ce que tu vas pour travailler ça ? La prison va pas t’aider. C’est certainement pas en prison que tu vas devenir moins violent, moins violeur, ou moins pédophile. Qui sont les psy. qui vont t’accompagner, j’suis pas sûre que, vu l’état dans lequel est la psychanalyse, je suis pas sûre que les mecs soient armés pour ça. Parce que c’est toujours pareil, c’est comme si tu n’existais pas. Où tu vas ? »
Tuaillon – « Patrice [7] il va à des groupes de parole. Il va à de la thérapie de groupe, et il dit, « c’est des putains de groupe de parole à la roule moi les couilles dans la laitue » ; il déteste ces groupes de paroles et il dit que « c’est que des mecs qui se cherchent des excuses, des explications, ils font genre ils sont soulagés de trouver des explications etc., mais en fait le seul moment où ces raclures chialent avec sincérité c’est le moment où ils s’apitoient sur eux-mêmes ». »Victoire Tuaillon, « Apocalypse maintenant ; Entretien avec Virginie Despentes »,
émission Les couilles sur la table, publiée en octobre 2019.
Tuaillon – « Vous aviez dit, suite à me too, qu’en fait on se rend compte que y’a énormément d’agresseurs, que y’a énormément de harceleurs, que y’a énormément de violeurs … Y’a deux choses en fait qu’on peut se dire par rapport à ça, vous vous avez dit dans Télérama, « J’en ai assez du féminisme carcéral, c’est quoi cette habitude d’aller voir les flics à chaque fois qu’il nous arrive un truc », donc c’est que ça vous dérange. Et puis ensuite quand on voit le nombre d’hommes impliqués, le nombre d’hommes que ça concerne, on se dit que là notre système judiciaire, notre système policier et tout, il est pas du tout adapté pour traiter tous les cas de violence sexuelle qu’il y a dans la société. »
Despentes – « Bah il est adapté à aucun niveau, parce que si la seule sanction c’est la prison… c’est pas une réponse adaptée, la prison fera jamais d’un mec un mec moins violent. Donc déjà on a un problème, parce qu’on va envoyer des mecs dans un système qui va les rendre pires. […]
Aller chez la police pour… y’a quelque chose de problématique, tu peux pas être tout le temps chez la police. Enfin tu peux, l’histoire c’est que j’ai pas tout le temps d’alternative meilleure. Fermer sa gueule est pas non plus une alternative. Mais tu peux pas non plus, déjà parce que la police, c’est Papa, c’est masculin, il nous faudra encore vingt ou trente ans avant de sortir de cette analogie, l’appareil policier, c’est vraiment la représentation d’un pouvoir masculin […]. Tu peux pas passer ta vie chez la police, et en plus une fois que tu te retrouves devant les tribunaux, j’ai l’impression qu’il y a énormément de cas de viols, c’est pas l’endroit où ils devraient être discutés. De toutes façons/ »
Tuaillon – « Bah de toute façon, déjà y’a énormément de plaintes pour viol qui sont classées sans suite, je précise parce que souvent on croit que « classé sans suite » ça veut dire que rien n’a eu lieu mais pas du tout, c’est juste que le cas qui est décrit, l’enquête est difficile à faire, ça correspond pas au cas typique du viol, ça correspond pas à l’image qu’on se fait du vrai viol, bref, on en a beaucoup parlé de l’émission, donc en fait, on se dit, peut être que tout l’appareil judiciaire est pas du tout fait en fait, pour traiter des violences sexuelles, on peut pas. Et donc, qu’est-ce qu’il faut faire ? Qu’est-ce qu’on invente ? »
Despentes – « Quasiment, il faudrait inventer une cour alternative uniquement dédiée, […] sur un problème de harcèlement ou de viol, il me semble que les tribunaux sont pas assez fins et n’ont pas les outils pour statuer. Alors après, faudrait en parler avec les victimes, elles savent mieux que moi, mais pour les victimes j’ai l’impression que c’est pas très réparateur, le procès, on nous le vend, quand je dis j’en n’ai pas parlé, c’est pas vrai, j’en ai déjà parlé, j’ai pas l’impression que ça soit le, qu’la reconstruction se fasse si bien que ça, même une fois que t’as envoyé ton agresseur en tôle, ce qui est vraiment pas sûr, et que probablement tu feras la démarche pour rien, démerde toi avec ça après, je suis pas convaincue que le fait de parler dans cet endroit là de ce qui t’est arrivé est quelque chose de bon pour toi en tant que victime à chaque fois, peut être des fois mais, pas systématiquement parce que c’est pas fait pour ça. Et enfin, je suis absolument convaincue que qu’est-ce que tu vas envoyer un mec en prison et deux ans après il ressortira, il sera dix fois pire, la prison c’est une machine à emmerdes, c’est une fabrique à emmerdes, donc on va, à tous les niveaux faudrait qu’on réussisse à inventer une autre instance, une autre institution qui soit vraiment spécialisée dans des problèmes de harcèlement sexuel, de violence de genre, quels que soient les problèmes qui arriveront plus tard, mais qui soit vraiment une institution apte à discuter de ça, et qui passerait pas forcément, je crois par la police, je crois que cette habitude d’aller chez les keufs tout le temps, elle est mauvaise. Point. Ils sont… pas nos amis, ‘fin faut jamais, t’es content de les trouver si on veut te tuer, oui, évidemment, mais quand même la police ça peut pas être l’amie des féministes, c’est pas vrai. Je crois pas, spontanément, peut-être c’est mon âge qui joue mais l’institution police ni l’institution justice, ça peut pas être les amis des féministes c’est… fondamentalement faux. »Victoire Tuaillon, « Apocalypse maintenant ; Entretien avec Virginie Despentes »,
émission Les couilles sur la table, publiée en octobre 2019.
ECUEILS
Nous avons vu l’entremêlement du politique et de l’affectif, du déterministe et du phénoménologique, du structurel et du personnel, dont la prise en compte peut nous permettre d’ajuster notre regard et notre posture lorsque la vie nous met face à des situations d’agressions sexuelles dont témoignent des proches, en tant qu’auteurs ou en tant que victimes.
Nous avons vu comment ces multiples entrées d’analyses invitent à questionner nos postures individuelles et collectives, et à repenser des processus de justice. Des questionnements étayés par les quatre exemples sommairement décrits ci-dessus.
Les propos développés dans la seconde partie de cet article soulèvent des « nœuds », des « hiatus » situés aux interfaces de ce qui pourrait constituer trois facettes d’une même réalité.
Une première facette est la « réalité » telle qu’elle est « construite », « fabriquée ». Cette réalité correspondrait aux construits sociaux dont nous héritons.
Elle pourrait être qualifiée de « fabrique sociale » de la réalité.
Par exemple : a) s’il est prouvé qu’un homme a violé une femme, il mérite une peine de prison.
Ou encore : b) une personne qui peut prouver qu’elle a été violée a besoin d’un accompagnement psychologique.
Ou encore : c) la prostitution est une activité illégale, répréhensible, asservissante et condamnable.
Des lois, des associations, des outils institutionnels sont mis en place dans ces perspectives.
Une seconde facette est la réalité telle qu’elle est « perçue » ou « représentée » :
Elle pourrait être qualifiée de « croyance populaire », soit une lecture populaire de la réalité.
C’est ce qui se pense souvent, ce qui se dit parfois.
Par exemple : a) un violeur est un monstre.
Mais aussi : b) les femmes qui ont été violées l’ont bien cherché, d’ailleurs, où se trouvaient-elles, quelle heure était-il, comment étaient-elles habillées ?
Ou encore : c) la prostitution est une activité sale et dégradante.
Une troisième facette est la réalité telle qu’elle est « vécue ».
Elle pourrait être simplement qualifiée de « expérience personnelle » de la réalité.
C’est ce qui se passe effectivement à échelle individuelle, mais qui n’est pas forcément verbalisé, revendiqué, voire conscientisé.
Par exemple, a) mon meilleur ami m’apprend qu’il a violé une personne, mais je continue de le considérer comme mon meilleur ami, et non un monstre. Ou encore : mon grand père m’a violé, c’est à la fois un monstre qui me fait peur, et à la fois mon grand-père que j’aime.
Mais aussi : b) après avoir été violée, je me relève sans me sentir forcément brisée – ce qui ne veut pas dire que je suis soumise et silencieuse, mais plutôt que je ne me sens pas anéantie, et que cet évènement ne sera pas un obstacle insurmontable dans la poursuite de ma vie au quotidien.
Ou encore : c) être travailleuse du sexe me procure une autonomie financière, me permet de bénéficier d’un réseau d’entraide et de protection, et m’apporte une stabilité sociale.
La confrontation de ces trois facettes d’une même réalité – fabrique sociale, représentations populaires et vécu personnel – peut provoquer des frictions, s’élever comme autant d’obstacles sur lesquels notre pensée butte lorsque nous cherchons à adresser les questions d’agressions, de domination, de violences sexuelles.
La confrontation de ces trois facettes d’une même réalité nous apprend par ailleurs qu’il n’y a pas de corrélation entre la violence d’un acte tel que socialement catégorisé, et la violence d’un acte tel qu’il est vécu.
Les réflexions qui suivent veulent simplement mettre en lumières ces nœuds.
Dessine-moi la vérité
Les histoires donnent l’impression qu’il n’y aurait qu’une version des faits.
Une bonne, la bonne version des faits, la vérité.
Le reste ne serait que mensonge, les mauvaises versions des faits.
Une vision binaire qui comporte ce risque : drame, dramatiser, misérabilisme
Et qui amène à trancher maladroitement dans le vif :
juste /injuste, justice, bien /mal, bon /mauvais, vrai /faux, moral /immoral /amoral...
donc jugement : juger, exclure, bannir, condamner, pointer du doigt, coupable, bouc émissaire
Bien souvent, la justice d’État cherche à établir « la vérité » dans le déroulé des faits, partant de récits, témoignages, preuves matérielles. Il est tentant d’emprunter cette direction, avec le sentiment d’avoir besoin de savoir exactement « ce qu’il s’est passé » pour pouvoir se construire une opinion propre. Mais il faut se rendre à l’évidence : nul ne peut avoir accès à cette « vérité des faits ».
Car il faudrait se baser sur les récits et témoignages desdites personnes.
Or ces témoignages sont soumis à la déformation de la mémoire, voire à des volontés d’oubli.
Ils sont soumis à la déformation causée par l’émotion vive d’un vécu, d’un ressenti.
Ils sont soumis à la mauvaise foi, qu’elle soit consciente ou inconsciente.
D’autre part, en tant que personnes extérieures à l’histoire, nos propres vécus et ressentis, nos projections et représentations interfèrent. Faire usage d’empathie implique donc d’avoir bien conscience qu’en dehors des deux (ou plus) protagonistes concerné.es, nul n’a assisté à la scène, et que même une simple volonté de comprendre peut trébucher sur les failles de notre propre histoire.
« La vérité est comme un diamant à mille reflets ; chacun, assis autour, en verra et en décrira une facette différente. »
Nous sommes singuliers, complexes, hétéroclites
Il n’y a pas une histoire qui soit similaire
Il n’y a pas un agresseur qui soit similaire
Il n’y a pas un.e agressé.e qui soit similaire
Nos parcours propres, uniques, sont la matrice aux histoires que nous formulons de nos vies, de nous-mêmes ; ces histoires sont un processus continu, actif ; le passé n’est pas plus « figé », « écrit », « immuable » que le futur : notre mémoire ne cesse de le ré-écrire, re-raconter, re-formuler.
Le propos et le vécu varient d’une personne à l’autre alors que les faits sont de même teneure dans les deux situations.
De plus, est-il nécessaire de tout dire ? Quid du bénéfice du doute, de l’empathie a priori ? Ne faut-il pas reconnaître à chacun.e la possibilité de ne pas avoir à partager publiquement son histoire individuelle, par pudeur, par honte, par fierté, par volonté de protéger les personnes impliquées… : Peut-on imposer à d’autres d’exhiber publiquement ces parts de leur histoire pour pouvoir leur accorder une possibilité de compréhension, d’empathie, d’excuse ?
Je n’ai pas de réponse à ces questions.
« […] si on veut vraiment faire entrer ces affaires là dans une justice, faut élargir le vocabulaire, on peut pas avoir un seul mot pour tous les viols. On peut pas qualifier de la même façon viol au Congo, de guerre, avec le viol du mec avec qui t’es sorti, mais qu’est lourd. C’est pas exactement le même viol, c’est pas exactement dans les mêmes conditions, c’est pas exactement les mêmes conséquences pour l’individu, ça peut pas être pris de la même façon, et c’est pas les mêmes causes, donc il faut des mots différents, il faut des mots différents pour tous les viols. »
« Apocalypse maintenant ; Entretien avec Virginie Despentes »
Emission Les couilles sur la table, réalisée par Victoire Tuaillon, publiée en octobre 2019.
Des mots et des idées
« agression » ; « agresseur » ; « agressée » / « agressé » ;
« viol » ; « violé » / « violée » ; « violeur »
« pointeur » ; « pédophilie » ; « inceste »
Chacun de ces termes véhicule des représentations sociales très fortes.
Tant que ces représentations ne sont pas déconstruites et dépassées, l’emploi de ces termes peut engendrer des conclusions hâtives, jugements à l’emporte pièce, réactions tantôt haineuses, tantôt méprisantes, tantôt misérabilistes, tantôt marquées par la peur, le dégoût. Et inversement, des personnes qui ont été agressées ne le reconnaîtront pas, parce qu’elles n’imaginent pas une agression sans violence par exemple.
En conséquence, il est difficile pour les personnes concernées de verbaliser leur vécu.
Ne pas ignorer le tabou social qui accompagne le viol, contrairement aux qualificatifs employés pour une agression.
Ne pas ignorer que de porter le sceau de la ou du violé.e s’accompagne facilement d’un regard misérabiliste, victimisant, de peur, de dégoût – voire de mépris, de moquerie, surtout si la victime est un homme.
Ne pas ignorer que de porter le sceau du violeur s’accompagne facilement de réactions de haine, de peur, de dégoût également – plus rarement de respect et d’admiration.
Des systèmes de représentations qui s’appliquent aussi aux termes d’agresseur et d’agressé.e, mais avec moins de caricatures et de tabous.
S’il faut dire « agression », « viol »,
faut-il dire « victime » ? « violeur » ?
Dans la continuité de cette réflexion, si l’on part du principe que le droit doit être reconnu à toute personne, indépendamment des « faits », d’user du terme de « viol » pour qualifier un vécu, un ressenti, doit-on pour autant affirmer que le qualificatif de « violeur » puisse être assigné à toute personne indépendamment des faits ? Peut-on, indépendamment de la nature des faits, réduire publiquement l’agresseur à l’état de « violeur » ?
Une personne accusée de la sorte est plus susceptible de se braquer, de nier, de réfuter, de se retrancher derrière ses contradictions ; de ravaler des excuses qui ne seront jamais formulées ; de se dépeindre en victime, plutôt que de reconnaître ce qu’elle a fait.
Enfermer dans le qualificatif « absolu » de « violeur » une personne qui agresse, la réduire « absolument » à ce statut apparait simplificateur et inefficace – au même titre qu’on peut interroger la pertinence qu’il y a à réduire ou à enfermer la personne agressée dans le statut /rôle permanent et durable de « victime », a fortiori si elle ne le souhaite pas.
De manière générale, quelle pertinence y-a-t-il à réduire une personne à un acte, à un fait ?
Par delà l’agression et le viol ; réagir
Parler d’agresseur n’équivaut pas à parler de violeur ; le traitement de l’un ou de l’autre est différent, puisqu’il ne soulève pas le même tabou.
Et déconstruire les dominations implicites du quotidien est un défi qui doit être pris avec le même sérieux que celui de s’attaquer au grand monstre « viol ».
Il existe donc un double travail à opérer : cesser de faire du viol un tabou monstrueux, car cela ne permet en rien d’adresser le problème avec plus de justesse : tout en prenant conscience de ce qui, dans nos comportements quotidiens, permet des rapports de domination et de pouvoir.
Cela a été largement souligné par d’autres, les personnes qui commettent un acte de violence /viol ne sont pas systématiquement des psychopathes, ou des imbéciles qui assumeraient avec morgue leur plein pouvoir et leur supériorité sur d’autres, sans remords ni remises en question. Ce sont souvent des proches, issus du cadre familial : famille, amis, amis d’amis, conjoints, collègues, personnes avec qui il existe une relation [affective] préalable.
Le viol opéré dans un lieu sombre et isolé, la traque, ces cas de figure existent mais sont rares. Et mêmes ces cas de figure invitent à être traités avec prudence.
D’où l’insistance à rappeler que les violeurs ne sont pas des monstres, mais des êtres humains qui à un instant T. ont commis un acte monstrueux ; or, nul être humain ne devrait se voir être entièrement réduit à un acte.
En parallèle, inviter chacun à prendre conscience des petites expressions de la domination au quotidien /des comportements qui sont vécus comme dominants par celles et ceux qui nous entourent (répartition des tâches manuelles et intellectuelles, répartition de la prise et du temps de paroles, attitudes protectrices /infantilisantes /paternalistes /autoritaires, faire pour au lieu de faire avec ou de transmettre un savoir, etc., sachant que nous n’avons pas tou.tes les mêmes référentiels), que l’on soit celle.celui qui les engendre ou qui les accepte.
La déconstruction de la domination et du pouvoir commence par ces comportements et ces acceptations bénignes et quotidiennes.
Degrés de conscience
Faut-il nommer viol l’acte sexuel commis sur une personne qui n’a pas le choix de l’agression autant que l’acte sexuel commis sur une personne qui a « le choix » de dire non ? Peut-on condamner de la même manière l’acte sur une personne qui est obligée et l’acte sur une personne qui « s’oblige à » ? Dans le premier cas, la personne agressée n’a aucune marge de manœuvre. Dans le second, elle décide de rester /revenir : dans ce cas, ne doit-elle pas autant travailler sur elle que la personne qui a commis l’agression ? Evidemment, mille nuances à apporter à ces propos, car comment évaluer ce qui tient du « choix », de l’« obligation », comment mettre en lumière les enjeux de domination qui se posent dans la sexualité ?
Explicitation : il existe des relations non consenties au sein de couples, entre deux partenaires d’un soir. Ces soirs où tu n’as pas envie, mais tu ne dis rien parce que tu as bien intégré dans les codes sociaux inscrits en toi qu’il serait de ton « devoir » de faire du sexe avec ton conjoint, ton partenaire de soirée, à sa demande. Ces soirs où tu hésitais, tu avais peut-être un peu envie, et puis finalement non, et puis tu préfères te taire et satisfaire l’envie de l’autre, que de dire que finalement non, tu as changé d’avis.
Tu te forces une fois, trois fois, cent fois, et jamais tu ne dis rien.
Tu ravales ton non-consentement au fond de tes tripes.
Et puis, pour une raison ou une autre, un jour, tu prends conscience que tu peux dire non.
Que tu as la possibilité de refuser.
Que tu ne dois rien à l’autre.
Qu’il peut peut-être même l’entendre, le comprendre, respecter ta volonté.
Est-ce que le terme de viol (dont le viol conjugal) est applicable à ces situations ?
La question ne fait pas consensus.
Pour moi, il s’agit ici d’un exemple où ce n’est pas le partenaire sexuel qui est à mettre en cause, mais les normes sociales, ces règles implicites qui nous ont inculquées qu’il serait de notre devoir de satisfaire sexuellement notre partenaire, indépendamment de nos envies.
Faut-il, alors, parler de viol ?
Peut-on s’accorder sur le fait qu’il y aurait bien une personne violée, car non consentante, et qui peut s’aliéner face au fossé entre ses ressentis propres et les codes sociaux qu’elle a intégré… sans pour autant qu’il y ait de violeur, car pas d’intention de violer de la part du partenaire sexuel ?
La formulation sous forme de question ouverte n’est évidemment pas anodine. Et les limites aux questions ici soulevées sont qu’elles pourraient trop facilement servir d’excuses mal intentionnées.
Attention, sont ici exclus les cas de femmes qui seraient économiquement dépendantes de leur conjoint et dans l’impossibilité matérielle de partir, qui feraient l’objet d’un chantage affectif ou autre. Je parle plutôt de cas de femmes qui restent parce qu’inconscientes de leurs postures de dominées.
« Il m’a souvent été demandé par des femmes avec des maîtres décents qui n’avaient aucune idée des atrocités subies par leurs sœurs moins fortunées : « pourquoi les épouses ne partent-elles pas ? »
Pourquoi ne courez-vous pas lorsque vos pieds sont enchaînés ? Pourquoi ne criez-vous pas quand vous êtes bâillonnées ? Pourquoi ne levez-vous pas les mains au dessus de la tête quand elles sont clouées de chaque côté de votre corps ? Pourquoi ne dépensez-vous pas des milliers de dollars quand vous n’avez pas un sou en poche ? Pourquoi n’allez vous pas à la mer ou à la montagne, pauvres folles brûlant dans la chaleur des villes ? S’il y a quelque chose qui m’irrite plus que n’importe quelle autre dans ce satané tissu de fausse société, c’est cette incroyable stupidité avec laquelle le vrai flegme de la bêtise insondable demande : « pourquoi les femmes ne partent-elles pas ? » »Voltairine de Cleyre, « L’esclavage sexuel », in Ecrits d’une insoumise, 2018 [1895], p.224.
Questionnement en miroir : quelle est l’intention du partenaire ? Agresse t-il en pleine conscience, ou non ? Agresse-t-il avec la volonté de dominer, ou non ? Et là encore, comment s’assurer de l’intention et du degré de conscience d’une personne qui revêt le rôle d’agresseur ? La « bonne foi » est une affirmation par trop légère.
Quelle lecture du consentement : ce n’est pas parce qu’il n’y a pas consentement qu’il y a volonté de dominer. Si le non consentement n’est pas exprimé, ou pas entendu, difficile en face de comprendre que non consentement il y a.
Alors, n’avons-nous pas la possibilité, nous femmes et toutes autres personnes dominées /se sentant concernées, de travailler à affirmer et imposer nos limites ? A titre personnel, c’est ici que j’inscris une des batailles ; comment espérer de la part d’un.e partenaire sexuel.le potentiel.le qu’il.le s’en soucie pour nous, si nous ne sommes pas en mesure de le faire pour nous-mêmes ?
Tuaillon – « Est-ce que par exemple vous pensez qu’un homme peut violer sans s’en rendre compte ? »
Despentes – « Ah oui ! »
Tuaillon – « Ah oui ? »
Despentes – « Bah les hommes de ma génération et les hommes plus vieux ont été éduqués de telle façon que vraiment ça comptait pas ce que pensaient les femmes. Ils baisaient tout seuls. En gros. Ils baisaient avec des corps mais de gens qu’étaient pas vraiment là donc y’avait quelque chose sur le consentement féminin qui leur échappait complètement c’est vrai, il y avait toute une culture qui disait faut toujours un peu les forcer, quand elles disent non, c’est qu’elles disent oui… Hollywood là-dessus a vraiment fait un vrai travail de fond […]. Et donc oui je pense qu’aujourd’hui y’a plein de mecs qui sont sincèrement surpris des problèmes qu’ils ont parce que sincèrement ils ont fait leur vie normalement, au vu et au su de tous, tout se passait bien, au contraire, ils étaient plutôt célébrés pour cette « vigueur » […] Simplement c’était tellement normal d’être vigoureux, d’être virils et ouais, je pense qu’il y a plein de mecs qui ont pu faire des trucs et qui seraient sincèrement surpris de savoir que vingt ans après, la fille y pense encore et qu’elle a envie de vomir. »Les couilles sur la table, une émission animée par Victoire Tuaillon.
Entretien avec Virginie Despentes, « Meuf King Kong », publié en octobre 2019.
L’agression comme prétexte à règlements de comptes [inter]personnels
Car il y a aussi ce risque : celui de l’ « agression » utilisée comme prétexte pour régler par l’interpellation publique et collective des affaires d’ordre (inter)personnel – déceptions et frustrations personnelles, mal-être existentiel… qui croiraient trouver des éléments de réponses aux mauvais endroits, ou, plus mesquin, volonté de mise à l’écart d’une personne critiquée ou non appréciée pour d’autres raisons etc.
Par exemple : un couple fait face à une disparition de la libido chez un des partenaires.
Explication première : s’il n’y a plus de désir, c’est parce qu’il y a eu viol dans son enfance.
Explication beaucoup plus simple, mais moins acceptable : s’il n’y a a plus de libido, c’est qu’il n’y a plus de désir, parce qu’il n’y a plus de sentiment. Si i.elle ne part pas, c’est qu’i.elle a peur de partir (dépendance économique, affective), qu’i.elle ne comprend pas pourquoi les sentiments ont tari (le comportement dominant du partenaire reste une explication potentiellement plus niable qu’un viol subi dans l’enfance).
Expliquer chaque moment de tristesse, de mal être par le trauma qu’aurait causé une agression… Parce qu’il est socialement légitime d’être mal à cause d’un viol. Or la vie est un vaste absurde, le monde un large tissu d’injustices, on est tou.te.s condamné.es à porter le deuil de quelqu’un qu’on aime un jour, ce sont des raisons suffisantes pour déprimer, viol ou pas viol. Il est toutefois certain que quand on va mal, les souvenirs les plus sombres reviennent à la surface. Quant à savoir avec certitude si ce sont des traumas passés qui nous plongent dans un mal être existentiel, ou si, fonctionnant tel une boite de Pandore, nos traumas passés nous reviennent en pleine face en temps de mal être existentiel… Ne peut-on pas aussi s’accorder à dire que « la conscience est naturellement le lieu d’une illusion. Sa nature est telle qu’elle recueille les effets, mais qu’elle ignore les causes ». [8]
Le viol est de fait une cause toute trouvée pour justifier d’un état de déprime, d’un mal être existentiel. Cela ne veut pas dire qu’il en est la cause effective, véritable, ou tout au moins unique ; peut-être même cette pensée n’est-elle que l’effet d’une autre cause, plus insondable.
Réguler la vie collective : les règles sociales, implicites et explicites, ne sont pas les mêmes que celles du couple
Il existe un tas de règles qui régulent la vie sociale collective.
Les règles officielles : lois d’Etat, règlements au sein d’établissements publics et privés, consignes de sécurité… Les communautés autogérées, les collectifs informels eux-mêmes prennent soin d’encadrer leurs modes de vie expérimentaux de règles supposément décidées collectivement, suivant le vieil adage « l’anarchie, c’est l’ordre moins le pouvoir ».
Ce bagage de lois, de règles sont censées faciliter le « vivre ensemble » et nous permettre de « faire société ».
Le couple, c’est une mini société comme s’amuse à le décrire Liv Strömquist à la fin de La rose la plus rouge s’épanouit.
Or, dans cette mini-société que forme le couple, les règles qui régulent la vie quotidienne sont souvent considérées comme allant de soi, et restent non explicitées, non exprimées.
Cet état de fait rend particulièrement difficile à des personnes extérieures (amis, personnes mandatées) d’intervenir au sein du couple pour désamorcer des situations de pouvoir, d’abus, de violence qui seraient dénoncées par l’une des personnes du couple.
Par exemple, l’usage de la domination dans la sexualité du couple peut être considéré comme source de plaisir, si conjointement accepté comme tel – et comme forme de violence autoritaire et abusive, si non consentie par un des deux partis. Mais comment faire la lumière sur une telle situation ? Comment excaver une « vérité » qui explicite ce que sont les règles tacitement admises au sein d’un couple, sachant que ces règles peuvent n’être jamais énoncées clairement, peuvent changer en cours de route, peuvent être acceptées pendant un temps, puis refusées du jour au lendemain, parce que devenues non conformes aux attentes de l’un.e, de l’autre ?
Plus largement, est-on en mesure de refuser toute forme de domination dans les couples, de décider pour des couples que des relations autoritaires au sein du couple sont synonymes d’abrogation des libertés et d’aliénation ?
C’est aussi maladroit et utopiste que de se moquer du corps salarié cherchant à protéger ses droits au travers d’organisations syndicales, en lui opposant que le travail est une aliénation et que la seule option acceptable est de s’y soustraire et de refuser le salariat, le patronat et l’ordre capitaliste qui régule ce monde. Ou de vouloir « sauver » une femme battue en lui disant de quitter son conjoint, alors qu’elle s’en sent incapable.
Qui a la légitimité de décider pour autrui ?
Epilogue : une dernière histoire…
C’est l’histoire de Chanvre.
Il reçoit un mail d’une collègue lui reprochant du « harcèlement » sur leur lieu de travail.
Chanvre tombe des nues ; il est mortifié à l’idée d’avoir eu des comportements déplacés dont il ne se serait même pas rendu compte ; il redoute les conséquences que cela peut avoir pour lui sur son lieu de travail.
Il connait assez bien la personne à l’origine du mail, la connaissance de son histoire personnelle lui permet d’imaginer une explication quant à sa réaction.
De retour au bureau, il demande à sa collègue d’expliciter ses accusations : elle lui reproche de la contraindre, par le fait de lui « barrer le passage », à lui « faire la bise » pour lui dire bonjour lorsque l’une ou l’autre arrive sur leur lieu de travail. Chanvre est décontenancé : c’est ainsi qu’il dit bonjour à l’ensemble de ses collègues, hommes et femmes, et il n’y a jamais vu de forme de harcèlement. Par ailleurs, il n’a pas eu l’impression, même rétrospectivement, de la contraindre en lui « barrant le passage. » Il le précise à sa collègue, et veille ensuite à ne plus avoir de contact physique avec elle. L’incident s’arrête là.
Quand Chanvre parle de cet épisode, il est explicite quand au fait que cette histoire le marque. Il est, toute proportion gardée, choqué.
Ce témoignage permet d’illustrer la plupart des remarques étayées précédemment.
Une femme vit comme forme de « harcèlement » la manière dont un collègue lui dit bonjour, en lui faisant la bise, comme il le fait avec tout son entourage.
Que signifierait la recherche d’une « vérité » dans cette histoire ?
Peut-on comprendre sa réaction à elle sans avoir connaissance de son passé ? Est-il nécessaire de connaître son passé pour donner du crédit à ce qu’elle formule, ce qu’elle ressent ?
Quelle corrélation établir entre un acte, le vécu traumatique de cet acte, et la possible condamnation sociale de cet acte ?
Qu’implique le choix qu’elle fait de parler de « harcèlement » ? L’emploi de ce terme est-il justifié ? Adéquat ? Qui peut en juger ?
Quelles pourraient être les conséquences de ces accusations pour Chanvre au sein de son lieu de travail ? _ Ses craintes de pâtir d’une accusation de harceleur sont-elles fondées ?
Le poids de la honte et de la condamnation sociale de qui est reconnu « harceleur », « agresseur », est il juste et proportionné, considérant l’acte ?
Mes réactions sont passées par trois paliers :
Premièrement : qualifier de « harcèlement » le fait de faire la bise ?! Ce terme est hors de propos !
Puis : il n’est évidemment pas un « harceleur », cela doit être énoncé clairement.
Enfin : quels que soient les termes, elle témoigne d’une souffrance qui doit être entendue.
Cet exemple peut paraître risible, ou partial.
A mon sens, il permet pourtant de mettre en lumière les impasses dans lesquelles nous pouvons nous engouffrer – donner trop rapidement du crédit à la personne qui accuse, ou au contraire, la discréditer trop rapidement. Ce n’est ni en s’acharnant sur l’accusé, ni en tournant l’accusatrice en ridicule que cette situation peut être dénouée.
IN FINE
Eléments de synthèse
En somme, nous pouvons agir collectivement contre les violences structurelles de domination, agir sur les structures et les règles explicites et tacites qui régissent nos sociétés ; et bien sûr, nous pouvons /devons agir sur nous-mêmes, nous aider mutuellement à déconstruire les comportements dominants – et les comportements de dominé.es ! – que nous portons, dans le but de nous rendre moins vulnérables.
En revanche, sachant que selon la lunette utilisée – fabrique sociale, croyances populaires ou vécu personnel – la réalité peut se vivre et se comprendre différemment, prendre la responsabilité de condamner un individu est peu satisfaisant ; si l’on admet par exemple que « la vérité n’existe pas », que nous n’aurons jamais pleine connaissance des trajectoires et vécus singuliers des personnes concernées et que nous n’aurons donc jamais pleine connaissance des systèmes de représentation qu’i.elles ont construits. D’autant moins que nous manquons cruellement de vocabulaire pour adresser avec justesse la multiplicité des situations existantes.
Cela ne doit pas nous empêcher de chercher à comprendre ce que vivent les autres, à protéger les personnes vulnérables, en ayant en tête que nous avons beaucoup plus en commun avec des agresseurs que nous pourrions croire, partant du constat simple que tout comme nous, et même s’ils ont commis les pires atrocités /si leurs « points de folie » ne correspondent pas aux nôtres, ils sont doués d’humanité, et que nous sommes à même de développer des liens affectifs /une empathie vis-à-vis d’eux.
Comment réagir, de quels outils disposons-nous ?
La parole, l’écoute, le dialogue peuvent occuper une place prépondérante dans ces processus de compréhension /reconstruction.
Faire le choix d’un traitement « privé » de l’affaire : laisser les proches des personnes concernées intervenir tant que celles-ci ne représentent pas un danger pour le collectif ou pour autrui ; faire appel à un /une médiatrice si voulu et nécessaire.
/converser, dialoguer, partager, écouter, comprendre, réfléchir, soigner, construire ---
Puisque la justice ou son idée sont peu satisfaisantes, emprunter le chemin de l’empathie pour développer nos questionnements, étendre notre compréhension, espérer des réponses ; plus tard, peut-être, la ligne de fuite qui échappe à l’affrontement justice /empathie.
Aussi, et ce n’est ni évident, ni négligeable, tant ces processus sont chronophages et épuisants : savoir et devoir se donner le temps, malgré l’urgence affichée. Ainsi, ce texte est le fruit de plus de deux ans de réflexions, discussions, recherches, enquêtes, lectures et travail.
Conséquences directes
Ces événements ont eu des conséquences directes dans notre lieu de vie et les lieux collectifs proches, qui méritent d’être énumérées, même s’il reste énormément de travail – existe-t-il seulement une fin ?!
1/ une libération de la parole, au sein de notre lieu de vie collectif et bien au-delà
2/ la tenue de plusieurs réunions non mixtes au sein du « réseau militant » proche (et informel), à l’initiative de personnes de genre féminin et masculin issues de ce milieu militant – mais pas de représentation du milieu lgbtqi+.
3/ la diffusion de brochures traitant du sujet, et la projection du documentaire « La domination masculine » avec invitation du réalisateur, au sein de notre lieu de vie collectif.
4/ une attention plus marquée et une volonté d’accompagnement portée vers Cactus, venant de ses ami.es.
5/ des phases de discussions et de réflexions portées tantôt individuellement, tantôt collectivement, dont ces écrits sont un des fruits.
En revanche, jamais la personne qui a dénoncé publiquement l’agression qu’elle a vécue n’a eu de retours sur les conséquences de sa prise de parole, sauf un temps de présence lors de la première réunion non mixte. Jamais il ne lui a été demandé ce qu’elle aurait attendu, voulu – si elle en attendait quelque chose.
C’est une absence de retours que je déplore, et ce texte voudrait être une manière de dire « tu es entendue », à défaut de lui apporter la moindre réponse.
Au bout du chemin…
Vous aurez compris le leitmotiv qui guide l’ensemble de cette réflexion ;
Ces événements peuvent avant toute chose nous amener à nous questionner sur nos propres comportements, en tant que dominé.e et dominant.e, agressé.e et agresseur.euse que nous sommes tou.te.s, inévitablement, un jour où l’autre.
C’est en faisant le constat de nos propres comportements dominants (relatifs et proportionnels), que nous pourrons mesurer la facilité qu’il peut y avoir à pointer la domination des autres, et la difficulté qu’il y a à reconnaître et déconstruire nos propres comportements de dominants et de dominé.es.
« Nous voudrions chauffer la carcasse de l’Homme et partir. Peut-être arriverions-nous à ce résultat : l’Homme entretenant ce feu par auto-combustion. L’Homme libéré du tremplin que constitue la résistance d’autrui, creusant dans sa chair pour se trouver un sens. »
Frantz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952.
« A la fin de votre vie, vous pourrez fermer les yeux en disant : ‘Je n’ai point été gouverné par l’idée dominante de mon siècle. J’ai choisi ma propre cause et je l’ai servie. J’ai prouvé par toute une vie qu’il est quelque chose en l’Humain qui le sauve de l’absolue tyrannie des circonstances, qui en triomphe et les refonde, et cela c’est le feu immortel de la liberté individuelle, laquelle est le salut de l’avenir. »
Voltairine de Cleyre, « L’idée dominante » in Ecrits d’une insoumise, 1910, p.117. [9]
.
Il nous appartient de dénoncer inlassablement les héritages structurels qui permettent à ces expressions de la domination de se reproduire et de perdurer. Alors seulement, on peut espérer une émancipation et un affranchissement à la fois à une échelle personnelle et à une échelle collective.
Nous avons aussi de le choix d’accompagner les personnes qui en font la demande, agressé.es autant qu’agresseurs ;
Tout en contribuant à remettre en question nos propres tendances à adopter des comportements dominants /dominé.es, car il serait trop facile et dangereux de défendre la non responsabilité individuelle, y compris la notre propre, sous prétexte qu’il existe des explications structurelles et des formes de responsabilités collectives. Où, plus élégamment formulé par Victorine de Cleyre, « La doctrine qui consiste à proclamer que les circonstances sont tout et les hommes rien a été et est le fléau de nos mouvements modernes de réformes sociales. »
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE
- Collectif, « Je ne veux plus être un violeur », 2013, Pointpointpoint.
- Collectif, « Nous sommes toutes des survivantes, nous sommes toutes des agresseur.euses », 2015, Infokiosques.
- Collectif, Revolution starts at home. Confronting partner abuse in activist communities, 2011, zine.
Disponible en ligne sur le site criticalresistance.org.
- Collectif, Education populaire et féminisme, récit d’un combat (trop) ordinaire. Analyses et stratégies pour l’égalité, éd. La Grenaille, 2016.
- Collectif, Caisse de solidarité de Lyon, « Il n’y a pas de recette miracle », 2020, Infokiosques.
- Anonyme, « Accounting for ourselves. Sortir de l’impasse autour des agressions et des abus dans les milieux anarchistes », traduit et mis en ligne en 2018, Infokiosques.
- Anonyme, « C’est la première fois que je témoigne en cour d’assises », oct. 2017, Lundi Matin.
/rectifié par : Anonyme, « Le consentement, ce n’est pas dire oui », nov. 2017, Lundi Matin.
- Voltairine de Cleyre, « L’idée dominante » et « L’esclavage sexuel » in Ecrits d’une insoumise, textes réunis et présentés par Normand Bataillon et Chantal Santerre, Lux Editeur, 2018, 309 pages.
- Virginie Despentes, King Kong Théorie, Le Livre de Poche, Grasset & Fasquelle, 2006, 153 pages.
/Et aussi les quatre entretiens enregistrés dans le cadre de l’émission « Les couilles sur la table », animée par Victoire Tuaillon, publiés en octobre 2019.
/Et aussi la tribune publiée dans Libération au lendemain de la cérémonie des Césars :
« Césars : Désormais, on se lève et on se barre », Libération, Tribune publiée le 1er mars 2020.
- Les Enrageuses, « Lavomatic – lave ton linge en public », 2009, Infokiosques.
- Eve Ensler, Les monologues du vagin, première parution en 1998. En libre accès sur Infokiosques.
- Eve Ensler, Pardon, traduction d’Eloïse Esquié, éd. Denoël & d’ailleurs, 2020 [Bloomsbury, 2019], 144 pages.
- Alexandria Marzano-Lesnevich, L’Empreinte, récit, traduction d’Eloïse Esquié, éditions Sonatines, 2019 [Flatiron Books, 2017], 471 pages.
- Guillaume Massart, La Liberté, 2019. Film documentaire sur la prison à ciel ouvert de Casabianda, Corse.
- Valérie Rey-Robert, Une culture du viol à la française. Du « troussage domestique » à la « liberté d’importuner », éditions Libertalia, 2019, 292 pages.
Pour l’art de l’humour, l’amour de l’art, l’amour de l’humour, l’humour de l’art et tout cela :
- Delphine Biard, Flore Grimaud, Caroline Sahuquet, Speculum, théâtre, printemps 2019. Manufacture des Abbesses, du 28 mars au 4 mai 2019.
- Juliette Boutant et Thomas Mathieu, « Projet Crocodiles », blog et BD.
- Quartet Buccal, Impertinence féminine a capella.
- Rockstardinausorpiratprincess (script), Tasse de thé et consentement, animation : Rachel Briand, narration : Lionel Bouzid, Blueseatstudio.com, posté en octobre 2016.
- Liv Strömquist, La rose la plus rouge s’épanouit, publié sous le signe noir de Rackham, 2019, pas de pagination.
- Liv Strömquist, Les sentiments du Prince Charles, publié sous le signe noir de Rackham, 2016 [2012], pas de pagination.
[1] Les noms /surnoms ont été, de toute évidence, changés.
[2] Voir la bibliographie (non exhaustif).
[3] Une personne dite « cis » est une personne qui se reconnait dans le genre qui lui a été attribué à la naissance.
[4] Il ne s’agit donc pas ici de cas à la DSK ou à la Polanski – d’autant que leur visibilité médiatique et leur instrumentalisation politique en font des cas symboliques relevant de la lutte structurelle – mais d’une situation qui touche un proche qui vit mal son statut d’agresseur.
[5] Anonyme, « C’est la première fois que je témoigne en cour d’assises », oct. 2017, Lundi Matin.
/rectifié par : Anonyme, « Le consentement, ce n’est pas dire oui », nov. 2017, Lundi Matin.
[6] Virginie Despentes, King Kong Theory, Le Livre de Poche, Grasset & Fasquelle, 2006, 153 pages.
[7] Patrice : personnage de Vernon Subutex, trilogie de Virginie Despentes.
[8] Gilles Deleuze, Spinoza, Philosophie Pratique, Les éditions de Minuit, coll. Reprise, 2003 [1970], p.29.
[9] Textes réunis et présentés par Normand Bataillon et Chantal Santerre, Lux Editeur, 2018, 309 pages. Disponible [en ligne→https://www.socialisme-libertaire.fr/2018/03/l-idee-dominante.html].
)
Merci à Lola L. et Virginie D. pour leurs mots, dans des registres très différents.
Merci à Alissa, Audrey et Audrey, Marianne, Marie, Mel., Myr., Jojo et Jojo, Jul et Luj, Zu., Zoé, Z. et zz. pour leur présence, écoute, patience, possibilités de dialogues, conseils, remarques toujours constructives et éclairantes.
Merci à T., ou H., ou N., aujourd’hui A. Une déclencheureuse.
c.l.e. éditions – Décembre 2020 – Paris
Pour tout commentaire, retour critique, témoignage, etc., écrire à : key_editions@@@riseup.net
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (573.8 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (720.9 ko)