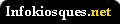S
La société de l’avenir,
suivi de L’âge de l’ersatz,
suivi de Où en sommes-nous ?
mis en ligne le 26 avril 2004 - William Morris
Notes de l’EditeurIce :
(Juste pour exprimer mes motivations à avoir mis ces textes en brochure...)
Ces textes sont trois conférences que William Morris a données entre 1887 et 1894. N’ayant pas l’envie de me hasarder sur une biographie, je dirais juste très grossièrement juste que c’était un utopiste radical, qui - du moins au niveau des finalités des luttes - ne voulait pas confondre ce qui était acceptable (une vision utopique) avec ce qu’il interprétait comme n’étant que des réformes. L’ensemble de ces trois textes peut apporter une critique de la société industrielle, de la consommation, du progrès, du travail, de l’activisme(!) dont le point le plus interpellant selon moi est que l’on pourrait les calquer à notre époque sans enlever une miette du fond ; Quand bien même on puisse avoir des divergences avec son point de vue, il paraît d’une déconcertante actualité... Il y a de quoi se poser des questions...
J’ai gommé les textes des rapports de genre. Certes, cela donne un certain anachronisme, mais je ne pense pas du tout dévoyer la pensée de l’auteur. Quoiqu’il en soit, les anachronismes me dérangent moins que les rapports de genre.
Si vous voulez le fichier au format RTF de cette brochure, mailez moi à :
mcpit at email.com.
Une chose qui est un peu moins temporelle est un certain vocabulaire ; particulièrement l’emploi du mot ‘socialiste’. Je voudrais exprimer ceci : à la manière dont il l’interprète, je veux bien me revendiquer socialiste aussi. Le mot pourrait faire rire de nos jours, mais l’idée qu’il met derrière est visiblement très loin de celle que l’on pourrait avoir maintenant.
La société de l’avenir
Nous, socialistes, qui revendiquons une transformation sociale propre à émanciper le travail et à jeter ainsi les bases d’une nouvelle société, nous nous contentons de réclamer ce que nous croyons nécessaire à l’avènement sans doute imminent de cette société. Nous préférons cela à l’élaboration de schémas utopiques et complexes pour l’avenir. Le monopole des moyens de production doit disparaître : celleux qui participent à la production marchande doivent pouvoir user elleux-mêmes, à tout moment, des biens qu’elleux seulEs créent, sans être contraintEs d’en abandonner la meilleure part aLau propriétaire oisiVe. Nous croyons aux vertus régénératrices de cette honnêteté élémentaire et pensons que le monde ainsi libéré entrera dans un nouveau cycle de progrès. Nous sommes prêtEs à assumer, avec sérénité, tous les désavantages qui pourraient résulter de ce nouveau développement ; nous sommes certainEs que se débarrasser de ce système sera en tout point bénéfique, puisqu’il réunit en lui presque tous les inconvénients. Nous sommes persuadéEs qu’en mettant fin à un système de production déliquescent et déficient on n’abolira pas les avantages acquis mais on les mettra au contraire à la disposition de touTes, au lieu d’en limiter la jouissance à quelques‑unEs. En un mot, après avoir examiné les conditions générales actuelles, nous en avons conclu qu’aujourd’hui le rôle des réformateurIces est moins de prophétiser que d’agir. Nous devons donc utiliser les moyens en notre possession pour remédier dans l’immédiat aux maux qui nous accablent, et laisser aux générations futures le soin de défendre la liberté que nos efforts leur auront acquise, et d’en jouir.
Toutefois, nous savons plus ou moins quelle voie empruntera le monde dans un futur proche : le cours de l’histoire passée nous l’enseigne. Nous savons en outre que le monde ne peut pas revenir sur ses pas et que les individuEs, dans la nouvelle société, développeront promptement leur corps et leur esprit ; dans l’ensemble, illes rempliront leurs devoirs envers la communauté bien mieux que ne l’ont fait les générations précédentes. Illes ressentiront davantage la nécessité de s’associer dans leur travail et dans leur vie en général. L’amélioration des conditions matérielles qu’entraînera un travail libre laissera à touTes plus de loisirs et plus de temps pour penser. Les tentations ayant changé, le nombre de crimes diminuera. Enfin, le développement du bien‑être et de l’éducation nous délivrera progressivement de nos maux, tant corporels que spirituels. En bref, nous savons que le monde ne peut progresser dans les domaines de la justice, de l’honnêteté et de la bienveillance sans que ne s’améliore l’ensemble des conditions matérielles d’existence.
Mais à côté de ce que nous savons, qui nous incite à organiser l’agitation en faveur d’une transformation sociale radicale, il y a ce que nous ne savons pas et que nous pouvons seulement imaginer. Cette image de l’avenir, cet espoir, ce rêve si vous voulez, attireront à leur tour au socialisme touTes celleux qu’un simple raisonnement, fait de déductions scientifiques ou politico‑économiques et d’arguments tirés des théories les plus pertinentes, ne toucherait pas le moins du monde. L’individuE acquiert ainsi la capacité d’examiner ses motifs d’espoir et le courage de mener à bien ses réflexions qui seraient sinon, comme l’a dit un roi arabe à propos de l’arithmétique, trop ennuyeuses pour qu’on les approfondît.
En fait, les partisanEs de la révolution sociale se divisent, comme les autres, en deux familles d’esprit : celleux qui sont portéEs à l’analyse théorique et celleux qu’attire surtout l’activité constructive. Appartenant moi‑même à ce dernier groupe, je suis pleinement conscient des dangers que nous encourons et, plus encore peut‑être, des plaisirs qui nous échappent. Je suis, me semble‑t‑il, aussi reconnaissant que je le dois aux esprits plus théoriciens qui nous remettent dans le droit chemin lorsque notre désir d’action nous égare, et je suis aussi, je le confesse, quelque peu envieux de la béatitude qu’illes connaissent en s’abîmant dans la contemplation de la perfection de leur théorie favorite. Bonheur dont nous ne jouirons jamais, ou rarement, nous qui utilisons nos yeux plutôt que la puissance du raisonnement pour examiner comment va le monde.
Néanmoins, puisque ces théoricienNes traitent et traiteront de chimères nos visions instinctives, et qu’illes ont presque toujours le dessus ‑ du moins c’est leur avis ‑ lorsque nous nous opposons amicalement, je dois mesurer mes paroles à leur égard ; je me contenterai donc, pour le moment, de parler des visionnaires, c’est‑à‑dire des genTes pratiques. Je dois commencer par vous confesser quelque chose, à savoir que nos visions à nous, visionnaires ou genTes pratiques, diffèrent largement entre elles et que nous ne sommes guère passionnéEs par celles des unEs ou des autres ; en revanche, les théories émanant des esprits analytiques diffèrent peu entre elles, et celleux‑ci sont extrêmement intéresséEs par leurs thèses respectives ‑ de la même façon qu’unE bouchèrE s’intéresse à un boeuf : pour le dépecer.
Je ne vais pas tenter de comparer mes visions avec celles d’autres socialistes, mais simplement vous parler de certaines d’entre elles, en vous laissant le soin de faire la comparaison vous‑mêmes (si vous faites partie des visionnaires), ou de vous consacrer à la critique (si vous êtes plutôt théoricienNes). Je m’apprête, en bref, à vous livrer un chapitre de mes confessions. Je souhaite décrire ici la société de l’avenir telle que je la désire, comme si je devais y renaître. Il est probable que vous trouverez assez étranges certaines de mes visions.
Une précision, honteuse et triste, confirmera votre impression. Je suis issu d’une classe aisée et j’ai toujours connu le luxe ; c’est pourquoi j’exige beaucoup plus de l’avenir que la plupart d’entre vous. Et la première de mes visions, celle qui illumine toutes les autres, est celle du jour où cette différence, avec toutes les incompréhensions qu’elle suscite, sera abolie et où les mots riche et pauvre, même s’ils figurent encore dans les dictionnaires, n’auront plus qu’un sens historique ; sens que nos grandEs théoricienNes devront expliquer avec soin, en y consacrant beaucoup de temps et de paroles, sans autre résultat qu’une feinte compréhension de la part de leur auditoire.
Il me faut bien supposer, pour commencer, que la réalisation du socialisme tendra à rendre les individuEs heureuXes. Mais qu’est‑ce qui rend les individuEs heureuXes ? Une vie pleine, libre, et la conscience de cette vie. Ou encore, employer agréablement notre énergie et jouir du repos que sa dépense nécessite. Voilà ce que j’entends par bonheur pour touTes ; cette définition couvre toutes les différences de tempérament et d’aptitude, des plus énergiques aux plus paresseuXes.
Tout ce qui entrave la liberté et la plénitude de la vie, quelque séduisante qu’en soit l’apparence, est mauvais ; on doit s’en débarrasser aussi vite que possible. Les individuEs censéEs, celleux bien sûr qui souhaitent être heureuXes, se doivent de ne pas l’endurer.
Voilà de ma part un aveu qui, je le crains, révèle un esprit bien peu scientifique. Il suggère que les individuEs usent de leur libre arbitre, ce que réfute, me semble‑t‑il, la science la plus récente. Mais, rassurez‑vous, je ne vais pas entrer dans la polémique à propos du libre arbitre et de la prédestination. Je veux seulement démontrer que si l’individuE est le produit des conditions extérieures, comme je le pense intimement, il doit être de son ressort en tant qu’animalE socialE (ou de celui de la société, si vous préférez) de créer le milieu qui fait d’ellui ce qu’ille est. L’individuE crée et doit créer ses conditions de vie : qu’ille en soit donc conscientE et qu’ille les crée à bon escient.
A‑t‑ille agi ainsi jusqu’à présent ? Je crois qu’ille a essayé mais seulement avec un succès limité et d’ailleurs sporadique. Cependant, ille est fierE des résultats de ce succès qu’ille appelle civilisation. De longues discussions sur ses bienfaits ou ses méfaits ont eu cours parmi des genTes d’opinions variées. Dans son excellent article sur le sujet, notre ami BaxP a, je crois, bien replacé le débat sur sa vraie base, en démontrant que la civilisation était bonne en tant qu’étape mais mauvaise en tant que fin. C’est dans ce sens‑là que je me déclare ennemi de la civilisation. Et puisque nous en sommes au chapitre des confessions, je vous dirai que ce qui motive particulièrement mon engagement comme socialiste est cette haine de la civilisation. Mon idéal d’une nouvelle société ne pourra être réalisé sans la destruction de la civilisation.
Car si le bonheur consiste à jouir de l’emploi de notre énergie et du repos nécessaire, il me semble que la civilisation, considérée d’un point de vue statique (selon les termes de Bax), tend à nous interdire ces jouissances ; elle réduit l’individuE, privéE de volonté, au rang de machine et lui retire progressivement, avec ses fonctions animales (à l’exception des plus élémentaires), le plaisir qu’ille prenait à les remplir. L’individuE de l’avenir semble devoir se réduire à une panse dotée d’intelligence, formée par des circonstances sur lesquelles ille n’a aucun contrôle, et à qui manque la faculté de communiquer les résultats de sa réflexion aux autres panses, ses congénères.
La société de l’avenir, telle que j’en conçois l’idéal, se caractérise d’abord par le règne et le développement de la liberté et de la volonté individuelles, que la civilisation ignore et même combat ; ensuite, par la fin de cet esclavage qui nous rend dépendantEs, non pas des autres individuEs, mais de systèmes artificiels conçus pour éviter aux individuEs toute peine et toute responsabilité humaines. Et, afin de renforcer cette volonté chez les humainEs, j’exige avant tout qu’illes mènent une vie animale libre et sans entraves ; j’exige la suppression totale de tout ascétisme. Si nous nous sentons le moins du monde aviliEs lorsque nous sommes amoureuXes, ou joyeuXes, ou affaméEs, ou fatiguéEs, c’est que nous sommes des animaLaux inférieurEs et donc des individuEs misérables. La civilisation nous pousse à avoir honte de tels actes ou de tels sentiments et nous demande autant que possible de les cacher ou, sinon, de trouver d’autres personnes pour se substituer à nous. En réalité, il me semble qu’on pourrait définir la civilisation comme un système organisé de façon à réserver à une minorité privilégiée l’exercice par procuration des facultés humaines.
Cette exigence concernant la suppression de l’ascétisme en entraîne cependant une autre : la suppression du luxe. Cela vous semble peut‑être paradoxal ? Pourtant ça ne l’est pas. Qu’apporte le luxe, si ce n’est une insatisfaction malsaine à l’égard des joies simples prodiguées par notre douce terre ? Le luxe n’est que la distorsion de la beauté naturelle des choses en une laideur perverse, apte à satisfaire l’appétit blasé d’unE individuE qui n’en est plus unE, puisqu’ille ne travaille plus ni ne se repose. Dois‑je vous rappeler ce que le luxe a apporté à l’Europe moderne ? II a couvert les prés verts et riants de taudis pour esclaves ; il a détruit les fleurs et les arbres avec ses gaz empoisonnés ; il a transformé les rivières en égouts, à tel point qu’en de nombreux endroits d’Angleterre les genTes ont oublié à quoi ressemblaient un champ ou une fleur ; leur idée de la beauté est un débit de boissons au décor clinquant et à l’atmosphère viciée, ou encore un théâtre à la vulgarité tapageuse. La civilisation s’en satisfait et n’en a cure. LAe riche, ellui, pense : “ Tout va bien ; le peuple est maintenant habitué à cela et, tant qu’il se contente de se remplir la bedaine de gruau à cochons, cela suffit. ” Et à quoi tout cela ellui sert‑il ? A commander de magnifiques portraits, à se faire construire de beaux édifices et réciter de bons poèmes ? Oh, que non. Ce sont des créations antérieures au luxe, antérieures à la civilisation. Le luxe produit plutôt les clubs de Pall Mall, tout capitonnés et comme destinés au repos de dames délicates et maladives mais qui sont pour l’agrément de graves messieurs à favoris venant papoter dans ces ridicules bonbonnières ; si bien que les laquaisEs en livrée chamarrée sont ici plus honorables que celleux qu’illes servent. Je m’en tiendrai là : un seul de ces grands clubs est assez représentatif de ce qu’est le luxe.
Je m’étends, voyez‑vous, sur le sujet du luxe, l’ennemi réel du plaisir, parce que je m’oppose à ce que les travailleurEuses considèrent, ne serait‑ce qu’un instant, un club huppé comme quelque chose de désirable. Je sais la difficulté qu’illes ont à regarder, du fait de leur pauvreté et de leur misère, en direction d’une vie de plaisir authentique et humain. Mais je leur demande de réfléchir à la bonne vie à venir, qui ressemblera aussi peu que possible à la vie actuelle des riches, car celle‑ci ne représentant que l’envers de leur condition sordide, étant ainsi la cause de leur misère, ne peut rien avoir d’enviable ni de souhaitable. Si nos adversaires vous demandent comment nous pourrons procurer une vie luxueuse à celleux qui vivront dans une société socialiste, répondez avec vigueur “ Il n’en est pas question, et nous nous en moquons éperdument ; nous n’en voulons pas et nous n’en aurons pas ! ” Je suis bien certain que lorsque l’humanité sera libre nous ne vivrons pas dans le luxe. Assurément, la vie comme les plaisirs d’individuEs libres doivent être simples. Si nous frémissons devant cette nécessité aujourd’hui, c’est que nous ne sommes pas libres et que nous avons engoncé nos vies dans un système de dépendance tel qu’il nous a renduEs fragiles et impuissantEs. Savez‑vous ce qu’est la simplicité ? Pensez‑vous par hasard que je fasse allusion à un alignement de maisons de briques jaunes, à couverture d’ardoises, ou à un phalanstère ressemblant à une pension, genre PeabodyS amélioré ? A la cloche du dîner qui vous convie devant la rangée de bols de bouillon en porcelaine blanche, à une jolie tranche de pain coupée au carré, à une tasse de thé réchauffé, accompagnée d’un mauvais gâteau de riz pour finir ? Non, tout cela, c’est l’idéal du philanthrope, pas le mien. Je le rapporte ici pour le dénoncer et dire qu’il s’agit, une fois de plus, d’un succédané de vie et que le plaisir en est absent. Je le rejette. Trouvez ce que vous aimez et pratiquez‑le, vous ne serez pas isoléEs et vous trouverez sans peine de l’aide pour réaliser vos désirs. En développant vos goûts personnels, vous développerez la vie sociale.
Ainsi, mon idéal se définit d’abord par une vie simple et naturelle, mais aussi sans contraintes. Il faut commencer par être libre pour pouvoir ensuite tirer plaisir de toutes les circonstances de la vie, puisque dans une société libre, chacunE devra abattre sa part de travail. Voilà qui est totalement opposé à la civilisation qui décrète : “Évitez les peines”, ce qui implique que les autres vivent à votre place. Je dis, et les socialistes ont le devoir de le dire : ‘Prenez la peine et transformez‑la en plaisir’. Telle est, je n’en démordrai pas, la clé du bonheur.
Tentons maintenant de nous servir de cette clé pour ouvrir quelques‑unes des portes de l’avenir. Rappelez-vous bien sûr, qu’en évoquant la société de l’avenir, je me permets de passer sur la période de transition ‑ quelle qu’en soit la nature ‑ qui séparera le monde actuel de l’idéal que nous devrons touTes, tant bien que mal, commencer à échafauder mentalement, une fois que notre conviction en la régénération du monde sera établie. Quelle sera d’abord formellement la position ‑ la position politique ‑ des membres de la nouvelle société ? La société politique telle que nous la connaissons n’aura plus cours : les rapports d’individuE à individuE ne seront plus subordonnés au prestige ou à la propriété. Ne seront pris en considération ni la position hiérarchique, ni la fonction de l’individuE, comme au Moyen Âge, ni l’étendue de ses biens, comme aujourd’hui, mais seulement sa personne. Les lois édictées par l’État sombreront dans le même oubli que la sacro‑sainte noblesse du sang. Ainsi serons‑nous d’un seul coup débarrasséEs de cette comédie qui exige que chacunE de nous sacrifie sa vie aux prétendues nécessités d’une institution chargée de régler des problèmes qui ne se poseront peut‑être jamais ; les conflits concernant les droits et les désirs de chacunE seront traités en tant que tels, c’est‑à‑dire réellement plutôt que légalement. Bien entendu, la propriété privée ne sera pas un droit : les articles de base seront si abondants qu’entre les individuEs les échanges élémentaires et directs ne seront plus impératifs. Personne cependant n’envisagera de s’approprier ce que chacunE aura développé de manière privée, autrement dit ce qui est devenu partie intégrante de ses habitudes.
Quant aux activités humaines, elles ne seront pas assujetties à la même division du travail qu’à présent ; les domestiques, les égoutièrEs, les tueurEuses des abattoirs, les préposéEs des postes, les cireurEuses, les coiffeurEuses, etc., disparaîtront. Nous ferons de ces activités des tâches plaisantes, accomplies par nous‑mêmes, ou bien par d’autres, sur le mode du volontariat ; sinon, il nous faudra y renoncer définitivement. De nombreux métiers éprouvants seront supprimés : nous n’apposerons pas de motif sur un tissu, ni ne modèlerons une anse de cruche pour les commercialiser mais afin de les enjoliver ou de nous divertir. Si nous fabriquons des objets de qualité grossière ou médiocre, ce sera pour remplir certaines fonctions concrètes et non pour les vendre car la disparition des esclaves entraînera celle des objets dont seuls les esclaves ont besoin. Les machines auront probablement atteint largement leur objectif en permettant aux travailleurEuses d’abolir les privilèges et, à mon avis, leur nombre diminuera beaucoup. Parmi les plus importantes, certaines machines seront considérablement perfectionnées tandis que la plupart deviendront inutiles. Et puisque presque tout le monde aura le choix, selon son désir, de s’en servir ou non, si par exemple nous décidons de voyager, nous ne serons pas contraintEs comme aujourd’hui d’emprunter les chemins de fer pour le seul bénéfice de leurs propriétaires mais nous pourrons satisfaire nos inclinations personnelles et cheminer dans un chariot bâché ou à dos d’âne.
D’autre part, les concentrations de population auront atteint leur but, qui était de permettre aux genTes de mieux communiquer entre elleux et aux travailleurEuses de tisser des liens de solidarité : elles cesseront d’exister à leur tour. Les immenses quartiers industriels seront démolis et la nature cicatrisera les plaies qu’ont créées l’avidité insouciante et la stupide terreur des individuEs. En effet, ce ne sera plus la terrible nécessité qui déterminera que le tissage du coton coûte un quart de penny de moins cette année que l’an passé. De notre propre gré, nous déciderons de travailler ou non une demi‑heure supplémentaire par jour afin de jouir de maisons avenantes et de verts paysages. La faim ou la misère de milliers de personNes ne seront plus liées aux caprices du marché, où s’échangent des marchandises qui ne valent même pas la peine d’être fabriquées. Bien sûr (j’aurais dû le mentionner auparavant), de nombreux travaux d’ornement seront exécutés en privé et sans inconvénient par chacun, pendant les heures de loisirs : en effet, la réalisation d’oeuvres d’art requiert moins d’ingéniosité que n’en nécessite la conception d’une machine fabriquant des ersatz. Il va enfin de soi que les centres de l’escroquerie et du larbinisme, comme le tas de fumier où se trouvent nos demeures (je veux parler de Londres), pourraient encore plus aisément disparaître ; quelques villages agréables le long de la Tamise remplaceraient ainsi avantageusement cette folie absurde autrefois appelée Londres.
Voyons maintenant ce que pourrait être dans l’avenir l’enseignement, aujourd’hui totalement soumis au commerce et à la politique. PersonNe n’est éduquéE pour devenir unE individuE, mais certainEs le sont pour détenir la propriété et d’autres pour la servir. Il faut là aussi un changement révolutionnaire, celui qu’impose une vie simple mais sans ascétisme. Nous devons également, dans ce domaine, nous débarrasser de la néfaste division du travail. ChacunE devrait savoir nager, monter à cheval, piloter un bateau sur une rivière ou sur les mers. Plutôt que des activités artistiques, ce sont de simples exercices corporels qui devraient entrer dans les moeurs de l’espèce humaine, ainsi qu’un ou deux arts élémentaires, comme la charpente ou la ferronnerie. La plupart des genTes devraient savoir ferrer un cheval, tondre un mouton, moissonner un champ, le labourer avec une charrue (car je crois que nous renoncerons assez vite aux machines agricoles lorsque nous serons libres). Je pense à d’autres activités encore comme cuisiner, boulanger, coudre, etc., que chaque individuE senséE peut apprendre en quelques heures et devrait parfaitement maîtriser. Tous ces arts élémentaires doivent entrer dans les moeurs, tout comme l’art d’écrire, de lire, ainsi que celui de réfléchir qui, à ma connaissance, n’est encore enseigné aujourd’hui ni à l’école ni à l’université.
ÉduquéE dans ces moeurs et familierE des arts, lAe citoyenNe pourra ainsi jouir de la vie qui s’ouvre à ellui. Car quelle que soit la manière dont ille développera l’usage de ses facultés, la communauté ellui fournira des conseils, des occasions ou des matériaux afin de l’aider. Mais je ne songe pas à ellui indiquer ce qu’ille devra faire, car je suis certain que ces mêmes moeurs qui ellui auront permis de développer ses capacités l’encourageront à les employer. Et l’accroissement de son plaisir dans la vie quotidienne se fera non pas aux dépens des autres citoyenNes mais à leur profit. Vous savez qu’aujourd’hui les récompenses offertes pour encourager l’effort de celleux qui ne sont pas stimuléEs par le fouet, ou la menace de mourir de faim, sont peu variées et se résument en général pour l’individuE de talent à l’espoir d’accéder à une position où ille n’aura pas à employer ses forces ; bref, dans notre civilisation, l’ennui que produit la satiété couronne la vaillance de l’effort. En revanche, dans d’autres conditions sociales, on pourrait certainement retirer de l’exercice de ses facultés des avantages substantiels et variés ; je ne crois pas du tout que le fait que les individuEs s’occupent de leurs propres affaires implique ou même fasse courir le risque de les voir limiter leurs efforts à leur intérêt personnel. Ayant enfin compris que leur vie serait ce qu’illes en feraient, illes en concluront immédiatement que la vie sans effort est morne. Je ne sais pas, évidemment, dans quelle direction doivent s’exercer ces efforts : je peux seulement affirmer que les individuEs seront libéréEs de la sordide obligation de travailler à ce qui leur déplaît, comme c’est le sort habituel des individuEs civiliséEs. J’ai néanmoins un espoir, tout à fait personnel, bien sûr : l’humanité va peut-être recouvrer la vue, qu’elle a aujourd’hui en grande partie perdue. Je ne fais pas ici allusion au fait que le nombre de personNes dont la vue est déficiente augmente mais à ceci, me semble‑t‑il, qui n’est pas sans rapport : à savoir que les genTes ont largement cessé d’utiliser leurs yeux pour recueillir des impressions sensibles, tandis qu’autrefois ceux‑ci étaient la principale source de la fantaisie et de l’imagination. Naturellement, les genTes se servent encore de leurs yeux pour ne pas tomber dans les escaliers ou pour éviter de se planter leur fourchette dans le nez au lieu de la porter à la bouche mais, en règle générale, l’usage qu’illes en font est à peu près insignifiant. J’ai souvent observé le comportement des genTes dans les expositions de peinture. Je me suis ainsi rendu compte que la plupart s’y ennuient beaucoup, et que leurs yeux errent, inexpressifs, à la surface des objets exposés ; curieusement, ce n’est jamais par le regard qu’une chose étrange ou inhabituelle les attire, car ce sont surtout leurs facultés mentales qui sont sollicitées par l’entremise des yeux : en revanche, s’illes tombent sur quelque chose dont l’étiquette indique qu’il s’agit là d’un objet bien connu, illes se montrent immédiatement intéresséEs et se poussent du coude l’un l’autre. Prenons un exemple : quand les profanEs visitent la National Gallery, illes veulent voir en priorité le Raphaël de Blenheim, qui est certes un tableau bien exécuté mais néanmoins fort ennuyeux pour quiconque n’est pas unE artiste. Illes réagissent de la sorte parce qu’on leur a dit que le ‑ hum, voyons... ‑ l’escroc qui le possédait avait réussi à le céder à la nation en extorquant en échange une somme d’argent exorbitante. Mais, lorsque Holbein leur présente une princesse danoise du XVIe siècle, toujours pleine de vie sur sa toile et dont les yeux reflètent encore un demi‑sourire de modestie, lorsque Van Eyck leur ouvre une fenêtre sur le Bruges du XIVe siècle, lorsque Botticelli leur représente les cieux tels qu’ils furent, vivants, au coeur des hommes, avant la mort de la théologie, illes n’en retirent aucune impression, pas même de quoi stimuler leur curiosité et les amener à se demander de quoi il s’agit. Car toutes ces oeuvres ont été conçues pour être regardées, afin que les yeux fassent goûter à l’esprit la poésie du passé, du présent et de l’avenir.
Un autre exemple : un jour, au musée de South Kensington [1], lorsque ce qui s’appelait le département de l’Éducation (par dérision sans doute) était plus ou moins regroupé avec le département des Beaux‑Arts, j’ai suivi un groupe de personNes à travers les merveilles produites par les mouvements artistiques du passé et je me suis aperçu que leurs yeux ne fixaient jamais aucun objet mais s’illuminaient immédiatement à la vue d’une vitrine présentant les constituants d’un bifteck analysé, soigneusement mis en valeur et explicités, étiquettes à l’appui. Leurs yeux emmagasinaient alors des bribes de tout et de n’importe quoi, avec une confiance aveugle dans l’analyste en question ; je ne pouvais partager leur confiance en cet individuE car ille lui aurait fallu, me semblait‑il, une honnêteté surhumaine pour ne pas faire passer n’importe quelles parcelles de poussière ou de cendre pour de mystérieuses substances que ses recherches avaient permis de découvrir dans ce banal morceau de viande. On trouve le même phénomène en littérature : les auteurEuses qui font appel à nos yeux pour transmettre des impressions sensibles sont reléguéEs au second plan, au moins, par nos critiques littéraires les plus “intellectuelLes”, qui ainsi négligent Homère, Beowulf et Chaucer. LAe “véritable intellectuelLe” place de simples rhéteurEuses, écorcheurEuses de mots et autres chasseurEuses d’introspection bien au‑dessus de maîtresSes de la vie comme Scott et Dickens, dont les récits éveillent nos sens en leur laissant le soin de tirer eux‑mêmes la morale de l’histoire.
Je me suis quelque peu attardé sur le thème de l’acuité visuelle car elle est pour moi un signe manifeste de l’évolution de la civilisation vers des conditions nous réduisant à cet état de panse intellectuelle que j’ai déjà dénoncé, et aussi parce que je suis convaincu que l’art et la littérature de l’avenir n’ont besoin d’aucun programme particulier : de saines conditions physiques, un solide et complet développement des sens, combinés à l’éthique sociale que la suppression de l’esclavage nous apportera, favoriseront l’éclosion naturelle d’un art et d’une littérature à notre mesure, quelle qu’elle soit. Mais si je me permettais à nouveau de prophétiser, je devrais ajouter que l’art comme la littérature, mais l’art tout particulièrement, s’adresseront directement aux sens, exactement comme autrefois. On ne pourra plus, voyez‑vous, se procurer de romans décrivant les affres d’un couple bourgeois en butte à son inutilité sociale, car les matériaux entrant dans la composition de tels chefs‑d’oeuvre n’existeront plus. Les vrais récits historiques en revanche subsisteront et on les contera, j’espère, avec un entrain aujourd’hui inconnu. Je ne doute pas personnellement que les arts raviveront les sens d’individuEs désormais en bonne santé physique. Ainsi l’architecture et les arts apparentés refleuriront parmi nous, comme à l’époque qui a précédé la civilisation. Car celle‑ci, par choix éthique et politique, empêche leur développement en nous contraignant à vivre dans un monde crasseux, désordonné et inconfortable, qui heurte en permanence nos sens et nous force à émousser inconsciemment leur acuité. Aujourd’hui, unE individuE sensible à l’aspect extérieur des choses ne peut que souffrir dans le Sud‑Lancashire ou à Londres ; ille est perpétuellement en proie à la violence et à la colère, et ille doit, pour ne pas devenir folLe ou encore assassiner unE être nuisible et être penduE pour ce crime, tenter d’émousser sa sensibilité. Cela implique bien entendu que de plus en plus de genTes naîtront privéEs de cette sensibilité gênante. Débarrassons‑nous donc de cette coercition irrationnelle, et nos sens connaîtront le développement qui leur est normalement dû, avec le plaisir que leur exercice procure ; ce qui, en résumé, signifie que l’art et la littérature retrouveront ainsi leur humanité et leur sensualité.
Je vais maintenant essayer de tirer une conclusion de ces remarques décousues et vous exposer de manière plus concise et plus aboutie mes idées sur la société dans laquelle j’aimerais renaître un jour.
Cette société ignore la signification des mots riche et pauvre, le droit de propriété, les notions de loi, de légalité ou de nationalité : c’est une société libérée du poids d’un gouvernement. L’égalité sociale y va de soi ; personne n’y est récompenséE d’avoir rendu service à la communauté en acquérant le pouvoir de nuire à autrui.
Dans cette société, la vie sera simple, plus humaine et moins mécanique, car nous aurons renoncé en partie à la maîtrise de la nature, quitte pour cela à accepter quelques sacrifices. Cette société sera divisée en petites communautés, dont les dimensions varieront selon l’éthique sociale de chacune, mais qui ne lutteront pas pour la suprématie et écarteront avec dégoût l’idée d’une race élue.
Fermement déterminéEs à être libres et donc à se contenter d’une vie plus simple mais aussi plus rude que celle des esclavagistes, les hommes (et les femmes, bien sûr) ne seront en général que peu assujettiEs à la division du travail : illes travailleront et prendront du plaisir par elleux-mêmes et non plus par procuration. Les liens sociaux seront ressentis d’instinct et par la force de l’habitude, et leur formalisation ne sera pas forcément nécessaire. La famille (au sens strict de la parenté de sang) se fondra dans les relations communautaires et humaines. Les plaisirs, dans une telle société, seront fondés sur le libre exercice des sens et des passions au bénéfice d’animaLaux humainEs en pleine santé, pour autant qu’illes ne nuisent pas aux autres individuEs de la communauté et qu’illes ne brisent pas l’unité sociale. Personne n’aura plus honte de ses sentiments humains, ni ne demandera plus que son dû.
Mais de cette saine liberté naîtront les plaisirs du développement intellectuel que les individuEs civiliséEs ont si stupidement tenté de séparer de la sensualité de la vie, et de glorifier à ses dépens. Les individuEs suivront l’enseignement de la beauté et en inventeront les formes, par égard pour elleux-mêmes et non pour assujettir leurs semblables ; illes en seront récompenséEs en trouvant beau et intéressant le travail le plus trivial, que leurs mains accompliront sans même s’en rendre compte. L’individuE qui prenait un plaisir intense à s’allonger, par une nuit d’été au milieu des moutons, dans une cabane de joncs construite à flanc de colline, n’appréciera pas moins les splendeurs d’une grande salle communale, de ses colonnes surmontées d’arcs et de ses voûtes nervurées. De même qu’ille prenait du plaisir à écouter le souffle du vent et le clapotis des vagues, assis à la barre de son bateau, ille sera bercéE par la beauté de l’art lyrique. Car seuls les travailleurEuses, et non les pédantEs, peuvent produire un art vrai et vigoureux.
Le travail comme le repos seront goûtés avec plaisir tandis que disparaîtra de la surface de la Terre la moindre trace de l’ancien esclavage. N’étant plus rongéEs par la peur et l’anxiété, nous aurons le temps d’éviter de défigurer la planète par la misère noire ou la crasse, et la laideur fortuite disparaîtra de même que celle que produisait la pure méchanceté. Le constat de Carlyle, énonçant que le monde est un cauchemar cockney, sera enfin périmé.
Mais peut‑être pensez‑vous que le succès même de cette société, si heureuse et paisible, l’entraînera à nouveau vers la corruption ? Ce serait plausible si les individuEs n’étaient pas vigilantEs et valeureuXes. Mais nous avons pris comme hypothèse qu’illes seront libres et des individuEs libres doivent être responsables, ce qui signifie qu’illes seront vigilantEs et valeureuXes. Le monde sera certes toujours le monde, je ne le conteste point ; mais, tels que je les ai décritEs, les individuEs seront certainement plus capables de remédier à leurs problèmes que celleux d’aujourd’hui, enliséEs dans un mélange confus d’autoritarisme et de révolte inconsciente.
D’autres pourront bien sûr arguer qu’un tel état de choses risque de conduire au bonheur, mais aussi à la stagnation. Je vois une contradiction entre les deux termes, si nous sommes d’accord évidemment pour penser que le bonheur consiste en l’exercice plaisant de nos facultés. Mais imaginons le pire : que le monde se repose effectivement après tant de tourments. Où serait le mal ? (Je me souviens d’une fois, après avoir été malade, où il avait été si agréable de rester au lit, sans fièvre ni douleur, à ne rien faire d’autre qu’observer les rayons du soleil et écouter les bruits de la vie au‑dehors.) Et le vaste monde des individuEs, une fois délivré de la lutte frénétique pour la survie dans ce contexte de malhonnêteté générale, ne pourrait‑il aspirer à un peu de repos, comme après une longue fièvre ? S’en trouverait‑il plus mal pour autant ?
De toute façon, je suis convaincu que ce serait la meilleure solution pour se débarrasser de la fièvre, quoi qu’il advienne par la suite. De même, la vie simple que j’ai évoquée, et que certains nomment stagnation, procurerait une existence digne de ce nom à la grande majorité des humainEs et serait pour elleux du moins une source de bonheur. Illes atteindraient ainsi un niveau de vie plus élevé, jusqu’à ce que le monde commence à se peupler, non pas de genTes communs, mais d’êtres honnêtes, non pas d’individuEs superbement conscientEs de leur supériorité ‘intellectuelle’ comme aujourd’hui, mais de personNes dignes et respectueuXes de la personnalité des autres, car illes se sentiraient heureuXes et utiles, c’est‑à‑dire vivantEs.
Quant aux êtres supérieurEs, si un tel monde n’était pas assez bon pour elleux, je suis désolé, mais je leur demanderais comment illes s’accommodent du nôtre, qui est pire. Je crains qu’illes ne doivent répondre : ‘Nous le préférons car il est pire et que nous, en conséquence, nous y vivons relativement mieux.’
Hélas, mes amiEs, voilà les propos des folLes qui sont actuellement nos maîtresSes. Les maîtresSes de folLes alors, dites‑vous ? Oui, exactement. Cessons donc d’être folLess, et ilLes cesseront d’être nos maîtresSes. La tentative en vaut la peine, croyez‑moi, quoi qu’il advienne ensuite.
Je conclurai ainsi mon rêve d’avenir : la preuve que nous ne serons plus folLess sera que nous n’aurons plus de maîtresSes.
L’âge de l’ersatz
De même que l’on nomme certaines périodes de l’histoire l’âge de la connaissance, l’âge de la chevalerie, l’âge de la foi, etc., ainsi pourrais‑je baptiser notre époque “ l’âge de l’ersatz ”. En d’autres temps, lorsque quelque chose leur était inaccessible, les genTes s’en passaient et ne souffraient pas d’une frustration, ni même n’étaient conscientEs d’un manque quelconque. Aujourd’hui en revanche, l’abondance d’informations est telle que nous connaissons l’existence de toutes sortes d’objets qu’il nous faudrait mais que nous ne pouvons posséder et donc, peu disposéEs à en être purement et simplement privéEs, nous en acquérons l’ersatz. L’omniprésence des ersatz et, je le crains, le fait de s’en accommoder forment l’essence de ce que nous appelons civilisation.
Je vais maintenant passer en revue un certain nombre d’ersatz, afin d’examiner ce qu’ils contiennent de funeste ou de bon, et quel genre d’espoir ils autorisent. Je suis venu aujourd’hui, je ne vous le cache pas, pour critiquer un état de fait ; mais le dénoncer sans chercher à le redresser serait, à mon sens, une vaine entreprise.
Vous allez sans doute penser que la plupart des exemples que j’ai choisis ne sont que des bagatelles mais l’ersatz est si omniprésent, si intimement mêlé à toute la trame de la société actuelle, que je préfère me pencher sur les quelques cas que je connais bien. Je pense pouvoir conclure cet exposé par la description de l’inquiétant tableau que compose l’addition de tous ces ersatz, la vie civilisée n’étant plus qu’un ersatz en comparaison de ce que devrait être la vie sur Terre.
Je commencerai par des exemples très terre à terre, par le sujet trivial, prosaïque, du boire et du manger. On y trouve donc des ersatz ? Que trop hélas ! Vous avez tous entendu parler de ce que l’on nomme le pain ; je soupçonne cependant que vous êtes fort peu nombreuXes à avoir jamais goûté la denrée véritable, quoique l’ersatz qui l’a supplantée depuis longtemps vous soit familier. Dans ma jeunesse, c’est surtout à la campagne qu’on mangeait du pain digne de ce nom et il était rare d’en trouver en ville. Aujourd’hui, le pain préparé par les boulangerEs des villages est plus mauvais encore que celui des villes. Les genTes des campagnes, du moins de celles que je connais, ont cessé de fabriquer leur propre pain. Illes l’achètent à la boulangerie locale, tandis qu’il y a encore trente ans, illes le cuisaient chez eux. Dans presque tous les vieux cottages du voisinage (dans les comtés d’Oxford, de Gloucester, etc.), on peut encore apercevoir au fond de la cheminée le petit four rond, désormais sans emploi. Vous vous dites peut‑être que les genTes peuvent toujours faire leur pain s’illes le désirent. Eh bien, non. Car une bonne miche de pain nécessite une bonne farine, et l’on n’en trouve plus. L’idéal dula meunierE moderne (importé, j’imagine, d’Amérique, patrie de l’ersatz) semble être de réduire les riches grains de blé en une poudre blanche dont la particularité est de ressembler à de la craie, car il recherche avant tout la finesse et la blancheur, au détriment des qualités gustatives.
Vous voyez donc qu’il est désormais pratiquement impossible de trouver du pain. Et cela, vous devez le comprendre, est un trait essentiel du processus d’édification de la société de l’ersatz : on impose à toute une population un ersatz quelconque, et en un laps de temps très court l’authentique, le produit d’origine, disparaît totalement.
Pour prendre un autre exemple d’ersatz, je suppose que le beurre va bientôt disparaître et être remplacé par la margarine. Il est déjà très difficile de se procurer du beurre frais acceptable, aussi bien en ville qu’à la campagne. Sa fabrication délicate est incompatible avec la production que régit le nouveau mot d’ordre ‘Pas de complications, le profit d’abord, et peu importe le reste !’ Je viens d’évoquer deux denrées de base de notre alimentation et je ne m’étendrai pas plus longtemps sur ce sujet ; cependant, avant de poursuivre, je vous recommande la lecture de Cottage Economy, de William Cobbett, à la fois parce que ce petit livre est charmant et amusant, et parce qu’il nous montre bien, par le contraste qu’il offre avec notre époque, la rapide progression de l’ersatz dans notre alimentation.
Il suffit de regarder autour de soi pour constater à quel point nous sommes comblés d’ersatz dans le domaine de l’habillement. Observez n’importe quelle foule moderne : qu’il s’agisse du va‑et‑vient habituel de la rue, des genTes allant travailler ou se promenant, ou d’un rassemblement lié à la politique ou aux loisirs, la couleur ordinaire des vêtements est un brun charbonneux d’où surgissent quelques nuances criardes provenant toujours des accoutrements féminins. Allez savoir ce qui nous retient de porter de belles couleurs harmonieuses, si ce n’est la tyrannie de l’ersatz quotidien ! Quant à la forme de nos habits, elle est généralement si hideuse qu’unE être arrivant d’une autre planète y verrait à coup sûr un signe de décadence. Même les femmes, qui jouissent d’un peu plus de latitude à ce sujet en raison de leur rôle ornemental, ne nous aident guère. Si jamais elles trouvent une robe bien coupée, celle‑ci est rapidement retirée des rayons alors qu’un détail grossier et mal seyant (comme, par exemple, les horribles “ manches gigot ” toujours à la mode) est assuré du succès. Ici à nouveau, en matière de vêtement, l’ersatz nous est imposé avec une tyrannie sans réplique. Non seulement il est impossible de se vêtir correctement mais même critiquer cet état de fait, quoique ce soit futile, est une entreprise épineuse. J’ai le sentiment que vous m’en voulez de m’attarder sur ce sujet. Je décocherai tout de même un dernier trait en vous demandant ce que vous pensez des ersatz de chaussures produits aujourd’hui et des déformations des pieds et des jambes qu’ils entraînent ?
Quoiqu’il s’agisse d’un autre point de détail, j’aimerais pouvoir acheter de la bonne coutellerie, quitte à la payer au prix fort. C’était possible il y a trente ans, plus maintenant. On ne peut nulle part acheter un couteau dont la lame reste tranchante. J’ai perdu l’autre jour une paire de ciseaux à ongles que j’appréciais depuis longtemps ; je m’apprêtais à en acquérir une nouvelle mais j’ai dû en acheter trois paires avant d’en trouver une quatrième qui ne coupe que médiocrement !
Je ne considère pas les distractions publiques comme un sujet frivole. Au contraire, je constate douloureusement que la qualité des pièces de théâtre est tombée bien bas et que nous sont imposés de déplorables ersatz qui requièrent le travail de genTes honnêtes et souvent non dénuéEs d’intelligence. Ce phénomène mérite de retenir notre attention car la majorité des citadinEs mène une vie si triste, leur travail est si mécanique et monotone, leurs moments de détente si vides de sens et si souvent écourtés par les heures supplémentaires qu’illes se satisfont de n’importe quel divertissement. Je peux d’autant mieux saisir ce que ces ersatz ont de lugubre que je suis un des rares chanceuXes dont le travail est un plaisir constant ; ainsi ne goûté‑je guère ces prétendues distractions, tout en appréciant les bienfaits d’un profond repos. En toute sincérité, ce qui m’agrée le plus est un moment de calme, sans préoccupation immédiate, après lequel je me remets au travail l’esprit libre. Et je crois que ce délassement, à l’inverse du pitoyable ersatz, satisferait la plupart des genTes. II existe cependant un autre ersatz de divertissement consistant à prendre le train pour une destination quelconque et en revenir. Deux raisons poussent les genTes à agir de la sorte, selon qu’illes sont riches ou pauvres. Un désir trouble d’être ailleurs entraîne les riches en Suisse, sur les bords du Rhin, en Italie, à Jérusalem, au pôle Nord, que sais‑je encore ? Et comme la plupart de ces voyageurEuses gardent les yeux dans leur poche, même s’illes satisfont leur besoin maladif de bougeotte perpétuelle, illes n’ont rien vu de plus que s’illes étaient restéEs chez eux. Pour les habitantEs pauvres des grandes villes et des régions industrielles, je reconnais que c’est différent : leurs maisons sont si dépourvues d’attrait qu’ils aspirent à retrouver, ne serait‑ce que pour quelques heures, ici ou là, les vertes prairies, le soleil éclatant, et même la pluie ou le vent.
Cependant, se déplacer d’un lieu laid et ennuyeux vers un bel endroit, l’entrevoir et s’en retourner à la laideur et à l’ennui n’est qu’un pauvre ersatz, en définitive. Je ne veux pas admirer les splendeurs terrestres une fois par mois seulement, ni une fois par semaine, mais tous les jours, tout le temps, de même que je n’accepte pas de ne dîner qu’une fois par mois. Cet ersatz de voyage se substitue au plaisir réel que vous éprouveriez à vivre et à travailler dans des endroits beaux et agréables. Alors vous auriez la joie de rester chez vous, d’apprendre à connaître librement la forme et le port de chaque arbre, voire de chaque rameau, la courbure de chaque colline ou de chaque vallon, jusqu’à ce qu’ils soient pour vous des amiEs, des amiEs très cherEs. Ainsi pourrez‑vous quitter l’aimable foyer pour découvrir de nouvelles merveilles, d’autres beautés, et imprégner votre esprit de leur souvenir pour les futurs jours de repos. Lorsque vous souhaiterez rentrer, vous saurez que vous attend l’inépuisable et familière beauté de vos maisons, bouclant ainsi le cycle du plaisir ininterrompu. Je vous ai décrit ce qui devrait être mais quand vous aurez compris pourquoi cela ne peut exister aujourd’hui, je pense et j’espère que vous ferez en sorte que cette fiction devienne réalité.
Considérons maintenant nos maisons et voyons de quels ersatz il s’agit lorsque leur construction remonte à moins d’un siècle. Il apparaît clairement, même à celleux qui ne font guère usage de leurs yeux, que presque toutes les maisons modernes sont de conception aberrante, d’aspect hideux et sont indignes d’être habitées ; en outre, leur concentration dans les grandes villes transforme à tel point les rues qu’elles en deviennent repoussantes. A la campagne, quand nous les rencontrons sur notre passage, elles font tellement tache que nous cherchons coûte que coûte à les éviter. A en juger par leur prix de revient et par les difficultés de leur mise en oeuvre, elles devraient au moins être utilisables : il n’en est rien, au contraire ! De tous les abris que les individuEs ont construits pour se protéger des intempéries, ce sont les plus inconfortables, les plus saugrenus : ces constructions sont, en un mot, ineptes ! La majorité d’entre vous ignore sans doute quels absurdes ersatz ont remplacé les vraies maisons bâties à la mesure d’individuE droitEs et senséEs ; par la force de l’habitude et parce que vous n’avez jamais connu mieux, vous pensez que ces habitations sont ce qu’elles doivent être et que leur taille est proportionnée aux moyens de leurs occupantEs, qu’elles aient six petites pièces ou soixante grandes, et que leurs occupantEs gagnent soixante livres par an ou en volent soixante mille. Mais je vous donne ma parole que les rues où étaient érigées de vraies maisons charmaient le regard et élevaient l’esprit. L’agencement pratique et astucieux de ces demeures était conforme aux exigences humaines ; loin de souiller le paysage de leur laideur, elles en étaient le principal ornement ‑ cela n’est devenu que trop rare. De fait, elles étaient utiles et non utilitaires. A mon sens, ce dernier mot exprime une qualité qui est pratiquement opposée à l’utile : cela désigne une chose qui ne sert qu’à tirer profit des besoins élémentaires des gens.
Quant aux villes et aux cités constituées de ces pseudo-maisons, que pourraient‑elles être dans ces conditions, sinon des ersatz ? Prenons les centres industriels typiques de la civilisation moderne ou bien les villes qui ont connu un fort développement du fait qu’y siège le pouvoir local ; leur seule taille les rend déjà impossibles à gérer. Quel contraste entre de telles monstruosités qui prolifèrent anarchiquement, comme votre Manchester‑Salford‑Oldham ou encore la métropole tentaculaire faite de brique et de gâchis qu’est devenue Londres, et mon idéal de ville : au centre, les édifices publics, les théâtres, les places et les jardins ; autour, une zone comprenant les grandes salles des guildes et les maisons d’habitation, avec ses propres parcs et jardins ; puis à la périphérie, de nouveau un quartier de bâtiments publics et de maisons, sans jardins propres, au milieu d’un parc. Enfin viendraient les faubourgs, où poindraient de rares maisonnettes, au milieu de champs et de vergers, jusqu’à ce que vous arriviez à la pleine campagne, avec de‑ci de‑là une ferme. Voilà à quoi ressemblerait une ville digne de ce nom. Je ne prétends pas qu’elle ait déjà existé car dans l’Antiquité ou à l’époque médiévale les villes étaient des forteresses ceintes d’épaisses murailles. Mais qu’est‑ce qui empêche ce type de ville d’être le modèle des futures communautés humaines ? Rien, ce me semble, dès l’instant que les individuEs seront libres de l’édifier. Ce qui les en empêche, c’est ce à quoi je vais en venir maintenant.
Parallèlement à la production de tous ces ersatz, je dois admettre qu’il existe un type de marchandises qui ne sont pas falsifiées à la façon des ersatz ‑ du moins si l’on s’en tient à leur fabrication, sans considérer leur destination. Je dis un, mais il s’agit plutôt de deux types : d’une part, les engins qui détruisent les biens et massacrent les individuEs, pour lesquels on déploie une ingéniosité fantastique confinant au génie (ce qui, soit dit en passant, n’est peut‑être pas mauvais car la guerre, en devenant de plus en plus onéreuse, pourrait ainsi disparaître). Voilà un genre de produits élaborés avec soin, prévoyance et succès ; d’autre part, l’ensemble des machines-outils nécessitées par la production marchande, gloire de notre siècle, et qui semblent aujourd’hui approcher graduellement de la perfection. Cependant, aussi merveilleux soient le talent et l’habileté prodigués pour leur fabrication et leur usage, leur finalité même n’est qu’un ersatz. A quoi ces ingénieuses machines si proches de la perfection sont‑elles ingénieusement destinées ? A la production d’ersatz, purement et simplement, à la production d’objets que personne n’aurait l’idée d’utiliser s’il n’y était contraint, et qui supplantent les biens authentiques dont nous userions si nous le pouvions.
Abordons un autre exemple d’ersatz qui ne peut, en vérité, être dissocié de la falsification dans le domaine de la construction dont je viens de parler, et qui n’est pas moins affligeant. Il faudrait donc que la douce terre de nos aïeux soit, jusque dans les campagnes les plus reculées, métamorphosée en un ersatz ! Comprenez-moi bien : je ne pense pas seulement aux horreurs indescriptibles des régions industrielles qui ont défiguré notre pays mais aussi à la banalisation du paysage rural. Les causes en sont multiples : la culture intensive, le déboisement massif, la suppression des haies, la misère sordide aux alentours des fermes ; mais aussi le plaisir que semblent éprouver les autorités, en particulier celles qui sont responsables de la construction des écoles, à substituer la laideur à la beauté : les grilles métalliques et les fils de fer barbelés au lieu de murets ou de haies, les ardoises à la place des tuiles ou des lauzes, les plantations de mélèzes et d’épicéas là où devraient croître des chênes et autres arbres dignes de ce nom, et ainsi de suite : autant de manières de démentir notre sotte vantardise quant à notre prospérité et notre bon sens. Voilà donc l’une des faces de cet ersatz. L’autre est si curieuse qu’elle pourrait presque déclencher l’hilarité, plutôt que la colère, car elle est due à des individuEs si peu conscientEs de leur vulgarité qu’illes se croient sublimes quand illes sont simplement ridicules. Je pense aux funestes conséquences du goût des genTes riches pour la villégiature. Les conditions de vie misérables des paysanEs sont sans doute le résultat, en grande partie, de leur stupidité mais, dans leur cas, la pauvreté peut être invoquée comme circonstance atténuante. En revanche, les nobles et les grosSes propriétaires terrienNess n’ont pas pour avilir la campagne l’excuse d’être sans le sou. Néanmoins, dès que vous pénétrez dans un village pittoresque, certes, mais gâté par les aménagements ineptes et les excroissances architect‑tûral‑lûralesÀ, s’offrent à vos yeux l’école prétentieuse, l’église restaurée, le cottage de Lady Bountifuls, les pavillons dans le style de Bayswater ou les parterres proprets du jardin de MadaMonsieur lAe vicaire. Cherchez ensuite la bâtisse appartenant à mAonseigneurEuse, à sirE RobertE, ou aLau capitaine Matamore, et vous êtes certain de la trouver au plus vite (à moins qu’il ne s’agisse d’une demeure ancienne, ou que vous ayez perdu l’usage réel de vos yeux). Vous regretterez alors sincèrement de ne pas l’avoir ratée tant sont réunies en elle laideur et vulgarité.
Je ne ferai que mentionner les beaux‑arts et la littérature car, pour dire l’affreuse vérité, les ersatz y sont monnaie courante et cela excéderait le temps dont je dispose de seulement les citer. Juste un mot pourtant à propos des beaux‑arts par lesquels j’entends la peinture, la sculpture et les disciplines assimilées. J’aimerais vous amener à partager mon point de vue sur une question précise : le fonds même des beaux‑arts est la physionomie de la nature et celle des demeures ordinaires des individuEs, dont je viens de déplorer l’état. De fait, elles sont à la fois des oeuvres d’art en tant que telles et la matière que l’art élabore ; si elles sont dégradées, il est impossible que l’oeuvre de l’artiste soit autre chose qu’un ersatz. Et je ne puis imaginer qu’il en soit autrement si son substrat même est corrompu. Aussi bien, la musique ne peut exister sans la rumeur de la nature, le chant des oiseLlaux, le mugissement des troupeaux, le murmure des rivières et le remous des océans, le bruit du vent, de la pluie et du tonnerre. Réfléchissez bien à tout cela : tant que la maison d’unE ouvrièrE sera laide, il sera vain de vouloir de beaux tableaux.
J’aimerais vous exprimer le fond de ma pensée à propos de l’ersatz en matière d’instruction : quelle différence entre ce qui se fait de mieux aujourd’hui et une bonne instruction ! Cependant si nous négligeons à présent, pour des raisons d’économie, d’élever autant que faire se peut le niveau de notre éducation nationale, autant abandonner toute prétention à être un peuple pratique et sensé. On pourrait résumer la chose ainsi : vous comptiez dépenser, disons, 50 000 livres, lorsque vous vous rendez compte qu’il faudrait en ajouter 10 000 pour obtenir un résultat satisfaisant et qu’en fait tous vos efforts seraient annihilés si vous n’ajoutiez pas cette somme ; ne serait‑il pas ainsi beaucoup plus économique de dépenser 60 000 livres à bon escient plutôt que 50 000 pour rien ? Voilà à mon avis le mode sur lequel nous devons envisager l’éducation : qu’elle soit la meilleure possible, quel qu’en soit le prix. Elle ne sera peut‑être pas excellente mais au moins elle nous débarrasseradecetteidéeineptequela finalité de l’enseignement est de modeler les hommes et les femmes pour en faire des travailleurEuses aptes à servir les besoins capitalistes. Rendre la vie plus agréable doit devenir le seul but de l’instruction : toute autre ambition se réduira à un lamentable ersatz.
Je viens donc de passer en revue un certain nombre de thèmes qui ne sont que des spécimens du grand ersatz général que l’on nomme civilisation. Et si mes vues sont justes quant à l’universalité actuelle de ce phénomène, l’époque moderne est à coup sûr atteinte d’une cruelle maladie dont ces maux et désagréments sont les symptômes. Je vais alors nommer cette maladie, puis en quelques mots j’en évoquerai le remède, pour autant que vous m’écoutiez jusque‑là. Le nom du mal qui empoisonne le monde civilisé, c’est la pauvreté. La raison pour laquelle nous créons tous ces ersatz est que nous sommes trop pauvres pour vivre autrement. Nous sommes trop pauvres pour pouvoir jouir des prairies enchanteresses, des landes battues par les vents, au lieu de quoi nous subissons les déserts effroyables qui nous entourent ; trop pauvres pour habiter des villes rationnelles judicieusement organisées et de belles maisons conçues pour abriter les honnêtes genTes ; trop pauvres pour empêcher que nos enfants grandissent dans l’ignorance ; trop pauvres pour démolir les prisons et les hospices et rebâtir à leur place des halles et des édifices publics pour l’agrément des citoyenNes ; trop pauvres surtout pour donner à chacunE la chance d’exercer l’activité pour laquelle ille a le plus de capacités et donc à laquelle ille prendra le plus de plaisir. Que dis‑je ! Trop pauvres pour que règne la paix entre nous, pour en finir avec la guerre entre riches et pauvres, entre celleux qui possèdent tout et celleux à qui tout manque.
J’ai nommé la maladie mais comment la guérir ? A présent, vous êtes nombreuXes dans cette assemblée à connaître au moins le genre de traitement nécessaire au malade. Mais permettez‑moi de répéter une fois de plus ce que j’ai si souvent dit, ici, à Manchester : la cause de cette pauvreté, dont souffrent toutes les nations mais aussi l’ensemble de la population de chaque nation, est précisément cette guerre entre celleux qui possèdent tout et celleux à qui tout manque, dont je parlais à l’instant. Celleux‑là renforcent perpétuellement leurs positions, n’imaginant pas que l’on puisse vivre dans un monde différent. Celleux‑ci luttent perpétuellement pour gagner un tout petit peu plus, dans la mesure où illes en ont la force. Vous remarquerez aussi que cette guerre produit fatalement le gaspillage. J’ai entendu monsieur Balfourà dire l’autre jour que le socialisme était irréalisable parce qu’il entraînerait une énorme baisse de la production. A cela je répondrai que nous produirons la moitié ou même le quart des quantités actuelles et que nous serons cependant plus prospères, donc plus heureuXes que maintenant, en mobilisant toute notre énergie à produire les objets utiles que nous désirons touTes, au lieu d’épuiser nos forces à fabriquer les choses inutiles dont personne d’entre nous ne veut, pas même les imbéciles. Quelle étrange aspect aurait un grand musée réunissant des échantillons de toutes les marchandises produites en ce pays. N’importe quelLe individuE senséE les taxerait, pour la plupart, d’aberrations !
Mes amiEs, un très grand nombre de genTes sont employés à produire de pures et simples nuisances, comme le fil de fer barbelé, l’artillerie lourde, les enseignes et les panneaux publicitaires disposés le long des voies ferrées, qui défigurent les champs et les prés, etc. Hormis ce genre de nuisances, combien de travailleurEuses fabriquent des marchandises dont la seule utilité est de permettre aux genTes riches de ‘dépenser leur argent’, comme on dit. Combien d’autres encore produisent les ersatz destinés à la classe ouvrière, si pauvre qu’elle ne peut s’offrir mieux ? Travail d’esclaves pour les esclaves du travail, comme je les ai souvent appeléEs. En résumé, de quelque manière qu’on la considère, notre industrie n’est que gaspillage car le système qui la gouverne permet tout juste à chacunE de subsister, certainEs honnêtement mais misérablement, d’autres malhonnêtement et médiocrement, un point c’est tout.
En fin de compte, la raison d’être de l’industrie n’est pas de créer des biens mais des profits réservés aux privilégiéEs qui vivent du travail des autres ‑ quoi qu’il lui arrive incidemment de produire des choses utiles sans lesquelles tout s’arrêterait. Telle est la finalité de notre système commercial et gouvernemental et de sa splendide organisation du travail, si magnifique et si infaillible. Tentez de lui faire mettre sur pied quoi que ce soit d’autre, il s’écroulera immédiatement car il est fait pour cela, exclusivement.
J’affirme que le peuple tout entier ne sera jamais heureux sous un tel régime, qui fait de la vie un lamentable ersatz. Le peuple tout entier ne sera heureux que lorsqu’il oeuvrera pour lui‑même et reconstruira la société dans ce but. Ce sera alors la fin de l’âge de l’ersatz ; car, pourquoi travailler en dépit du bon sens lorsqu’il s’agira de satisfaire nos propres désirs ? ChacunE sera alors solidaire de saon voisinE, tout en ellui témoignant sa confiance. L’artisanE seulE connaît la complexité de sa tâche et peut juger de sa perfection. Il n’y a que lorsque lae charpentièrE travaille pour lae forgeronNe, lae forgeronNe pour lae laboureurEuse, et ainsi de suite, que toute activité humaine alors empreinte d’amitié devient passionnante. Ainsi nous ne vivrons plus dans des camps séparés, armés les unEs contre les autres, mais dans différents ateliers dont touTes partageront les secrets.
Survient donc la vieille question : ‘Comment s’y prendre ?’ CherEs amis, vous en savez long désormais sur le sujet, aussi je ne m’y attarderai pas, sans pour autant éluder le problème. La société de l’ersatz continuera à vous utiliser comme des machines, à vous alimenter comme des machines, à vous surveiller comme des machines, à vous faire trimer comme des machines ‑ et vous jettera au rebut, comme des machines, lorsque vous ne pourrez plus vous maintenir en état de marche. Vous devez donc riposter en exigeant d’être considéréEs comme des citoyenNes. Vous avez commencé à le faire. J’estime que l’exigence d’un salaire décent, du règlement des problèmes de chômage, de la diminution légale du temps de travail et autres revendications du même ordre ne sont pas, prises séparément, la panacée qui provoquera un changement immédiat de société. En revanche, l’ensemble de ces exigences, dès aujourd’hui (et leur nombre s’accroîtra sans doute au fil du temps), signifie pour moi le réveil de cette revendication, à savoir le droit pour les travailleurEuses de régler leurs affaires elleux‑mêmes. Continuons à élargir la brèche dans le système de propriété actuel, qu’il nous faut détruire, avant de pouvoir produire rationnellement, avec plaisir, et d’en finir avec l’âge de l’ersatz.
Toutefois, pour en arriver là, je crains que nous ne devions avoir recours à un ersatz ‑ la politique, pour la nommer ‑, cet odieux ersatz qui nous est imposé en substitut de la discussion sérieuse et avisée de nos propres affaires, que nous rétablirons un jour à sa place légitime. Il serait bon de pouvoir nous passer de cette nuisance, mais je crois qu’au train où vont les choses, c’est le plus court chemin, et peut-être même l’unique, qui nous mènera au changement. Cependant, je voudrais prévenir touTes celleux qui tentent de construire les prémices de la société réelle : l’action politique en soi doit être comprise comme moyen et non comme but de ce combat ; cela semble évident mais je suis convaincu que cet avertissement est indispensable. Car les unEs et les autres, dans l’ardeur de la campagne électorale, sont fort enclinEs à oublier l’objet de la lutte (autrement dit l’égalité pratique) et à penser que tout est joué lorsqu’illes ont unE députéE au parlement ; en cas d’échec, leur découragement est tel qu’illes sont capables de tout laisser tomber. Je donne donc priorité à la propagande, qui consiste à enseigner à touTes quel est notre but, en quoi il est rationnel et combien il est nécessaire. Nous avons beaucoup fait en la matière mais certainement pas assez. Non, pas suffisamment, tant que chaque ouvrier, chaque ouvrière, ayant envisagé l’avènement possible d’un autre monde, ne l’aura soit rejeté, soit accepté. Oui, tant que ce monde nous ne l’aurons pas décrit assez souvent, clairement et honnêtement pour qu’il soit voulu par touTes ou presque.
Lorsque ce travail sera achevé, que le socialisme sera accepté, je pense que les moyens de le réaliser, en Angleterre du moins, seront à notre portée ; bientôt alors, nous découvrirons pratiquement que nous, les héritierEs de toutes les époques passées, nous avions été frappéEs de pauvreté par une sorte de maléfice et non en raison de conditions immuables et naturelles. En d’autres termes, c’est par notre faute que nous menons cet ersatz de vie dont, sachons‑le, riches et pauvres pâtissent également ; les pauvres en souffrent au point d’en former comme une autre nation, de vivre dans un autre pays que celui des riches, qui ferait à ces dernierEs, si on les condamnait à y séjourner, l’effet d’une vaste prison gouvernée par la folie et la rapacité de cruelLes geôlièrEs.
Encore un mot : je serai bientôt un vieil homme et il y a peu de chances que je connaisse le début du grand bouleversement qui remplacera les privilèges et la concurrence par l’égalité et la solidarité. Mais j’espère que beaucoup d’entre vous le vivront, et il me semble dès à présent l’entrevoir ; quelle différence profonde entre la conscience de la classe ouvrière aujourd’hui et celle qui existait il y a quinze ans ! Dans cette région manufacturière du Nord, j’en ai la certitude, le changement a dû être brutal. Je dois vous avouer que lorsque je vins pour la première fois prôner le socialisme à Manchester, les perspectives n’étaient nullement encourageantes : c’est maintenant l’inverse. Désormais, les ouvrièrEs du sud du Lancashire sont au moins sensibiliséEs, et je pense et j’espère que leurs progrès en la matière seront rapides. Bien des choses ont contribué à cela, en particulier le fait que, même si l’on ne s’en rendait pas compte ces dernières années, les genTes se préparaient au changement, quoique de manière imperceptible.
Désormais les blés sont mûrs, il ne manque plus que les individuEs pour les récolter. Je connais ici quelques moissonneurEuses énergiques et je veux distinguer parmi elleux le directeur du Clarion [2] et ses compagnonNes de travail. Il est difficile d’apprécier l’étendue des services qu’illes ont rendus à la cause en défendant le socialisme avec intransigeance, ténacité et générosité, et en même temps sans hargne. Je suis donc très heureux de pouvoir leur exprimer ma gratitude, ici, à Manchester et en public, comme je l’ai si souvent fait, chez moi, en privé. Espérons, mes amiEs, que la nouvelle École de Manchester effacera des mémoires les plus mauvais aspects de l’ancienne qui, tout en défendant les libertés civiles et religieuses, l’égalité des citoyenNes devant la loi, l’abolition des survivances féodales ou la libre concurrence, fit l’erreur fondamentale de ne tenir pour rien les habitantEs de ce pays, en dehors de la bourgeoisie dont elle défendait les intérêts.
Tirons‑en la leçon et faisons en sorte que notre combat actuel supprime toute distinction de classe et apporte l’égalité à touTes ; c’est cette égalité sociale qui permettra à chaque citoyenNe de développer pleinement ses propres talents, à l’humanité tout entière de bénéficier des connaissances et du savoir‑faire transmis au cours des temps, et qui nous débarrassera ainsi à jamais de l’ersatz.
Où en sommes‑nous ?
Pour celleux qui sont sérieusement engagéEs dans un mouvement de luttes, il est bon de regarder en arrière de temps à autre, afin d’examiner le chemin parcouru ; cela suppose aussi d’examiner autour de nous l’effet qu’il produit sur celleux qui n’y participent pas. De multiples raisons justifient cet examen, la meilleure étant que les individuEs engagéEs dans une telle activité se laissent facilement confiner dans une atmosphère artificielle qui les sépare du monde extérieur, les empêche de distinguer ce qui s’y passe réellement et d’orienter à bon escient la poursuite de leur action.
Voilà maintenant sept ans que le socialisme a refait surface dans ce pays. Le temps a pu sembler long à certainEs, tant cette période fut riche d’espérances et de déceptions. Cependant, sept années ne représentent qu’un laps de temps très court dans l’histoire d’un mouvement sérieux ; peu de causes ont autant progressé, et en si peu de temps, que le socialisme ne l’a fait à sa manière.
Que cherchons‑nous à accomplir ? Changer l’organisation sociale sur laquelle repose la prodigieuse structure de la civilisation, qui s’est construite au cours de siècles de conflits, au sein de systèmes vieillissants ou moribonds, conflits dont l’issue fut la victoire de la civilisation moderne sur les conditions naturelles de vie.
Sept années pouvaient‑elles suffire à faire visiblement progresser vers sa réalisation un projet d’une telle ampleur ?
Considérez de surcroit les qualités de celleux qui s’attelèrent à cette tâche de renverser les bases de la société moderne. Où sont les individuEs d’État qui ont abordé les questions capitales que posaient les socialistes anglaisEs à l’Angleterre du XIXe siècle ? Où sont les grandEs théologienNes qui, du haut de leurs chaires, ont prêché la bonne nouvelle du bonheur à venir ? Où sont les physicienNes qui ont exprimé leur joie ou leur espérance face à l’avènement d’une société qui saurait au moins utiliser leurs découvertes extraordinaires pour le bien de l’humanité ?
Inutile de mettre la main à la plume pour transcrire leurs noms. LAe voyageurEuse (c’est‑à‑dire lAe travailleurEuse) est tombéE aux mains des voleurEuses, et lAe prêtreSse ou lae lévite ont passé leur chemin ; ou peut‑être, dans notre cas, ont-illes même jeté une pierre ou deux à l’individuE blesséE : il fallut pour l’aider unE samaritainE, unE paria, unE personnE peu respectable.
Et qui étaient‑ils, ceux qui entreprirent de ‘faire la révolution’ ‑ c’est‑à‑dire, comme je l’ai dit, de donner à la société une base nouvelle diamétralement opposée à la nôtre ? Quelques ouvrierEs, plus durement atteintEs encore dans leurs misérables conditions de travail que leurs compagnonNes ; quelques éléments épars du prolétariat cultivé dont le ralliement à la cause socialiste devait ruiner les maigres chances de réussite ; unE ou deux déclasséEs du monde politique ; quelques étrangèrEs fuyant la tyrannie bureaucratique de leurs gouvernements ; enfin, ici et là, unE écrivainE ou unE artiste, chimériques et plus ou moins cingléEs.
Et malgré tout, illes étaient assez nombreuXes pour agir. Contrairement à toute prévision, ce mouvement vers la liberté qui existe depuis sept ans, à travers elleux si ce n’est grâce à elleux, a profondément gravé dans son époque l’idée de socialisme. Certes, les travailleurEuses n’ont pas encore récolté le bénéfice de leur action mais c’était impossible qu’ils le pussent : aucun profit matériel et durable ne peut leur être acquis tant que le socialisme reste une simple cause et n’est pas parvenu à fonder une nouvelle société. Mais comme je l’ai écrit la semaine dernière, ce mouvement a du moins réussi en ceci qu’aucunE individuE conscientE n’est satisfaitE des choses comme elles sont. Si les exclamations de triomphe glorifiant la civilisation étouffaient autrefois les récriminations des plus pauvres (il y a tout au plus une dizaine d’années), elles ont maintenant tourné à l’apologie mal assurée de l’horreur et de la stupidité du système existant, que nous supportons faute de mieux (c’est la seule justification de son maintien), jusqu’à ce que nous ayons trouvé les moyens de le jeter aux oubliettes. Et les ouvrierEs, dont on pensait à l’époque de la ‘prospérité galopante’ qu’illes avaient atteint le bout du rouleau et qu’illes se satisferaient d’une sorte de paradis terrestre pour subalternes, montrent maintenant qu’illes n’en resteront pas là, quoi qu’il arrive. Les principes du socialisme commencent à être si bien assimilés que, pour certainEs d’entre nous qui les ont entendu énoncer très souvent, ils font figure de lieux communs sur lesquels il semble inutile de s’appesantir ; jugement que je ne peux cependant en aucun cas partager, comme je vais tout de suite m’en expliquer.
Tout cela est du passé. Comment ? Et pourquoi ? Est‑ce en vertu des qualités de celleux qui sont à l’origine du mouvement ? Cette petite bande d’excentriques qui a fait siennes les thèses socialistes au cours des dernières années, valait‑elle mieux que ne le laissaient croire les apparences ? Nous avons pour la plupart fait preuve d’humanité, certes, mais on ne peut pas dire que se soient développés parmi nous de grands ou d’inattendus talents pour la gestion et la conduite des affaires, ou de grandes qualités de prévoyance. Nous avons été ce que nous paraissions, du moins aux yeux de nos amiEs, et c’était la moindre des choses. Nous avons commis dans nos rapports internes autant d’erreurs que n’importe quel parti dans un laps de temps équivalent. Plus souvent qu’à notre tour, nous avons vidé des querelles et parfois aussi, par crainte de celles‑ci, nous avons acquiescé à ce avec quoi nous étions en désaccord.
Nous avons connu l’égoïsme, la vanité, la fainéantise et l’irréflexion jusque dans nos rangs, ainsi, tout de même, que le courage et le dévouement. Lorsque j’ai rejoint le mouvement, j’espérais tout d’abord que se révéleraient un ou même plusieurs meneurEuses, issuEs du milieu ouvrier, et qu’illes deviendraient, en repoussant toute aide de la bourgeoisie, de grands personnages historiques. je garderais bien cet espoir s’il semblait proche de se concrétiser, car il me tient à coeur en vérité ; mais, en toute franchise, cela ne paraît pas en prendre le chemin.
Cependant, je le répète, malgré tous les obstacles, nous avons obtenu des résultats. Pourquoi ? Mon propos ci‑dessus a déjà fourni une partie de la réponse mais il faut en répéter la teneur : parce que l’infrastructure de la société moderne qui semblait inexpugnable va à la ruine. Elle a fait son temps et va se transformer en autre chose. Voilà donc la raison qui, en dépit de nos erreurs, nous a permis d’agir. Je ne crois pas non plus que puissent se réunir les moyens du grand changement sans que parallèlement se développe la capacité des piliers de la société (c’est‑à‑dire des ouvrierEs) à prendre en charge ce changement et à construire le nouvel ordre qui en sortira.
Voilà du moins de quoi nous encourager. CertainEs d’entre nous ne sont‑illes pas déçuEs, malgré la façon nouvelle dont le socialisme est généralement considéré ? Cette déception n’est que trop naturelle. Lorsque au début nous avons commencé à nous unir, presque rien n’était exprimé en dehors des grands idéaux du socialisme. Et sa réalisation nous semblait tellement lointaine que nous ne pouvions guère envisager les moyens de sa mise en oeuvre, si ce n’est sous la forme de grands événements dramatiques qui auraient certes transformé nos vies en tragédies, mais nous auraient extirpéEs de la ‘paix’ sordide qu’est la civilisation. Avec l’influence croissante du socialisme, cela aussi a changé. Notre succès même a estompé les grands idéaux qui nous guidaient alors, car l’espoir d’une réalisation partielle et, pour ainsi dire, vulgarisée du socialisme nous a rendu impatientEs. Nous sommes touTes convaincuEs, je pense, qu’il se réalisera ; il n’est donc pas extraordinaire que nous mourrions d’envie de le voir se réaliser de notre vivant. Par conséquent, ce sont les méthodes pour y parvenir plutôt que les grands idéaux qui nous préoccupent. Mais il est inutile de parler de méthode si elle n’est pas, du moins en partie, immédiatement applicable ; et c’est dans la nature même de telles méthodes partielles d’être prosaïques et décourageantes, bien qu’elles soient nécessaires.
Deux tendances coexistent à propos de ces méthodes : d’un côté, notre vieille connaissance qu’est le réformisme, qui prend aujourd’hui beaucoup plus d’importance qu’auparavant en raison du mécontentement grandissant et des nets progrès du socialisme ; de l’autre, la révolte, ou plutôt l’émeute, limitée, dirigée contre les autorités qui règnent absolument et sans partage et qui peuvent aisément la réprimer : elle est donc nécessairement vaine et inconséquente.
je désapprouve les deux méthodes : principalement parce que les palliatifs que sont les réformes doivent être mendiés et que les émeutes sont le fait d’individuEs qui ne savent rien du socialisme et ignorent totalement quelle pourrait être l’étape suivante si, contrairement à toute prévision, leur lutte était victorieuse. Par conséquent, nos maîtresSes, au mieux, seraient toujours les maîtresSes car rien ne les remplacerait. Nous ne sommes pas prêtEs pour un tel changement ! Les autorités pourraient être un peu bousculées sans doute et légèrement plus enclines à céder du terrain face aux revendications des esclaves, mais celleux‑ci le demeureraient : car les individuEs resteront assujettiEs tant qu’illes ne seront pas préparéEs à prendre elleux‑mêmes leurs affaires en main. Je pense même que l’utilisation de moyens violents et partiels n’ébranlera pas du tout le pouvoir des autorités mais au contraire le renforcera car les timides de toutes les classes, qui ensemble font la masse des individuEs, se rallieront alors à lui.
Je viens d’évoquer les deux directions que celleux que j’appelle les partisanEs de l’impatience déclarent ouvertes. Avant de décrire la seule méthode qui puisse convenir à certainEs d’entre nous, je veux exprimer, aussi brièvement que possible, mon avis sur l’état actuel de notre mouvement. Celleux qui sont plus ou moins attiréEs par le socialisme, sans être vraiment socialistes, se tournent généralement vers le nouveau syndicalisme ou le réformisme. Ces individuEs estiment qu’illes peuvent arracher aux capitalistes quelques lambeaux de leurs profits et privilèges. Les maîtresSes croient aussi, à en juger d’après leurs récentes menaces de coalition, que cela pourrait advenir. Mais ces avantages ne seraient que très partiels, et nous, socialistes, contrairement à d’autres, savons bien que les genTes ne pourraient pas en rester là si cela arrivait. Passons là‑dessus pour le moment. L’aspect parlementaire de la lutte semble être actuellement en suspens et il a fait place à l’aspect syndical. Mais, bien entendu, il réapparaîtra. Et, en son temps, si rien ne vient entraver le cours logique des événements, une loi finira par proclamer la journée légale de huit heures, sans que cela ne change grand-chose pour les travailleurEuses et leurs maîtresSes.
D’autre part, je crois que le socialisme d’État n’est ni désirable en soi, ni surtout possible comme projet global. Cependant, une réalisation quelconque en sera certainement tentée et, à mon avis, cette tentative précédera toute édification du nouvel ordre des choses. A ce propos, le succès de l’utopie de monsieur Bellamy, aussi mortellement ennuyeuse soit‑elle, prouve que son ouvrage est dans l’air du temps. Et l’attention générale que l’on porte à ces genTes habiles que sont nos amiEs conférencierEs et pamphlétaires fabienNesµ n’est pas due à leurs talents littéraires : les genTes ont réellement le regard plus ou moins tourné dans leur direction.
Aujourd’hui les genTes sont mécontentEs, illes conçoivent l’espoir d’améliorer leurs conditions de travail, et pourtant les moyens d’atteindre ce but restent incertains, ou plutôt on confond le commencement de l’emploi de ces moyens et la fin elle-même ; et c’est justement parce que les genTes s’enthousiasment pour un socialisme dont illes ignorent souvent à peu près tout qu’il faut mettre en avant ses principes élémentaires, sans aucun souci de politique à court terme.
Les lecteurIces saisiront mieux mon propos si j’ajoute que je m’adresse à celleux qui sont réellement socialistes, aux communistes donc. Pour nous, maintenant, la tâche essentielle est de former des socialistes, et je ne crois pas que nous puissions mener d’activité plus utile aujourd’hui. Celleux qui ne sont pas de vraiEs socialistes ‑ les syndicalistes, les fauteurEuses de troubles, que saisie ‑ feront ce qu’illes sont contraintEs de faire et nous n’y pouvons rien. Quelque chose de bon se dégagera peut‑être de leur action, mais nous n’avons nul besoin de travailler de concert avec elleux ‑ d’ailleurs nous ne pourrions le faire de gaieté de coeur ‑ puisque nous savons que leurs méthodes ne mènent pas dans la bonne direction.
Nous devons, je le répète, former des socialistes, c’est‑à‑dire convaincre les genTes que le socialisme est bénéfique et qu’il est réalisable. Lorsque nous aurons réuni assez d’individuEs autour de cette conviction, ils découvriront d’elleux‑mêmes le type d’action nécessaire pour pratiquer leurs idées. Tant qu’aucune prise de conscience massive n’existe, l’action en vue d’un changement total qui profiterait à toute la population est impossible. En sommes‑nous là, en approchons-nous ? Certainement pas. Si nous nous éloignions de cette atmosphère ensorceleuse qui émane du combat militant, nous verrions clairement ceci : aussi nombreuXes soient celleux qui croient possible de contraindre par quelque moyen les maîtresSes à mieux se comporter vis‑à‑vis d’elleux et qui sont impatientEs de les y forcer (par des moyens prétendument pacifiques comme la grève, par exemple), aucunE d’entre elleux, excepté une toute petite minorité, n’est prêtE à se passer de maîtresSes. Illes ne se sentent pas capables de prendre leurs affaires en main et de devenir responsables de leurs vies dans ce monde. Lorsqu’illes y seront prêts, le socialisme sera alors réalisé mais sinon rien ne peut raccourcir ce délai, ne serait‑ce que d’un jour.
Formons par conséquent des socialistes. Nous ne pourrons rien faire de plus utile, et propager sans cesse nos idées n’est pas un moyen dépassé. Au contraire, pour celleux qui comme moi ne croient pas au socialisme d’État, c’est le seul moyen rationnel d’arriver à un nouvel ordre des choses.
[1] Aujourd’hui Victoria and Albert Museum, dont la décoration d’une des salles fut la première commande importante de Morris & Co
[2] ournal socialiste de Manchester dans lequel William Morris et ses amis exposaient leurs idées, après que Commonweal fut devenu un mensuel anarchiste.
)
ce texte est aussi consultable en :
- RTF par téléchargement, en cliquant ici (142.2 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.2 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (925 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.4 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (2.3 Mo)