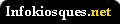Q
Quelques archives de la lutte pour la défense libre
mis en ligne le 12 novembre 2012 - Collectif
QUELQUES ARCHIVES
DE LA LUTTE
POUR LA DÉFENSE LIBRE
DÉFENSE LIBRE ?
L’une des revendications du mouvement pour la défense libre a été l’accès des justiciables à leur dossier dans les procédures correctionnelles et la possibilité de mener sa défense sans l’aide d’un avocat. Formellement, ce combat a été gagné en novembre 1982. Cette brochure, en livrant des documents de l’époque permet de mieux comprendre les enjeux de cette lutte et de s’interroger, aujourd’hui, sur les stratégies de défense. Car le mot d’ordre « Défense libre ! » reste d’actualité.
SOMMAIRE
Introduction
Se défendre
Vous avez la parole
Projet de plateforme pour une défense libre
Défense insoumise
Un prévenu pourra se défendre sans avocat, dossier en main
La roue de justice (ou les luttes des justiciables pour accéder au dossier)
De la stratégie judiciaire
À lire, à voir
***
« Se défendre », « Vous avez la parole » et « Projet de plateforme pour une défense libre » ont été publiés dans la brochure Pour la défense libre, document préparatoire aux premières assises de la Défense libre qui se sont tenues à la Sainte Baume (près d’Aix-en-Provence), du 23 au 26 mai 1980.
« Défense insoumise » est extrait du numéro 2 (octobre 1980, p. 6) du CAP/Revue de la stratégie judiciaire, publié par le CAP-J (Comité d’Action Prison-Justice).
« Un prévenu pourra se défendre sans avocat, dossier en main » a été publié par Béatrice Vallaeys dans Libération, le 24 mai 1982.
« La roue de justice (ou les luttes des justiciables pour accéder au dossier) », signé par Dominique Nocaudie, est extrait de La défense libre au tribunal (Paris, éd. vrac, 1983) de Frédéric Joyeux.
Sous le titre « De la stratégie judiciaire », est reproduit ici la Préface de Michel Foucault à la deuxième édition de l’ouvrage de Jacques Vergès, De la stratégie judiciaire (Paris, Éd. de Minuit, 1981). La version que nous proposons est celle qui a été republiée dans le quatrième tome des Dits et Écrits de Michel Foucault (Paris, Gallimard, 1994).
Les textes sont reproduits intégralement.
Les notes de bas de page sont celles des textes originaux, à l’exception de celles signées S&A.
***
INTRODUCTION
par Soledad & associées
(2012)
Être confronté à la justice, ça implique généralement de trouver un avocat, de le payer et surtout de lui faire confiance. Il faut s’en remettre au « professionnel », à celui qui a fait de la justice son métier. Parce que les procédures seraient compliquées, que la justice a son vocabulaire, et que, finalement, l’aspect technique du droit trace la frontière entre « eux » et « nous », les justiciables [1].
Les avocats et « nous »
Autant l’avouer, l’idée de cette brochure est née d’agacements. Par exemple, d’entendre les avocats [2] dire « nous » (pour parler de leurs clients). « Oui, Monsieur le Juge, nous ferons appel de votre décision ! » Y a pas de « nous » qui tienne, seul le condamné fait appel. Moi, si j’ai rendez-vous avec un avocat, je ne lui dis pas qu’on se retrouvera à « notre cabinet ». C’est certes un (banal) sale tic langagier et il y a plus grave, à vrai dire. Mais c’est franchement abusé et révélateur : le « bon » avocat réussit à faire croire à son client que, de ses problèmes, il en fait « son » affaire.
Combien d’avocats acceptent de donner à leurs clients une copie de leur dossier ? Quand ils ne se réfugient pas derrière de fallacieuses considérations juridiques ou, notamment avec leurs clients qui bénéficient de l’Aide Juridictionnelle [3], derrière des arguments économiques (le prix des copies), ils disent généralement ne pas comprendre l’intérêt d’une telle démarche – certains évoquent même les risques de mauvaises interprétations de leurs clients et donc leur refuser l’accès au dossier, c’est un peu les protéger contre eux-mêmes…
De plus, beaucoup d’avocats refusent de réellement se mettre au service de leurs clients : ils imposent une stratégie ou, au mieux, acceptent de la dévoiler avant l’audience. Souvent, ils suggèrent (liste non exhaustive) à leurs clients d’adopter telle ou telle attitude (y compris vestimentaire) à l’audience et de s’adresser au juge ou aux parties civiles de telle ou telle manière. En un mot comme en cent, dans la pièce qui doit se dérouler au tribunal, ils veulent garder la main sur la partition et qu’on leur serve la soupe. Que leurs clients soient de « bons » justiciables, qui se conforment au rôle qui a été écrit pour eux.
Durant les procès, nombre d’avocats collaborent à la police de l’audience : ils implorent leurs clients de rester dans une attitude soumise face aux juges et au procureur. L’accusé élève la voix ou coupe la parole à un juge, un témoin, un expert ou un procureur ? Son avocat lui conseillera fermement d’arrêter, sans que cela ne l’empêche, éventuellement, plus tard (c’est-à-dire trop tard), sur les marches du Palais, de se plaindre que « la parole de la défense n’a pas été entendue ». D’une manière générale, les avocats s’enflammeront toujours davantage pour un vice de procédure que pour la parole de leurs clients. Car si ceux-ci devaient se taire tout au long de la procédure, il se trouverait peu d’avocats que ça dérangerait. Pour beaucoup d’entre eux, leurs clients, avec leur désespérante incapacité à se conformer aux manières et usages de la justice, seraient leurs premiers ennemis.
Autre point qui mériterait de plus amples développements : les formes de connivence entre avocats et juges. Au-delà des effets de manche et des déclarations outragées (« Le juge a été déloyal… », « Le parquet [4] est soumis au pouvoir exécutif… »), les rapports entre gens de robe sont surtout faits de connivences, largement dissimulées aux yeux des profanes. On ne parle pas uniquement des amitiés forgées par les fonds de culottes usés sur les mêmes bancs d’écoles, puis des cuites partagées lors des soirées étudiantes et de la similitude des milieux d’origine qui favorise la consanguinité et un entre-soi rassérénant. Non, la connivence n’est pas qu’affaire de famille et de soirées cocktail. Si les avocats sont appelés des « auxiliaires de justice », c’est bien parce qu’ils ont en commun, avec leurs compères, qu’ils siègent assis ou debout [5], des codes et des usages, mais surtout le respect de l’institution judiciaire.
Fondamentalement, les avocats croient à la justice, à la procédure (qui garantit blablabla…) et aux peines (qui permettent aux victimes de blablabla…). C’est cet ensemble de croyances partagées qui explique leur aversion pour le mensonge : mentir, ça serait ne pas « jouer le jeu ». C’est pour cela que se pose entre les justiciables et les avocats, un gros problème : les avocats plaident sur la base de ce qu’ils croient, eux, et de ce qu’ils pensent être crédible (et le crédible n’est pas le même d’un juge à l’autre, devant des juges professionnels et un jury de cour d’assises, etc.) : ils plaident ce qu’ils croient ou veulent bien (nous faire l’honneur de) croire et non pas ce qu’on lui demande de dire. Le justiciable doit donc réussir à convaincre son avocat, avant même d’espérer pouvoir convaincre un juge. Et les avocats le reconnaissent sans trop de mal : ils n’aiment rien tant qu’un client qui reconnait les faits… Ils vont alors plaider le cœur léger, débarrassés de la crainte d’être « lâchés » par un client qui « craquerait » au cours d’une audience (en reconnaissant finalement les faits ou en montrant son « vrai » visage). Drôle de situation, tout de même, que de devoir aller chez un avocat comme si on allait à confesse, s’entretenir avec une personne crassement honnête, alors que les accusés ne se sont pas encore vus contesté le droit de mentir.
Sans doute que l’essentiel, lorsqu’on est poursuivi en justice, c’est de connaître le contenu de son dossier et de pouvoir se défendre comme on l’entend. Mais il faudrait aussi évoquer la dimension économique des rapports entre justiciables et avocats. Il y a les vrais bandits (qui demandent, par exemple, la veille d’une audience une nouvelle somme d’argent et feignent de l’avoir annoncé au premier rendez-vous), mais ceux-là sont finalement moins dangereux (car leur mauvaise réputation finit par avoir raison d’eux) que la masse des demi-canailles. Si on ne leur demande pas expressément, il est rare que les avocats établissent un devis (une convention) dès le premier contact et qu’ils énoncent clairement leur tarif-horaire (y compris du premier rendez-vous) et des actes qu’ils se proposent de faire. Ce flou leur permet de jauger leur client et de tirer sur la corde… C’est le temps des promesses.
Si c’est tout à fait ordinaire, dans les luttes anti-répression, de recueillir de l’argent « pour payer les avocats », il est, par contre, très rare que le montrant de leurs honoraires soient divulgués. Entendons-nous. Je ne suis pas en train de dénoncer un détournement d’argent par tel ou tel collectif. Non. Par contre, force est de constater que si on connaît généralement le montant précis des amendes et parties civiles à payer par des condamnés, les frais entraînés par un procès sont toujours moins clairs lorsqu’il s’agit des honoraires des avocats. Il faut reconnaître que nombre d’entre eux n’ont pas encore pris l’habitude qu’on leur demande une facture.
Ce rapide constat ne date pas d’aujourd’hui. Et se serait se méprendre que de tenir pour uniques responsables les avocats. C’est bien à nous de remettre les choses dans le bon ordre en imposant notre stratégie de défense aux avocats (lorsqu’on leur fait l’honneur de les désigner pour nous assister).
Et si on (re)prenait en main notre défense ?
Du milieu des années 70 au milieu des années 80, un mot d’ordre s’est répandu : « Défense libre ! » En fait, cette expression a été popularisée par des militant-e-s du CAP (Comité d’Action des Prisonniers) qui se sont plus spécifiquement intéressés au problème de la défense juridique. Le mouvement de la défense libre, constitué autour du CAP-J (Comité d’Action Prison-Justice), a mené des luttes sur deux plans principalement : 1. La possibilité pour les justiciables de se défendre eux-mêmes (c’est-à-dire sans l’intervention d’un avocat), ce qui implique l’accès direct au dossier 2. La diffusion de réflexions sur les stratégies de défense et un appel résolu à une « défense insoumise » [6].
Pour comprendre ce que, sur le champ de bataille judiciaire, prendre le parti de la défense libre apporte, faisons une comparaison… Les savoirs médicaux sont extrêmement pointus et demain, pas plus que (si on m’y autorisait) je ne revêtirais une robe d’avocat pour aller défendre une personne devant une cour d’assises, je ne pratiquerais une opération à cœur ouvert. C’est du bon sens. Par contre, ce n’est pas parce que, en tant que patient, je n’ai pas les mêmes connaissances que le médecin que j’ai choisi que je ne peux pas exiger de lui d’obtenir les résultats de mes analyses, de comprendre les options possibles, les risques encourus, etc. En médecine, on parle de « consentement éclairé ». Vous me direz qu’il s’agit bien souvent de mots et qu’on est tout autant susceptible d’être de la chair à bistouri que de la chair à justice… Mais les luttes menées par les associations de malades et la promotion des approches communautaires de la santé ont montré qu’un rapport de forces favorable aux malades permet de changer les pratiques…
Cette brochure essaie de rendre compte, à travers un choix de textes, de certaines idées et combats qui ont animé le mouvement pour la défense libre. Il ne s’agit pas ici de faire un bilan, encore moins d’adhérer à tout ce qui a été fait, dit ou écrit. Et les textes rassemblés dans cette brochure n’épuisent pas la question de la défense libre. En proposant ces textes, il s’agit surtout de contribuer à la mémoire des luttes qui ont été menées et de les continuer, aujourd’hui, en se posant, notamment, deux questions :
- Comment faire pour que, lorsque nous sommes poursuivis en justice, nous puissions nous défendre comme nous l’entendons (vraiment) ?
- Comment faire pour que les luttes contre la répression permettent, entre ceux qui les mènent, une circulation des savoirs et des expériences ?
Un procès n’est pas qu’affaire de droit, de textes et de procédures. L’aspect juridique, qui s’incarne dans une tonne de codes, de lois et autres textes comme dans l’épaisseur des dossiers d’instruction, peut faire croire que des connaissances spéciales sont requises pour « bien » se défendre. C’est comme tout, ça s’apprend. Mais surtout, le manque de connaissances juridiques n’est qu’une partie du problème. Il est en effet rare que la nature du débat ne soit finalement que juridique. La vraie question qui se pose est celle du rapport de forces que nous décidons d’instaurer.
La justice n’est pas un champ de luttes séparé des autres. Sur celui-ci comme sur tous les autres, nous devons refuser que d’autres décident à notre place comment mener nos luttes.
Autonomie & défense libre !
SE DÉFENDRE
par Michel Foucault, Jean Lapeyrie, Dominique Nocaudie, Henry Juramy, Christian Revon et Jacques Vergès
1- Évitons d’abord le problème ressassé du réformisme et de l’anti-réformisme. Nous n’avons pas à prendre en charge les institutions qui ont besoin d’être transformées. Nous avons à nous défendre tant et si bien que les institutions soient contraintes de se réformer. L’initiative doit donc venir de nous, non pas sous forme de programme mais sous forme de mise en question et sous forme d’action.
2- Ce n’est pas parce qu’il y a des lois, ce n’est pas parce que j’ai des droits que je suis habilité à me défendre ; c’est dans la mesure où je me défends que mes droits existent et que la loi me respecte. C’est donc avant tout la dynamique de la défense qui peut donner aux lois et aux droits une valeur pour nous indispensable. Le droit n’est rien s’il ne prend vie dans la défense qui le provoque ; et seule la défense donne, valablement, force à la loi.
3- Dans l’expression « Se défendre », le pronom réfléchi est capital. Il s’agit en effet d’inscrire la vie, l’existence, la subjectivité et la réalité même de l’individu dans la pratique du droit.
- A) Se défendre ne veut pas dire s’auto-défendre. L’auto-défense, c’est vouloir se faire justice soi-même, c’est-à-dire s’identifier à une instance de pouvoir et prolonger de son propre chef leurs actions. Se défendre, au contraire, c’est refuser de jouer le jeu des instances de pouvoir et se servir du droit pour limiter leurs actions.
- B) Ainsi entendue, la défense a valeur absolue. Elle ne saurait être limitée ou désarmée par le fait que la situation était pire autrefois ou pourrait être meilleure plus tard. On ne se défend qu’au présent : l’inacceptable n’est pas relatif.
4- Se défendre demande donc à la fois une activité, des instruments et une réflexion.
Une activité : il ne s’agit pas de prendre en charge la veuve et l’orphelin mais de faire en sorte que les volontés existantes de se défendre puissent venir au jour.
De la réflexion : se défendre est un travail qui demande analyse pratique et théorique. Il lui faut en effet la connaissance d’une réalité souvent complexe qu’aucun volontarisme ne peut dissoudre. Il lui faut ensuite un retour sur les actions entreprises, une mémoire qui les conserve, une information qui les communique et un point de vue qui les mettent en relation avec d’autres. Nous laisserons bien sûr à d’autres le soin de dénoncer les « intellectuels ».
Des instruments : on ne va pas les trouver tout faits dans les lois, les droits et les institutions existantes mais dans une utilisation de ces données que la dynamique de la défense rendra novatrice.
VOUS AVEZ LA PAROLE
par Christian Revon
Non, je n’ai pas la parole. Ni personne, vraiment.
Ni le prévenu, ni les témoins, ni le Procureur, ni le Président.
Si la parole suppose deux personnes, l’une qui parle et l’autre qui écoute, on peut compter dans une audience correctionnelle les paroles qui sont dites.
Sans parole, pas de défense.
Libérer la parole, pour libérer la défense.
Il n’y a manifestement plus de place pour la défense dans une audience correctionnelle. Dans les audiences correctionnelles, celles où 15 ou 30 affaires ont été inscrites au rôle pour cet après-midi là ; qui commencent à 13h30 et dont chacun se demande quand elle va finir. Pour une affaire qui n’a pas fait l’objet d’un sort particulier, pour laquelle on n’a pas spécialement réservé de temps, pour un délit banal, mais qui reste une affaire grave car elle va se traduire par 1 an, 2 ou 3, il n’y a plus de place pour qu’on s’entende, pour dire, pour sentir, expliquer, faire comprendre, se faire entendre ; il n’y a pas de place, pas de temps, pas de lieu, pas d’échos, pas de résonance, pas d’écoute, pas de dialogue.
Quinze avocats se pressent au début : trois heures plus tard, on leur dira « vous avez la parole ». Mais leurs phrases seront comptées, et puis dans une telle ambiance, on n’a plus envie de parler, mais de s’en aller. L’audience est souvent attendue comme l’oasis dans le désert, par l’inculpé qui va pouvoir enfin dire aux juges quelque chose, qu’il a longtemps ruminé en prison ; l’avocat qui s’est trouvé le plus souvent devant un mur pendant l’instruction, et sans pouvoir ouvrir la bouche, va pouvoir dire enfin quelque chose, on va pouvoir s’expliquer enfin.
Au lieu de cela, à moins d’être particulièrement agressif, d’avoir la notoriété ou grand talent, c’est du fond d’un puits qu’il vous faut clamer la défense pendant qu’en haut, ceux à qui on s’adresse, pensent ou vaquent à autre chose. C’est toujours par chance qu’une minute d’attention est captée, que des regards se croisent, que des hommes se parlent : des mots, des phrases sont dites à personne : un bruit de fond qui n’éveille rien. Rien n’est dit, tout est répété et ces audiences se passent, alors que le temps presse, à répéter des choses qui n’intéressent personne.
Le président qui dirige les « débats », répète l’acte d’accusation ; il a étudié le dossier, comme on apprend une histoire pour la dire aux enfants ; il en a retenu les détails qui font sourire ou condamner, mais son idée est faite.
Nous sommes en bout de chaîne : le tribunal qui reçoit le dossier 8 ou 15 jours avant l’audience suppose – et comment faire autrement ? – que ceux qui l’ont précédé – la police judiciaire, le Parquet, le juge d’Instruction, voire la Chambre d’Accusation, ont bien fait leur travail, et qu’on ne renvoie pas devant lui pour jugement un dossier qui comporterait un vice fondamental.
L’ennui, c’est qu’au niveau inférieur, on s’est dit la même chose, mais à l’inverse. La police se dit que s’il y a une erreur, le Parquet la verra. Le Parquet pense de même du juge d’Instruction – et le juge d’Instruction pense que le tribunal fera enfin la lumière. La justice n’est souvent qu’une suite d’incertitudes et d’erreurs, transformées miraculeusement en vérité inébranlable par la confiance réciproque des différents échelons.
De plus, le jour de l’audience, un président ne se lance pas dans la suite de trente dossiers, comme dans une promenade du dimanche : il y a la « Jurisprudence » du tribunal !
Cette affaire qui est singulière pour le prévenu, et souvent aussi pour l’avocat, c’est la Nième du même type qui réapparaît. La procédure, le dossier, sont suffisamment renseignés, éclairés ; c’est bien dommage qu’il faille encore juger, car les faits étant déjà établis à l’évidence, la peine, la sanction sont déjà prêtes dans son esprit : que peut-on dire de nouveau, d’intéressant, qu’on ne sache pas déjà, qu’on n’ait pas entendu mille fois ?
L’accusation, pour faire semblant, ou lorsque le tribunal semble enclin à trop d’indulgence, ou pour ne pas s’ennuyer de trop, répète encore une fois le réquisitoire définitif, en essayant de « personnaliser » un peu les poursuites, ou ne dit rien du tout, ce qui est une grande sagesse.
Les avocats, quand on les entend plaider à la suite, et encore une fois, sauf exception (ou soi-même qu’on écoute toujours avec intérêt) ne disent rien. Rien qui apporte quelque chose de nouveau. Répéter pour accuser ou répéter pour défendre, c’est pareil, ça ne dit toujours rien à personne. On connait déjà tous les systèmes de défenses, tous les stéréotypes, tant sur les faits que sur la personnalité. On a beau s’agiter, s’émouvoir, parler fort, ou parler bas, ce ne sont finalement que des paroles en l’air : elles peuvent un peu contrarier une décision déjà prise, un peu la confirmer au contraire, elles ne créent rien.
Tout cet après-midi, plein de paroles, de phrases, mais pas d’échanges, pas de découvertes, pas d’inédit, pas de débat.
Quand on est à l’instruction, le magistrat dit volontiers « vous direz cela au jugement, votre avocat le plaidera ». Et le jour du jugement, on dit « mais vous n’avez jamais dit cela à l’instruction, vous le dites pour la première fois ».
On peut se demander si cela vaut encore la peine de tenir des audiences correctionnelles, si ce n’est pas du temps perdu, et si l’on ne ferait pas mieux, les uns et les autres, d’utiliser ce temps à autre chose, à se promener par exemple, à aller à la piscine ou au cinéma, ou à travailler chez soi. Sans doute, ce constat peut choquer ceux qui sont les acteurs de bonne foi de ces séances ; chacun y joue son rôle en y mettant tout son cœur ; on essaie chacun de trouver la « vérité » et on est pris subjectivement par ce rôle et aucun n’est plus malhonnête que l’autre. Le tribunal a le sentiment de juger impartialement, le procureur de défendre les braves gens, l’avocat de défendre son client. Il n’y a guère que le prévenu qui fasse grise mine, quand on le ramène.
Et puis, on y tient à cette audience publique, à ces séances, à ces « représentations ». On ne peut pas, pense-t-on, dire n’importe quoi, juger n’importe comment, il y a des témoins ; la démocratie réclame que chacun puisse s’exprimer librement : la presse peut y venir, et le caricaturiste, même si le son et l’image sont interdits.
Et puis, pourrait-on dire comme pour les messes du dimanche, ça marche encore. Il y a encore l’émotion, tout le monde semble y croire vraiment. Il y a communion, et respect des fonctions. Un bon ordonnancement, l’assistance fidèle garde le silence, les choses se déroulent sans heurt, et même s’il y a grand ennui, on pense qu’il s’y passe quelque chose, que c’est utile, on ne la remet pas en question. Ça fait partie des rites, des choses sacrées, qu’il ne faut pas perdre.
L’audience correctionnelle, c’est donc un lieu où tout est agencé apparemment pour parler, mais où on ne fait que répéter et réciter. Sans faire de grands projets de réforme, la seule chose qu’il faudrait réintroduire dans les audiences, c’est LA PAROLE LIBRE. On n’aurait pas le temps ? On n’aurait pas les moyens ? Ou l’envie ? Alors, qu’on juge moins ; qu’on ait au moins l’honnêteté de juger sans débat, sans audience ; qu’on applique un tarif sans jugement, ce serait plus clair. Mais qu’on ne fasse pas semblant. Qu’on applique un tarif, administrativement. Pourquoi vouloir juger tout et tout le monde. Pourquoi se réunir en audiences publiques si c’est une formalité ? On pourrait aussi bien sanctionner sans juger, ce que l’on fait couramment d’ailleurs, au niveau du voisinage, de l’entreprise, au niveau social. Mais si la justice veut rester un lieu de débat, qu’elle redonne et se redonne la parole libre. Tout le monde a droit à cette liberté de parole, les magistrats comme les prévenus, les témoins comme les avocats et l’accusation. La justice est un lieu de parole, ou elle n’est rien.
La DEFENSE LIBRE est d’abord une libre parole, non seulement à l’audience, mais partout. Mais on a honte, on est seul ; la machine semble énorme ; elle ne va pas dans le sens de ce que l’on pense, de ce que l’on sait et voit. On se croit incompétent, ignorant, on a peur.
Libérer la défense, c’est d’abord redonner la parole, et laisser dire des choses simples, que tout le monde sait, mais qu’on ne dit pas. On ressent, on peut être l’objet d’intenses émotions, de ce qu’on a vu, su ou vécu, mais tout cela est étouffé, recouvert, oublié.
Mais si on disait, on verrait que tout ce qu’on pense n’est pas faux ; qu’on a raison peut-être, qu’on n’est pas seul, que d’autres ressentent les choses de la même façon, qu’il n’y a pas à désespérer. Libérer la défense, c’est parler. Si quelqu’un se préoccupe de défense, qu’il soit policier, juge, avocat, justiciable, la première des choses c’est de ne pas garder pour soi ce que l’on sait : c’est de le mettre sur le tapis ; on peut se tromper, mais pas tant qu’en se taisant. Le secret de la police, le secret de l’instruction, le secret du délibéré, ne sont peut-être rien à côté du secret que l’on garde par rapport à soi-même, ces choses que l’on garde secrètes à soi-même, que l’on ne veut pas se dire, que l’on ne veut pas dire. La société garde le secret, se tait, mais l’homme parle. Sa Parole est liberté. Ses Chaînes sont dans le silence.
PROJET DE PLATEFORME POUR UNE DÉFENSE LIBRE
A LA POLICE
Abolition du secret policier
Dans le système judiciaire actuel, ce sont les rapports et interrogatoires établis dans les locaux policiers qui déterminent toute la suite de la procédure, or la défense y est interdite. C’est à partir de l’intervention policière que commence le déséquilibre entre accusation et défense.
Vouloir que l’individu poursuivi soit en mesure d’organiser sa défense dès le départ de l’accusation est logiquement la première revendication d’une association pour la DÉFENSE LIBRE.
A L’INSTRUCTION
Communication libre et sans limite avec le juge d’instruction. Libre accès au dossier pour l’accusé et ses défenseurs.
Il faut mettre fin à l’adage qui veut que le « juge d’instruction est maître de son dossier » ce qui lui permet de museler autant que de favoriser la défense suivant ses goûts, ses opinions ou ses convictions.
Ce dossier d’instruction sera transmis au juge et sera leur instrument de condamnation. La défense doit donc pouvoir s’exercer pleinement pendant tout le temps de l’élaboration du dossier d’instruction, comme c’est le cas pour l’accusation.
Le juge d’instruction doit être tenu de répondre aux notes de l’inculpé ou de ses défenseurs, comme il le fait pour celles du parquet.
Toutes les pièces du dossier doivent être en permanence à la disposition de la défense et non seulement 48 heures avant les audiences d’instruction comme c’est le cas actuellement.
A L’AUDIENCE
Fin de l’interrogatoire inquisitorial du président.
En interrogeant l’accusé, le président du tribunal ou d’une cour oriente forcément les débats suivant un dossier qui a été préparé en l’absence de la défense, le débat n’est plus contradictoire dès le début de l’audience. L’interrogatoire pour être objectif ne peut être que mené égalitairement par l’accusation et la défense. Le président ne faisant qu’arbitrer et pour cela ne devrait pas avoir connaissance avant les débats d’un dossier qui n’est que celui de l’accusation.
Fin de la notion d’outrage à magistrat et des devoirs de respect des défenseurs vis-à-vis des juges.
Le magistrat qui dort, discute ou rêve pendant une plaidoirie, qui coupe brutalement la parole à l’inculpé ou à sa défense, ne sera pas considéré comme ayant outragé la défense, alors que le défenseur qui aura relevé une impartialité du président ou qui voudrait simplement exprimer un avis contraire, risque, suivant les juges, l’inculpation d’outrage à magistrat.
Les notions d’outrage et de respect sont d’autre part arbitraires, les juges n’ont pas les mêmes conceptions : tel juge s’estimera outragé là où tel autre pensera que le défenseur ne fait que son métier.
Les notions d’outrage et de respect sont des entraves à la libre défense en mettant à la disposition des magistrats une arme pour limiter la libre expression et le libre choix de son système de défense.
Suppression des règles déontologiques qui limitent la défense.
Actuellement la déontologie interdit aux avocats de rencontrer des clients en dehors de leur cabinet. Ils sont tenus de respecter sans réserve les juges. Il leur est interdit de commenter publiquement un dossier ou de critiquer des décisions judiciaires, ils ne peuvent participer à des conférences de presse sans autorisation, ils n’ont pas le droit de faire de déclaration sur l’organisation de leur profession, ils ne doivent pas transmettre à leur client emprisonné des pièces de leur dossier. Autant de règles qui font que l’avocat doit être un auxiliaire de l’appareil judiciaire et de moins en moins un défenseur. La défense libre ne peut pas avoir de limites. Ce qui sert ou peut servir la défense, comment et avec quels contenus elle est menée n’est ni l’affaire du parquet, ni du tribunal, mais exclusivement celle de l’accusé et de ses défenseurs. Toutes les règles de déontologie qui contrarient ce principe doivent être abolies.
L’INCULPÉ-L’ACCUSÉ
La défense doit se libérer dans le seul intérêt de l’individu qui est poursuivi.
Tout ce qui empêche cette liberté doit être prohibé, s’il veut se défendre seul, il doit en avoir la possibilité :
- La présence d’un avocat ne doit jamais être obligatoire ;
- L’inculpé doit avoir libre accès à son dossier ;
- S’il a un défenseur, celui-ci doit pouvoir lui remettre les pièces du dossier le concernant (ce qui est actuellement interdit).
Les inculpés et accusés doivent disposer des informations et de la connaissance dont ils ont besoin pour mener la meilleure défense possible, quand ils sont emprisonnés. Ils doivent pouvoir diffuser comme ils l’entendent leurs écrits et mandater leurs défenseurs pour prendre la parole où bon leur semble.
C’est à l’accusé seul de juger en dernier ressort de l’intérêt de sa défense.
DROITS DE L’HOMME - DÉFENSE LIBRE
La liberté de la défense ne peut être dissociée des droits fondamentaux des individus. Le système accusatoire, tel qu’il fonctionne actuellement, viole constamment l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen :
« Tout homme est présumé innocent tant qu’il n’est pas reconnu coupable ».
Ce principe, qui supposait une défense totalement libre, ne rentrera dans les faits qu’après la suppression des contraintes et des soumissions que subit actuellement la défense. L’adoption de ce manifeste devrait permettre la réalisation de cette présomption d’innocence qui, depuis 1789 et pour de multiples raisons d’Etat, va de dégradations en inversion : policiers, procureurs, juges s’orientant vers la présomption de culpabilité et pour les besoins de leurs causes bâillonnent la défense.
DÉFENSE INSOUMISE
par le CAPJ (Comité d’Action Prison-Justice)
En 1968, J. Verges publiait De la stratégie judiciaire, définissait les théories de défense de rupture et connivence, s’appuyant sur l’histoire et son vécu de défenseur, ce fut la ruée des récupérateurs. C’était à qui faisait la meilleure rupture, à qui avait travaillé avec verges, à qui l’avait le mieux compris.
Nous, justiciables, qui avions adopté De la stratégie judiciaire d’abord parce que toute la stratégie de défense que nous exposait Verges était basée sur notre capacité à nous défendre, à participer entièrement à notre défense et à ne pas accepter le jeu des règles judiciaires imposées pour nous détruire, nous, ces justiciables en lutte dans les tribunaux pénaux comme devant les TPFA [7], avons trop souffert du galvaudage de l’expression « défense de rupture ».
C’était à qui faisait de la rupture, la rupture devenait le dernier chic de « gôche ». « Mes chers, venez aujourd’hui à la 16ème, je fais de la rupture », Daumier présent aurait pu légender l’un de ses dessins ainsi : « Votre mari a pris perpétuité, mais quelle belle rupture j’ai fait ». Plus fort que cela ! Quand le client dominait l’avocat, lui imposait sa stratégie et sa parole, puis GAGNAIT, l’avocat s’empressait de déclarer : « Ce n’est pas une victoire judiciaire, c’est une victoire politique », si son client s’était tu et avait suivi son avocat, cela aurait sans doute été une défaite judiciaire ! Car ces défenseurs se disant de rupture osaient accepter la défaite au nom de la rupture ! Pour cela le CAPJ, qui aime gagner, vous informe que pour lui, la rupture, c’est terminé !!! Le CAPJ crée la DEFENSE INSOUMISE, le CAP organe du CAPJ, journal de la stratégie judiciaire, devient donc aussi la revue des DEFENSES INSOUMISES. Oui !
Cela veut dire qu’il y a des défenses soumises, dont beaucoup se cachaient derrière l’expression de rupture, et le souvenir fantomatique de Verges. OUI ! La DEFENSE INSOUMISE est la copie conforme de ce que Verges a appelé la défense de rupture, nous la récupérons ? ET ALORS ? Ce qui compte au CAPJ, c’est de se battre pour gagner, c’était cela le FLN [8] et ils ont réussi avec la défense de rupture, c’est cela que nous explique et démontre Verges , et que les « bon chic, bon genre » du barreau ont récupéré pour « perdre avec élégance », alors que Verges parlait de gagner tout simplement. La bataille sur des mots ne nous intéressant pas, nous leur laissons faire et proclamer et s’enchiquer et encore glousser et toujours perdre avec ce qu’ils appellent traitreusement DEFENSE DE RUPTURE. Le CAPJ vous invite à la DEFENSE INSOUMISE, pour vaincre.
UN PRÉVENU POURRA SE DÉFENDRE SANS AVOCAT,
DOSSIER EN MAIN
par Béatrice Vallaeys
Insoumis amnistié, Frédéric Joyeux doit bientôt comparaitre en correctionnelle pour « violences à agents ». Il a obtenu d’avoir communication de son dossier alors qu’il refuse l’assistance d’un avocat. Une première…
Le 30 juin prochain, la 17ème chambre du tribunal correctionnel de Paris va connaitre une situation assez exceptionnelle : un prévenu viendra s’y défendre seul mais, pour une fois, en pleine connaissance de son dossier. Le 14 mai dernier, Frédéric Joyeux, inculpé depuis la fin du mois de novembre 1981 de « violences, rébellion, outrage à agents et détérioration de matériel de la RATP », a en effet reçu la communication intégrale des procédures engagées dans son affaire. Et ce fait – apparemment sans précédent – sans l’intermédiaire d’un avocat.
La chose en vérité n’a pas été simple. Elle constitue sans aucun doute une brèche dans la jurisprudence en la matière. Une jurisprudence qui repose sur certaines lacunes du code de procédure pénale et sur leur interprétation pour le moins restrictive. Car si le Code est extrêmement clair et précis en la matière criminelle, il reste très flou dès qu’il s’agit d’un délit.
En matière criminelle en effet, la loi impose à l’accusé de se faire assister d’un avocat (art. 274), mais elle prévoit par ailleurs (art. 379) « la communication gratuite à l’accusé des copies des procès verbaux constatant l’infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d’expertises ».
En matière correctionnelle en revanche, la loi n’oblige pas le prévenu à désigner un défenseur mais lui en laisse la « faculté » (art. 417). Autrement dit, il peut se passer d’un avocat pour assurer sa défense.
Les choses se compliquent cependant très vite quand on aborde le problème des communications de procédures pourtant essentielles si l’on veut mener à bien sa défense. Pour le code de procédure en effet, si l’affaire nécessite une information (une instruction), les procédures seront mises « à la disposition du conseil », et non à l’accusé directement (art. 118). Pas un mot en revanche sur le destinataire des pièces dès qu’il s’agit d’une « citation directe ». D’où l’interprétation hâtive de la cour de cassation : le législateur n’ayant pas pu « oublier » de le préciser, et puisque le code ne désigne pas expressément l’inculpé, c’est que celui-ci n’y a pas droit.
En clair, pour avoir non seulement accès aux procédures mais surtout à leurs copies, l’accusé qui veut se défendre seul devant le tribunal doit en tout état de cause prendre un avocat pour au moins connaitre son dossier. Bien fou celui qui persisterait à s’en passer, et surtout en « citation directe » : l’instruction se faisant à l’audience, l’accusé doit nécessairement être en mesure de discuter « contrairement » les preuves apportées par le Parquet. Avouez qu’on nage en pleine hypocrisie.
Une hypocrisie que Frédéric Joyeux n’a justement pas voulu subir, lui qui jusque là s’était surtout familiarisé avec la justice militaire : militant insoumis plus connu sous le nom de « Vaïma », c’est encore pour une « histoire d’insoumission » qu’il est inculpé cette fois en correctionnelle. Le 8 novembre dernier, à l’occasion d’un collage d’affiches dans les couloirs de la RATP invitant à un meeting en faveur des « insoumis amnistiés », il s’était trouvé en butte à de très nombreux policiers. Lesquels ne se priveront pas d’un tabassage en règle, avant de porter plainte pour « violences » (cf. Libération du 11 novembre 1981).
Quand il apprend fin novembre, qu’il est inculpé, Frédéric Joyeux aussitôt décide qu’il se défendra seul. « Parce que l’affaire n’est pas trop grave, reconnait-il, mais surtout pour que ce droit existe dans les faits et que ceux qui le souhaitent puissent enfin s’en servir ».
Pour reconnaitre les chefs d’inculpation retenus contre lui, il va consulter le fichier le concernant au service informatique du Parquet. Qui lui indique également la section chargée de son dossier. Mais là, impossible de consulter même les pièces : le secrétariat ne veut pas en entendre parler et refuse même d’en référer aux responsables du Parquet.
Entre temps, Frédéric Joyeux apprend que pour voir communication des procédures, il faut remplir un « bon de commande » au « bureau d’ordre » du Palais de Justice. Même accueil : il a beau invoquer le droit français, la Convention Européenne, rien n’y fait. Les secrétaires lui renvoient le risque possible de pièces détruites ou dérobées si l’on autorise les accusés à avoir accès à leur dossier. Elles seront finalement démenties par un substitut, M. Lazari, qui invite Frédéric Joyeux à faire une demande de bon de commande, dont il avertira ses supérieurs du Parquet. Huit jours plus tard, la demande est acceptée. Le 11 mai, Frédéric Joyeux consulte les procédures et remplit son bon de commande. Le 14, il reçoit toutes les copies qu’il a demandées. Depuis il prépare sérieusement et tranquillement sa défense…
Publié en 1983 par Frédéric Joyeux, La défense libre au tribunal (Paris, éd. vrac) fait un récit détaillé de la lutte (victorieuse) de l’auteur pour assurer seul sa défense.
LA ROUE DE JUSTICE
(OU LES LUTTES DES JUSTICIABLES POUR ACCÉDER AU DOSSIER)
par Dominique Nocaudie
Juin 1982 : un justiciable de correctionnelle obtient pour la première fois dans l’histoire de la justice française, du moins par la voie officielle, communication de son dossier où sont consignées toutes les pièces de l’accusation.
Frédéric Joyeux a su ainsi trouver les écritures déposées dans la salle des coffres du palais de justice.
Il a su rentrer dans le labyrinthe du palais, aux portes-miroirs et en ressortir. Car la grande caractéristique de ce palais labyrinthe est d’être composé d’enceintes successives (instance, appel, cassation). Chaque enceinte a des portes couvertes de miroirs que l’on peut facilement pousser de l’extérieur, mais desquelles il est quasiment impossible de sortir, car ces portes n’ont pas de poignées de l’intérieur.
Il a pris avec lui le passe-intérieur : un caillou transparent caché dans la poche de son pantalon violet, car il connaît la justice du dedans. Habitué à être passe-muraille face à l’appareil et à la justice militaire, il connait bien le fonctionnement du moulin à illusion : il sait que la roue de justice si elle donne l’illusion de tourner dans un sens, en réalité tourne dans l’autre. Et c’est à cette fin qu’il ouvre sa main dans laquelle est le caillou transparent qui lui sert alors de miroir.
Il a eu maintes et maintes fois l’occasion de dire ou d’écrire aux généraux qui nous gouvernent que l’armée n’a pas pour but primordial de protéger la société des dangers de l’extérieur, mais de ceux de l’intérieur. Et si même l’opinion publique sent bien cette vérité lorsqu’il s’agit de l’armée russe au-delà du rideau de fer, la machine à œillères l’empêche de voir cette vérité en France.
Car ainsi fonctionnent l’homme et la justice : ils n’accusent hystériquement les autres que de leurs propres turpitudes.
Chargée de rendre plus équilibrée la balance pour les exclus du gâteau social, la justice préfère frapper à coups de talon ceux, qui déjà à terre, ont montré une dernière réaction de gourmandise.
Frédéric Joyeux l’a compris. Non-violent roué de coups par le bras de fer des institutions, antimilitariste, il a quasiment de naissance perçu que la justice avait pour but de cacher à tous et à elle-même la violence institutionnelle par l’accusation de ceux qui ne sont pas robotisés.
Dès lors, plutôt que de laisser s’accomplir l’œuvre de la roue de justice, en essayant de combattre l’illusion par l’illusion, il en a simplement repéré le mécanisme et a mis son petit caillou dans l’engrenage.
Ce mécanisme, il le connait bien, et il a pu en apprendre parfaitement le fonctionnement tant par intuition personnelle qu’avec ses amis du CAP, des insoumis et des boutiques de droit.
Et c’est ainsi qu’il a naturellement demandé accès à son dossier lorsqu’il a été cité en correctionnelle. En effet, aussi évident soit le fait que le justiciable puisse avoir accès à son dossier, autant chacun a toléré jusqu’alors qu’il ne l’ait pas.
Toute personne en France peut être l’objet d’une poursuite en correctionnelle, ne serait-ce que pour une simple affaire de voiture. Mais peu ont vu qu’il était important de connaitre les pièces de l’accusation. Sans doute parce qu’ils pensent que la correctionnelle, c’est pour l’autre. Et s’il a la malchance de devenir gibier de correctionnelle, le justiciable croit facilement qu’il a été victime d’une erreur judiciaire. Il apprendra alors plus tard qu’il n’y a pas d’erreur judiciaire puisque le juge est libre, en matière pénale d’estimer coupable quelqu’un parce qu’il le pense coupable : c’est très simple.
Pour le juge, si les faits sont déniés par l’accusé, ça ne peut être que parce que l’accusé ment : de toute manière, il est difficile d’aller à l’encontre de la logique des faits en quelques minutes à l’audience car il se passe la même chose que dans la vie courante : pour les tiers, plus c’est gros plus ça passe. Inversement pour l’inculpé, plus il est étranger aux faits, plus il bafouille.
Sans accès à son dossier, le justiciable est incapable de démonter la logique des faits. Il ne s’agit d’ailleurs pas là du même problème que l’avocat, car celui-ci n’ayant pas vécu les faits ne peut, sauf exception, ou s’il est devin, voir s’il y a contradiction dans les faits.
A cet égard on rappellera qu’en Cour d’assises l’inculpé a depuis longtemps la possibilité d’avoir des copies de son dossier et qu’au début de notre siècle, les justiciables de la correctionnelle de la belle époque avaient demandé accès à leur dossier. Mais la cour de Cassation oubliant la règle d’or d’interprétation du droit en matière de libertés publiques (« tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ») retourne le postulat du théorème de justice en indiquant que tout ce qui n’était pas autorisé par le code de procédure pénale était interdit. Ainsi donc, au nom de cette logique de père fouettard, puisque l’accès au dossier était autorisé à l’inculpé pour les assises, c’était interdit pour la correctionnelle et le tribunal de simple police, puisque l’accès au dossier était autorisé à l’avocat dans ces derniers cas, cela était interdit pour l’inculpé (criminelle, 2 mai 1903).
Cette jurisprudence fut confirmée après la seconde guerre mondiale, les juges n’en ayant pas tiré les conséquences (6 novembre 1952, JCP 1953, II 7357).
Après tout puisque l’opinion publique veut que les petits délinquants soient enfermés en prison immédiatement, pourquoi donner dans la nuance. Ce qui compte, c’est que les « sales gueules » soient derrière les barreaux car même s’ils n’ont pas commis d’infraction, ils ne peuvent qu’avoir l’intention d’en commettre, surtout s’ils sont jeunes, chômeurs et basanés. A quoi bon leur donner un dossier alors qu’ils sont condamnés de naissance ! Comme l’avaient été les juifs, comme le seront les arabes.
Et il a fallu attendre la foulée de l’après 1968, pour qu’un mouvement de justiciables demande l’accès au dossier. Cela n’a d’ailleurs pas été facile, puisque les militants du Comité d’Action des Prisonniers (le CAP), qui ont commencé ce mouvement lassés de se battre contre leurs propres avocats qui recelaient aussi l’information, se sont aussi heurtés à d’autres militants du CAP ne voyant comme solution unique aux problèmes des prisonniers qu’un changement radical au système.
Les militants du CAP voulant porter la lutte dans le sein même de l’institution judiciaire et désirant assumer leur défense eux-mêmes sont devenus militants actifs de la boutique de droit qui venait de se créer à Paris, dans le 19ème, et le travail de fourmis a démarré.
La lutte commencée en 1975 a été longue et n’a nullement été le fruit du hasard.
Et si ces luttes de l’accès au dossier procèdent d’un mouvement tendant à la lutte concrète du justiciable sur le terrain, à la prise en charge par les personnes de leurs propres problèmes, au lieu du discours d’appareil, les quatre luttes symboliques qui ont eu lieu sur ce point – deux femmes, deux hommes – ne peuvent se réduire à cette tendance sociale.
Deux faits s’imposent :
Dans les quatre affaires, les inculpés étaient des justiciables qui n’avaient aucune illusion sur la justice pour en avoir eu une connaissance personnelle intuitive dès leur prime jeunesse.
Dans les quatre affaires aussi, il y a eu un phénomène d’inversion et de miroir, la police qui s’était mise en dehors de la légalité, et avait malmené les inculpés, a, pour se couvrir, accusé les justiciables en cause de rébellion et outrages à agent.
Le premier à avoir demandé son dossier, Jean Lapeyrie, a été élevé dans une cour de préfecture, comme d’autres dans dans une cour de ferme : dès son plus jeune âge, il apprit comment le préfet et le procureur de la république fabriquaient les dossiers, et comment les gendarmes venaient aux ordres. Sans doute Napoléon en écrivant ses codes et en nommant les préfets n’avait-il pas prévu qu’un petit garçon en culottes courtes divulguerait à tous les secrets des rapports du triangle : préfet-police-justice.
Agnès Ouin qui s’est battue sur ce point n’avait pas non plus confiance : elle n’a jamais cru aux mirages d’une société de consommation où son père, ponte dans la construction automobile, était trop bien placé pour qu’elle eut quelques illusions.
Babette Auerbacher, dont les parents juifs ont dû se cacher toute la guerre, dans le fin fond de la campagne française, n’a jamais eu confiance dans la police et la justice de son pays : elle sait de naissance ce que discrimination sociale veut dire et comment elle oriente un dossier.
F. Joyeux, le dernier, est plus énigmatique : son refus viscéral de l’armée, sa non-violence active ne s’explique pas clairement par son milieu familial, même si son père industriel devenu artisan ébéniste, lui a quelque part enseigné la sagesse et le refus du masque. C’est un peu le tintin non-violent de la justice : le tintinmarre policier et l’appareil militaire ont peu de prise sur lui, il leur glisse entre les doigts comme une anguille.
Intransigeants sur les principes, ces militants n’ont par contre aucun respect pour les policiers ou les juges qui foulent les principes au pied. Et c’est bien volontiers qu’à l’audience ils confirment les outrages à agents, lorsqu’ils entendent – avec ravissement – les juges prononcer avec le sérieux de circonstance les mots incriminés.
Cela va de « salopards », à « pions manipulés », en passant par « vieux cons » et « connards ».
Dans la première affaire, Jean Lapeyrie, passant dans le quartier Barbès, voyant des « flics » tabasser un colporteur africain, en bon citoyen, a traité de salopard le flic cognant le plus : l’africain fut laissé tranquille, mais les flics l’embarquèrent.
Dans la seconde, Agnès qui vendait le CAP (Journal du Comité d’Action des Prisonniers) devant une prison, et qui a été interpelée illégalement pour une Xième fois (les militants du CPA étant retenus par la police, ce jusqu’à la fin des visites des familles de prisonniers) a été inculpée d’outrages à agents.
Dans la troisième, Babette, handicapée, qui avait été à deux manifestations, a été accusée d’avoir commis des violences à l’égard de trois flics.
Dans la quatrième, F. Joyeux, nouveau Tarzan, tout seul contre neuf gendarmes, en aurait blessé trois alors qu’il collait des affiches pour une fête d’insoumis.
On comprend dès lors que ces personnes eurent envie d’avoir accès à leur dossier pour connaitre le secret de l’alchimie policière, toujours conduite par la logique de la chaussure du flic abimée par le crâne du manifestant !
Jean jugé à la dix-septième chambre correctionnelle eut accès à son dossier mais seulement à l’audience. Le parquet le lui ayant refusé, il ne put se battre sur ce point car le président Hennion lui accorda au début de l’audience. Cela ne peut donc réellement constituer un précédent.
Quand Agnès demanda accès à son dossier sur la base de l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, le juge Schlexer craqua faisant une colère, et fit semblant de ne pas voir les conclusions déposées par celle-ci.
La cour d’appel ayant confirmé ce jugement, mais sans explosion, car son président lors de l’audience avait agi comme un grand papa gâteau, la cour de cassation rendit un arrêt inapplicable puisqu’elle écrivait que le prévenu voulait se défendre seul et voulait avoir accès à son dossier n’avait qu’à demander à un avocat d’aller le lire et de le lui dire ce qu’il y avait dedans, quitte à se séparer de l’avocat, la course faite.
Le mépris tant du justiciable que de l’avocat, considéré comme coursier, était total et la situation devenait vaudevillesque.
C’est alors que Babette, suivant scrupuleusement l’arrêt de la cour de cassation, demanda à un avocat de lui indiquer le contenu précis de son dossier : comme on pouvait le prévoir, cela se passa mal et elle n’eut pas connaissance de son dossier. Le jour de l’audience, le président ne put, pour limiter la casse, que lire lui-même une partie du dossier.
C’était le blocage jusqu’à l’affaire de F. Joyeux.
Sous la pression de F. Joyeux, le parquet se laissa finalement convaincre, se rendant aussi peut-être compte qu’il n’y avait aucune raison de ne pas permettre au justiciable l’accès à son dossier pénal, alors que par ailleurs de récentes lois permettaient à tout citoyen, d’avoir accès aux décisions administratives le concernant et aux renseignements contenus dans les fichiers informatiques.
C’est un progrès. Le justiciable est enfin considéré comme un adulte.
A terme, cela peut permettre aux justiciables et aux inculpés d’intervenir dans le débat judiciaire. Le premier concerné, le justiciable, s’il prend la parole pourra sortir des deux analyses préfabriquées qui sont toujours le fondement de l’idéologie politico-judiciaire : si on supprime les délinquants, la société n’aura plus de problèmes, si on change la société, il n’y aura plus de délinquance. Ces deux propositions n’étant d’ailleurs que les deux faces d’une même vérité : la mise à l’écart du bouc émissaire source supposée de tous les maux sociaux. Dans la première proposition, la vermine est le pauvre, jeune, chômeur, drogué et voleur, et dans la seconde, le patron bourgeois capitaliste et le contre-révolutionnaire.
Il est dur d’aller à l’encontre d’une mentalité policière toute faite façonnée par l’opinion publique : mais il est dramatique pour l’inculpé de ne pouvoir accéder à son dossier, surtout quand il est isolé de tout contact extérieur par la prison. C’est sans doute une des raisons du chiffre-record des suicides intervenant en détention provisoire.
L’accès au dossier, s’il est généralisé à tous les inculpés, y compris ceux qui sont en détention provisoire pourra peu à peu changer la mentalité judiciaire.
D’abord en améliorant le rapport avocat/justiciable en sortant ce dernier de l’infantilisation dans laquelle il se trouve et des conflits qui en découlent, amenant l’avocat à être la profession la plus mal vue en France par ses utilisateurs, faute de transparence.
Ensuite en permettant à l’inculpé en détention provisoire, de discuter pied à pied avec le juge d’instruction pour demander sa liberté provisoire : si l’inculpé a un avocat, une nouvelle répartition du travail s’en suivra qui permettra à l’avocat de se battre plus efficacement pour le respect du droit.
Pourquoi la justice a-t-elle cédé à F. Joyeux officiellement, après qu’un juge, le président Hennion, eut cédé en 1976 à Jean Lapeyrie, alors que ce sont deux implacables accusateurs de la justice.
F. Joyeux, en mars 1981, a bravé les juges militaires sans cacher un mot de ce qu’il pensait. Jean, lui s’est trouvé engagé, avec le CAP, dans la plupart des luttes judiciaires qui ont défrayé la chronique.
Pourquoi le parquet n’a-t-il pas attendu qu’un gentil justiciable, un notable le demande ?
La réponse est sans doute plus simple qu’il ne parait : Dame Justice est névrosée.
Et comme toute personne humaine dont les œillères grandissantes obscurcissent la vision des faits, elle développera une conduite névrotique « dont l’objet est d’obtenir la reconnaissance par les autres d’une part de son être qu’elle ne tolère plus elle-même », de son refoulé.
Son refoulé, c’est le non-respect de la vraie loi, c’est d’être obligée de condamner des personnes comme Jean, Agnès, Babette et Frédéric qui ont tous agi au nom de lois.
Jean au nom de l’antiracisme, Agnès au nom de la liberté d’information des taulards et de leurs familles, Babette pour le refus de l’exclusion sociale, de la mise en QHS, Frédéric au nom de la non-violence.
Dans chaque cas le dossier de police est auto-accablant : l’irréalité du dossier atteint l’invraissemblance, sauf si l’on remplace le mot police par inculpé et vice-versa.
Il n’est pas vrai que Guignol puisse rosser autant de gendarmes, même si Guignol a des réflexes d’auto-défense efficaces et si son genou réagit normalement au marteau-matraque du médecin-policier agissant dans le cadre d’un contrôle médico-social.
Babette de son fauteuil roulant, aurait agressé trois policiers. F. Joyeux, le chantre de la non-violence, contre neuf gendarmes en aurait blessé trois, Jean aurait sans doute dû dire aux policiers de taper plus fort sur l’africain, Agnès aurait dû s’excuser et vendre des médailles miraculeuses aux familles des taulards.
Les dossiers, la justice ne veut plus les lire. Elle les refoule car ils mettent trop à jour ses propres carences, le renoncement de ses principes de base et sa complaisance envers les institutions dominantes. Refoulant ce défaut, elle se dit comme en amour, prête à jouer le jeu de la vérité en laissant son dossier à son amant justiciable.
Comme toute personne, elle préfère se voir accuser par l’autre de menteuse, car elle peut lui mettre le miroir devant les yeux, plutôt que de s’avouer à elle-même qu’elle se ment en se regardant de l’intérieur, à travers la glace sans tain.
Mais la vérité éclate un jour : le réel amène à l’évolution.
Le refoulé devient réalité dans la vie : le président Hennion, qui n’avait que fauté un peu, en condamnant Jean Lapeyrie à une amende pour avoir réagi à un tabassage raciste mais après lui avoir donné accès au dossier, a vu son laxisme puni. Il a vu la mâchoire de son neveu bien endommagée par la police alors qu’il rentrait un soir chez lui. Contrôle de routine. Ça n’arrive pas qu’aux autres.
Sophocle, il y a déjà très longtemps, l’avait bien repéré : lorsqu’on accuse les autres de ses propres maux, la terrible « diké » veille et frappe cruellement le coupable.
Et si la famille de Madame Clavery, Présidente du Tribunal qui a condamné F. Joyeux, ou de Monsieur Domino, procureur de ce même tribunal, peuvent un jour respirer, c’est parce que les F. Joyeux devenus plus nombreux, auront permis à la société de dénouer les vieilles contradictions encombrant les cerveaux et d’accéder à une nouvelle naissance.
Car F. Joyeux est cohérent, il n’aime pas les armées qu’elles soient de gauche ou de droite. Il se moque de l’opposition patron et salarié. Il travaille avec des amis dans une entreprise auto-gestionnaire qui marche même si elle lui rapporte un salaire modeste. Il se moque de l’opposition locataire-propriétaire. Il se bat pour et avec les occupants-rénovateurs du 19ème – « Squatters » implantant des activités sociales, culturelles et économiques dans des immeubles laissés à l’abandon dans l’attente d’une spéculation (réserve foncière passive dans les rapports des urbanistes). Grâce et avec ce mouvement, il a trouvé un local pour une partie des Polonais de SOLIDARNOSC France que la CFDT ne voulait plus accueillir, cherchant toujours sans concession la troisième voie.
Par cette cohérence, Frédéric Joyeux montre que l’on ne peut agir efficacement sur une question de principe que dans le cadre d’un changement profond de sa personnalité. Il laisse entendre que le combat contre soi-même est dur mais il confirme le mythe.
Car c’est lorsque les luttes des marginaux deviennent conscientes à l’inconscient social endormi que la société évolue. C’est lorsque la bête dans les contes devient prince charmant qu’un nouveau cycle social commence ; mais celui-là n’est pas raconté car il a nom la « routine » qu’un autre héros devra remettre en cause.
DE LA STRATÉGIE JUDICIAIRE
Préface de Michel Foucault à la deuxième édition (1981) de l’ouvrage de Jacques Vergès, suivie d’un entretien.
Dans cet ouvrage, Jacques Vergès dresse une typologie des procès pénaux à partir de deux figures :
- le procès de connivence, où l’accusé et son défenseur acceptent le cadre de la loi qui l’accuse ;
- le procès de rupture, où l’accusé et son défenseur disqualifient la légitimité de la loi et la justice au nom d’une autre légitimité.
Avocat des nationalistes algériens emprisonnés, J. Vergès théorisait leur volonté politique d’être traités comme des belligérants.
Comprendre la justice comme « un monde ni plus ni moins cruel que la guerre ou le commerce », comme « un champ de bataille », en prendre la mesure et l’analyser tel qu’il est, quoi de plus utile en ce temps de réarmement de l’accusation pénale ? La seule réponse à cette politique dont le dernier avatar est la loi sécurité et liberté [9] ne se trouve pas dans des considérations plaintives, mais dans le réarmement de la défense. La loi n’est jamais bonne : il n’y a pas de passé heureux ni d’avenir meilleur ou inquiétant : il y a une défense morte ou vive.
La stratégie judiciaire débouchait, en novembre 1968, sur une vague de répression à l’encontre des militants gauchistes. Quatre ou cinq années s’ouvraient qui pouvaient permettre une mise en application de quelques principes simples, débarrassés de nos a priori moraux ou politiques : elle fut ratée. « Connivence ou rupture » n’a été qu’un slogan. Le passé et le prestige de Vergès faisaient autorité, mais, comme pour mieux écarter ce qu’il disait vraiment, on a tout réduit à des critères de comportements à l’audience. Tonus, agressivité, déclamation, force en gueule représentaient la « rupture » avec un ersatz de Défense collective [10] par l’assemblage de quelques avocats autour des mêmes causes. Mais peut-être les militants, les enjeux, les combats de l’époque n’étaient-ils pas, eux non plus, à la hauteur.
Puis la vente du livre se ralentit, comme s’il était à écarter avec la guerre d’Algérie, au motif d’une expérience trop exceptionnelle, trop radicale. Sa remise en circulation date des années 1976-1977, grâce aux militants du Comité d’action des prisonniers qui, sortant des murs de la prison, s’attaquaient aux procès, aux condamnations et aux peines, et à ceux des Boutiques de droit [11] qui, affrontés à l’injustice quotidienne, savaient que les « pauvres gens » sont perdus s’ils jouent le jeu de la connivence. Dans le marasme de l’après-gauchisme, un front judiciaire s’affirmait de nouveau contre l’accusation quotidienne, centrée sur les « droit commun ». Bon nombre de procès plus ou moins importants ont été menés dans cette optique, que ce soit pour lutter contre une expulsion, contre une inculpation de vols dans un grand magasin ou contre les QHS [12].
Quels sont les traits fondamentaux de cette défense ? D’abord, que tout se décide à partir de l’attitude de l’accusé. Ce n’est pas d’un avocat ou d’un magistrat, fussent-ils de gauche, qu’il faudra attendre une défense de rupture : les avocats et les magistrats militants n’existent pas sur qui on pourrait se reposer. Ensuite, que tout procès recèle un affrontement politique et que la justice est toujours armée pour défendre l’ordre établi. Enfin, que la morale individuelle, la vertu de justice, l’innocence ou la culpabilité d’un homme, son bon droit n’ont qu’un rapport lointain avec un affrontement judiciaire où il est seulement question de société.
Se défendre sur un terrain miné, se référer à une autre morale, à une autre loi, ne pas s’en remettre, ne pas se démettre : voilà ce que Vergès ne cessait de nous dire. Michel Foucault, Jean Lapeyrie, des comités d’action Prison-Justice, responsable du journal Le Cap [13], Dominique Nocaudie, des Boutiques de droit, Christian Revon, du réseau Défense libre [14], parmi d’autres, reprennent contact avec Vergès et lui posent des questions :
D. Nocaudie : Pour quelles raisons, à votre avis les avocats, et les juristes en général, répugnent-ils à la stratégie judiciaire et à la défense de rupture ?
J. Vergès : Ils sont là pour aider à résoudre les conflits sociaux, non pour les exacerber. C’est seulement quand la machine a un raté qu’ils sont amenés à s’interroger un instant sur le sens et la finalité de la loi. Mais, comme ces idolâtres croient ou font semblant de croire au caractère sacré de la justice, l’interrogation ne tarde pas à tourner court.
C. Revon : Pour reprendre le titre de votre introduction, je vous demanderai : « Qui êtes-vous ? Un iconoclaste ? »
J. Verges : En effet, je hais les images toutes faites. Il faut avoir assisté à un interrogatoire récapitulatif à la fin d’une instruction, quand le juge met de l’ordre dans son puzzle, comme un monteur de cinéma devant ses rushes, pour la rendre compréhensible (c’est-à-dire meurtrière) au tribunal (c’est-à-dire à la majorité silencieuse), et bâtit son accusation sur des poncifs, pour sentir à quel point le lieu commun est anthropophage.
J. Lapeyrie : Vous ne croyez pas au bon juge ?
J. Verges : Les bons juges, comme les héros de la presse du cœur, n’existent pas. À moins de dire bon juge comme on dit de Napoléon qu’il était un bon général. De ce point de vue il y a effectivement des juges efficaces, et d’autant plus qu’ils font oublier leur qualité de juges, c’est-à-dire de gardiens de la paix.
M. Foucault : Devant les formes nouvelles de pratiques judiciaires que la loi sécurité et liberté veut imposer, comment, selon vous, peut-on adapter les stratégies de rupture que vous aviez suggérées dans votre livre ?
J. Verges : Au temps de la guerre d’Algérie, beaucoup de magistrats qui protestent aujourd’hui contre le projet sécurité-liberté couvraient la torture. Connaissez-vous un seul procès de torture qui ait abouti ? Et beaucoup de mes confrères portaient en cortège au garde des Sceaux de l’époque une pétition pour réclamer des sanctions contre les avocats du F.L.N. Le texte importe moins que le regard qu’on porte sur lui, ou que la communication avec l’opinion, non pas pétrifiée par un sondage mais évaluée dans son mouvement. Si Isorni [15] a été frappé plus lourdement que moi, ce n’est pas que, des procès du F.L.N. à ceux de l’O.A.S., les textes aient changé ni que son éclat fût plus grave que les miens, c’est que je défendais des vainqueurs et lui des vaincus.
J. Lapeyrie : Ce qui a fait pour nous, prisonniers de droit commun, l’importance de votre livre, c’est la manière dont vous avez rejeté la distinction entre procès politiques et procès de droit commun pour lui substituer celle de connivence et de rupture. Est-ce toujours là votre position ?
J. Vergès : La distinction entre crimes de droit commun et crimes politiques est une distinction dont je me suis toujours méfié, même quand les circonstances faisaient de moi un avocat se consacrant presque exclusivement aux affaires politiques, car elle n’éclaire en rien le déroulement du procès. Elle minore l’importance politique, sociale, morale que peut avoir un crime de droit commun, elle occulte le côté sacrilège du crime politique de quelque importance. Dès qu’il y a sang versé, le crime politique perd son caractère politique et relève de la répression de droit commun.
M. Foucault : Votre livre a été élaboré et écrit dans une conjoncture historique déterminée et, même si dans son projet il débordait largement le cadre de la guerre d’Algérie, cet événement y est encore très présent et commande sans doute une part de vos analyses. Ne pensez-vous pas que le développement pratique d’une nouvelle stratégie judiciaire impliquerait un travail d’analyse et de critique globales du fonctionnement judiciaire actuel et comment pensez-vous que l’on pourrait mener collectivement ce travail ?
J. Vergès : Ce qui distingue la rupture, aujourd’hui, c’est qu’elle n’est plus le fait d’un petit nombre dans des circonstances exceptionnelles, mais d’un grand nombre à travers les mille et un problèmes de la vie quotidienne. Cela implique une critique globale du fonctionnement de la justice et non plus seulement de son aspect pénal comme il y a vingt ans. Cela implique aussi qu’à un collectif fondé sur les règles du centralisme démocratique on substitue un réseau assurant la circulation des expériences et la rencontre des groupes existants, en leur laissant leur autonomie et leur initiative. C’est la tâche que s’est fixée le réseau Défense libre fondé à la Sainte-Baume, le 26 mai 1980.
D. Nocaudie : Aviez-vous imaginé que la technique, la défense de rupture soit appliquée à la défense des droits de la vie quotidienne ?
J. Vergès : Non, mais je m’en réjouis. Cela prouve que la stratégie judiciaire ne m’appartient plus, qu’elle n’est plus seulement l’affaire des gens en robe, mais des gens en jeans.
C. Revon : Le titre de votre conclusion m’amène à vous demander : « Quelle est votre loi ? »
J. Vergès : Ma loi est d’être contre les lois parce qu’elles prétendent arrêter l’histoire, ma morale.
À LIRE, À VOIR
Des défenses libres et des accusés en lutte contre le système judiciaire :
- Pierre Goldman, Souvenirs obscurs d’un juif polonais né en France, Paris, Seuil, 1975.
- Frédéric Joyeux, La défense libre au tribunal, Paris, éd. vrac, 1983. [l’histoire et les documents de lutte du premier justiciable à s’être défendu sans avocat en correctionnel]
- Roland Agret, La Justice à deux doigts près, Paris, Carrière, 1986.
- Serge Livrozet, L’empreinte, éditions La Brèche, 1989.
Du côté des avocats, des juges et des contre-enquêtes :
[parce que c’est toujours intéressant d’aller voir de l’autre-côté…]
- Olivier de Tissot, Sans âme ni conscience, Paris, Balland, 1975.
- Gilles Perrault, Le Pull-over rouge, Paris, Ramsay, 1978. [une contre-enquête exemplaire, qui innocente Christian Ranucci, le dernier guillotiné en France]
- Jacques Vergès, De la stratégie judiciaire, Paris, éd. de Minuit, 1981. [incontournable !]
- André Giresse, Seule la Vérité blesse. L’honneur de déplaire, Paris, Plon, 1987. [président de la cour d’assises de Paris de 1975 à 1985, politiquement infréquentable, il décrit bien le système judiciaire de l’intérieur]
Internet :
- « Stratégie judiciaire », Courant Alternatif, n° 220, mai 2012. [une histoire du mouvement pour la défense libre]
- Action Justice (association de Roland Agret)
Films (fictions et documentaires) :
- Douze hommes en colère, Sidney Lumet, 1957.
- La Vérité, Henri-Georges Clouzot, 1960.
- Du silence et des ombres, Robert Mulligan, 1962.
- Verdict, André Cayatte, 1974.
- Le Verdict, Sidney Lumet, 1982.
- Music Box, Costa-Gavras, 1989.
- La Dixième Chambre, Instants d’audience, Raymond Depardon, 2004.
- Jugez-moi coupable, Sidney Lumet, 2006.
- La Défense Lincoln, Brad Furman, 2011.
***
Contact : soledadetassociees [at] ymail [point] com
[1] Le propos ici n’est pas limité au cas d’un procès pénal (tribunal correction, assises). Par exemple : procédures de divorce, de changement d’état civil, litige autour de la garde d’un enfant, etc.
[2] Il se trouve peut-être des avocats à qui on ne pourrait adresser aucune des charges contenues dans ce texte. Cela importe peu, car ce ne sont pas les individualités qui nous intéressent, mais les avocats en tant que groupe social et leur rôle dans le système judiciaire.
[3] L’Aide Juridictionnelle (AJ) est un système de prise en charge, par l’État des honoraires et des frais de justice (avocat, huissier, etc.) pour les personnes les plus démunies. L’AJ peut être totale ou partielle.
[4] Le Parquet ou Ministère public défend les intérêts de la collectivité nationale : c’est le procureur au Tribunal correctionnel et l’avocat général en Cour d’assises.
[5] L’expression « magistrature assise » désigne les juges et « magistrature debout » le Ministère public (car les procureurs se lèvent quand ils prennent la parole lors des procès, contrairement aux juges).
[6] L’expression fait référence, également, aux luttes des réfractaires au service militaire qui ont eu une place importante dans le mouvement de la défense libre (comme en témoignent plusieurs textes de cette brochure).
[7] Les Tribunaux Permanents des Forces Armées (TPFA), créés en 1965, jugeaient les infractions d’ordre militaire et celles de droit commun commises par des militaires, soit dans le service, soit à l’intérieur d’un établissement militaire. Ils ont été supprimés en 1982 et remplacés par des chambres spécialisées au sein des Tribunaux de Grande Instance (TGI). Les TPFA jugeaient notamment les réfractaires (ou « insoumis ») au service militaire.
[8] Jacques Verges a développé sa stratégie de la défense de rupture lorsqu’il défendait des membres du Front de Libération Nationale pendant la guerre d’Algérie [S&A].
[9] Préparée par le garde des Sceaux Alain Peyrefitte, votée en 1980, elle réforme le Code pénal et le Code de procédure pénale, très critiquée par l’opposition de gauche, qui dénonçait un transfert d’attribution de la justice pénale à la police. Elle fut abrogée en mai 1983 par la gauche.
[10] Nom du collectif d’avocats qui défendit les militants gauchistes après Mai 68.
[11] Permanences juridiques, souvent situées dans des arrière-boutiques de librairies, gratuites ou à un prix modique offrant une défense juridique pour les conflits de la vie quotidienne. L’avocat Christian Revon contribua à leur mise en place.
[12] Dans les prisons, Quartiers à sécurité renforcée, dits « quartiers de haute sécurité », créés en mai 1975.
[13] Journal du Comité d’action des prisonniers, mouvement qui succéda au G.I.P.
[14] Nom d’un mouvement créé en 1980, notamment à l’initiative de Christian Revon, en faveur des gens exclus économiquement ou culturellement d’un accès à la justice. Plusieurs réunions préparatoires, avec les participants à cet entretien, eurent lieu au domicile de M. Foucault, qui rédigea largement la plate-forme des assises du mouvement, les 23-26 mai 1980, à la Sainte-Baume.
[15] Avocat du maréchal Pétain après la guerre, puis des militants en faveur de l’Algérie française et du mouvement terroriste Organisation armée secrète.
)
Photo de couverture de la brochure :
Jonathan Jackson, Ruchell McGee, William Christmas et James McClain sortant, le 7 août 1970, du tribunal du Comté de Marin avec le juge Harold Haley tenu en otage.
Jonathan Jackson, un Black Panther de 17 ans, est d’abord entré dans le tribunal où il a libéré trois détenus qui y comparaissaient. La prise d’otage, réalisée pour obtenir la libération des trois « frères de Soledad » (poursuivis pour le meurtre d’un gardien de prison en représailles de violences et de crimes racistes perpétués à la prison de Soledad), s’est soldée par la mort de Jackson, Christmas et McClain, ainsi que celle du juge.
Angela Davis fut soupçonnée d’avoir aidé à l’opération. Elle fut poursuivie, arrêtée, puis finalement relaxée.
Georges Jackson, frère de Jonathan et l’un des « frères de Soledad », fut assassiné en 1971 à la prison de San Quentin.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.1 Mo)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (1.1 Mo)