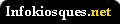R
Réflexions autour d’un tabou : l’infanticide
mis en ligne le 4 juin 2011 - Collectif
Récit
« Je me suis mariée à dix-huit ans. À vingt-et-un ans, j’avais trois enfants. Je me suis dit : "Si ça continue comme ça, à quarante, j’en aurai vingt-trois. Je ne suis pas capable d’élever tous ces enfants et est-ce que je suis capable d’aimer tout ça ?". Et voilà, à partir de là, je cherchais des moyens de ne pas avoir d’enfants...
Mon mari disait que je n’étais pas une bonne épouse, que je ne répondais pas à mes devoirs, que j’étais une emmerdeuse, tout ça parce que je ne voulais pas faire tout ce qu’il voulait, pas seulement sur le plan sexuel d’ailleurs. Je ne voulais pas faire ceci cela, je ne voulais pas garder les enfants tout le temps. J’étais bien obligée parce que lui ne voulait pas les garder. Il fallait bien que je les garde. C’est vrai que c’était quand même assez dur. Quand mon fils aîné avait deux ans, j’attendais le troisième. Ils ont douze et treize mois de différence. Je trouvais que c’était quand même assez rapide.
Alors mes parents m’ont convoquée très solennellement et m’ont dit : "Réfléchis parce que si ton mari te laisse, qu’est-ce que tu vas faire avec tes enfants ?". C’étaient mes enfants, et si mon mari me laissait parce que je n’étais pas plus docile... Je ne savais pas quoi faire pour être plus docile, j’étais comme ça. Il a dit que j’étais malade, donc j’ai dû aller voir un psychiatre. C’était assez loin, on y est allés en voiture et il a fallu que ma mère garde les enfants. Je me suis dit : "Effectivement, si je ne suis pas normale, il faut faire quelque chose, il ne faut pas que mes enfants soient élevés par quelqu’un de cinglé !". J’avais vingt-deux ans et déjà trois enfants et j’avais déjà fait des avortements. Oui, j’avais fini par me dire que je n’étais pas normale. Ma mère me le disait et mon père ne disait rien mais il était indigné. Mon mari ne m’a jamais rien dit, il est allé voir mes parents et on n’en a jamais parlé ensemble après. On ne parlait pas de toute façon. On avait des relations très curieuses. Moi, je n’ai jamais vu mon mari nu. J’avais l’impression d’être un tiroir : toc, on met un enfant et, quand c’est vide, on en remet un autre, et voilà.
Le psychiatre était un monsieur très gentil, un peu âgé qui me tutoyait, il me tapait sur l’épaule... très gentil. On a parlé deux heures et il m’a posé plein de questions, je ne me rappelle plus exactement quoi, mais des questions qui n’avaient rien à voir, me semble-t-il, avec cette situation de fille anormale : si j’aimais faire la cuisine, laver le linge, un tas de trucs. À la fin : "Tu sais quoi, tu rentres chez toi, tu t’occupes de tes enfants si tu veux, et puis tu prends du Calcibronat, un comprimé par jour et puis voilà". C’était une drôle de médication, je suppose que c’était du calcium avec du bromure, peut-être que c’était pas moi qui avais besoin de ça. Je suis rentrée chez moi avec mon mari et les enfants. Et la vie a continué... aussi conne qu’avant ! On n’a jamais parlé de ça après avec mon mari, c’est comme si on n’avait rien fait. Et puis j’aimais rien de ce qu’il aimait, je me foutais éperdument du rugby et du foot, je n’aimais pas trop aller au stade, parce que c’est enquiquinant de passer un dimanche avec les trois enfants qui s’ennuient aussi. Eh bien, c’était pas être une bonne mère ça. Je n’avais pas à avoir de désirs, j’avais tout ce que je pouvais désirer, paraît-il : je mangeais tous les jours, j’avais des enfants qui allaient à l’école. Il ne voulait pas savoir si j’avais d’autres espérances, c’était le moindre de ses soucis.
Quand j’étais enceinte de six ou sept mois, c’est arrivé que je fasse des avortements à cet âge-là, il n’avait même pas vu que j’avais changé ! À l’époque, j’étais quand même assez maigre. Mon mari disait que s’il enlevait son pantalon et le mettait au fond du lit, j’étais enceinte. Je me demandais quelle était cette bête que j’avais dans le ventre... qui aspirait les enfants comme ça, je ne savais pas quoi faire. On disait facilement : "Oh ben celle-là, elle est tout le temps enceinte, qu’est-ce qu’elle doit coucher". Mon anormalité était aussi dans ce sens-là. Ce qui m’effrayait, c’était cette capacité inouïe à chaque fois, enfin pas à chaque fois, parce que quand il y en a un tu ne peux pas en mettre un par-dessus. Mais si ça avait été possible, ce serait arrivé. C’est ça qui est incroyable : cette fertilité ! Si quelque chose me faisait peur, c’était ça, ne pas savoir comment arrêter. C’est terrible. Tu essayes de multiples moyens, tu avales tout ce qu’on te dit, dès que tu entends quelque chose, tu le fais. J’ai avalé des litres d’armoise, j’ai sauté des centaines de murs, d’arbres, j’ai fait de la moto, un tas de choses stupides, des après-midi entiers les pieds dans des bains de moutarde... qui te font rien du tout, ça te lave les pieds quand tu les baignes et voilà. Et puis, à force que l’on me dise : "Comment ça se fait que tu aies des enfants comme ça ?", j’avais honte, vraiment honte d’être encore enceinte. On passe pour une salope, t’es pas normale. Mes trois enfants ont peu de différence entre eux, ça fait trois enfants en deux ans.
La première fois, c’est une femme qui m’a aidée. Ensuite, on a déménagé, je n’avais pas de voiture. Je ne la voyais plus, on n’avait pas le téléphone non plus. L’année d’après, j’ai fait la connaissance d’une femme qui m’a placé une sonde, elle était infirmière et je n’ai pas eu cet enfant-là, ça a été presque une fête. Mais j’ai fait une hémorragie, j’étais en train d’étendre le linge et puis, tout à coup, le sang s’est mis à couler jusqu’à mes pieds. Vite, vite, je monte à l’étage, je mets toutes les couvertures que je trouve, les pieds en l’air et je crie au secours. Le sang coulait par terre. Des gens qui passaient ont appelé le docteur, qui m’a amenée à l’hôpital. Et là je me suis fait engueuler comme tout. L’infirmière m’a dit : "Ça ne se fait pas, si tout le monde faisait comme ça...". Elle m’a fait la morale, si bien qu’après... c’est difficile quand tu es aussi seule que ça. Dans un quartier où il n’y avait que des retraités, à qui veux-tu que je parle ? Il y avait beaucoup de choses à faire à la maison, je finissais mon travail vers onze heures, onze heures et demie le soir, ranger, laver, tout ce qu’il fallait faire quoi, sans machine, sans rien. Et j’allais faire un tour avec le gros chien que l’on avait à l’époque, et c’était un moment, comment dire... tranquille ! Mais ça n’a pas plu aux voisins qui trouvaient ça très mal. Qu’est-ce que foutait une jeune femme à se trimballer dans les rues à minuit, seule ? On l’a dit à mon mari, au boulot. Il fallait que je me tienne mieux. Pourtant, je peux te dire que je n’avais pas envie de rencontrer d’autres gars ! Vraiment pas ! L’année d’après l’hémorragie, c’était de nouveau le même problème et ça devient obsessionnel, on ne sait pas où se mettre. Il y a eu des moments où je ne trouvais pas le moyen d’avorter tôt parce qu’il n’y avait pas de moyens. Il fallait connaître quelqu’un, je n’avais pas d’argent non plus. Moi, j’ai vécu tout ça à l’époque où il n’y avait aucun moyen de contraception connu ou divulgué. On était complètement ignorantes de ce qui se passait dans notre corps, dans notre couple, les choses arrivaient comme ça. C’est comme ça qu’un jour je savais que j’étais enceinte, et que si je n’arrivais pas à le faire plus tôt, j’accoucherais. Et c’est arrivé. Qu’est-ce que tu veux faire dans ce cas-là ? Personne ne sait rien. Ma mère se doutait un peu de quelque chose. Elle est venue me voir une ou deux fois, mais je ne lui ai parlé de rien non plus. Je disais que je n’étais pas enceinte. Je savais que je l’étais mais je ne voulais pas. Et c’est là que commence le déni... pour moi. Je pense que c’est souvent la même chose pour de nombreuses femmes, parce qu’après j’ai entendu beaucoup de récits. Le déni, en fait, c’est que l’on ne veut pas ! Et je crois que ce "on ne veut pas" est aussi fort que le "on veut". C’est exactement la même chose pour moi. Et, si on ne veut pas, on fait tout ce que l’on peut pour que ça n’arrive pas. Du moins pour que les autres imaginent que ce n’est pas ça. Alors, on se serre, on se tient comme on peut, comme ça, penchée sur le dossier de la chaise. Personne ne voit que l’on devient de plus en plus arrondie. Et puis un beau jour, on accouche quand même.
Et donc j’ai accouché. On venait de déménager. Mes enfants étaient dans la cuisine, moi dans la chambre. Il fallait que ça se passe vite pour que personne ne se rende compte de rien et qu’enfin je sois débarrassée de ce problème et de cette horreur. J’ai accouché, j’ai pas vu ce qui se passait, j’ai mis tout ça dans un sac en plastique que j’avais mis sous le lit, j’ai mis tout ça dans l’armoire, sous un tas de serviettes de toilette, puis je suis repartie dans la cuisine... préparer le repas. Et ensuite, quand j’ai été toute seule, j’ai pris ce paquet et je suis allée le mettre dans la campagne quelque part. J’ai vécu ça deux fois et maintenant ça me fait quelque chose de le dire, mais sur le moment, ouf, quel soulagement. Mais j’en parlais pas parce que ça ne se dit pas. Mon mari ne s’est jamais aperçu de rien. Puis je suis tombée enceinte quelques mois après. Là encore, j’ai pu me débrouiller assez tôt mais quelques années après je n’ai pas pu. C’est pas possible de vivre avec cette peur de devoir le refaire. Donc, un jour, j’ai dit à mon mari qu’il se débrouillait comme il voulait mais que je ne voulais plus avoir de relations sexuelles avec lui. J’ai pris mon matelas et je suis allée dans une autre pièce. Ça paraît tout simple mais il tapait à la porte pendant je ne sais combien de temps. Quand je sortais, il me foutait un coup de pied, me poussait la tête contre le mur et les enfants entendaient quand même. Ils étaient là dans la maison.
Je suis restée jusqu’à ce que le plus jeune soit majeur. Donc ça fait une vingtaine d’années. Il y a des moments, de toute façon, tu ne peux pas y échapper, tu te fais coincer et ça aussi, c’est horrible. Parce que tu as beau te fermer, trouver toutes sortes de stratagèmes, à un moment où tu n’y penses pas, tu te fais coincer. Et ça recommence. Et tu te dis : "Je ne sais pas qui est gaga là-dedans". J’avais toujours peur de devoir refaire ça. En tout, j’ai fait neuf avortements dont, j’ai du mal à le dire, deux infanticides. C’est pas évident mais les autres ne me posent pas de problème, et pourtant c’était pas facile du tout. Et puis, des fois, c’est arrivé sans que je ne fasse rien. C’est drôle, parce que ça me fait honte. Pas pour moi, mais que l’on m’ait obligée à vivre ça. Ce qui est terrible aussi, c’est que toi la femme, tu es l’ordure, et ton mari, c’est le gars bien, qui rentre du boulot, qui ne manque pas un seul jour de travail. Mais en fait personne ne sait rien.
Il faut que ce soit connu et pas laissé comme une tache sur la vie des femmes. Quand tu es dans cette vie-là, tu ne penses pas qu’il y en ait d’autres comme toi. Tu penses à toi, à ta peau, tu essaies de te protéger. Je pense que la solitude a à voir là-dedans. Parce que quand tu essayes de parler de ce problème, aussitôt, tu vois une réaction. Bon, tu la fermes. Ça t’isole vraiment, c’est la grande solitude. Plus tard, j’ai vu et entendu d’autres femmes qui ont vécu ça. C’était la terreur pour elles, peur de la société, de la famille. C’est hallucinant que l’on puisse être mariée et accoucher sans que l’on n’en parle jamais. Ce n’est pas un truc anodin quand même. C’est une situation inhumaine, mais au moment où tu le fais, c’est ta seule solution. Enfin, t’es débarrassée. Quand tu lis une histoire comme ça qui est arrivée à quelqu’un, eh bien, tu ne trouves pas ça normal ! Et quand il s’agit de toi, au moment où ça se passe, c’est une fin. Enfin, le problème est réglé. Et ça, je trouve que c’est horrible. Oui, je trouve horrible d’avoir à faire ça. Et je sais que je ne suis pas la seule à le vivre. C’est ça aussi qui est terrible. Eh bien, ça existe toujours. »
Témoignage recueilli en 2006
Point de départ : essai de décorsetage
Nous sommes huit femmes à avoir décidé d’écrire et de publier cette brochure. Huit femmes de vingt-huit à soixante-quatorze ans. Certaines d’entre nous ont des enfants, d’autres pas. Ce qui nous a rassemblées et qui nous rassemble, ce n’est pas le fait d’être mère ou pas, mais le fait d’être, parce que femmes dans cette société, toutes traversées par les questions de maternité. Ce qui nous rassemble, c’est aussi que nous n’aimons pas ce monde tel qu’il est et que nous voulons agir contre toutes les dominations et les oppressions, et donc entre autres contre le patriarcat.
Au départ de notre envie de réfléchir collectivement, il y a l’histoire d’une femme jetée en prison pour infanticide. Cela nous touche et nous interroge. Nous révolte aussi, quand la presse se déchaîne en présentant les femmes infanticides comme des monstres, au mieux comme des malades.
Alors nous cherchons des réponses. Et les seules que nous trouvons proviennent des psychiatres et des magistrats. Réponses partielles et insatisfaisantes, explications d’experts qui décortiquent des « cas », parfois avec bienveillance ou indulgence mais toujours du haut de leur savoir et de leur position sociale.
Or nous sommes de celles qui pensent qu’il ne faut pas laisser aux spécialistes le monopole de la réflexion et de la parole sur les sujets qui nous concernent directement. Et nous voulons exprimer ici que l’infanticide fait partie de notre histoire à toutes et à tous. C’est cette position qui nous a amenées à rechercher des approches et des discours moins normatifs, et nous a conduites à une rencontre décisive. Cette rencontre a déclenché notre envie de porter une parole publique exprimant notre solidarité et notre révolte contre le sort fait aux femmes qui vivent cette violence et cette solitude.
Cette parole, nous l’avons construite avec des questions : qu’est-ce qui contraint aujourd’hui les femmes à vivre un infanticide ? Pourquoi est-ce aussi profondément réprouvé ? Pourquoi y a-t-il encore des femmes en détresse face à une grossesse non prévue ? Quelle est la place des hommes dans ces cas-là ? Quels sont les « bons » et les « mauvais » moyens d’éviter une naissance ? Qui y a accès ? C’est quoi une « bonne » mère ? C’est quoi une « mauvaise » mère ? C’est quoi une « mère » ? Qui décide et comment de ce qui est hors la loi et condamnable en matière de reproduction ? Et bien d’autres questions encore qui sont apparues au cours de ce travail.
Nous avons cherché un terme pour remplacer le mot infanticide, lourdement et juridiquement connoté. Un terme qui définirait mieux ce dont nous voulions parler. Le néologisme « néo-naticide » nous a paru tout aussi lourd. Il y eut aussi « avortement différé », « avortement à neuf mois »… Des périphrases encore… Alors tant pis, on parlera d’infanticide dans ces textes, mais on tentera de redéfinir ce que l’on entend par là, et surtout on tentera de parler de la maternité autrement. En rappelant que vouloir ou ne pas vouloir d’enfant est une question non pas naturelle mais sociale, et qu’il n’est pas plus biologique d’en avoir que de ne pas en avoir.
Nous avons eu beaucoup de débats, de discussions, de confrontations. Nous avons connu beaucoup de doutes. Nous en avons encore. Nous n’avons pas fait un travail d’enquête en partant à la chasse aux témoignages ou en épluchant les statistiques (d’ailleurs inexistantes sur ce sujet). Nous avons creusé certaines pistes, pas toutes, choisissant au gré de nos débats et de nos doutes ce qui nous questionnait et qui nous importait le plus. Nous n’avons ni la prétention d’être exhaustives sur le sujet, ni même celle d’avoir épuisé les thèmes que nous avons abordés. Les textes qui suivent peuvent se lire de façon autonome dans un ordre ou dans un autre.
Nous avons voulu ici retranscrire nos réflexions, nos expériences communes et individuelles, dans le but de briser un tabou qui pèse lourdement dans l’histoire et la mémoire des femmes. Nous souhaitons créer les conditions pour que les femmes confrontées à des grossesses non désirées, contraintes à des infanticides, aient la possibilité de parler, d’être entendues. Pour que leur souffrance ne soit plus ignorée et qu’un débat soit porté sur la place publique. C’est dans cette volonté de rendre visible l’invisible que nous sommes, et c’est en ce sens que nous nous inscrivons dans la continuité des luttes des femmes : sortir du secret et du privé et rendre public ce qui fait notre oppression pour pouvoir nous en débarrasser. Et au cœur de cette oppression il y a l’interdiction de choisir in fine de ne pas avoir les enfants dont nous ne voulons pas.
Par cette réflexion, nous voulons questionner la société qui amène des femmes à pratiquer des infanticides, avoir une lecture sociale ou politique et non pas psy ou judiciaire... Notre parti pris est d’être contre la culpabilisation des femmes, contre la prison, contre notre déresponsabilisation. Nous ne sommes ni coupables, ni malades, ni victimes. Notre propos part de notre subjectivité, il est partiel mais, nous l’espérons, partageable avec les femmes et entendable par les hommes.
Infanticide, un terme lourd de sens
Voici comment le dictionnaire Petit Robert définit l’adjectif infanticide : « Qui tue volontairement un enfant et spécialement un nouveau-né. Ex. : une mère infanticide ». Dans ce que l’on appelle le « sens commun », c’est-à-dire ce bric-à-brac d’idées reçues qui alimente les conversations et constitue le fonds de commerce des médias, le terme infanticide renvoie à l’idée de mère, de « mauvaise » mère. Et les dictionnaires viennent, à coups d’exemples choisis, relayer cette pensée dominante. Nous voudrions proposer un autre regard et un autre angle d’approche de la réalité de l’infanticide, en mettant en évidence les connotations morales qui sous-tendent une définition présentée comme neutre.
Historiquement, le mot infanticide apparaît quand l’acte devient juridiquement condamnable. Ce n’est pas un hasard si cela correspond au moment où les déclarations de grossesse et d’accouchement deviennent obligatoires : l’État du début de la Renaissance cherche à contrôler sa population, et donc à surveiller ce que les femmes font de ces futurs sujets que sont les enfants à naître. Infanticide est un mot qui a aujourd’hui disparu du code pénal. Les femmes sont maintenant accusées de « meurtre sur mineur de moins de quinze ans ». L’élimination d’un nouveau-né est ainsi assimilée en termes législatifs au meurtre de n’importe quel enfant jusqu’à quinze ans. En faisant disparaître la spécificité de l’acte, la loi nie l’inégalité bien réelle entre les hommes et les femmes dans le rapport aux enfants et prétend ignorer que les contraintes obligeant les femmes à avoir recours à l’infanticide existent toujours.
Mais, malgré la volonté de neutralité et de « lissage » du législateur, le mot réapparaît dans les jurisprudences et n’a jamais quitté les colonnes des journaux. Pourquoi ? Parce qu’il met l’accent moins sur un acte (l’horrible « meurtre » dont parle le code pénal) que sur une relation (la filiation) et un statut (celui de mère) qui sont bien spécifiques. Non seulement ce terme évoque quasi exclusivement l’image de la mère, mais il définit aussi comme mères des femmes qui précisément commettent cet acte pour ne pas l’être. Ces « mères » infanticides sont contraintes à être qualifiées par ce qu’elles n’ont pas voulu : être mères à ce moment-là. Les comptes-rendus des journaux à propos des enquêtes ou des procès d’infanticides décrivent les femmes concernées comme des monstres, des folles, ou les deux, à la fois coupables et victimes. La question des contraintes sociales qui obligent les femmes à se débrouiller seules avec la fécondité en est absente. Si ces faits divers provoquent une telle émotion, c’est parce qu’ils concernent des nouveau-nés, êtres sans défense en même temps que promesses d’avenir, et des femmes, qui ont en charge la perpétuation de l’espèce.
Dans la société française actuelle, nous devons composer avec deux réalités imbriquées : celle de la permanence des contraintes biologiques et celle des techniques qui évoluent continuellement. Quoi qu’il arrive, la gestation humaine dure toujours neuf mois, et le nourrisson humain est le moins autonome des bébés mammifères. Il n’est pas viable à la naissance si d’autres êtres humains ne sont pas disposés à en prendre soin. En même temps, les évolutions techniques et les progrès en matière de médecine fœtale conditionnent notre rapport à la vie : aujourd’hui, un fœtus est viable beaucoup plus tôt et les techniques d’examen prénatal donnent très vite corps au projet d’enfant dans les têtes des futurs parents et de leurs proches.
L’infanticide touche au sacré, au mythe. Il remet en cause le statut sacré de l’enfant et le rôle sacré de la mère qui donne la vie. C’est pourquoi il est tabou. Les femmes sont ainsi contraintes au silence à la fois par la menace d’une lourde condamnation et par la réprobation morale de toute la société, y compris elles-mêmes. Pourtant, comme pour le viol ou l’inceste, dès qu’on ose aborder cette question, on s’aperçoit que l’on est nombreuses à ne pas se satisfaire des discours convenus – fussent-ils compréhensifs ou même compatissants –, à se sentir interrogées, interpellées, concernées par ce qui n’est pas qu’une sordide histoire individuelle mais surtout une révoltante histoire collective.
Il est bien évident que, pour les femmes qui le vivent, un avortement à neuf mois n’est pas le même qu’à trois mois. Une fois cela dit, ce qui nous intéresse ici, c’est notre situation commune face à des grossesses non désirées. C’est du point de vue des femmes, de notre point de vue, que nous voulons élaborer une définition de l’infanticide. Voici donc quelques tentatives de définition :
- « acte par lequel une femme fait disparaître le produit d’une grossesse non désirée arrivée à terme » ;
- « situation dans laquelle se trouve une femme déterminée à ne pas donner suite à une grossesse non désirée arrivée à terme » ;
- « attitude qui traduit la détermination d’une femme à faire disparaître le produit d’une grossesse non désirée arrivée à terme ».
Comme n’importe quelle définition, les nôtres sont froides, et c’est volontaire. Au moins sont-elles exemptes de tout jugement moral, et chaque mot y est pesé. Elles ne rendent évidemment pas compte des mois et des semaines de solitude, de trouille, à se débrouiller comme on peut, seule, pour se débarrasser du fœtus. Elles ne rendent pas compte de cette violence vécue, une de celles liées à la domination, ni du fait que c’est la femme toute seule qui prend en charge le problème, hors contrôle, hors cadre légal, faute d’autres moyens d’aide (qui n’ont pas fonctionné, n’ont pas été utilisés, ou n’existent pas). Si des femmes ont encore aujourd’hui recours à l’infanticide, c’est qu’aucune autre solution n’a pu être mise en place en amont pour éviter l’arrivée d’un enfant qu’elles ne peuvent pas avoir. Le monde qui les a isolées va ensuite les juger et les condamner.
Pour finir, rappelons-nous qu’une femme n’est infanticide que si son acte est exposé au grand jour par une mise en accusation, les autres ne seront pas mères cette fois-là.
Déni de grossesse
Dans le brouhaha médiatique autour des affaires d’infanticide, il est souvent question du déni de grossesse. Pourquoi ? Qu’entend-on par là ? À quoi cela sert-il ?
La notion de déni est d’origine psychanalytique. Elle nomme « le refus de reconnaître une réalité traumatisante pour le sujet », nous dit Le Petit Robert de 1996. Elle est utilisée pour désigner la situation où une femme découvre soudain qu’elle est enceinte, après un temps plus ou moins long où elle ne le savait pas, temps qui peut d’ailleurs aller jusqu’au terme de la grossesse. Elle peut être notamment convoquée à décharge pour expliquer face à la justice le geste d’une femme accusée d’infanticide. Pour la défense, il s’agira d’expliquer qu’on ne peut parler de crime pour une femme qui ne sait même pas qu’elle porte un enfant et qui se tord de douleur sans savoir que c’est un accouchement qu’elle vit.
Il semble en effet que ce soit une des seules explications recevables par la justice, les médias et l’opinion publique pour comprendre un infanticide. Il est très risqué de dire face à un tribunal et face à la société entière, quand on est culpabilisée et traînée dans la boue, qu’on a caché sa grossesse jusqu’à son terme, qu’on ne voulait pas de cet enfant-là. La pression sociale est tellement forte qu’on peut même être amenée à dire qu’on l’aurait bien gardé, cet enfant que tout un processus pénal et social fait soudain exister.
Il n’y a pas forcément de lien de cause à effet entre déni de grossesse et infanticide. Des femmes découvrent qu’elles sont enceintes au moment de l’accouchement et se débarrassent du produit de la grossesse. Des femmes acceptent de garder l’enfant qui naît au terme d’un déni, qu’elles s’accommodent de cette naissance ou qu’elles s’en réjouissent. Et des infanticides ont lieu sans déni, pratiqués par des femmes qui ont bien conscience de leur grossesse et ne veulent pas d’enfant.Ce que sous-entend le déni de grossesse, qu’on le considère comme une pathologie ou comme un moyen de défense face à une réalité qui ne nous convient pas, c’est qu’il n’est pas « normal » de ne pas savoir que l’on est enceinte. Bien des symptômes de la grossesse peuvent pourtant se confondre avec des maladies diverses et il existe des raisons objectives, logiques, de ne pas savoir. Les médecins eux-mêmes peuvent s’y tromper, tant les signes sont équivoques : on peut ne pas avoir ses règles et ne pas être enceinte ; on peut être enceinte et avoir encore des règles ; maux de ventre et nausées ne sont pas des symptômes spécifiques à la grossesse.
Il existerait une façon « normale » d’être enceinte qui est de le savoir, de l’accepter et d’en être heureuse. Tout le reste peut apparaître comme déviant et/ou nécessitant des soins. Et, effectivement, ne pas être conforme à ce qui est attendu peut produire des maux profonds.
Ce qui est en jeu dans l’explication par le déni, c’est de nous ramener à la fatalité biologique attachée à notre destin de femme. Assignation qu’il nous faudrait assumer, accepter coûte que coûte et que les psys se chargent bien de nous rappeler.
Un enfant, c’est quoi ?
On parle d’infanticide, terme qui évoque l’acte de tuer un enfant. Or, s’agit-il vraiment de cela ? Un enfant, c’est quoi ? C’est quand ?
La réponse ne peut être trouvée dans un stade d’évolution biologique du fœtus, il n’y a pas de moment « naturel » à partir duquel on peut parler d’un enfant.
Si l’on regarde les délais légaux d’avortement dans les pays qui l’autorisent (quatorze semaines en France, vingt-huit semaines à Barcelone dans certaines cliniques en payant cher, pas de délai au Québec), par exemple, il est clair qu’ils correspondent à un arbitrage social propre à chaque pays. Chaque société décide du moment à partir duquel l’avortement n’est plus acceptable et devient un acte répréhensible puisqu’il ôte la vie d’un enfant.
Le statut de l’enfant, la « valeur » de sa vie, est une construction sociale. Dans le haut Moyen Âge, on s’appuyait sur la date d’introduction de l’âme dans le corps du fœtus (qui était de quarante jours pour les garçons et de quatre-vingts pour les filles !). Aujourd’hui, ce n’est plus l’introduction de l’âme, mais la viabilité du fœtus de plus en plus tôt grâce aux progrès médicaux qui sert de base à ceux qui veulent créer un statut juridique pour l’embryon. La science se superpose à la religion. Contrairement à ce que l’on voudrait nous faire croire, c’est tout aussi arbitraire.
En d’autres temps ou dans d’autres sociétés, l’enfant n’a pas d’existence pleine, même après la naissance : dans certaines civilisations, il faut attendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour donner un prénom au nouveau-né ; dans d’autres, le bébé n’est visible par d’autres personnes que ses parents qu’au bout de quelques semaines, son existence sociale ne démarre ainsi que quelque temps après sa naissance ; chez les Romains, le père avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants bien après leur naissance.
Or, de ce point de vue, si les luttes des femmes ont permis certaines avancées (contraception, avortement), on assiste dans le même temps à un mouvement de sacralisation de l’enfant à naître qui va de pair avec la place grandissante de l’enfant dans les sociétés occidentales. Les projections sur des enfants aujourd’hui moins nombreux et le plus souvent « choisis » sont importantes et pèsent sur les mères qui les portent et les fabriquent. Elles sont d’ordre individuel mais aussi social : l’enfant « rare » ne peut décevoir, il représente un enjeu de survie de l’espèce mais aussi de reproduction des identités, de sauvegarde du patrimoine culturel (Pourquoi donne-t-on tant d’importance au taux de fécondité des femmes françaises et contrôle-t-on autant l’entrée des enfants venus d’ailleurs ?), il est aussi un enjeu économique…
Cette place donnée à l’enfant explique le jugement que notre société porte sur l’acte appelé infanticide et sur celles d’entre nous qui y sont contraintes.
Un enfant n’existe que quand il y a projet d’enfant, que quand la femme qui le porte le fait exister comme tel, donc dès les premières minutes si on le désire. Dans l’espèce humaine, on naît d’un acte biologique et d’une reconnaissance (on dit bien « concevoir » un enfant). Quand on ne veut pas d’un enfant, quand on ne l’attend pas, c’est un problème, une galère, une catastrophe mais pas un enfant. La femme n’est alors pas mère, elle ne tue pas un enfant, elle règle un problème.
Jugement médiatique
Les « affaires » d’infanticide sont rendues publiques à la suite de découvertes fortuites, de dénonciations qui enclenchent une instruction judiciaire. Comme pour tous les faits divers, la médiatisation porte sur le traitement judiciaire. Les journalistes tirent leurs informations de la police, qui a procédé à l’arrestation et découvert l’objet du délit. Ce moment est fortement médiatisé, avec des photos du lieu, des personnes proches, du village et son église, des micro-trottoirs de passants, de voisins, permettant l’élaboration d’un discours jouant sur le sensationnel.
Le traitement médiatique est essentiellement basé sur un jugement moral qui fait que la condamnation est évidente, qu’une punition est nécessaire.
Les médias, avec la police et la justice, contribuent à créer un enfant qui n’a jamais existé et, de la découverte d’un fœtus mort, ils font un crime, de la femme une criminelle. D’ailleurs, ils nomment cette femme « mère infanticide », lui assignant une maternité qu’elle a refusée dans ce cas, et que cette femme ait ou non des enfants, elle sera toujours qualifiée par la justice et les médias de « mère ».
Tous les clichés sont à l’œuvre pour parler d’une femme criminelle car elle est avant tout « femme » et on la juge en premier lieu en fonction de la norme du rôle féminin, en particulier comme mère potentielle. Les femmes accusées d’infanticide sont décrites comme des monstres, d’autant plus si elles ont des enfants, car une mère exemplaire ne peut pas tuer des enfants, selon le rôle monolithique et figé de la bonne mère. Le vocabulaire journalistique use à loisir du terme « enfant », citant parfois même un prénom, ou transformant le mot de fœtus utilisé par un témoin par celui de « bébé ». « Qui sont ces mères qui tuent leur enfant ? », a-t-on pu lire à la une d’un journal. Alors qu’il n’y a pas d’enfant, et donc pas de mère, on leur renvoie ce qu’elles n’ont pas voulu être et ce qu’elles ne sont pas puisqu’il n’y a aucun enfant ! Tous les articles sans exception reprennent à l’envi ces dénominations : « La mère des bébés a évoqué… », « La mère de famille a avoué », « Prison ferme pour mère infanticide », « Le mystère de la mère infanticide »…
Quand il s’agit du déni de grossesse invoqué pour la défense juridique de certaines femmes, le regard sur les femmes accusées est différencié selon la classe sociale. On a pu lire : « Pourquoi des femmes éduquées, actives, ne peuvent-elles voir qu’elles sont enceintes ? ». Doit-on comprendre que des femmes non éduquées, au chômage, peuvent ne pas réaliser qu’elles sont enceintes mais que, pour des bourgeoises épargnées par ces difficultés sociales, cela ne se conçoit pas ? Tout comme, pour une mère ayant déjà un ou plusieurs enfants, le refus d’une grossesse par déni ou par infanticide n’est pas admissible.
Les articles de presse traitent rarement des hommes, relayant sans commentaires leur déclaration d’ignorance de la situation. Lorsqu’il s’agit d’hommes de milieux considérés comme « arriérés » ou « barbares », ils sont plus volontiers considérés comme complices ou au moins mis sous les feux de la rampe. Un journal évoquait en novembre 2008 « le père qui l’aurait égorgée s’il avait appris qu’elle était enceinte, toute la famille dans le petit appartement qui n’a pas remarqué, rien vu … » : cela se passe en banlieue et les parents, les deux sœurs et les trois frères devront répondre à l’enquête et témoigner devant la cour d’assises.
L’évocation publique et médiatique de l’infanticide pourrait-elle contribuer d’une certaine manière à lever le tabou ? On ne peut plus dire qu’on ne savait pas, on sait maintenant qu’il y a des femmes qui vivent cela. Mais cette façon de le mettre sur la place publique alimente au contraire le tabou et ne rend en rien compte de la réalité de nos vécus face à nos grossesses non désirées. Avant tout, les médias créent et exploitent le spectacle de nos souffrances.
La loterie pénale
Les « femmes infanticides », déjà sous le rouleau compresseur judiciaire, se retrouvent aussi face à l’opprobre de l’opinion publique alimentée par le traitement médiatique. Dans ce contexte, l’enquête va s’attacher à savoir quel genre de mères, si elles l’étaient déjà, et de compagnes elles pouvaient être, s’il y a eu des complices, si le nouveau-né était vivant ou pas. La vie de ces femmes est scrutée sous le microscope judiciaro-policier et une pléiade d’experts (psychiatres, médecins légistes) viendra isoler les éléments qui pourront annuler, atténuer ou aggraver la notion de meurtre lors du procès. La situation familiale, la classe sociale, l’état mental entreront aussi en jeu au moment du verdict.
Dans la plupart de ces procès, la ligne de défense est le déni de grossesse : les femmes, comme leur entourage, ont été surprises par l’arrivée de ce nouveau-né qu’elles n’attendaient pas. L ’ « état de sidération » dans lequel se trouvent ces femmes au moment de l’accouchement les rend donc irresponsables de leurs actes. Mais il subsistera à leur encontre une suspicion de dissimulation les présentant comme manipulatrices. De là à parler de préméditation, il n’y a qu’un pas que la justice franchit souvent pour réfuter l’existence du déni.
Une autre question importante : y a-t-il eu volonté de donner la mort ? L’enjeu est de taille. Le code pénal punit l’homicide d’une peine de trente ans de réclusion. Le fait qu’il soit commis sur un mineur de moins de quinze ans et le fait qu’il soit commis par un ascendant sont deux circonstances aggravantes qui peuvent valoir la réclusion à perpétuité. Les « femmes infanticides » cumulent ces deux circonstances aggravantes. S’il est prouvé qu’il n’y a pas eu volonté de donner la mort, les femmes pourront être, dans certains cas, condamnées pour absence de soins.
Il est surprenant de constater la disparité des peines : acquittement, mise à l’épreuve ou réclusion de cinq à quinze ans, alors que la ligne de défense est sensiblement la même au cours de ces procès. La lourdeur des peines va dépendre, en partie, de la capacité des juges, des procureurs et des jurés à comprendre ce qu’est le déni de grossesse, à se défaire de leurs présupposés sur la grossesse en général voulant qu’une femme sache qu’elle est enceinte et que ce soit visible. Ils doivent ainsi admettre que l’arrivée d’un enfant n’est pas nécessairement un cadeau et peut être vécue comme une violence. Il sera toujours reproché aux accusées de ne pas avoir pris les choses en main à temps. Il est très difficile d’adopter une autre ligne de défense que celle du déni de grossesse. Comment, en effet, faire admettre que cette grossesse non voulue n’a pas été arrêtée à temps et que l’arrivée d’un enfant était inconcevable sans que la justice, les médias et l’opinion publique ne revêtent ces femmes d’un costume de monstre ?
C’est avec ce costume cousu main qu’elles arrivent en prison. En détention, les deux tiers des femmes ont des enfants dont elles sont le plus souvent séparées. La maternité est au centre des préoccupations et des conversations. Elle permet de garder un statut quand l’incarcération nie socialement les individus et elle constitue une base commune entre les détenues, voire avec les matonnes.
Il serait naïf de croire que le secret concernant les dossiers est respecté. Les matonnes ont vite fait de signaler la présence d’une « infanticide ». Celle-ci est appelée « pointeuse », au même titre que les violeurs sont appelés « pointeurs ». Elle est, la plupart du temps, isolée, voire maltraitée, par les détenues et le personnel pénitentiaire. Elle se voit donc doublement condamnée, par la justice et par ses pairs, puisque doublement coupable : d’un délit contre la loi et d’un délit contre l’ordre moral.
Il était une fois une histoire de lois
Il nous a paru important de relever comment la société a légiféré au fil des siècles sur le ventre des femmes selon le contexte social, économique, politique, moral et religieux.
Il s’agit ici de recenser les évolutions des diverses réglementations concernant la grossesse. Cela apparaît comme une évidence – mais il nous semble bon de le rappeler –, la loi est une photographie des rapports de force en présence dans la société. Donc, quand il s’agit de légiférer sur la procréation, la constante est la domination patriarcale. Selon les époques, les législations seront un peu plus ou un peu moins répressives envers les femmes suspectées d’infanticide.Définition juridique de l’infanticide
Le premier texte de loi écrit à ce sujet dans l’État moderne français est l’édit de 1556 promulgué par Henri II. Il rend la déclaration de grossesse obligatoire et inflige la peine de mort à la mère en cas de décès d’un nouveau-né non baptisé. En 1791, dans le contexte révolutionnaire, le premier code pénal est voté. Il supprime toute référence à la morale religieuse et fait disparaître du droit la notion d’infanticide.
Le crime d’infanticide réapparaît en 1810 dans le code pénal promulgué sous le règne de Napoléon (articles 300 et 302). Le coupable, au même titre que l’assassin, l’empoisonneur ou le parricide, encourt la condamnation à mort. Pour être qualifié d’infanticide, le crime doit être commis sur un nouveau-né, sans que soit précisée la différence entre un nouveau-né et un enfant. C’est en 1835 que ce point est précisé par un arrêt de la cour de cassation : il y a infanticide tant que le nouveau-né n’a pas été déclaré à l’état civil, c’est-à-dire dans le délai légal de trois jours après sa naissance (article 55 du code civil). Au-delà de ce délai, il n’y a plus « infanticide » mais « meurtre ».
Un siècle et demi plus tard, le 1er mars 1994, une modification du code pénal abroge les articles relatifs à l’infanticide. Cet acte est désormais qualifié de « meurtre sur mineur de moins de quinze ans ». S’y ajoute une circonstance aggravante dans le fait que l’« auteur » soit un ascendant direct. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité (depuis 1994, aucune femme n’a été condamnée à cette peine).
L’infanticide perd ainsi sa spécificité, et les femmes accusées de ce crime sont jugées comme toute autre personne, homme ou femme, accusée de crime sur mineur. Subsiste cependant dans cette loi, au détour d’un article relatif aux circonstances du crime, l’expression de « mère infanticide ».Morale, justice, jurys populaires
Quelle que soit l’époque, les jurys populaires des cours d’assises seront pour la plupart réticents à envoyer les femmes à l’échafaud. Pour contrer cette « clémence », au cours des siècles, le législateur va s’ingénier à faire évoluer les peines encourues pour obtenir malgré tout condamnation. Ainsi, en 1824, il prévoit, dans les cas où les circonstances atténuantes sont retenues, non plus la peine de mort mais celle des travaux forcés à perpétuité. Cette peine paraît encore trop lourde aux jurés populaires, qui rechignent à la prononcer. En 1832, le code pénal est à nouveau modifié, ce ne sont plus les travaux forcés à perpétuité que les femmes encourent, mais les travaux forcés, pour une durée déterminée.
À partir de 1863, le jugement est déplacé de la cour d’assises vers le tribunal correctionnel s’il n’y a aucune preuve que le nouveau-né a vécu. La femme n’est alors plus accusée de crime, mais de délit de « suppression d’enfant ». Elle sera jugée uniquement par des magistrats et non plus par un jury populaire. En tant que professionnels, ils se doivent d’appliquer la loi qui prévoit une peine allant jusqu’à cinq ans de prison.Si, jusqu’en 1900, les femmes sont rarement jugées coupables, donc la plupart du temps acquittées, c’est que l’infanticide n’est à l’époque pas pensable comme crime prémédité. Ce sont des « circonstances extraordinaires » qui poussent ces « femmes victimes » à cet acte inimaginable. Pour reconnaître cette circonstance particulière, la loi du 21 novembre 1901 impose que la distinction soit faite dans les affaires d’assassinat d’enfants entre les cas de « tiers » poursuivis pour meurtre et assassinat, et ceux poursuivis pour « infanticide ». Ces dernières peuvent valoir une peine de travaux forcés, modulée selon que la préméditation est ou non reconnue.
Après la seconde guerre mondiale, dans un contexte où il faut reconstruire et repeupler le pays, la loi de 1954 est votée, qui prévoit une peine unique pour infanticide allant de dix à vingt ans de réclusion.
Évolution des mœurs dans la société et pénalisation de l’avortement
Vers 1875, la société connaît une chute démographique qui découle des transformations socio-économiques de l’époque : la pauvreté, mais aussi l’espoir d’une possible ascension sociale, font que les familles sont moins nombreuses ; les classes fortunées limitent leur descendance pour éviter la dispersion de leurs biens ; la surmortalité infantile devient inacceptable ; les méthodes contraceptives commencent à se propager (méthode Ogino, diaphragme, préservatif).
La démographie devient un outil politique de gestion du pays. Les néo-malthusiens prônent la réduction des naissances pour lutter contre la pauvreté mais aussi contre le capitalisme (réduction de la main-d’œuvre bon marché), contre les guerres (moins de soldats) et pour « libérer la femme de maternités successives qui nuisent à son émancipation ».
À l’encontre de ces thèses, les ligues natalistes incitent à une augmentation de la natalité « au nom de la paix sociale, de l’intérêt national, et de la protection de la race » : la concurrence pour l’emploi entre les familles nombreuses ouvrières les rend plus dociles ; il faut de nombreux soldats pour la guerre ; l’immigration issue des colonies représente un danger pour l’identité nationale.
L’État choisit le camp des natalistes et octroie en 1902 une prime à la naissance qui est pour le garçon le double de celle de la fille (vingt francs contre dix). La guerre de 1914 renforce cette position. Les thèses néo-malthusiennes sont considérées comme une trahison nationale.
C’est dans ce contexte où la maternité est un fort enjeu politique que la loi de 1920 est votée. Elle fait de l’avortement un crime passible de six mois à trois ans de prison et interdit la contraception. Elle réprime également la complicité et la provocation à l’avortement et toute propagande anticonceptionnelle.
Par la suite, face à l’inefficacité de la répression et à la relative tolérance des tribunaux, le législateur va voter trois textes successifs pour durcir cette loi :
- en 1923, les peines encourues en cas d’avortement sont alourdies et la moyenne des acquittements devant les tribunaux correctionnels est réduite de 72 % à 20 % ;
- en 1941, l’infanticide est puni de trois à dix ans de prison, sans possibilité de sursis ni de circonstances atténuantes ;
- en 1942, l’avortement devient un crime contre la sûreté de l’État passible de la peine capitale, dont Marie-Louise Giraud est victime en 1943 pour avoir aidé des femmes à avorter. Cette loi est abrogée à la Libération.Légiférer pour maîtriser la reproduction
Les modifications législatives tantôt allègent les peines tantôt les alourdissent.
À chaque époque, les gouvernants adaptent les lois en fonction des besoins et des valeurs dominantes. Ces valeurs répondent aux diverses influences qui sont de l’ordre de la morale, de la religion, de la nécessité économique (pauvreté, récession), de la relance industrielle et de la consommation (baby-boom), de l’évolution du statut de l’enfant, de l’apparition de la notion d’hygiène de vie (création du concept de protection maternelle et infantile, du carnet de santé).
Mais dans l’évolution de la législation, jamais le principe d’interdiction de l’IVG et de l’infanticide contenu dans la loi de 1920 n’a été abandonné. Onze propositions de loi seront déposées entre 1956 et 1967 pour tenter d’assouplir cette loi, elles sont toutes repoussées.Les luttes de l’après-guerre
En 1956 est créée l’association Maternité heureuse, dont le but est d’obtenir la légalisation des moyens anticonceptionnels. En 1960, elle devient le Mouvement français pour le planning familial (MFPF), qui ouvre en toute illégalité les premiers centres d’information et de prescription en matière de contraception. Des actions militantes imposent un débat parlementaire sur ce sujet dès 1965. Le premier dépôt de projet de loi pour la légalisation de la contraception, présenté par Lucien Neuwirth, a lieu en 1966. La loi est adoptée et promulguée le 28 décembre 1967. Elle suspend les articles 3 et 4 de la loi de 1920 sur l’interdiction de la diffusion de la contraception. À partir de cette date, le Planning familial peut se développer légalement, informer sur et diffuser les moyens de contraception.
En 1975, la loi Veil suspend partiellement l’article 317 du code pénal pour cinq ans et autorise l’avortement sous certaines conditions : durant les dix premières semaines de grossesse et avec l’accord obligatoire des parents pour les mineures.
Entre 1975 et fin 1979, son application est difficile. La forte réticence du corps médical, notamment des chirurgiens obstétriciens, ainsi que le manque de moyens et de « personnel motivé et volontaire », compliquent l’accès des femmes à ce droit pourtant inscrit dans la loi.
Au cours de cette période, des femmes continuent de militer pour la dépénalisation totale de l’IVG et réclament dans l’immédiat son inscription au code de la santé. Celle-ci permettrait un traitement judiciaire en correctionnelle au titre de simple délit, alors que la législation continue de qualifier l’IVG hors délai légal de crime passible de la cour d’assises.
Ces luttes et revendications des années 1970-1980 pour le droit des femmes à disposer de leur corps imposent une évolution de la législation encadrant ce droit. C’est dans un climat de débat houleux et sur fond de propagande anti-avortement que la loi Veil-Pelletier est définitivement promulguée en 1980. Elle met fin au mouvement de revendication des femmes qui exigeaient la dépénalisation de l’avortement et soulève la question du « respect de tout être humain dès le commencement de la vie ». Elle n’abroge pas la loi de 1920 et l’avortement reste interdit, sauf dans des conditions très précises. Par là même, elle instaure la protection du fœtus au-delà de la dixième semaine de grossesse et encadre la liberté des femmes à disposer de leur corps.
En 1982, l’IVG est remboursée par la Sécurité sociale.
Le 23 septembre 1988, un laboratoire pharmaceutique obtient pour la France l’autorisation de mise sur le marché du RU486, pilule abortive qui permet les IVG jusqu’à la cinquième semaine de grossesse (quarante-neuvième jour d’aménorrhée).
Sur fond de polémique dénonçant la banalisation de l’acte, les pressions religieuses amènent le laboratoire à suspendre sa distribution. Le ministre de la Santé du moment impose au laboratoire de revenir sur cette décision.
Le 20 février 1990, décision est prise de rembourser la pilule abortive au même titre que l’IVG chirurgicale.
Depuis le milieu des années 1980, les commandos anti-IVG multiplient les actions contre les centres de planification et les centres d’interruption volontaire de grossesse. En janvier 1993, la loi Véronique Neiertz punit pénalement le délit d’entrave à l’IVG.
Le 4 juillet 2001, la loi Veil-Pelletier est modifiée : le délai légal pour l’IVG passe de dix à douze semaines de grossesse, l’accès des mineures à l’avortement est autorisé sans le consentement des parents ou d’un titulaire de l’autorité parentale, la propagande ou la publicité en faveur de l’IVG ne sont plus sanctionnées, l’entretien préalable n’est plus obligatoire pour les majeures et les chefs de service d’un hôpital public devront assurer l’organisation des IVG. L’éducation à la sexualité en milieu scolaire est rendue obligatoire par cette même loi.Des acquis fragiles
L’interdiction pour une femme de disposer librement de son corps en cas de grossesse est toujours en vigueur. Les quelques droits acquis ne cessent d’être remis en cause. À titre d’exemple, cet avis du comité national d’éthique créé en 1980 qui, suite au débat sur l’utilisation de cellules embryonnaires à des fins médicales ou expérimentales, affirme que « l’embryon ou le fœtus doit être reconnu comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous ». S’appuyant sur cet avis, l’article 16.1 du code pénal de 1994 stipule que tout être humain a droit à la protection de sa vie. Mais il rappelle (fort heureusement !) qu’en regard de la loi de 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG), il y a des situations où l’on peut y mettre fin. Ces débats font malgré tout peser une menace sérieuse sur le droit à l’avortement.
Autre exemple : en novembre 2007, un texte a été déposé et discuté au Sénat contre la banalisation de l’avortement.
Dernier exemple en date : le 7 février 2008, la cour de cassation a fait valoir que la notion de seuil de viabilité n’étant pas inscrite dans le code civil, la « déclaration à l’état civil de tout fœtus ou embryon né sans vie, quel que soit l’état de son développement », pouvait être légitime. L’embryon peut donc être reconnu comme une personne.
Quand aurons-nous le droit de disposer librement de notre corps ? En attendant, ce sont les législateurs, en écho aux scientifiques de tous bords, qui en disposent à leur guise !
Pourquoi y-a-t-il encore des infanticides aujourd’hui alors que nous avons à notre disposition la contraception et l’avortement pour prévenir ou interrompre les grossesses non désirées ? Telle est la question qui est systématiquement posée quand on aborde ce sujet. Il nous a paru important de revisiter ces moyens et leur mise en œuvre.
In vitro, in vivo… et la libido ?
Le succès des luttes pour l’accès des femmes à la contraception a fait de celle-ci le seul moyen acceptable socialement de ne pas avoir d’enfants. Par conséquent, le recours à d’autres formes de régulation des naissances est analysé au mieux comme un échec, au pire comme une faute ou même un crime.
La contraception est aujourd’hui décrite par le monde médical comme sans faille, efficace et adaptée à chaque femme.
Quand une femme doit choisir un moyen de contraception, il est rare que le ou la médecin qui fera la prescription lui parle d’elle. Il est question de l’outil en lui-même, sans que son adéquation au mode de vie des femmes concernées ne soit évoquée. Exemple : si tu as moins de vingt ans, on te parlera de la pilule ; si tu as des enfants, du stérilet ; si tu as eu plusieurs IVG, on te proposera l’implant ou l’injection trimestrielle ; si tu as une histoire qui dure, on t’expliquera que la capote ne convient plus. Des solutions stéréotypées qui prétendent être des réponses adaptées alors que les vraies questions n’ont pas été posées. En effet, quand parle-t-on de pratique sexuelle ou de mode de vie ?
Nous sommes censées en savoir assez sur la contraception pour ne pas avoir le droit à l’erreur, pour éviter les grossesses non désirées. Pourtant, on en sait rarement assez pour décider du moyen de contraception qui nous serait adapté, pour faire de vrais choix.
Si, socialement, la contraception est l’affaire des femmes, elle est en réalité l’affaire des médecins. Les progrès techniques s’accompagnent d’une emprise de plus en plus forte des spécialistes sur nos vies. En d’autres termes, plus la technologie est élaborée, plus elle demande de compétences techniques, moins l’autonomie de celles qui y ont recours est possible. On se retrouve démunie devant les médecins, sans maîtrise réelle de ce qui nous arrive, loin des revendications et des pratiques féministes de l’époque de la lutte pour la libéralisation de la contraception dont nous sommes pourtant censées être les bénéficiaires…
Les moyens de contraception sont classés en fonction de leur niveau d’efficacité, mesuré loin de nos vies. Si, en laboratoire, la pilule est efficace à 99 %, c’est sans compter les aléas de la vraie vie, qui entraînent des oublis, de mauvaises prises.
Le discours scientifique sur la contraception idéalisant les moyens existants implique la culpabilité des femmes, qui seraient les seules en cause en cas d’échec de la contraception.
Il n’existe pas de moyen de contraception efficace à 100 %, aucune vie qui ressemble à un laboratoire. C’est un énorme leurre de considérer que, dans ce monde où la contraception se veut efficace, les avortements, les abandons et les infanticides seraient censés ne plus avoir cours.
Le parcours de la combattante
En 1975, après des années de lutte, une loi est votée, dépénalisant partiellement l’avortement pour cinq ans. Elle sera confirmée après les cinq années « d’essai », sans toutefois que soit abolie la loi de 1920 interdisant la pratique de l’avortement. On parle de libéralisation de l’avortement, mais la réalité est un encadrement strict de la pratique par une loi restrictive, le dépénalisant dans des conditions spécifiques, dans des délais définis précisément par la loi.
« Art. L. 2222-2. L’interruption de la grossesse d’autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 francs d’amende lorsqu’elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l’une des circonstances suivantes :
- 1. Après l’expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical.
- 2. Par une personne n’ayant pas la qualité de médecin.
- 3. Dans un lieu autre qu’un établissement d’hospitalisation public ou qu’un établissement d’hospitalisation privé satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d’une convention conclue selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. »
« Cette infraction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 500 000 francs d’amende si le coupable la pratique habituellement. »
« La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines. »
« Art. L. 2222-4. Le fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer une interruption de grossesse sur elle-même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 francs d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 francs d’amende si l’infraction est commise de manière habituelle. En aucun cas, la femme ne peut être considérée comme complice de cet acte. »
« La prescription ou la délivrance de médicaments autorisés ayant pour but de provoquer une interruption volontaire de grossesse ne peut être assimilée au délit susmentionné. »
Outre le fait que l’avortement doit être pratiqué par un médecin, il ne peut avoir lieu que dans un délai qui, en 1975, était de dix semaines de grossesse et qui, depuis 2001, est passé à douze semaines. Même si on peut considérer comme une avancée cet allongement de deux semaines, il relève plus de la discussion de marchands de tapis que d’une prise en compte de notre besoin de trouver une solution quand nous ne souhaitons ou ne pouvons pas poursuivre une grossesse.
L’avortement relève moins du droit que de la tolérance. Trente ans après sa dépénalisation, l’IVG reste difficile d’accès en France. Au niveau national, une enquête réalisée entre janvier et avril 2005 pour la Direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins a constaté 47 % de refus de prise en charge d’une IVG à l’issue d’un appel téléphonique. Les raisons avancées sont diverses : pas de rendez-vous disponible, absence de prise en charge des IVG après dix semaines de grossesse, refus car la femme n’habite pas à proximité, clause de conscience brandie par les médecins.
Dans 94 % des établissements, l’IVG est pratiquée en fonction des plages horaires laissées libres par les autres activités. Lorsqu’une date d’intervention est donnée, elle est fixée dans 25 % des cas deux ou trois semaines après l’appel. Il suffit ensuite d’un jour férié, de ne pas trouver tout de suite la bonne adresse… et les délais sont dépassés.
La loi est restrictive et sa mise en œuvre aléatoire. Pour qu’un droit existe, il ne suffit pas qu’une loi soit votée, c’est l’organisation matérielle de l’IVG qui fait de l’avortement un droit. Or il apparaît aujourd’hui que les moyens déployés ne sont pas à la hauteur des besoins et des exigences de la loi. Il n’y a pas de volonté politique de l’État en ce sens et il n’existe plus de mobilisation collective suffisante pour créer un rapport de force favorable à un accès facilité à l’avortement.
Aujourd’hui, face à la diminution du nombre de centres d’interruption volontaire de grossesse, l’État répond par la mise en place de l’IVG en ville, portée par des médecins généralistes. Si cette loi, dans le texte, est censée faciliter notre accès à l’avortement dans des délais raccourcis, sa mise en œuvre est, pour les rares médecins volontaires, un véritable parcours d’obstacles.Il nous est abondamment rappelé que l’avortement n’est pas un moyen de contraception mais un échec, nous culpabilisant de ne pas avoir su anticiper et prévoir. Nous sommes fécondables quelques jours par mois, et ce pendant quarante ans. Nous ne connaîtrons en moyenne en France qu’une IVG au cours de notre vie. On peut donc dire que nous aurons su nous prémunir d’une grossesse non désirée toutes les autres fois.
Un autre argument utilisé pour jeter l’opprobre sur l’avortement consiste en une analyse des chiffres des IVG. En effet, plus de trente ans après la loi, 220 000 avortements sont pratiqués en France chaque année. Le fait que ce chiffre soit à peu de choses près stable depuis 1975 est présenté comme un échec, mais le nombre de femmes en France n’a-t-il pas augmenté dans les mêmes proportions que la population française ?
Si l’IVG est autorisée sur la pointe des pieds en France, la volonté publique d’en faire baisser le nombre persiste. La sexualité serait-elle le seul domaine dans lequel on pourrait imaginer que les accidents n’arrivent pas ? On considère souvent la contraception et l’avortement comme deux choses opposées : la contraception comme un moyen utilisé par des femmes sérieuses qui anticipent, et l’avortement comme un recours pour des femmes inconséquentes. Mais la contraception n’est pas sans faille et nos vies non plus. Ces deux outils pour ne pas avoir les enfants que l’on ne désire pas sont utilisés par les mêmes femmes et pour les mêmes raisons, à des moments différents de leur vie.
Un lobby important existe en France en faveur de la criminalisation de l’avortement. Si, depuis 2001, il existe en France un délit d’entrave à l’IVG, les militants anti-avortement manifestent toujours devant les centres d’IVG. Les groupes d’influence provie distillent toujours dans les médias et dans les hémicycles leur vision de l’avortement comme un génocide auquel il faudrait mettre fin de toute urgence.
Dans les années 1960, des féministes, dans leur lutte pour permettre à toutes les femmes l’accès à la contraception, ont prophétisé la disparition progressive des avortements comme une sorte de conséquence triomphale de la généralisation des méthodes contraceptives. Paradoxalement, cette mise en opposition de l’avortement et de la contraception et les débats que cela a généré construisent encore aujourd’hui une approche morale, culpabilisante, de cet acte.
Ce n’est que depuis 2001 que l’entretien pré-IVG n’est plus une obligation de la loi pour les femmes majeures (Il demeure obligatoire pour les mineures). Cet entretien a pour vocation de nous entendre sur les raisons qui nous poussent à pratiquer une IVG et aussi d’entendre notre « détresse ». La loi de 1975 relative à l’interruption de grossesse posait les choses en ces termes : « La femme enceinte que son état place dans une situation de détresse peut demander à un médecin l’interruption de sa grossesse ». Même si la loi française en matière d’interruption de grossesse décrit la femme comme seul juge de la situation et seule maîtresse de sa décision, le législateur a trouvé utile de préciser que la femme qui accède à l’avortement doit être en « détresse ». Certes, certaines femmes qui demandent une IVG se trouvent dans une réelle situation de détresse liée à une grossesse qu’elles ne souhaitent pas poursuivre ou liée à l’acte même d’avorter, réprouvé et parfois difficile à assumer. Mais quand on parle ici de détresse c’est pour marquer le caractère tragique dont on veut revêtir l’avortement, c’est un terme idéologique. Or c’est la grossesse non désirée qui est tragique, et non le moyen d’y mettre fin. Un substrat moral demeure qui a récemment autorisé le Sénat à donner un avis sur sa volonté de non-banalisation de l’avortement.
Si, aujourd’hui, l’avortement ne comporte plus pour notre santé les risques encourus alors qu’il était pratiqué illégalement, donc en dehors de lieux appropriés, il implique (pour nous) une forte dépendance au corps médical et le risque de s’exposer au jugement et à la réprobation des personnes qui sont seules détentrices du pouvoir légal d’agir sur cette grossesse non désirée. Avant 1974, des femmes et des hommes se sont organisés pour rendre l’avortement possible malgré son caractère illégal. À entendre les récits des personnes engagées dans ces groupes, nous avons sur cette question beaucoup perdu en autonomie. La médicalisation de l’avortement a fait de nous des patientes plutôt que des sujets. Lors d’une IVG, on est traitée comme une malade alors qu’être enceinte sans le vouloir n’a rien à voir avec la maladie.Un avortement comme un autre
« Des années de pilule, un intermède de trois ans de stérilet, puis de nouveau la pilule. Et la sensation de ne jamais avoir eu un cycle régulier, “normal”. Alors je décide de faire un bilan hormonal, pour vérifier mon cycle, savoir des choses de moi… Je ne sais pas d’où me vient la certitude d’avoir un cycle irrégulier. J’ai pris la pilule à dix-sept ans. Avant, oui, il y a eu des épisodes avec parfois deux ou trois mois sans règles. Mais, quand j’ai eu un stérilet, j’avais des règles environ toutes les six semaines. C’est probablement parce que ça ne correspondait pas aux sacro-saints “vingt-huit jours” que je ne me croyais pas normale. Ou alors c’était un prétexte, cette histoire de bilan hormonal, pour donner libre cours à mon envie de ne plus être sous contraceptif quel qu’il soit, de ne plus contraindre mon corps soit avec des hormones, soit avec des bouts de cuivre… Bref, je vais voir ma gynéco pour lui faire part de mon histoire de bilan hormonal, elle me dit qu’il faut donc arrêter la pilule (ben ouais, logique... pour voir mes hormones à moi, faut pas que j’en avale tous les jours) et faire une échographie. Elle me file une ordonnance pour l’échographie et une adresse pour prendre rendez-vous pour le bilan. Elle ne me parle pas de contraception alternative, et je ne lui pose pas non plus la question. Nous sommes entre personnes averties et informées, on en reste donc là. Merci docteur, au revoir et rendez-vous après le bilan. Je suis sujette aux infections génitales type mycose, et là, hop ! en v’là une ! Du coup, re-gynéco : examen, analyses, pas d’interrogations non plus cette fois-là sur la contraception… Elle me prescrit un médoc costaud car je fais un truc inhabituel (là non plus ça ne nous interroge ni l’une ni l’autre), accompagné de ces mots dont je me souviens bien : “Attention, il peut provoquer des nausées, mais prenez-le quand même pendant dix jours”. Avec tout ça, ça ne va pas tarder à faire deux mois que je n’ai pas mes règles. Mais comme, précisément, je veux consulter pour un cycle irrégulier, je ne suis pas vraiment inquiète. Pas totalement irresponsable non plus, et donc j’achète un test de grossesse : négatif. Ouf ! Donc tout va bien. Il y a bien ces nausées matinales qui commencent à me jeter hors du lit, mais comme le médoc provoque des nausées… Bon, d’accord, le médoc je l’ai fini y a un moment maintenant. Mais cette idée ne me trouble pas. Et puis le test est négatif, oui ou non ? Le jour prévu pour l’échographie pré-bilan hormonal arrive. Je me retrouve sur la table. Le toubib me demande pourquoi je fais une écho. Je lui réponds pendant qu’il installe son matériel et met en route ses machines : “Bilan hormonal, bla bla, pas mes règles”. Il me répond le nez sur son écran (je m’en souviens comme si c’était hier) :
– Ça m’étonne pas que vous n’ayez pas vos règles.
– Pourquoi ?, dis-je, alors que je sais et que j’ai la gorge qui se serre.
– Parce que vous êtes enceinte.
– De combien ? (C’est la première question qui me vient.)
– Vous inquiétez pas, il n’est pas vieux, me répond-il…
Dans la foulée, parce que c’est un chouette hôpital plein de gens qui assurent et ne jugent pas, je me trouve prise en charge, dirigée vers le service IVG, les rendez-vous sont pris, en une semaine c’est réglé, on m’explique comment, on compatit même au choc que j’ai dû avoir en l’apprenant juste là… Mais comment ça se fait que je l’ai appris juste là ? J’ai des années de contraception derrière moi, je suis informée, je connais mon corps, j’ai réfléchi au désir ou non d’enfant, je sais comment on les fait, les enfants. Et si je n’avais pas eu la bonne idée de prendre ce rencard pour l’échographie (parce que c’était fin juin, et j’ai failli repousser tout ça à la rentrée de septembre) ? Ben, le temps que je réalise que les nausées duraient, ou que mon ventre s’arrondissait, ou que mes seins me faisaient mal, j’aurais été hors délais… Il aurait fallu trouver le fric pour partir en Angleterre ou alors… Ou alors quoi ? Quelle issue ?
Voilà. Juste une petite histoire banale pour souligner qu’il suffit de rien pour basculer du mauvais côté des délais, et se retrouver seule face à son énorme problème, sans le personnel de l’hôpital, sans la Sécu pour payer, sans solution simple, sans solution tout court. Pour dire qu’on n’est pas des machines parfaitement programmées qui savent toujours bien où elles en sont, et que ça, on le paye cher, très cher. Qu’on continue à le payer cher ».Témoignage recueilli en 2006
Délais dépassés
En 2001, l’État français rallonge les délais d’accès à l’IVG de deux semaines, permettant aux femmes d’avorter jusqu’à douze semaines de grossesse ou quatorze semaines d’aménorrhée (absence de règles). Si l’objectif de la loi était de répondre à la problématique des femmes contraintes de partir à l’étranger, c’est raté. Ces deux semaines ne résolvent bien sûr pas le problème de dépassement des délais pour celles d’entre nous qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse et se rendent compte de leur situation trop tard ou décident de mettre un terme à cette grossesse après douze semaines.
L’efficacité relative de la contraception, la méconnaissance du corps, le manque d’information et de lieux d’information sur les questions de sexualité, les difficultés d’accès à l’interruption volontaire de grossesse, l’isolement, sont autant des raisons qui empêchent les femmes d’avoir accès à l’IVG en France dans les délais autorisés par la loi.
Environ 5 000 femmes partiraient avorter à l’étranger chaque année, ou s’informeraient au moins sur les conditions de départ.Voici un extrait du rapport d’activité d’un groupe local du Mouvement français pour le planning familial répertoriant les femmes venues au cours de l’année 2006 à la recherche d’une solution pour interrompre une grossesse de plus de douze semaines. Pour chacune d’elles sont indiqués l’âge, le nombre de semaines d’aménorrhée et un résumé des éléments qui font selon elles qu’elles se trouvent dans cette situation.
33 ans – 14 semaines d’aménorrhée – séropositive, a perdu beaucoup de poids et ne s’est pas rendue compte de la grossesse.
40 ans – 14 semaines d’aménorrhée – manque d’informations après un accouchement.
14 ans – 15 semaines d’aménorrhée – n’a pas osé en parler, a eu peur.
48 ans – 15 semaines d’aménorrhée – pensait être ménopausée.
17 ans – 15 semaines d’aménorrhée – a fait un test de grossesse urinaire qui s’est avéré négatif, pensait que l’absence de règles était liée au stress des examens.
39 ans – 15 semaines d’aménorrhée – a changé de situation familiale.
20 ans – 16 semaines d’aménorrhée – a été mal orientée.
_ ? ans – 16 semaines d’aménorrhée – a été victime de violences en lien avec la grossesse.
23 ans – 17 semaines d’aménorrhée – a des cycles irréguliers.
37 ans – 18 semaines d’aménorrhée – a pris une pilule du lendemain qui n’a pas fonctionné, ne savait pas que cela pouvait arriver.
32 ans – 18 semaines d’aménorrhée – a fait les démarches pour une interruption médicale de grossesse qui lui a été refusée, ce qui a pris du temps, temps pendant lequel le nombre de semaines d’aménorrhée a inévitablement augmenté.
_ ? ans – 22 semaines d’aménorrhée – ne connaissait pas les délais légaux pour avorter.
40 ans – 23 semaines d’aménorrhée – grossesse sous pilule.
16 ans – 24 semaines d’aménorrhée – viol.
20 ans – 28 semaines d’aménorrhée – sous traitement médical, ne s’est pas rendu compte de la grossesse.Il est impossible de savoir les réponses qu’ont données les femmes dont il est question ici à leur situation.
Certaines feront une demande d’interruption médicale de grossesse pour raison « psychosociale ». Elles raconteront leur histoire à des médecins et peut-être à des psychologues qui mesureront leur niveau de détresse et la fermeté de leur décision. Ils décideront de la légitimité ou non pour ces femmes de stopper leur grossesse après les douze semaines autorisées par la loi. Ils rendront leur réponse dans certains cas après plusieurs semaines, ce qui compliquera d’autant la possibilité de trouver d’autres solutions pour les femmes, si leur réponse est négative.
Certaines seront sûrement parties à l’étranger, aux Pays-Bas, en Espagne ou en Angleterre, dans des cliniques privées. Pour cela, il aura d’abord fallu qu’elles réunissent en liquide des sommes allant de 380 à 1 390 euros pour payer l’intervention, en fonction du nombre de semaines de grossesse. Il faudra aussi qu’elles aient l’argent nécessaire pour le voyage, une nuit sur place pour elles et peut-être aussi pour la ou les personnes qui les accompagneront. Il faudra également qu’elles puissent partir de chez elles, de leur lieu de travail, pour plus d’une journée, dans des délais et à un moment qu’elles ne décideront pas.
Pour certaines, provoquer une fausse couche pourra être envisagé, faire de la course à pied, ingurgiter des médicaments, tomber dans l’escalier, se donner des coups…
Certaines accoucheront peut-être sous X.
Certaines aussi accoucheront seules et se débarrasseront du fœtus. Pour celles-là, le fait d’avoir cherché des solutions au cours de leur grossesse, demandé de l’aide, les aura rendues visibles comme femmes enceintes et multipliera le risque qu’elles aient affaire à la justice.
Certaines se seront débrouillées seules sans passer par la case Planning ou médecin.
Certaines deviendront mères.Un fœtus sain dans un corps sain, sinon rien !
L’interruption thérapeutique de grossesse existe depuis 1975. Sa mise en œuvre est modifiée en 2001 et 2002, elle est désormais appelée interruption médicale de grossesse (IMG). De quoi s’agit-il ?
Selon la loi française, l’interruption médicale de grossesse est autorisée quel que soit le terme dans les conditions suivantes :
« Art. L. 2213-1. L’interruption volontaire d’une grossesse peut, à toute époque, être pratiquée si deux médecins membres d’une équipe pluridisciplinaire attestent, après que cette équipe a rendu son avis consultatif, soit que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, soit qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. »
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins trois personnes qui sont un médecin qualifié en gynécologie obstétrique, un médecin choisi par la femme et une personne qualifiée tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue. Les deux médecins précités doivent exercer leur activité dans un établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé satisfaisant aux conditions de l’article L. 2322-1. »
« Lorsque l’interruption de grossesse est envisagée au motif qu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, l’équipe pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme est celle d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Lorsque l’équipe du centre précité se réunit, un médecin choisi par la femme peut à la demande de celle-ci, être associé à la concertation. »
« Dans les deux cas, préalablement à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire compétente, la femme concernée ou le couple peut, à sa demande, être entendu par tout ou partie des membres de ladite équipe. »Un des motifs permettant d’interrompre la grossesse, et cela jusqu’à son terme, est la mise en « péril grave » de la santé de la femme. Le terme « santé » doit en théorie et peut en pratique s’entendre selon la définition de l’OMS, à savoir « un état complet de bien-être physique, moral et social » (une définition « idéale » souvent très loin de nos réalités quotidiennes…). Le terme de santé ainsi défini, peut englober toute situation de détresse morale ou sociale ne permettant pas à une femme de se projeter dans la maternité alors qu’elle est enceinte.
La notion de « péril grave » vient cependant restreindre considérablement les possibilités d’application de la loi, d’autant que cette notion reste à l’appréciation des seuls soignants.Cinq mille interruptions médicales de grossesse (IMG) ont lieu chaque année en France, en comparaison, on compte environ 220 000 interruptions volontaires de grossesse pour 800 000 naissances. La proportion d’interruptions médicales de grossesse pour raison maternelle (pour des raisons qui concernent la génitrice) varie selon les études de 10 à 20 % avec une tendance à la diminution. Les interruptions médicales de grossesse pour raison fœtale (pour des raisons qui concernent le fœtus) varient de 80 à 90 %. Les progrès en diagnostic prénatal ont augmenté le dépistage de pathologies fœtales incurables. Pour cette raison, le nombre d’interruptions médicales de grossesse (IMG) s’accroît.
Ce qui est déterminant pour l’interruption volontaire de grossesse, c’est que c’est la démarche d’une femme à qui il revient, et à elle seule, de juger des raisons qui la conduisent à vouloir ne pas poursuivre sa grossesse. L’interruption médicale de la grossesse est une autre démarche : les femmes, et plus largement les couples, se trouvent placés dans une situation de dépendance particulièrement grande à l’égard des médecins.
En ce qui concerne l’IMG pour raison fœtale, aucune liste des pathologies présentant les critères retenus ne figure dans la loi. Elle laisse en fait aux praticiens toute latitude pour apprécier la légitimité de poursuivre ces grossesses ou non. Les décisions de recours à l’IMG sont celles dans lesquelles les praticiens sont formellement les plus libres de faire prévaloir leur propre conception de ce que les autres (parents aussi bien qu’enfants) peuvent supporter en matière de handicap. Même si la décision de poursuivre la grossesse revient aux familles, la façon qu’ont les médecins de présenter les choses aura une incidence considérable sur la décision finale. Leur qualité d’expert et le fait que ce sont eux qui pratiqueront l’interruption de grossesse, le cas échéant, les autorisent à être très présents, voire pressants, dans la prise de décision.Parce que c’est une décision des médecins, et uniquement dans le cas d’une mise en péril grave du fœtus ou de la femme, l’IMG n’est pas une extension de la loi sur l’IVG et son application reste exceptionnelle et strictement encadrée.
L’IVG, qui est un avortement à la demande de la femme, ne peut se réaliser que dans un délai de douze semaines de grossesse. Quand la décision dépend des médecins, et c’est le cas de l’IMG, l’État laisse beaucoup plus de latitude et permet qu’il soit possible jusqu’à terme.On ne reconnaît pas aux femmes la compétence de juger de leur propre situation ou de celle d’un fœtus à naître. Dans la loi, il est dit que les femmes ou les couples « peuvent » être entendus « à leur demande » par l’équipe. Les médecins peuvent donc légalement prendre la décision en fonction d’un handicap, d’une situation sociale et psychologique donnée, mais sans forcément tenir compte de ce que les géniteurs en pensent.
Même si la femme qui demande une IMG en raison de difficultés psychosociales est entendue, et même si elle passe du temps à exprimer sa détresse, au final, cette détresse va être quantifiée par d’autres qui vont décider si elle lui permet ou pas d’avoir accès à l’arrêt de la grossesse. Les femmes sont contraintes, pour convaincre leur auditoire, de construire leur récit et leurs arguments en fonction de ce qui est socialement reconnu comme une détresse et de ce qui fera d’elles de « bonnes » victimes méritant d’être secourues.
Bien sûr, il sera plus facile d’avoir accès à une IMG pour raisons psychosociales si on est très jeune, très pauvre, droguée… bref, si on ne correspond pas à ce que la morale sociétale définit comme une bonne mère, à l’image idéalisée de la famille. Et comme ce sont au final les médecins qui décident, ils deviennent dès lors les gardiens d’une définition de la norme sociale qu’ils s’appliquent à reproduire.
Il y a « consensus d’opinion » pour une IMG quand il s’agit d’un fœtus porteur d’un handicap tel que la trisomie. En revanche, quand il s’agit de la vie ou plutôt de la survie de la femme qui dit qu’elle n’est pas en situation d’avoir un enfant, les choses sont beaucoup moins simples. On anticipe l’hypothétique détresse d’un être qui n’est pas encore né, mais la détresse réelle, immédiate, des femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse après les délais légaux de l’IVG est, elle, beaucoup moins prise en compte. Pourquoi une malformation ou un handicap seraient-ils des raisons plus légitimes pour la collectivité d’interrompre une grossesse que l’avis de la première concernée, la génitrice ?Être consciente d’être enceinte, être dans l’impossibilité ou refuser de poursuivre cette grossesse, déléguer son arrêt à des médecins et ce jusqu’à terme, y compris en intervenant sur le fœtus après accouchement, est admis, encadré strictement, suspendu à la décision des soignants, mais admis.
Être consciente d’être enceinte, être dans l’impossibilité ou refuser de poursuivre cette grossesse, y mettre fin jusqu’à terme y compris en ne donnant pas les soins nécessaires au fœtus après un accouchement solitaire est inacceptable socialement, puni pénalement, et produit le plus souvent le bannissement des femmes concernées.
Quant à l’abandon…
Pour refuser une maternité à venir quand une grossesse est enclenchée, l’abandon est théoriquement une possibilité.
Théoriquement toujours, on pourrait se demander pourquoi les femmes qui se débarrassent d’un fœtus à la naissance n’abandonnent pas plutôt leur enfant en vue d’une adoption.
D’une part, cette question sous-entend que cette seconde solution est plus acceptable, sans doute parce qu’y trouve son compte le sacro-saint principe du « respect de la vie », dont le poids idéologique est toujours croissant ces dernières décennies.
D’autre part, dans la réalité, nous n’avons pas le choix entre plusieurs possibilités, plusieurs solutions techniques dont on peut tranquillement peser les avantages et les inconvénients. Nous faisons face selon les situations, les moments de nos vies, avec ce que nous pouvons, et il n’y a pas de solution meilleure qu’une autre.Les statistiques sont éloquentes, l’abandon à la naissance (avec ou non accouchement sous X) est rare en France. La première explication de cette rareté vient comme une évidence : l’abandon d’enfant est socialement réprouvé. Le fait que cela ait toujours existé n’a pas pour autant fait évoluer les mentalités. Au contraire, la mère est aujourd’hui tellement idéalisée que l’abandon d’enfant à la naissance est difficilement toléré. Notre société n’accepte pas qu’une mère puisse faillir, encore moins choisir librement de ne pas être la mère d’un enfant qu’elle reconnaît pourtant (puisqu’elle le porte et lui donne naissance). Cette réprobation va même assez loin : alors que l’adoption est valorisée, l’abandon est condamné, y compris par nombre de familles adoptantes.
Les femmes qui font ce choix s’exposent donc grandement à l’opprobre public, à des représailles sociales de tout ordre, et même parfois à des retours de bâton inattendus quand, des années après, leur ex-conjoint n’hésite pas à évoquer à l’occasion du divorce la culpabilité de « cette femme qui a abandonné leur enfant… ».
L’image véhiculée de la femme en détresse qui accouche sous X, trop jeune, voire mineure, victime de viol, précaire … ne représente pas la réalité : il n’y a en effet pas de profil social type.Le poids de la réprobation sociale explique partiellement le choix généralement fait de l’anonymat (accouchement sous X), quand il y a décision d’abandon à la naissance. Mais il y a une autre raison : en restant anonyme, la femme s’assure de ne pas être retrouvée par l’enfant et forcée de devenir la mère qu’elle ne voulait justement pas être, de ne pas être amenée à se justifier.
Sur ce point, les choses sont aussi en train de changer, et pas dans le bon sens. Sous la pression d’associations d’enfants nés sous X notamment, et dans le contexte général d’un droit des victimes devenant hégémonique, de discours sur l’importance de la filiation, des racines, un nouveau dispositif a été mis en place. Il vise à inciter les femmes à laisser leur identité sous couvert d’anonymat pour permettre au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP, association créée en 2002) de relayer de « façon neutre » l’éventuelle demande d’identité de l’enfant quand il sera plus grand. Concrètement, l’enfant ne peut pas avoir directement accès à l’identité de sa génitrice mais le CNAOP peut, si elle a accepté de laisser une trace lors de l’accouchement, la contacter et lui demander si elle accepte qu’il communique ses coordonnées à l’enfant. Libre à elle de refuser, bien sûr.
On voit bien là comment celle qui ne voulait justement pas être mère sera rappelée à son devoir et ce qui a été une maternité biologique peut à tout moment ressurgir dans sa vie pour lui enjoindre d’être une mère sociale.Lors d’un abandon, les femmes projettent l’enfant qu’elles portent dans un avenir mais ne s’imaginent pas mère. Elles assument la rupture génitrice-mère.
Les géniteurs, quant à eux, sont informés, quand ils sont présents, que la loi les autorise à reconnaître et élever cet enfant. Pourtant, on a rarement vu des pères faire cette démarche. Comme s’il leur était impossible de se reconnaître père d’un enfant dont la génitrice ne se reconnaît pas comme mère.Au-delà de la décision de l’accouchement sous X, il faut aussi assumer les mensonges que l’on est contrainte de faire après l’accouchement : pour expliquer sa disparition pendant un temps afin de cacher son état, pour faire croire à un fibrome, ou encore à un enfant mort-né.
L’abandon à la naissance n’est pas un refus de grossesse ni un refus d’enfant mais un refus de maternité. Il n’est pas l’ultime recours une fois les délais d’IVG dépassés ou parce qu’on n’aurait pas les moyens de partir à l’étranger. L’abandon à la naissance est le fait de femmes qui souhaitent que cet enfant vive en dehors d’elles.
Tota mulier in utero
« Toute la femme est dans l’utérus »
(locution latine – tirée d’une phrase du médecin grec Hippocrate)Avec les bribes d’informations sur la procréation que nous avons pu recevoir par les copines, l’école ou la famille, nous avons assez vite conscience de notre potentialité reproductive. Seulement, cette potentialité est généralement rattachée à la maternité. On peut concevoir que l’on pourra, ou non, être mère, mais cela induit que l’on aura choisi le moment. Beaucoup d’entre nous se sont dit « un jour je serai mère… », mais très peu « je risque d’avoir des grossesses non désirées… ». Nos existences sont fréquemment très éloignées du modèle disneylo-capitalo-patriarcal : j’ai quelques flirts, je rencontre le bon, je me marie et fais des enfants. Pour la plupart, nous avons des vies bien plus décousues, plus mouvantes, que ce soit sur un plan affectif, professionnel ou militant. Nos histoires et, à travers elles, nos sexualités s’essaient, se questionnent, se séparent, recommencent, doutent, s’extasient… Il est tout à fait possible d’être soi en dehors de sa biologie. Comment, dans ces moments, se rappeler notre utérus quand nos têtes sont déjà pleines de nos vies ? Pourquoi nos corps iraient-ils au-delà de ce qu’on leur demande ?
2006Con-former la sexualité
Dans notre société, qui se veut moderne et hautement civilisée, nous sommes censées être averties, informées du fonctionnement de notre corps, des liens entre sexualité, fécondité et reproduction, et avoir tous les éléments pour une fécondité maîtrisée. On pourrait attendre d’une éducation à la sexualité bien faite qu’elle réduise les situations de grossesse non désirée. Pourtant, il n’en est rien…
« Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées à raison d’au moins trois séances annuelles et par groupes d’âge homogènes. »
Voilà ce que dit l’art. 22 de la loi du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. À notre connaissance, ce programme est loin d’être effectif partout et son application dépend de la bonne volonté des établissements scolaires.
L’essentiel se passe ailleurs et se joue bien avant, en dehors des apprentissages scolaires, dans la famille, avec les pairs, les voisins... Quand ils sont tout petits, on demande à la fille qui est son amoureux, au garçon avec qui il se mariera plus tard... sans parler des modèles véhiculés par les histoires enfantines et leurs illustrations. Très tôt, les codes de la société hétéro-normée s’imposent.
Toute l’éducation à la sexualité se déroule à l’ombre du tabou pesant sur le sexe. À l’école, les adolescents et adolescentes apprennent certes les mécanismes de la reproduction, en passant de la fleur à la grenouille avant d’en arriver à l’être humain. Mais l’approche scientifique demeure abstraite et déconnectée des expériences sexuelles de chacune, chacun... L’apprentissage de la sexualité est morcelé : d’un côté la pornographie, la contrainte à la performance, les hommes « actifs » et les femmes « passives »… et, de l’autre, des silences prudents ou des informations sur la contraception et les maladies. Comment faire le lien entre toutes ces informations ? Et comment les relier à son propre rapport au plaisir, au désir ?
La pénétration est présentée comme l’aboutissement logique du désir et la voie royale d’accès au plaisir. Cette idée reçue formate l’image que les plus jeunes se font de la sexualité adulte et va modeler leurs premières expériences sexuelles. On considère avoir fait l’amour pour la première fois lorsqu’il y a eu pénétration vaginale par un sexe masculin. De ce fait, lorsque le risque de grossesse est évoqué avec des jeunes filles, il leur est dit que c’est en « faisant l’amour » qu’elles peuvent être enceintes, alors qu’il existe de multiples façons de faire l’amour sans pénétration ou avec pénétration non fécondante.
En fait, l’essentiel des informations données sert surtout à construire une norme centrée sur des rapports sexuels fécondants. D’une part, les façons de faire l’amour sans pénétration vaginale sont peu évoquées, d’autre part on élude la question de la fécondité à partir du moment où on parle de désir et de plaisir. Et ceci en particulier avec les garçons, pour lesquels le lien entre leurs premières éjaculations et la naissance de leur fécondité est rarement évoqué. Quant aux pratiques homosexuelles, qui par définition excluent tout souci lié à la gestion de la fécondité, on n’en parle pas, comme si leur évocation risquait de « contaminer » les jeunes générations auxquelles on prétend s’adresser...
Alors, où et comment apprend-on de quelle façon on tombe enceinte ? Non pas en théorie, mais d’une manière qui ait à voir avec les interrogations et les pratiques réelles des plus jeunes auprès desquels il serait souhaitable de faire de la prévention ? Il faut commencer par briser le silence sur les différentes pratiques sexuelles et permettre à tous et toutes de parler et d’agir librement. C’est un préalable. À quelle efficacité peut prétendre la prévention si on ne commence pas par remettre en cause la norme sexuelle dominante ?
Imaginons un seul instant qu’autant d’énergie et d’imagination soient mises dans des campagnes d’information sur les risques de grossesse que dans les campagnes de lutte contre le sida, qui ont d’ailleurs levé des non-dits sur un certain nombre de pratiques sexuelles. Non, impossible. Parce que, envers et contre tout, une grossesse est censée être un événement heureux, et parce que c’est un fait que la gestion des risques de grossesse non désirée n’incombe pas à toute la société, mais à nous et à nous seules.Mères d’aujourd’hui, mères d’alors
« La production des enfants a toujours été, et demeure, un enjeu de pouvoir ; le contrôle de la fécondité féminine est le lieu par excellence de la domination d’un sexe sur l’autre. »
Yvonne Knibielher (Histoire des mères et de la maternité en Occident)Les femmes ont un utérus et des seins, elles portent les futurs enfants et elles accouchent. On peine à comprendre pourquoi ces données biologiques devraient entraîner, dans la vie sociale, l’obligation de faire la vaisselle et le ménage et de s’occuper seule des soins aux enfants. Pourtant, c’est bien ce qui se passe : ce rôle biologique somme toute limité conditionne l’ensemble de notre vie. Nous avons la responsabilité des tâches domestiques à la maison (même quand elles n’ont rien à voir avec les enfants) et, depuis toujours, nous travaillons également hors de la maison. Et quand nous avons commencé à travailler ailleurs qu’aux champs ou à l’usine, les premiers métiers qualifiés qui nous ont été accessibles étaient et demeurent en lien avec la fonction maternelle : institutrice (l’éducation), secrétaire (le service), infirmière (le soin). De quoi se poser des questions, non ?
La maternité est considérée comme un devoir social, en contrepartie duquel on acquiert le statut social correspondant à la fonction, et cette fonction maternelle a longtemps été le seul moyen pour les femmes d’avoir du pouvoir : depuis la régente, qui gère l’État en lieu et place de son fils mineur, jusqu’à la belle-mère qui « régente » la maison et la famille. En Occident, cette place sociale des femmes conditionnée par leur fonction dans la reproduction est un héritage du droit romain et de la médecine grecque. Le droit romain codifie la fonction maternelle et les pratiques d’hygiène et considère la mère comme un simple réceptacle à contrôler étroitement. Il donne au seul père le pouvoir d’introduire l’enfant dans la famille. La médecine grecque assigne comme unique destin aux femmes d’avoir des enfants et de les nourrir, les réduisant à leur utérus. Rappelons que les traditions grecques et romaines ont nourri les législations et les sciences des pays européens jusqu’à nos jours…
Les femmes étant les seules concernées par les grossesses, les naissances et les soins aux enfants en bas âge, c’est tout « naturellement » qu’elles ont pris en charge la régulation des naissances, en résistant depuis toujours à l’obligation de mettre au monde et d’élever tous les enfants qu’elles pouvaient biologiquement « produire ». Au Moyen Âge, la relative indifférence des États à la question de la natalité et la tolérance de l’Église chrétienne ont permis les recours à l’avortement et à l’infanticide, camouflés le plus souvent en accidents. La volonté étatique de contrôle des populations n’en est qu’à ses prémices et l’Église n’est pas nataliste à l’époque : pour les chrétiens des origines, la chasteté est préférable à la fécondité. Ils croient la fin du monde proche et s’y préparent en prêchant la pureté sans se soucier de l’avenir de l’espèce.Au XVIe siècle, plusieurs facteurs se conjuguent pour changer la donne. L’État moderne commence à se structurer et veut contrôler plus efficacement son territoire et sa population. Des troubles religieux secouent la chrétienté : la doctrine luthérienne s’élabore notamment en réaction aux mœurs dissolues qui ont cours au sein de la hiérarchie catholique. Le succès de la Réforme protestante va provoquer une contre-réforme moralisatrice dans l’Église catholique, et donc dans les États qui se sont appuyés sur le catholicisme pour se consolider. La population d’Europe occidentale émerge tout juste de la guerre de cent ans et la meurtrière épidémie de peste a liquidé en un siècle les quatre-cinquièmes de la population. Dans les mentalités populaires comme chez les dirigeants, la question de la survie de l’espèce et à l’ordre du jour.
En 1556, la décision officielle de condamner l’infanticide est prise en France par un édit royal qui contraint les femmes à déclarer leur grossesse, sous peine de mort si l’enfant décède sans baptême. En 1588, une bulle du pape interdit toute forme de contraception et d’avortement. Dans le même temps, les sages-femmes se voient soupçonnées de sorcellerie, de complicité d’infanticides et d’avortements, et obligées par l’Église et la monarchie à se constituer en corporation sous la surveillance des chirurgiens. L’invention d’instruments nouveaux (comme le forceps), qui demandent une compétence technique dont l’acquisition est refusée aux femmes, marque le début des prétentions masculines dans le domaine de l’obstétrique.La deuxième grande rupture après celle de la Renaissance a lieu au XVIIIe siècle : l’influence de l’Église chute et la philosophie des Lumières invente la « bonne mère ». La femme est glorifiée dans sa fonction de mère, au service de l’enfant, lui-même avenir du monde. L’amour maternel devient une valeur fondamentale de la société, un code de bonne conduite (la compassion maternelle est invoquée pour secourir les malheureux), et fait l’objet d’un véritable culte. Cette glorification de la maternité, qui ne reconnaît une valeur sociale aux femmes que si elles sont mères, est « une forme nouvelle, débonnaire, paternaliste, du patriarcat » (Y. Knibielher).
La philosophie des Lumières ne fait là que précéder de quelques décennies un réaménagement de la société qui interviendra au cours de la Révolution française. Pendant les premiers temps de la Révolution, les femmes avaient pu croire que le vent de la liberté soufflait aussi pour elles. Mais la réorganisation sociale aboutit à une société étatisée, hiérarchisée et autoritaire, dans laquelle les femmes sont réassignées à la fonction unique de mère et nourricière, renvoyées dés 1793 aux fourneaux et au lavage de couches. Elles risquent, si elles se soustraient à ce rôle, la mort parfois, l’opprobre toujours.
Le code civil de 1804 parachèvera l’éviction des femmes en en faisant des mineures à vie et en prenant soin d’interdire la recherche en paternité (pour « assurer la tranquillité des familles »). Cela profitera aux jeunes bourgeois, aux contremaîtres d’usine, etc.Le XIXe siècle est celui de la révolution industrielle, de l’exode rural et du développement du salariat. Les femmes des milieux populaires urbains sortent des maisons pour aller, comme les hommes, travailler à l’usine. Comme les hommes ? Pas tout à fait... elles gagnent moitié moins et conservent la charge entière du foyer et des enfants. Travaillant de douze à quatorze heures par jour, contraintes de s’occuper en plus du ménage et des enfants, elles sont épuisées au point que cela en devient contre-productif socialement.
À la fin du siècle, l’obsession de « rendre la mère à ses petits » s’impose au sein de la classe des décideurs, dans le but de faire de la mère le relais de l’idéologie dominante. Celle de l’Église, bien sûr, mais aussi celle de la morale de l’État, qui compte sur les mères pour éloigner la famille des deux fléaux identifiés du moment : l’alcool et l’anarchisme. C’est l’époque de la « théorie des deux sphères » : la sphère publique, celle des hommes qui gèrent les affaires publiques justement, et la sphère privée, la maison bourgeoise où « règnent » les femmes qui ont en charge le foyer, l’éducation et le soin de la famille. Cette théorie n’enferme pas totalement les femmes dans le privé grâce au développement de la philanthropie. Cette doctrine, qui prône une gestion privée du social par le biais de sociétés de bienfaisance et de bonnes œuvres, vise à pallier les carences de l’État en venant au secours des laissés-pour-compte de la société. Vue comme une extension au domaine public des tâches domestiques d’éducation, de nourrissage et de soin, elle accorde une large place aux femmes (de la bourgeoisie toujours, les femmes du peuple forment justement la majorité des laissés-pour-compte). C’est ainsi que les premières femmes qui accéderont à des métiers à haute reconnaissance sociale le feront par le biais de la fonction maternelle : inspectrice des écoles publiques ou médecin, pour soigner les futures mères.Toutes les périodes d’agitation sociale ont vu sortir les femmes, qui ont à chaque fois posé le problème de la régulation des naissances. Si, en Europe, c’est la France qui a le taux de natalité le plus bas au début du XXe siècle, c’est grâce en partie aux bourses du travail (anarcho-syndicalistes), qui ont largement relayé la propagande pour le contrôle des naissances au sein de la classe ouvrière.
Le déclin des naissances est général dans toute l’Europe à la fin du XIXe siècle et concerne tous les milieux. Les États s’en alarment et jugent qu’il n’est plus possible de déléguer la tâche du renouvellement des générations aux familles, et surtout aux femmes, qui s’en acquittent bien mal. Ils élaborent dès lors une politique nataliste qui prend deux formes. D’une part, on encourage la maternité par le biais d’assistances matérielles aux mères (la création des congés maternité, l’ouverture de centres et d’hôtels maternels) et la médicalisation de la reproduction, qui fait chuter le taux de mortalité des femmes. Cette doctrine transforme l’État en un super-père, qui aide et en même temps contrôle les familles en s’immisçant toujours plus dans la relation mère-enfant. D’autre part, on réprime l’avortement et la contraception. Sur ce point, la France est la plus féroce des démocraties dans l’entre-deux-guerres.
Les États s’attachent à l’encadrement moral et idéologique, à l’endoctrinement des femmes (leur vocation, c’est d’élever des enfants au service de la patrie) par le biais des livres scolaires, de l’Église, des encouragements symboliques (La fête des Mères est instaurée en France en 1926). Finalement, d’innombrables mesures plus ou moins disparates vont bien toutes dans le même sens : cantonner les femmes dans leur fonction maternelle en contrôlant toujours davantage la façon dont elles l’assurent.
Venons-en aux années 1960 : le deuxième baby-boom, après celui de la fin de la seconde guerre mondiale, est le troisième grand moment de rupture dans cette histoire de la maternité et de la régulation des naissances. Les femmes font à ce moment-là plein d’enfants, encouragées par l’« État-providence », qui accentue encore son rôle de super-père à coups de construction de crèches et de paiement d’allocations familiales (qui sont, à l’époque et pour de longues années encore, allouées au père de famille). C’est pourtant pendant ce baby-boom que la contraception se répand et que le nombre d’avortements augmente (jusqu’à 500 000 avortements pour 800 000 naissances). La situation est complexe et contradictoire : les femmes veulent des enfants, mais plus dans la passivité traditionnelle. Elles ont un besoin croissant d’autonomie et se rebellent massivement contre la pseudo-fatalité biologique qui les transformerait à vie en ménagère et servante sous prétexte qu’elles peuvent enfanter. Elles arrachent de haute lutte des « droits » à la contraception et à l’avortement, qui restent encore aujourd’hui étroitement corsetés dans des lois restrictives et toujours à la merci d’un retour de bâton moraliste.
Alors oui, on peut choisir maintenant d’avoir ou de ne pas avoir d’enfant, et oui, ça a facilité la vie de pas mal d’entre nous. En particulier la nôtre, femmes occidentales, blanches, majeures, avec papiers et Sécu. Mais quel est le prix à payer ? D’abord, la prise en charge de la régulation des naissances, c’est encore pour nous et pour nous seules. Nous restons les responsables de la reproduction de l’espèce. Et, d’une certaine façon, plus encore qu’avant, puisque, avec tous les moyens à notre disposition (pilule, stérilet, implant, etc.), on aurait mauvaise grâce à ne pas s’occuper de tout ça. Et les hommes prennent aussi peu, et parfois moins qu’avant (du temps où le retrait était le seul moyen), de responsabilités à ce sujet. Et puis, maintenant qu’on peut choisir, que c’est si simple, pas question de se planter sans passer pour une idiote ou une irresponsable, et pas question non plus de ne pas être folle de joie d’être mère. Comme le dit si justement Yvonne Knibielher dans son Histoire des mères : « Auparavant les femmes n’avaient pas le droit de refuser une naissance, à présent elles n’ont plus le droit de laisser naître un enfant non désiré ».Quoi qu’il arrive, nous n’échappons pas à cette injonction à être mère qui imprègne toute notre vie. Qu’il advienne une crise existentielle et celles qui sont sans enfant s’interrogeront sur le vide qu’elles ressentent : ne serait-ce pas la frustration de ne pas être mère ? Quant à celles d’entre nous qui en ont, elles sont confrontées au fait que, contrairement à ce dont on veut nous convaincre depuis notre plus tendre enfance, les enfants ne remplissent pas toute une vie, même une vie de femme.
Naître mère ou ne pas être
L’idéologie nataliste en France n’a pas fléchi aujourd’hui : en effet, l’État encourage toujours à faire des enfants, comme le montrent par exemple l’attribution d’une prime de naissance, l’existence du congé maternité, la retraite précoce accordée aux fonctionnaires qui ont eu trois enfants, les réductions de tarifs pour les familles nombreuses… Un autre fait révélateur est que soit saluée comme une excellente nouvelle l’annonce que la France ait un des plus forts taux de fécondité en Europe, avec plus de deux enfants par femme.
Pourquoi cette persistance de l’idéologie nataliste en France ? Bien sûr, faire des enfants demeure le symbole de l’avenir et de la croissance. Cette idéologie repose sur l’idée que faire des enfants, c’est assurer le renouvellement d’une population et équilibrer son vieillissement dû à l’allongement de l’espérance de vie. Les enfants représentent aussi un marché important (couches, jouets, loisirs, etc.), et une source d’activité économique non négligeable (crèches, écoles, formations, apprentissages, etc.). Pourtant, s’il ne s’agissait que d’assurer la reproduction nécessaire au renouvellement des générations et à la machine économique, la croissance démographique mondiale et l’arrivée de populations venues d’ailleurs ne pourraient-elles pas y subvenir ? Ne soyons pas naïves : des rigidités nationalistes toujours vivaces contribuent à faire de l’immigration une menace de dilution de l’« identité nationale » et à compter, pour la perpétuation de cette identité, sur de nombreuses et nécessaires naissances « françaises ».
L’idéologie nataliste n’a pas été affectée par la légalisation de la contraception et la dépénalisation partielle de l’avortement. On aurait pu penser, comme certains opposants à la loi Veil, que les femmes allaient faire moins d’enfants. Ce fut certes le cas en 1975, mais le nombre d’enfants s’est stabilisé dans les années suivantes autour de 750 000 naissances par an. Il a ensuite augmenté de façon significative dans les années 2000, jusqu’à retrouver le nombre de 1974. Pas d’effet majeur sur la fécondité, donc, la grande majorité des femmes fait des enfants. Les femmes nées en 1960 sont mères à 90 %, ce qui était déjà le cas pour celles nées en 1940.
Comment se fait-il que les femmes, qui ont gagné théoriquement le libre choix de la maternité, continuent à faire le « bon » choix, conforme à l’idéologie nataliste, c’est-à-dire celui de l’enfantement ? Comment se fait-il qu’il ne reste du slogan des années 1970 « un enfant si je veux, quand je veux » que « un enfant quand je veux » ?
Si nous sommes toujours majoritairement mères, ce n’est plus seulement pour répondre aux injonctions de la patrie, par obéissance à la propagande d’État, par contrainte sociale ou économique (le mariage, par exemple), mais pour notre épanouissement individuel. C’est dans l’adhésion « librement » consentie, portée, intégrée, au bonheur d’être mère que réside le changement. La conviction qu’une des principales sources d’épanouissement pour les femmes est la maternité nous amène à faire les enfants que notre société attend. Cela ne signifie pas qu’être mère c’est être davantage soumise ou moins émancipée que de ne pas être mère. Nous avons toutes à composer avec ce modèle de la femme accomplie.
Et ça commence tôt. Une des principales différences dans la construction sociale des filles et des garçons est la préparation des filles au futur rôle de mère : par les jouets qui surchargent les rayons roses des magasins (poupons, landaus, dînettes, etc.), par les encouragements à s’occuper des plus petits (et des autres en général), par la valorisation chez elles de la douceur, de l’écoute, de l’attention, du dévouement… Le fait que les enfants imitent en général les adultes de leur sexe joue aussi dans la reproduction par les petites filles des tâches « maternelles ». Et les modèles de vie de femmes véhiculés par la famille, l’école, les adultes de l’entourage, les images publicitaires, les films, les livres, la presse enfantine, etc., sont peu variés. Avec ça, difficile pour les filles d’échapper à ce destin tout tracé : être mère un jour. Difficile aussi d’avoir une identité de femme par-delà ce destin. Rien de tel pour les petits garçons : où et quand apprennent-ils qu’un jour ils devront changer les couches, se lever la nuit, faire quatre lessives par jour, qu’une grande partie de leur temps va être consacré à ces occupations parentales et que, en plus, cela les rendra follement heureux ?
Après ce « formatage », il apparaît difficile d’envisager, adulte, une vie de femme accomplie sans enfant. La maternité est même tellement « naturalisée » pour les femmes, c’est-à-dire vue comme leur destin naturel, qu’il est difficile de l’interroger ou de douter du bonheur censé l’accompagner. Autant il est possible de remettre en question son couple, son boulot, d’en être insatisfaite, autant il est très difficile d’interroger la maternité, même si nous savons que la réalité est beaucoup moins radieuse que la belle histoire promise. Ne pas vivre la maternité comme un bonheur, ou ne pas avoir d’enfant, révèle un problème. Refuser une maternité est suspecté de pathologie : la question est traitée sous l’angle psychologique, individuel, occultant ainsi l’obligation sociale faite aux femmes d’enfanter. Ce jugement est intériorisé par les femmes, qui peuvent être féroces entre elles à ce sujet. La pression sociale nous formate toutes et s’y conformer procure un confort psychologique. Il est difficile de vivre le refus ou l’impossibilité de maternité en toute sérénité. Les femmes qui ne sont pas mères ne peuvent entièrement appartenir à la « communauté des femmes », comme si il leur manquait une part essentielle de leur identité. Et comme elles ne représentent qu’une minorité (10 %), leur place n’est pas confortable.
La société encadre depuis longtemps la question de la maternité. Il y a toujours plus de marge de manœuvre pour les hommes concernant la paternité que pour les femmes concernant la maternité. Les hommes sont moins assignés à la paternité, on n’attend pas d’eux qu’ils donnent une grande partie de leur temps à la gestion des enfants ; à la rigueur, on compte sur eux pour apporter la sécurité financière dans le foyer et jouer le rôle de l’autorité si nécessaire à l’éducation de notre progéniture – rôle que les femmes sont bien incapables de tenir, elles qui sont si douces et aimantes. On ne châtie pas avec la main qui caresse. Le rôle que les mères ont à tenir est beaucoup plus précis et le jugement plus dur si ce rôle n’est pas tenu. Les attentes vis-à-vis des mères sont socialement partagées et portées alors que la responsabilité en cas d’échec devient une affaire personnelle. Être une mauvaise mère, c’est être une mauvaise femme puisque ces deux notions ne sont pas dissociables. Une femme complète est une mère. Oser mettre sur la table ses doutes de mère, ses ras-le-bol, c’est prendre le risque d’être considérée comme une femme ratée.
Par ailleurs, la maternité façonne notre statut social : en étant mère, on est utile et reconnue par la société. Dans un contexte social où la précarité s’accroît et touche particulièrement les femmes, être mère est un moyen de trouver une place et une reconnaissance. Si la maternité annoncée par un ventre rond confère soudain une aura, attire les sourires, les sympathies, si les félicitations fusent à l’annonce d’une future naissance, le refus de maternité est à l’inverse un acte réprouvé, difficilement pensable pour une femme digne de ce nom. Le libre choix de la maternité avec le pack bonheur intégré implique que les femmes qui refusent cette perspective suscitent l’incompréhension, la condamnation plus ou moins violente, proportionnellement à l’avancée de la grossesse. L’opprobre est jeté sur celles qui, par tous les moyens dont elles disposent – comme des milliers de femmes avant elles –, n’auront pas cet enfant qu’elles ne veulent pas avoir.
Autres regards
Texte librement inspiré de l’article « Paternité biologique, maternité sociale », de Nicole-Claude Mathieu, in Femmes, sexisme et sociétés, Andrée Michel, 1977.
La mise au monde et la prise en charge de l’élevage des enfants par les femmes est généralement la raison avancée des inégalités sociales entre les sexes : elle sert de justification aux différences de statuts, d’emploi du temps et d’occupations techniques…
À focaliser sur le lien biologique mère-enfant, sur cette symbiose vue comme naturelle, on a toutes les chances d’oublier la femme comme sujet social. On admet bien la différence entre « père social » et « géniteur », et qu’un processus de socialisation est nécessaire pour passer de l’un à l’autre ; en revanche, la différence entre « génitrice » et « mère sociale » n’est pas pensée.
Et pourtant. Dans la société rubaka, au Nigeria, nous dit Nicole-Claude Mathieu, les relations sexuelles préconjugales chez les adolescents sont autorisées à condition de ne pas porter de fruit : si la jeune fille est enceinte, on a recours à l’avortement, à l’infanticide ou à l’adoption. En effet, la fille comme le garçon ne doit pas être socialement mère ou père. L’engendrement est alors « sciemment annulé par la société ». Et donc, tout autant que le jeune garçon, le fait que la jeune fille soit mère au sens physique n’implique pas qu’elle soit une mère sociale.
« L’avortement exprime de la maternité son caractère culturel : il ne suffit pas d’être enceinte pour être mère. La maternité et son inverse, l’avortement, sont signes que, dans les sociétés humaines, l’engendrement ne saurait être que volontaire (Je parle bien entendu de la décision du groupe, et non des acteurs individuels) - donc social . […] L’avortement est le refus culturel d’un processus biologique entamé ». Il nous semble que l’analyse que Nicole-Claude Mathieu fait ici de l’avortement s’applique de même à l’infanticide, que nous considérons comme un avortement différé.
« On considère très généralement que l’engendrement par la femme est un donné naturel […] mais encore faut-il qu’il y ait naissance et, après la naissance, qu’il y ait reconnaissance par la société de la maternité sociale. »
Dans le même temps, on élimine trop aisément le rôle biologique du père pour ne s’attacher qu’à sa fonction sociale.
« Que la plupart des sociétés, dans leur besoin d’enfants pour se reproduire […], insistent à travers mythes et rites sur la fécondité des femmes et leur lien avec la « nature » ne doit pas faire oublier que l’enfantement est toujours contrôlé d’une manière ou d’une autre. « Vouloir » des enfants est d’ailleurs aussi une forme de contrôle, l’aspect « positif » de la maternité sociale, comme l’avortement en serait l’image « négative ». »
Dans notre société, le sens social de la non-maternité est généralement rejeté et le refus de maternité renvoyé dans les ténèbres et l’ignorance, et pratiqué dans le silence et la solitude par les individus femmes.
Or la régulation de la démographie dans nos sociétés s’est aussi faite par les avortements et les infanticides. « L’existence d’une telle intervention sociale sur l’engendrement est déniée lorsque la maternité est caricaturalement présentée comme une donnée immédiate de la féminité. »Ce qui nous intéresse dans la réflexion ethnologique de Nicole-Claude Mathieu, c’est la mise à distance qu’elle permet des contraintes morales encadrant nos choix et nos comportements. Ainsi, quand on compare différentes sociétés entre elles, on s’aperçoit que, dans la panoplie des moyens de régulation des naissances, de la contraception à l’abandon en passant par l’avortement et l’infanticide, elles peuvent en privilégier certains au détriment d’autres. Selon la société dans laquelle on vit, certains vont être encouragés, d’autres condamnés. Pèsent alors sur les individus les valeurs attachées à tel ou tel mode d’intervention sur l’engendrement.
Ainsi, notre société privilégie la contraception sur tout ce qui vient arrêter une grossesse déjà entamée. Il est donc difficile de se retrouver acculées à mettre fin à une grossesse par des moyens réprouvés socialement, qu’il s’agisse de l’avortement ou, plus encore, de l’infanticide.Féministes : une histoire de luttes
Malgré ce que dit Simone de Beauvoir (« On ne naît pas femme, on le devient »), il existait, il existe encore, une situation où, naissant femme, on le reste, et c’est bien celle dans laquelle se trouvaient et se trouvent encore les femmes enceintes sans l’avoir voulu.
Longtemps, le fait pour une femme d’avoir des relations sexuelles s’est presque toujours accompagné du risque d’une grossesse non désirée. Qui peut dire mieux qu’elles-mêmes la somme des frustrations, des tortures, des vies gâchées, des blessures et des morts qui ont été et sont encore le quotidien des femmes dans ce cas ?Écrire sur la contraception et l’avortement apparaît aujourd’hui bien désuet, juste bon à rappeler de vieux souvenirs, et cela est heureux. Ces droits, qui ont été conquis de haute lutte, sont si fondamentaux qu’ils passent aujourd’hui inaperçus, comme allant de soi.
Et pourtant...
C’est au terme de décennies de pratiques clandestines et de luttes que la contraception est autorisée en 1967.
Le 5 avril 1971 paraissait le manifeste de trois cent quarante trois femmes s’accusant du délit d’avortement, alors passible de prison.
À l’été 1972, venue des États-Unis, la méthode Karman arrive en France par le biais du Groupe information santé. C’est une méthode d’avortement par aspiration qui peut être pratiquée sans anesthésie. Simple et sans danger, elle ne nécessite pas d’hospitalisation. Sa diffusion permet aux groupes militant pour la dépénalisation de l’avortement de le pratiquer en toute autonomie. Dans ce contexte de lutte, des femmes acceptent de rendre leur avortement public pour montrer que l’intervention est bénigne et qu’on s’en relève aussitôt.
En novembre 1972 a lieu à Bobigny le procès d’une jeune fille de seize ans qui a été violée et de sa mère qui l’a aidée à avorter. Certains groupes féministes en font une tribune pour exiger la dépénalisation de l’avortement.
Le 4 avril 1973, c’est la naissance du MLAC (Mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception), qui va permettre à la fois de donner une plus grande publicité aux avortements et une couverture juridique à celles et ceux qui les pratiquent par le biais du statut associatif et d’un groupement d’avocat-e-s militant-e-s. C’est aussi le MLAC qui met en place et revendique publiquement une autre pratique illégale : les voyages collectifs vers l’Angleterre ou les Pays-Bas où l’avortement est autorisé.
L’accès à la contraception et à l’avortement, nous le devons bien aux luttes des femmes, et c’est un progrès réel. Si ces progrès ont eu lieu, c’est parce que les femmes se sont battues pour porter sur la place publique ce qui restait caché au fond des maisons. Et nous en profitons toutes aujourd’hui, y compris toutes les femmes qui n’envisageraient pas de se passer de la pilule, mais qui refusent absolument d’être qualifiées de féministes, comme si c’était un gros mot... Souvent, les pionnières et les pionniers des revendications sont considérés par leurs contemporains moins audacieux comme des personnes folles, irréalistes ou dangereuses. C’est arrivé aux ouvriers et ouvrières revendiquant la journée de huit heures, par exemple. Sauf que l’on ne s’imaginerait pas les qualifier ainsi encore aujourd’hui. C’est toutefois ce qui arrive aux féministes du mouvement des années 1970 : dites « hystériques » à l’époque, elles sont toujours considérées comme telles par beaucoup aujourd’hui...
C’est pourtant une belle histoire que racontent celles d’entre nous qui ont vécu cette période. Une histoire de fête, de solidarité, de bonheur d’être ensemble. Comme une grande bouffée d’air, le fait de ne plus se sentir seule, de découvrir que ton malheur n’était pas lié à toi mais que toutes les femmes vivaient cela et que c’était ensemble qu’on pouvait changer les choses. La volonté de porter sur la place publique, de rendre visible l’oppression des femmes et de lutter contre, en particulier contre cette obligation d’avoir des enfants.
De tout temps, les femmes ont lutté contre l’oppression à laquelle elles étaient confrontées, contre la domination des hommes. Mais on ne le sait pas, ou si peu.
D’abord parce que ce sont les hommes qui écrivent l’histoire, et que du coup le rôle des femmes y a été oublié, ou vu à travers un prisme déformant. Ensuite parce que ces luttes ont souvent pris et continuent à prendre la forme d’une résistance souterraine, clandestine, dans le privé de la famille et derrière les murs de la maison. Là où sont les femmes, puisqu’elles ont, encore et toujours, la charge de l’entretien quotidien des être humains de tous les âges (enfants, compagnons, vieillards). Une résistance faite de petites choses quotidiennes, sourde et obstinée, nouant des complicités entre femmes qui sont volontairement cachées aux yeux des hommes dominants, et donc de la société.
Cette invisibilité des luttes des femmes, nous en sommes conscientes et nous la portons nous-mêmes. Même entre des générations proches, la transmission est difficile. Alors, dès que l’on s’éloigne dans l’histoire, c’est encore plus compliqué, plus flou. Les femmes ont pourtant été là dans toutes les révolutions, dans toutes les luttes de libération nationale, dans toutes les grèves. Elles se sont battues contre toutes les oppressions en même temps que contre l’oppression spécifique qui les reléguait dans les maisons, devant les fourneaux et avec les enfants, à cause de leur sexe.
Elles sont sorties, nombreuses au sein des mouvements sociaux, et n’ont pas bénéficié au même titre que les hommes des avancées obtenues. Parce que leur rôle dans ces victoires a été minoré, voire ignoré. Et du coup nous avons du mal à retrouver nous-mêmes dans l’histoire les traces de la présence des femmes, nous connaissons mal cette histoire qui est pourtant la nôtre.
Nous sommes héritières de ces luttes. Celles des années 1970 en Occident, si fondamentales pour notre vie quotidienne d’aujourd’hui, mais aussi les « grèves des ventres » qui ont eu lieu plusieurs fois au cours des siècles et lors desquelles des femmes refusaient de donner naissance à des enfants pour la patrie, pour le travail, pour la famille... ou les « grèves des femmes » quand elles arrêtent (pour un temps...) de remplir leurs rôles traditionnels de nourricières, de ménagères et d’objets sexuels. Ce fut le cas en Suisse, le 14 juin 1991, lorsque des centaines de milliers de femmes ont participé à une journée de grève pour l’égalité au cri de « Les bras croisés, le pays perd pied ! ».
Nous sommes héritières et solidaires de ces batailles diverses et mouvantes qui ont lieu en permanence partout dans le monde, et décidées à les poursuivre tant qu’il le faudra.
Extrait
« On a longtemps pris la parole de l’homme pour la vérité universelle et la plus haute expression de l’intelligence, comme l’organe viril constituait la plus noble expression de la sexualité.
Il faut que les femmes crient aujourd’hui. Et que les autres femmes – et les hommes – aient envie d’entendre ce cri. Qui n’est pas un cri de haine, à peine de colère, car alors il devrait se retourner contre elles-mêmes. Mais un cri de vie. Il faut enfin guérir d’être femme. Non pas d’être née femme mais d’avoir été élevée femme dans un univers d’hommes, d’avoir vécu chaque étape et chaque acte de notre vie avec les yeux des hommes et les critères des hommes.
Et ce n’est pas en continuant à écouter ce qu’ils disent, eux, en notre nom ou pour notre bien, que nous pouvons guérir. »
Benoîte Groult (Ainsi soit-elle)Où sont les hommes ?
Au début de l’histoire, il y a une rencontre entre deux êtres de sexe différent qui ont une relation sexuelle et, parfois, l’alchimie « du hasard et de la nécessité » enclenche le processus de procréation qui engage, dans le corps féminin, une grossesse. Quelle conscience ont les deux personnes en présence, lors de leur relation, de cet engrenage ? Il faudra bien aussi poser la question à l’homme car, à la fin de l’histoire, il n’y a qu’une femme pour assumer la responsabilité … disparu, le partenaire masculin, dès que la biologie fait son œuvre dans le corps féminin !?
Dans notre travail de réflexion, nous avons eu du mal à parler de la place des hommes, en tant qu’êtres sexués et sociaux, dans la problématique de la maternité, tout en sachant qu’ils y jouent bien sûr un rôle important. Notre propos vise la qualité d’être social, construit et assumé par les hommes en tant que genre masculin en regard de la catégorie « femmes » dont nous faisons partie et qui est le sujet principal de cette brochure. Interroger la place des hommes à partir des relations sexuelles, de la conception, de la situation de grossesse est difficile. Cette difficulté est directement liée à la position de dominants dont ils héritent, bon gré mal gré, dans la société.
Dans les « démocraties capitalistes occidentales », ce sont les hommes qui, en grande majorité, détiennent les leviers du pouvoir, que ce soit au niveau économique, social, culturel ou politique, et ce ne sont pas les quelques rares femmes formées dans les hautes écoles du pouvoir en place qui pourraient y changer quelque chose.
Penseurs, gérants de la société, ils édictent des principes, des dogmes sur l’avenir de l’humanité dans son ensemble, et du rôle des femmes en particulier. Si, à notre époque, ce pouvoir tend à s’amoindrir, le poids séculaire d’une histoire écrite principalement par des hommes, curés ou législateurs, politiques ou spécialistes, chercheurs ou historiens, pèse toujours lourd sur nos représentations du monde.
Certaines sociétés ont attribué aux seules femmes le pouvoir de faire des enfants ; elles nous ont divinisées, adorées pour ce pouvoir. D’autres nous ont considérées comme le simple réceptacle de la semence masculine. Aujourd’hui, les législations, les codes de moralité, les dogmes religieux sur le respect de la vie dès la conception, la place de la mère… relèvent de la même logique : nous sommes perpétuellement renvoyées à notre ventre. Et c’est notamment à ce titre que nous sommes sous contrôle.Nous vivons dans une société patriarcale. On n’éduque pas les garçons comme les filles : dès la petite enfance, les rôles se dessinent. C’est un long processus de construction sociale qui prépare chaque membre de la société à être à sa place. Les parents, les femmes, les hommes, l’entourage participent à perpétuer les clichés du mec, petit macho, et de la petite fille, femme puis mère. Dans les relations entre adultes, quand un homme et une femme se rencontrent et font l’amour, ils sont déjà « construits », et ces adultes construits éduqueront des enfants qui eux-mêmes grandiront…. C’est ainsi que se perpétue le système patriarcal.
Certes, la place des hommes a un peu évolué : ils s’impliquent davantage dans l’élevage des enfants et réclament leur part de parentalité, en particulier devant le juge. Dans le quotidien, ils sont de plus en plus à faire « des petits gestes » … qui sont tout de suite remarqués. Il y a quelques changements de droits, de valeurs et d’attitudes, mais cela ne dépend que de la bonne volonté des personnes concernées. Si, dans le discours, les choses semblent avoir avancé, les incidences sont minimes et le système ne bronche pas.
Ce sont toujours les femmes en majorité qui effectuent les tâches essentielles à la survie, et cela sans reconnaissance sociale, sans considération de l’importance de ce travail.Il serait temps que les hommes prennent conscience de la situation, qu’ils cessent de gérer le corps des femmes malgré elles, qu’au contraire ils assument, participent, se responsabilisent différemment dans le processus de la grossesse. Que cette situation soit vécue au pluriel, masculin-féminin, et non plus au féminin singulier.
Par exemple, qu’en est-il de la recherche sur la contraception masculine ?
Pourtant, ce sont majoritairement des hommes qui dirigent et gèrent les laboratoires produisant les pilules, les stérilets. Ils constituent aussi l’essentiel du corps médical qui les administre ou qui pratique les avortements.
Quant à l’infanticide, pratiqué par des femmes dans la plus grande solitude, les hommes s’en échappent la plupart du temps sauf, dans de rares cas, quand ils sont mis en cause par une procédure judiciaire.
Comment le pouvoir, en l’occurrence des hommes, pourrait-il prétendre accompagner la décision des femmes de vouloir ou non poursuivre une grossesse, en respectant notre volonté d’autonomie et la reconnaissance de nos choix ?
Il faut souligner que lorsque nous revendiquons la liberté de décider nous-mêmes de gérer les suites de relations sexuelles, nous nous piégeons en quelque sorte, en déclarant que ces affaires sont les nôtres et pas celles des hommes. Tout cela n’est pas simple !Si nous vivons des situations tellement difficiles pour éviter un enfantement non désiré, les hommes portent une grande part de responsabilité : à la fois par leur position de pouvoir au titre de juges, de médecins, de psychiatres, de législateurs, par leur non-prise en charge du rôle de leurs spermatozoïdes et par leur croyance tenace au fait que le désir masculin serait plus impérieux que le désir féminin. Ils participent aussi à construire un imaginaire de la Femme et de l’Amour qui les dédouane d’une prise en charge concrète des conséquences de l’acte amoureux. La femme idéale n’a pas ses règles, n’ovule pas régulièrement et ne court pas le risque d’une grossesse à chaque relation sexuelle.
Il faudrait une prise de conscience commune de la situation actuelle faite aux femmes par la « désinvolture » masculine à ne pas anticiper la contraception, à ne pas comprendre comment nous vivons notre assignation biologique et devons la gérer.
Il y a aussi à interroger les connotations négatives portées par l’abstinence ou par la masturbation comme expressions de manque, de perversion, ne laissant valide qu’un seul mode de plaisir sexuel avec un partenaire : la relation hétérosexuelle avec érection, pénétration et éjaculation. Et ce n’est pas un hasard si le mode de plaisir socialement prôné est celui qui est fécondant.
De fait, les hommes sont bien présents dans l’histoire des femmes mais se cachent derrière un paravent social qui les protège de toute responsabilité individuelle et collective. Dans la posture de domination, il est plus aisé de garder les avantages sans les inconvénients. Ainsi, on désigne les hommes comme géniteurs mais rarement comme procréateurs potentiels. Leur destin n’est pas lié à la biologie : un homme peut exister socialement sans être père, son identité culturelle n’est pas liée à la paternité ; ce qui n’est pas le cas pour une femme revendiquant une identité détachée de sa condition dite « féminine » car, pour ce faire, il lui faudra alors gagner une place dans le domaine masculin : cette caricature de la sexuation de nos sociétés est, hélas, encore bien réelle.Conclusion
Tous nos coïts ne peuvent pas aboutir à la naissance d’un enfant. Et
pour que cela ne soit pas, il faut bien que quelqu’un s’en préoccupe.
C’est en cela que notre société est hypocrite : elle charge les femmes
qui, par leur biologie, sont les seules exposées au risque de grossesse,
d’assurer la régulation des naissances tout en les condamnant si elles le
font en dehors des limites étroites fixées par la morale, la justice et la
technique.Cette responsabilité nous incombe dès la première caresse… et, si le
coït a été fécond, l’angoisse et la recherche des moyens de ne pas avoir
d’enfant ne nous quittent pas.Des femmes, coincées, choisissent la vie, la leur, en annulant cette autre
vie potentielle et prennent tous les risques plutôt que d’être mères, à
commencer par celui de mourir, mais aussi celui d’être jetées en prison.Ce qui est puni dans l’infanticide, c’est notre capacité à gérer nous-mêmes
les contradictions dans lesquelles nous sommes placées. Cette
réalité, en plus d’être condamnée, est taboue.Cette brochure s’attaque à ce tabou et veut sortir du silence et de
l’isolement des situations individuelles. Nous souhaitons que l’analyse
collective permette la déculpabilisation et que nos réflexions suscitent
des débats et une remise en cause des condamnations, morales comme
judiciaires.Nous voulons que l’on cesse de légiférer sur le ventre des femmes et, audelà,
interroger cette société qui nous punit pour notre façon de gérer
une fécondité dont les hommes, pour la plupart, n’assument pas les
conséquences.Nous avons réfléchi à huit, dans nos diversités de situations, de vécus, et
nous pensons que l’infanticide, parce qu’il est le résultat de la situation
faite aux femmes dans cette société, fait partie de notre histoire et que
cette histoire est commune à toutes les femmes.
Bibliographie
BABIN, Sylvie (2001). Des maternités impansables. Accompagnement
des parentalités blessées. L’Harmattan, Sexualité Humaine.
BADINTER, Élisabeth (1980). L’Amour en plus. Histoire de l’amour
maternel - XVII-XXe siècle . Flammarion.
BELOTTI, Elena Gianini (1974). Du côté des petites filles. Des
femmes.
BARD, Christine, CHAUVAUD, Frédéric, PERROT, Michelle, & PETIT,
Jacques-Guy (dir.) (2002). Femmes et justice pénale. XIX-XXe siècles.
Presse universitaires de Rennes.
BAULIEU, Étienne-Émile, HERITIER, Françoise, & LERIDON, Henri
(dir.) (1999). Contraception : contrainte ou liberté. Odile Jacob.
BONNET Catherine (1990). Geste d’amour. L’accouchement sous X.
Odile Jacob.
DHAVERNAS Odile (1978). Droits des femmes, pouvoir des hommes.
Seuil, coll. « Libre à elles ».
DELPHY, Christine (1998-2001). L’ennemi principal. Vol. 1 : Économie
politique du patriarcat. Vol. 2 : Penser le genre. Syllepse.
DELPHY, Christine (octobre 2000). « Comment nous en venons à
avorter (nos vies sexuelles) ». Le Monde.
DUVERT, Tony (1973). Le Bon Sexe illustré. Minuit.
DUVERT, Tony (1980). L’enfant au masculin. Minuit.
EHRENREICH, Barbara, & ENGLISH, Deirdre (1976). Sorcières, sages-femmes et infirmières. Une histoire des femmes et de la médecine. Le
remue-ménage, Québec.
FIRESTONE, Shulamith (1972). La Dialectique du sexe. Stock.
FRIGON, Sylvie (2003). L’Homicide conjugal au féminin d’hier à
aujourd’hui. Le remue-ménage, Québec.
GAUTHIER, Xavière (2004). Paroles d’avortées. La Martinière.
GROULT, Benoîte (1977). Ainsi soit-elle. Livre de poche.
GUERNALEC-LEVY, Gaëlle (2007). Je ne suis pas enceinte. Stock.
GUILLAUMIN, Colette (1992). Sexe, race et pratique du pouvoir. L’idée
de Nature. Côté-femmes.
KNIBIELHER, Yvonne (2000). Histoire des mères et de la maternité en
Occident. PUF.
KNIBIELHER, Yvonne, & FOUQUET, Catherine (1982). L’Histoire
des mères du Moyen-âge à nos jours. Hachette, Pluriel.
LES CHIMÈRES, Collectif (1975). Maternité esclave. 10/18.
MAC LAREN, Angus (1996). Histoire de la contraception de l’Antiquité
à nos jours. Noêsis, Paris.
MARINOPOULOS, Sophie (2008). La Vie ordinaire d’une mère
meurtrière. Fayard.
MARINOPOULOS, Sophie (2005). Dans l’intime des mères. Fayard.
MATHIEU, Nicole-Claude (1977). Paternité biologique, maternité sociale
in MICHEL, Andrée (dir.) Femmes, sexisme et sociétés. PUF, coll.
« Sociologie d’aujourd’hui ».
MOSSUZ-LAVAU, Janine (1991). Les lois de l’amour. Les politiques
de la sexualité en France (1950-2002), 1ère édition. Payot, coll. « Petite
bibliothèque Payot ».
TABET, Paola (1998). La Construction sociale de l’inégalité des sexes,
des outils et des corps. L’Harmattan.
TRINQUIER, Christel (1997). Femmes en prison. Le Cherche Midi,
coll. « Documents ».
TSIKOUNAS, Myriam (2008). Éternelles coupables. Les femmes criminelles
de l’Antiquité à nos jours. Autrement.
VIDAL, Catherine & BENOIT-BROWAEYS, Dorothée (2005).
Cerveau, sexe et pouvoir. Belin.
COLLECTIF, D’une révolte à une lutte : 25 ans d’histoire du planning
familial, Tierce, Paris 1982
« Les implications d’une décision judiciaire sur les droits des femmes ».
Article paru dans Courant alternatif, mai 2008, n°180.
« De la pénalisation de l’infanticide à la remise en cause de l’infanticide »,
L’Envolée n°24, novembre 2008.
Autres références :
Films et documentaires
Une mère tue ses enfants. France 2, émission Mots croisés. Yves Calvi. 17
octobre 2006.
Regarde, elle a les yeux grand ouverts, film de Nicole Grand et Yann Le Masson,
Les Films du grain de sable, 77 minutes, documentaire, France, 1980.
Avortement, une liberté fragile, film de Régis Sauder, 52 minutes, documentaire,
2004.
Émissions France Culture
Sur les docks. Pierre Chevalier. « Tabous (2/5). L’infanticide : dissipation
d’un tabou ». Documentaire de Maylis Besserie et François Teste. 18 mars
2008.
Le bien commun. Antoine Garapon. « L’inscription à l’état civil de tout
foetus né sans vie ». Maurice Godelier, anthropologue, et Dominique Thouvenin,
juriste, 12 mars 2008.
Colloque
Le déni de grossesse. État des lieux, enjeux et perspectives (23-24 octobre
2008) organisé par l’Association française pour la reconnaissance du déni de
grossesse. Université Paul-Sabatier, Toulouse.
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (747.5 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (5.1 Mo)