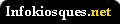E
L’enfance comme catégorie socialement dominée
mis en ligne le 19 juin 2008 - Anonyme
Au commencement était S. Firestone ...
Cette recherche trouve sa source, son point de départ, son élément déclencheur, dans un livre. Dans un hasard finalement. Préoccupée par des questions sociologiques liées au genre, politiques liées au féminisme, je trouvais un vieil ouvrage intitulé La dialectique du sexe, dont l’auteure m’était parfaitement inconnue. Dans ce livre, un chapitre, intitulé « Pour l’abolition de l’enfance » déclencha – sans le savoir – le processus qui me mena ici. Au fil de ces pages, tout un ensemble d’éléments, de certitudes, de représentations sous-jacentes, qui m’avaient toujours semblé si familier, bien que douloureux, m’est soudain apparu comme éminemment problématique : pourquoi l’enfance ? pourquoi l’autorité ? et surtout, comment ?
Au commencement sûrement bien avant ça...
L’enfant heurtée par le monde des adultes, par ses rappels à l’ordre, par ses injonctions à la soumission. L’enfant « rebelle », « violente », « insolente », « écorchée-vive », selon leurs mots à eux/elles, leurs mots d’adultes.
L’enfant réprimée, punie, renvoyée, frappée, jugée, méprisée.
L’enfant qui ne comprenait pas pourquoi d’autres pouvaient décider à sa place, qui ne voyait pas pourquoi leur obéir.
L’enfant que j’étais.
Celle que je suis encore, au fond. Mon moteur.
L’enfant que chacun-e a quelque part en lui/elle.
L’enfant que partout ce monde essaie d’étouffer, de contraindre, de dresser.
Bases théoriques et problématique
Occupant une place importante dans le droit et la psychologie, l’enfant comme être social semble souvent délaissé par la sociologie, du moins en tant qu’objet. Ainsi, sur quatre dictionnaires de sociologie consultés, il n’y a pas d’entrée à "enfance" ou "enfant". La sociologie de l’enfance apparaît comme un champ relativement nouveau, encore au stade de la définition de ses paradigmes et de l’élaboration de ses outils de recherche.
A. Tentative de définition des éléments théoriques
Le sujet mobilisant des notions polysémiques et polémiques, imprégnées de sens commun et aux contours flous, il m’a paru nécessaire de consacrer une partie à tenter de les définir, tout en inscrivant ma démarche dans le cadre théorique qui la sous-tend. N’ignorant pas que le regard sociologique est lui-même tributaire des représentations de sa discipline, il semblait important de préciser quelle était ma posture et comment elle s’inscrivait dans l’ensemble théorique. Cette partie peut sembler longue et fastidieuse, mais il me semble important que les termes employés soient éclaircis.
1. L’enfance comme catégorie socialement construite
À la suite des travaux de P. Ariès (La vie familiale sous l’ancien régime), on s’accorde à considérer la notion d’enfance comme une construction sociale : « l’enfance renvoie à des réalités fort diverses au fil du temps, réalités caractérisées davantage par la dépendance que par l’âge. Les êtres que l’on distingue et traite aujourd’hui comme enfants n’étaient pas toujours différenciés » (Danic I., Delalande J., Rayou P., Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets, méthodes et terrains de recherche en sciences sociales), « l’enfance est une forme structurelle de toute société, c’est une construction sociale variable selon les contextes socio-historiques » (Sirota R., Éléments pour une sociologie de l’enfance). On constate dès lors une double réalité de l’enfance : l’objectivité du développement physiologique qui fait de l’enfant un-e être inachevé-e biologiquement ; la construction culturelle d’une catégorie qui redouble et dépasse la différenciation biologique. A partir de là, on peut appréhender l’enfance comme catégorie sociale résultant d’un processus de classification : l’enfant est « un membre d’une catégorie sociale, soumis à un statut qui, dans une société donnée, détermine les caractéristiques de sa condition d’enfant » (Chombart de Lauwe M-J. et al, Enfants en-jeu).
Définition de ce qui est entendu ici par catégorie
La pensée humaine fonctionne par catégorisation : pour comprendre le monde qui nous entoure, nous nous référons à des représentations qui nous permettent d’appréhender les objets et les individus non comme singulier-e-s mais comme correspondant à un modèle. Ainsi nous distinguons une montagne d’une vallée, alors même que la limite est floue, l’un étant la continuité de l’autre ; et ce parce que nous avons intégré les représentations mentales de ce qu’est une montagne et ce qu’est une vallée. Il en va de même dans le monde social, où les individus sont contraint-e-s de recourir à des catégories pour comprendre leur environnement, s’adapter aux situations, communiquer, interagir dans les relations. Selon les disciplines et les auteurs, on parlera de schèmes, de stéréotypes (dans le sens de représentations typiques et non dans son acceptation courante péjorative), de lieux communs, d’étiquettes, de préjugés, de représentations, de modèles, etc.
« Toute interprétation de ce monde est basée sur une réserve d’expériences préalables, les nôtres propres ou celles que nous ont transmises nos parents ou nos professeurs ; ces expériences, sous forme de "connaissances disponibles", fonctionnent comme schèmes de références. » (A. Schütz, Le chercheur et le quotidien)
Les catégories employées définissent les frontières, la différence entre « nous » et « eux-elles », renvoyant à la notion d’altérité ; mais également des informations sur les membres reconnu-e-s comme appartenant à ces catégories, les attributs qui leur sont supposés : « la catégorie activée n’indique pas seulement l’appartenance d’une personne à un groupe donné, mais fait également appel à la connaissance contenue dans ces structures » (Moscovici S., Psychologie sociale des relations à autrui). Elles permettent aussi de définir les rôles des individus, tels qu’analysés par E. Goffman, la manière dont on attend qu’ils-elles se comportent comme l’attitude à adopter face à eux-elles. Ces rôles fonctionnent comme grilles de comportements et génèrent des attentes : conformément à l’étiquette qui nous est attribuée, nous sommes tenus d’agir d’une manière donnée : « on peut définir un rôle comme une réponse type à une attente type » (Berger P., Invitation à la sociologie), ces modèles nous étant pré-fournis par la société. Dans ce sens on peut les rapprocher de la notion d’habitus chez P. Bourdieu. Les catégories sont à étudier de manière relationnelle, chacun-e attendant de l’autre qu’il-elle corresponde à ses attentes, chaque individu agissant conformément à l’étiquette qui lui est attribuée, dans un processus réciproque : « nous devenons ce qu’on dit que nous sommes » (idem).
Le langage est un mécanisme fondateur de cette catégorisation, en tant qu’il objective l’expérience et lui permet de se détacher du phénomène particulier : ainsi nous sommes capables d’échanger nos expériences et de les partager, et même de les identifier : saurions-nous que nous sommes amoureux s’il n’y avait pas un mot, un concept que nous ayons intégré auquel nous puissions faire correspondre notre expérience singulière ? Le langage permet de définir la réalité sociale et de la maintenir : le simple fait d’avoir des termes différents pour désigner les catégories entérine leur distinction, leur séparation.
Ces catégories comportent toujours une part d’arbitraire : le fondement apparemment rationnel de la distinction n’est que le résultat du processus de légitimation. L’autre est celui socialement reconnu comme tel ; il n’existe pas forcément d’adéquation entre réalité et représentation mais simplement une saisie d’éléments jugés significatifs établissant une différentiation ; « nous ne nous penchons que sur certains aspects de cet objet typifié » (Schütz A., Le chercheur et le quotidien). Les classifications sont liées aux rapports sociaux, au contexte historique, varient dans le temps et l’espace. Pourtant, elles sont vues comme « naturelles », intériorisées au point d’invisibiliser leur fondement social : les catégories ne sont pas appréhendées comme constructions sociales mais comme réalités objectives, comme « allant de soi » (A. Schütz), rendues évidentes par un processus de légitimation, comme l’expliquent P. Berger et T. Luckmann (La construction sociale de la réalité).
Si ces catégories se créent dans l’expérience et se constituent au travers des interactions, elles se cristallisent, s’institutionnalisent et se transmettent socialement : le « stock commun de connaissance », s’il est constamment modifié, complété, négocié est à la base hérité, comme le langage nous est appris à l’enfance. Dans ce sens, il s’impose d’une certaine manière aux individus, puisqu’il est donné et non choisi et généralement vu comme incontestable.
2. Le rapport entre enfant et adulte et la question de l’autorité
D’autre part, il semble que, dans les représentations courantes, les rapports entre adultes et enfants sont liés à la question de l’autorité, l’ « autorité parentale » étant consacrée par le droit, celle des enseignant-e-s perçue comme attribut nécessaire. Depuis l’autorité paternelle de la Rome antique octroyant au père le droit de vie et de mort sur ses enfants, cette notion semble avoir beaucoup évolué jusqu’à parler aujourd’hui d’ « autorité démocratique ». La notion apparaît également fréquemment comme problématique, puisque les médias traitent régulièrement de « crise de l’autorité ». « L’adulte est a priori dans une situation de dominant face à l’enfant, du fait de leurs statuts respectifs » (Danic I., Delalande J., Rayou P., Enquêter auprès d’enfants et de jeunes. Objets, méthodes et terrains de recherche en sciences sociales), « l’adulte est celui qui a autorité sur [les enfants], qui sait et enseigne aux enfants » (idem). Les travaux de M. Fize (A mort la famille !), sociologue au CNRS, semblent intéressants dans leur démarche de reconstitution de l’histoire de l’autorité parentale (paternelle plus précisément). Toutefois, la frontière entre idéologique et sociologique paraît ici parfois bien mince.
Définition de ce qui est entendu ici par autorité
Là aussi, il convient de préciser les concepts mobilisés. Les thématiques de l’autorité, du pouvoir et de la domination semblent parcourir l’histoire de la sociologie : centrales dans la typification proposée par M. Weber ou dans l’analyse stratégique de M. Crozier, tout comme dans la sociologie de P. Bourdieu, elles sont présentes en filigrane à travers de nombreuses notions sociologiques, dans l’idée de contrôle social, de normes, des relations internationales aux relations de genre. Toutefois, il ne semble pas y avoir de consensus quant à l’usage de ces notions, dont le contenu peut varier d’un auteur à l’autre, selon l’objet d’étude auquel elles sont appliquées ou la discipline dans laquelle l’auteur s’inscrit. De plus, les concepts mobilisés ne sont pas toujours clairement définis, souvent utilisés comme synonymes ou explicités uniquement par rapport à l’objet et non dans leur sens général. J’ai donc essayé de synthétiser plusieurs point de vue, afin de proposer une définition de ces concepts et de leurs liens applicable à l’analyse.
Le pouvoir est la capacité pour un individu à imposer sa volonté, « capacité de contraindre, de forcer, de violenter autrui » (Fischer G-N., La dynamique du social. Violence, pouvoir et changements), Il est toujours inscrit dans une relation sociale qui suppose une asymétrie, une inégalité, c’est-à-dire que l’individu l’exerçant détient des ressources supérieures à celles de l’autre. On peut préciser que la contrainte exercée peut viser à faire adopter un comportement à l’individu ou alors une idée : le pouvoir serait alors aussi bien applicable aux actions qu’aux représentations. Le pouvoir peut se définir comme « la chance de faire triompher au sein d’une relation sociale sa propre volonté, même contre la résistance d’autrui » (Weber M., Economie et société, Les catégories de la sociologie).
Les ressources qui fondent le pouvoir peuvent être de nature différente : G-N. Fischer (ibidem) distingue la possession des moyens de sanction, incluant tous les moyens dont un individu dispose pour menacer, récompenser ou punir, ce qui renvoie à l’usage de la coercition, de la force et de la violence ; l’information et toutes formes de connaissance ; la compétence qui renvoie à la notion d’expert-e ; l’identification qui érige le-la détenteur-rice du pouvoir en modèle ; la légitimité, qui concerne les fondements rationnels et idéologiques tendant à faire voir le pouvoir comme allant de soi ; la structure socio-affective plaçant l’individu subissant le pouvoir dans une relation de dépendance vis-à-vis d’une personnalité centrale idéalisée. Ce modèle parait intéressant pour saisir les différentes assises du pouvoir, toutefois certaines ressources conférant à leur détenteur-rice un certain pouvoir semblent manquantes, comme la propriété privée, la possession ou encore le règlement ou la loi.
Le pouvoir est un rapport de domination et de soumission : « tout pouvoir est pouvoir sur » (idem), ce qui implique que le rapport de pouvoir est structuré entre des positions de supériorité et d’infériorité, des rôles de dominant-e-s et de dominé-e-s. La domination peut être interpersonnelle, mais également sociale quand elle oppose deux catégories distinctes au sein d’une société. La domination est le pouvoir en actes, l’accomplissement de la capacité dans la relation. Elle implique également une généralisation, une systématisation du pouvoir exercé par une catégorie sur l’autre, et renvoie le plus souvent à des aspects structurels.
L’autorité est une forme spécifique de pouvoir, qui intervient lorsque celui-ci est légitime, c’est-à-dire sous-tendu par un système de représentations qui vise à le faire accepter. La légitimité peut être rapportée à des valeurs définissant ce qui est juste et équitable, et par là donnant le droit à l’individu détenteur-rice du pouvoir de l’exercer. Dans la notion d’autorité l’interaction est centrale : si l’on peut considérer l’existence de pouvoirs unilatéraux, l’autorité implique une réciprocité, un échange de sens. Auctor, d’où dérive autorité, aurait signifié en latin « possédant le pouvoir d’imposer l’obéissance » : l’autorité suppose une forme de reconnaissance, d’adhésion, passant par un certain acquiescement de celui-celle qui la subit, ce dernier reconnaissant à son-sa détenteur-rice le droit de l’exercer. La subjectivité joue également un rôle plus important, la légitimité différant de la légalité par son caractère non-objectif et non-rationnel. L’autorité est la forme particulière du pouvoir qui ne nécessite aucun recours à la coercition, puisqu’elle est supposée produire l’obéissance par sa seule légitimité, sans nécessiter d’explications ou de justifications : « l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué » (Arendt H., « Qu’est ce que l’autorité ? »). G. Mendel explique cependant qu’autorité et coercition ne peuvent être complètement séparées : derrière la première plane implicitement la menace de la seconde, « la force a toujours été présente comme l’ultima ratio de l’autorité » (Mendel G., Une histoire de l’autorité, permanence et variations), comme recours ultime en cas de désobéissance.
B. Questionnements et regard sur l’objet
On peut considérer la constitution des catégories comme liée à la question du pouvoir, dans la mesure ou elle s’inscrit dans une structure sociale et est tributaire des rapports de forces exercés dans cette structure. Puisqu’elles reflètent une certaine vision des choses et dans ce sens participent à la construction du monde, les catégories, comme le pouvoir de les constituer, représentent un enjeu de lutte, certains groupes étant en position de les décider pour d’autres. Il nous faut alors postuler l’existence d’inégalités sociales, opérant le lien entre les interactions de la vie quotidienne et l’existence de structures agissant en retour sur celles-ci. Ceci amène à mobiliser les travaux de P. Bourdieu, à travers des notions telles que celles d’ « habitus », de « violence symbolique », en considérant la classification comme le pouvoir d’imposer sa conception du monde, et donc liée à une sorte de "lutte de classement", en tant que les catégories ne sont pas uniquement distinctives mais également normatives, et sont tacitement acceptées comme légitimes par les deux parties, en même temps que le mécanisme de pouvoir qui les sous-tend est rendu invisible. De là, on peut étudier la constitution des catégories comme rapport de pouvoir, la distinction étant initiée par la catégorie dominante et considérée comme légitime de part et d’autre.
Le lien entre classification et pouvoir peut être appréhendé dans le cadre des rapports entre enfants et adultes. Il semble intuitivement que les caractéristiques même de l’enfance en tant que catégorie se lient à la question de l’autorité, puisque déjà au niveau juridique le droit consacre une sorte de mise sous tutelle de l’enfant, auquel l’autonomie et la responsabilité ne sont pas attribuées : le statut d’enfant implique donc une autorité de l’adulte concernant la prise de décisions, certains choix concernant l’enfant ne pouvant être effectués que par des adultes.
Notre problématique est donc double : tenter de mettre en lumière les caractéristiques différentielles socialement attribuées à l’enfant, et voir leur articulation avec le pouvoir détenu par les adultes à l’égard des enfants et ses mécanismes de légitimation, dans la quotidienneté des individus.
Ne disposant pas réellement de cadre d’analyse pour mener cette recherche, nous essaierons d’établir un parallèle entre les rapports hommes-femmes et les rapports adultes-enfants, les premier-e-s ayant fait l’objet de suffisamment de recherches pour nous éclairer. À la manière de ce que l’on appelle aujourd’hui les gender studies, on peut partir des mécanismes de différenciation et de classification pour en arriver à leur contribution au rapport de domination. De la même manière que E. Goffman parle de « classes sexuelles » (L’arrangement des sexes) pour désigner la catégorisation qui résulte de l’assignation à chaque sexe d’une étiquette de genre, nous pourrions parler de « classes d’âge » pour les deux groupes socialement définis sur la base du critère de l’âge, distinguant enfant d’adulte. « Il faudrait un terme qui soit à la notion d’âge ce qu’est le concept de genre à la notion de sexe. À défaut, on pourrait parler d’âge social au sens où il y a production sociale d’un groupe d’âge » (Enquêter auprès d’enfants et de jeunes, ibidem).
Le lien entre les rapports homme/femme et adulte/enfant nous paraît intéressant puisque présentant de nombreuses similitudes, s’agissant dans les deux cas d’une différence biologique, l’enfant étant effectivement un-e humain-e en cours de développement, entraînant des conséquences sur l’organisation sociale qui dépassent ce cadre d’origine, la distinction socialement produite tendant à apparaître de part et d’autre comme « naturelle ». Au delà des différences objectives s’élaborent des types, des modèles définissant des identités et des rôles différenciés à l’enfant et à l’adulte : à l’enfant le monde du jeu, de l’apprentissage, de l’école ; à l’adulte celui des responsabilités, du travail. Nous nous interrogerons donc sur ces modèles sur lesquels se fondent nos perceptions de l’autre et de nous-même, de l’enfant et de l’adulte. Comme l’ont étudié E. Goffman et P. Bourdieu qui, s’ils diffèrent de par leur méthodologie, leur vocabulaire, leurs cadres théoriques, s’accordent sur certains éléments d’analyse ; le sexe est une catégorie sociale, et la différenciation des rôles un processus d’identification double, de la part des hommes comme de celle des femmes, entérinant une certaine infériorité de statut des femmes, « dominées » chez P. Bourdieu, « groupe défavorisé » chez E. Goffman.
De plus, la désignation sociale de l’enfant est par de nombreux traits similaire à celle de la femme, comme le souligne S. Firestone en consacrant un chapitre intitulé « Pour l’abolition de l’enfance » dans un livre traitant de sexisme et de féminisme (La dialectique des sexes). Elle y établit un parallèle entre la domination subie par la femme et par l’enfant dans le cadre d’un système patriarcal, définissant ces deux catégories comme unies par « une expérience commune de l’oppression » ; de l’autorité paternelle romaine jusqu’à l’époque actuelle, où si les signes extérieurs de domination tendent à disparaître, « la ségrégation opère encore de toute sa force pour affermir la sujétion des enfants en tant que classe sociale », notamment à travers la dépendance économique et le système scolaire.
Notre intention est donc d’essayer de joindre la constitution des catégories à la question du pouvoir, en essayant de déceler comment la première peut influer sur la seconde, en tentant d’utiliser les outils de réflexions proposés par les études sur le genre.
L’idée de l’enfance comme construction sociale induit une difficulté de la définition de l’objet, puisque non-fondée sur des caractéristiques objectives et tributaire des évolutions socio-historiques. On peut retenir le critère juridique qui consacre le statut de mineur-e, et de considérer comme enfant tout individu de moins de 18 ans. Toutefois je suis consciente des limites de cette définition, dans la mesure où l’accession à la majorité ne semble pas marquer un changement radical dans la perception des individus par les autres comme par eux-elles-mêmes.
En guise de conclusion, quelques précisions s’imposent. Si je choisis de centrer mon regard sur le rapport d’autorité, c’est qu’il me semble que celui-ci reflète bien comment des institutions sociales peuvent être ressenties par ceux qui y sont engagés comme naturelles, normales, allant de soi ; et qu’il m’apparaît que le rôle du-de la sociologue est bien de questionner ce genre de représentations. Toutefois, il est certain que l’autorité est loin d’être le seul aspect de la relation entre enfants et adultes, qu’elle se mêle à des rapports affectifs, des besoins de protection, des craintes, des manifestations d’amour ; et qu’elle n’a pas pour but de nuire à l’enfant. Il me faudra par rapport à cela être vigilante, et ne pas plaquer la domination là où il peut se tramer nombre d’autres choses.
C. Questions qui articulent cette recherche
En guise de méthodologie
Cette enquête a mobilisé divers outils méthodologiques que je ne détaillerais pas ici : observations, entretiens, analyse de documents, discussions informelles, analyse d’image, etc.
J’ai fait le choix ici de présenter les pistes sue lesquelles s’appuie mon questionnement, selon les éléments que je souhaitais mettre en lumière. il s’agit donc plus de ce j’avais en tête dans mes situations de terrains, classé par thématiques abordées. À chaque fois sont donc présentés plusieurs types de questions, différentes manières d’aborder les choses. Sont traités ici conjointement l’enfant et l’adulte, dans la mesure où les éléments mis en valeur sont sensiblement les mêmes pour les deux catégories.
La désignation de l’autre catégorie :
Le langage jouant un rôle essentiel dans le processus de classification, puisque c’est en nommant le différent qu’on marque la limite ; il est intéressant de se pencher sur la manière dont les individus parlent de l’autre catégorie, quels sont les termes utilisés par l’adulte pour désigner les enfants et inversement, et quelles sont les connotations rattachées à ces termes.
Comment se parlent les catégories :
L’usage de la parole n’est pas neutre et peut révéler des mécanismes de pouvoir. Il est intéressant de voir comment les adultes s’adressent aux enfants et inversement, notamment sur les modes les plus significatifs d’une inégalité. Au niveau de l’observation, il s’agit de noter qui de l’adulte ou de l’enfant coupe la parole à l’autre, donne des ordres, utilise l’impératif et dans quelles occasions, à quelle fréquence, puis d’observer la réaction de l’autre (l’accepte-t-il ou non).
La représentation des catégories :
Il s’agit de voir comment chaque classe d’âge perçoit l’autre ainsi qu’elle-même, quelles différences les individus placent entre les deux, quelles sont les caractéristiques attribuées à l’enfant et à l’adulte. Les questions suivantes pourraient permettre d’aborder cet aspect : qu’est ce qu’un-e enfant/un-e adulte pour vous ? Pouvez-vous décrire un enfant/un adulte que vous aimer particulièrement ? Pouvez vous décrire le père/la mère/l’instituteur/l’enfant idéal-e ? Qu’est ce qui change quand un enfant devient un adulte ? Pour un-e enfant : est que tu aimes être un-e enfant ? Est-ce que tu as envie de devenir adulte ? Pourquoi ?
Le déroulement des conflits :
Il est question ici d’essayer de voir qui fait prévaloir son point de vue au sein de la relation enfant-adulte en cas de désaccord, puisqu’il nous semble que c’est au cœur des oppositions que l’autorité se fait voir de la manière la plus flagrante, dans la mesure où nous l’avons définie comme capacité à soumettre malgré le désaccord. Est entendu ici par conflit toute interaction où l’un-e des acteur-rice-s exprime une insatisfaction et réclame un changement de la situation en conséquence, et non l’acceptation courante qui en fait ne désigne que les cas où le désaccord tourne en dispute. Il semble que les ordres et interdictions entrent également dans cette catégorie, puisqu’ils sont moyens d’imposer sa volonté. Au niveau de l’observation, il s’agit de regarder le déroulement du conflit : ses causes, ses enjeux, l’attitude de chacun-e, sa conclusion. Qui est en désaccord ? Pourquoi ? Est-ce que l’un des deux essaie de calmer le jeu plus que l’autre ? Est ce que l’un des deux s’obstine plus que l’autre ? Est-ce que les acteurs expriment clairement leurs attentes ? Est-ce qu’ils écoutent et prennent en considération celles de l’autre ? Y’a-t-il tentative de compromis ? Si non, qui l’emporte ? Comment s’y prend l’enfant pour influer sur les décisions de l’adulte ? Comment s’y prend l’adulte pour influer sur les décisions de l’enfant ? Au niveau de l’entretien, les questions seraient les suivantes : quel est le dernier conflit/désaccord que vous ayez eu avec vos parents/enfants/élèves/instituteur ? A quel propos ? Vous êtes vous disputés ? Qui avait raison/tort ? Qui a « gagné » ? Etes vous souvent en désaccord ? Est-ce qu’il arrive que vos enfants/parents/instituteurs aient tort/agissent mal ? Dans quel cas ? Est-ce que votre père/mère/animateur/enfant vous donne des ordres ou vous interdit des choses ? Dans quel cas ? L’acceptez-vous ? Quel est le dernier ordre que vous ayez donné ?
La prise en compte de la volonté de l’enfant, de la parole de l’enfant :
Il s’agit ici de tenter de voir si les opinions, volontés, désirs exprimés par l’enfant sont pris en compte par l’adulte, si ses choix sont respectés. Si cet aspect nous semble important, il parait difficile à aborder. Il s’agit de parvenir à répondre aux questions suivantes : qui effectue les choix concernant l’enfant ? Quels sont les choix que peut faire l’enfant ? Quelles sont les décisions qu’il-elle peut prendre seul-e ? Quand prend-t-on en compte les opinions, les volontés de l’enfant ? Quand ne le fait-on pas ? On peut peut-être essayer d’aborder la question par des exemples précis : qui choisit l’école de l’enfant (quand un choix doit être fait) ? Qui choisit les activités extra-scolaires de l’enfant ? Qui choisit ses livres, ses vêtements ? Pourquoi ?
La conscience de l’autorité et ses mécanismes de légitimation :
J’essaie ici de voir si enfants et adultes identifient un rapport d’autorité ou non, quels termes ils utilisent, comment ils les définissent. Puis il est possible d’interroger les arguments, les justifications apportées de part et d’autre sur la question de l’autorité. Ceci me parait ne concerner que l’entretien : aux adultes, on pourraient poser les questions suivantes : qu’est ce que l’autorité ? Qui la détient ? Pourquoi ? Est ce normal ? Est-ce qu’un bon parent/enseignant/animateur doit faire preuve d’autorité ? Dans quels cas un parent/enseignant/animateur doit-il faire preuve d’autorité/donner des ordres ? À quoi sert la punition ? Que doit-on interdire à l’enfant ? L’enfant doit-il obéir à l’adulte ? Pourquoi ? À l’enfant, on peut demander : Qui a le droit de te punir/de t’interdire ? Pourquoi ? Est-ce normal ? Tes parents/enseignants/animateurs te donnent-ils des ordres/des interdictions/des punitions parfois ? Si oui, quand et lesquels ? Est-ce normal ? Est-ce qu’un bon parent/enseignant/animateur doit faire preuve d’autorité ? Est-ce que tes parents/enseignants/animateurs te disputent parfois ? Ont-ils raison ? Arrive-t-il que tes parents/enseignants/animateurs aient tort ? Dans quels cas ? Dois-tu obéir ? Pourquoi ?
Dans des situations plus spécifiques, on peut poser des questions plus précises (à l’entretien comme à l’observation) : par exemple le repas : qui décide du menu ? Comment participe l’enfant à la préparation du repas ? Qui décide de la quantité que mange l’enfant ? Que se passe-t-il quand l’enfant refuse de manger ? Quand l’enfant quitte-t-il la table et comment ?
Une dernière précision s’impose : les résultats présentés et les analyses mises en valeur ici sont bien évidemment tendanciels et ne reflètent en aucun cas l’ensemble des situations.
Partie 1 : La différenciation des catégories : un statut spécifique à l’enfance
Cette partie est consacrée à la distinction entre enfant et adulte : il s’agit de montrer qu’à partir d’une construction sociale, enfants et adultes ont des statuts différents.
I. Bref historique de l’émergence du statut spécifique de l’enfant
Cette partie tente, sur la base des travaux de P. Ariès, de montrer que la distinction entre enfant et adulte est une construction sociale qui a considérablement évolué au cours des siècles.
P. Ariès le premier a mis en avant l’idée de l’émergence du « sentiment de l’enfance », expliquant que celui-ci, tel qu’on peut le connaître aujourd’hui, n’existait pas au Moyen-Âge. L’examen des tableaux de l’époque en donne confirmation : les enfants y sont représenté-e-s comme des adultes miniatures, sans caractéristiques distinctives spécifiques autres que leur petite taille.
Au Moyen-Âge, donc, la vision de l’enfant héritée de l’antiquité le-la dépeint comme un-e être mauvais-e, porteur-se du pêché originel, qui constitue une charge pour la famille jusqu’à ce qu’il-elle soit en âge de travailler et de participer ainsi à l’économie domestique. Une seconde conception émerge peu à peu, issue du christianisme, insistant sur la pureté et l’innocence de l’enfant ; et avec elle apparaît le soucis de protection de l’enfance : interdiction de l’avortement et de l’infanticide par l’Église dès le IVe siècle. La création et la généralisation de sacrements religieux spécifiques à l’enfance, comme la première communion, montre bien cet intérêt particulier porté à l’enfance.
L’histoire du développement du sentiment de l’enfance, d’une considération spécifique apportée à l’enfant est, au-delà des images religieuses, à mettre en parallèle avec l’histoire de l’école et de l’institution scolaire.
« L’école est effectivement associée à la construction sociale de l’enfance, étant donné que l’État, au milieu du XVIIIe siècle, à institué, pour la première fois, la libération des activités du travail productif en faveur d’une partie du groupe générationnel le plus jeune [...], qui s’est progressivement élargie à toute la génération, avec l’institutionnalisation de la scolarité obligatoire » (Eléments pour une sociologie de l’enfance)
En effet, si au Moyen-Âge l’éducation se déroule dans la cellule familiale et est essentiellement axée sur l’apprentissage du métier paternel, les réflexions des pédagogues et des philosophes mettront l’accent sur la spécificité de l’enfant et la nécessité de distinguer les différents stades de l’enfance afin de donner à chacun-e une éducation adéquate.
L’époque des Lumières est celle d’une nouvelle approche de l’enfant notamment avec la publication de Emile ou de l’éducation de J-J. Rousseau, en 1762 et qui reste aujourd’hui un ouvrage de référence en matière d’éducation de par les idées novatrices, pour l’époque, qu’il développe en faveur de l’enfant. L’ouvrage s’adresse à un lectorat de mères et de précepteurs pour leur donner conseil sur le développement de l’enfant en sachant répondre à ses besoins réels. J-J. Rousseau se situe avec cet ouvrage en précurseur des recommandations qui se sont succédées à l’époque de la Révolution Française, fondées sur l’idée du progrès – à savoir que la connaissance libérerait l’homme de sa condition d’asservissement et que le progrès de l’humanité tiendrait à la diffusion du savoir. L’éducation devient alors un mot d’ordre et acquiert une place de choix dans la réflexion. on serait alors tenter de dire que ces travaux ont fourni le terreau pour le développement des travaux sur les pédagogies. Émerge alors le sentiment que l’avenir de l’humanité tient à la formation des enfants qui doivent être pris en charge par la société, notamment par l’institution scolaire.
Les enfants des classes populaires, tant qu’ils-elles ne pouvaient pas travailler, se retrouvaient en quelque sorte livré-e-s à eux-elles-mêmes durant la journée. En outre un grand nombre d’enfants étaient abandonné-e-s et se retrouvaient à vagabonder. C’est contre ce vagabondage et cette errance enfantine que des écoles ont été mises en place. Pour faire face à l’oisiveté des pauvres, l’école charitable gratuite a été mise en place dès la seconde moitié du XVIIe siècle avec les écoles des Frères qui, en plus d’« éviter la fainéantise des enfants , cherchaient à former de bons apprentis, une main d’œuvre qualifiée. L’école s’est développée pour devenir une institution étatique et laïque. L’Église, tout comme l’État se soucient de plus en plus de l’éducation des enfants, comme en témoigne la création des écoles maternelles en 1882. Au cours du XXe siècle, l’âge d’entrée à l’école s’est successivement réduit. Avec le développement du travail féminin, l’enfant est désormais couramment mis en crèche dès son troisième mois, soit à la fin du congé de maternité.
La popularisation au cours du XVIIe siècle de la mise en nourrice, si elle est parfois analysée comme un abandon et une marque d’indifférence des parents vis-à-vis de leurs enfants (cette pratique provoquait la mort de 25 à 30 % des nourrissons séparés de leur mère.) n’en constitue pas moins une pratique consacrant la spécificité de l’enfant. De même que les abandons, fréquents jusqu’aux XVIIIe et XIXe siècle traduisent la volonté des parents pauvres d’assurer la survivance de leurs enfants en les confiant à des hôpitaux (et donc un soucis de l’enfance), et ont pour conséquence la création de structures hospitalières spécialisées dans l’accueil des enfants abandonné-e-s. Cette pratique est décrite dans les contes de Perrault ou des Frères Grimm où les parents abandonnent les enfants dans la forêt, poussé-e-s par la misère.
Le lien que la mère entretient avec le nourrisson est manifeste de la représentation que celle-ci se fait de son rôle et de l’évolution de la place de l’enfant au sein de la famille : ainsi une certaine partie des mères s’est mise à allaiter sur les recommandations des Lumières et notamment de Rousseau. La question de l’allaitement et des soins portés aux enfants est sans cesse remaniée et les réponses qui y sont données fluctuent à mesure des modes. Ainsi il y a quelques décennies l’allaitement n’était plus préconisé pour redevenir aujourd’hui une pratique valorisée jugée bénéfique pour l’enfant. Suite à un long processus commencé au XIXe siècle, la maternité est aujourd’hui, en Occident tout du moins, très médicalisée. Un nombre considérable d’ouvrages scientifiques et de vulgarisation traitent spécifiquement de la grossesse. Des informations de toute part se succèdent pour dire à la mère ce qu’elle doit faire pendant sa grossesse et avec son enfant. L’enfant est donc devenu l’objet d’une préoccupation avant même qu’il-elle ne soit né-e.
Les enfants sont également objets d’un soucis médical particulier face aux taux de mortalité infantile très élevés : développement des maternités, stérilisation des tétines, utilisation de lait bouilli, accent mis sur l’hygiène etc.
Dans les milieux aristocrates et bourgeois, l’enfant commence à acquérir un statut spécifique, comme en témoigne le développement de tenues enfantines. Au XIXe, dans les milieux urbains aisés, un espace spécifique à l’enfant commence à être mis en place, visant, dans la logique hygiéniste de l’époque, à préserver l’enfant de l’intimité de ses parents. Cette nouvelle disposition de l’habitat rend compte d’une séparation entre l’univers de l’adulte et celui de l’enfant et de l’acquisition par l’enfant d’un espace privé symbolique.
La thématique du droit de l’enfant, si elle fait des apparitions régulières au cours des siècles, se cristallise au XXe siècle, et connaît ces dernières décennies un développement conséquent. En 1924 est adopté par la Société des Nations le premier texte international, appelé Déclaration de Genève, qui reconnaît un statut spécifique à l’enfant. Il sera confirmé par la création en 1947 de l’UNICEF (Fond des Nations Unies des secours d’urgence à l’enfant) et l’adoption par l’assemblée générale des Nations Unies en 1959 de la Déclaration des droits de l’enfant, jusqu’à la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, proclamée en 1989. Ces différents textes affirment la spécificité de l’enfant, qui, « en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d’une protection spéciale ».
Sous l’influence des sciences humaines, et notamment de l’accent mis par S. Freud et la psychanalyse sur la spécificité de l’enfance, s’accentue la consécration du statut de l’enfant : il n’est plus conçu comme passif, mais l’accent est mis sur ses capacités de compréhension et d’apprentissage. Il devient sujet, objet de recherche, champ d’investigation scientifique : des disciplines sont créées pour lesquelles il a une place centrale : psychologie du développement, pédiatrie, sciences de l’éducation, et dans une moindre mesure sociologie de la famille. Au XXe siècle, il est donc acquis que l’enfant a un statut particulier, et se développe nombre de discours qui lui sont réservés : comment l’éduquer, le-la soigner, comment l’aider à se développer. L’apparition de nombreuses revues de vulgarisation (Parents, Famili, Enfants magazine) concourront à entériner cette attention spécifique portée à l’enfant.
La notion de bientraitance vient parachever ce nouveau statut de l’enfant : l’orientation amorcée par la reconnaissance internationale des droits de l’enfant amène à la prise en considération de ses spécificités notamment psychologiques et la mise en place de structures adaptées à des enfants subissant des mauvais traitements. Cependant jusqu’à la publication d’un rapport national sur l’enfance maltraitée en 1992, le traitement de la maltraitance restait réservé aux professionnels du domaine de la santé. A partir de cette date nous pouvons considérer que cette question est devenue une préoccupation politique. Au même moment, au début des années 1990 a émergé la notion de bientraitance. « Bien-traiter, [...] c’est respecter la continuité du développement de l’enfant dans son histoire et l’aider à construire son identité dans la sécurité affective et l’épanouissement de toutes ses compétences. » (Enfants, adultes, vers une égalité de statuts ?)
II. Monde de l’adulte – monde de l’enfant
Cette partie s’attache à montrer en quoi les représentations consacrent la différence entre enfants et adultes, en décrivant pour chacun-e un monde spécifique et des manières d’être spécifiques.
A. Monde du jeu – monde des responsabilités
« L’enfance. Cette heureuse et brève période de l’existence où l’on a tout juste assez de conscience pour savourer la joie d’être et d’inconscience pour ignorer les difficultés de la vie. »
André Duval
La différenciation entre enfants et adultes se traduit par la représentation de deux univers distincts. Ainsi à l’enfant est associé le monde du jeu, du loisir, du plaisir immédiat, comme en témoigne la multitude d’activités disponibles pour enfants : poupées, légos, jeux de cartes, jeux vidéos, activités ludiques en MJC, parcs d’attractions, piscines, etc... L’univers de l’enfance est celui de l’insouciance, de la contrainte minimale : l’enfant « fait ce qu’il a envie, sans réfléchir aux conséquences » me dit Émilie, 17 ans, confirmée dans ses propos par Valérie, 12 ans : « Quand on est enfant, on peut encore faire plein de bêtises... ».
Le seul entretien que j’ai réalisé avec un enfant très jeune est à cet égard assez révélateur. En effet, quand je lui ai demandé ce qu’était un-e enfant, il m’a répondu en plaçant lui-même l’enfant en opposition à l’adulte, en marquant directement la distinction : « [les enfants], ils vont au lit plus tôt que les adultes », « [les adultes] ils font des choses plus difficiles que les enfants ».
En opposition, le monde des adultes est celui du sérieux : « un adulte il doit avoir quand même pas mal de responsabilités, il doit s’occuper, il doit travailler, il faut qu’il paye des choses... les courses, le loyer, l’électricité... Et ça ça fait pas trop envie... » m’explique Valérie, 12 ans. Le monde de l’adulte est représenté d’une manière peu attractive : « on ne peut même plus jouer » me dit Marie, 8 ans.
Le monde de l’enfant est également caractérisé par l’école, l’apprentissage, la découverte, mais sous une forme un peu légère, par contraste au monde de l’adulte. C’est l’âge où on apprend la vie, plus que des connaissances au sens strict.
Dans ce système de représentations, l’enfant est vu comme insouciant-e, ne se rendant pas réellement compte des réalités du monde. D’où une attention particulière qui doit lui être apporté, pour parer à sa naïveté et à son irresponsabilité.
B. Langue des adultes – langue des enfants
Dans Les mots et les femmes, étude de socio-linguistique portant sur le genre, M. Yaguello distingue entre langue des hommes et langue des femmes, soulignant que la manière de parler est différenciée selon le genre : les hommes respectent moins les tabous verbaux, usent d’un langage plus grossier tandis que les femmes se montrent plus polies. Ceci nous renvoie au statut des gros mots chez l’enfant, bien souvent règle d’or des parent-e-s comme des enseignant-e-s : « c’est pas joli des choses comme ça dans la bouche d’une petite fille » disait une dame à une fillette au parc (la fillette avait dit « merde »). Marc, 8 ans, m’expliquait qu’il y avait une tirelire chez lui, où tout le monde devait mettre dix centimes quand il-elle disait un gros mot. Elle a été installée à la base principalement par rapport à son grand-frère, qui semble en dire beaucoup. Il remarquait que ses parent-e-s mettaient beaucoup plus souvent de l’argent dans la tirelire que les enfants, « alors qu’ils le font même pas à chaque fois ». La majorité des parent-e-s insiste particulièrement sur ce point, et tou-te-s les adultes avec, sous la question de la politesse. Au final, les enfants ont effectivement un langage moins grossier que les adultes, au point que ce sont bien souvent eux-elles qui font remarquer aux adultes leurs écarts de vocabulaire (mon cousin de 6 ans me reprend constamment à grand renfort de « c’est pas bien de dire ça », « t’as dit un gros mot »).
Toujours dans le même ordre d’idée, il faut souligner la différenciation des sujets de conversation, certains thèmes étant reconnus comme l’apanage des adultes : politique, économie et actualité en général. Fréquemment les enfants s’entendent dire « c’est une discussion de grandes personnes », « tu comprendras quand tu seras grand-e », les excluant ainsi des conversations jugées « sérieuses ». Pour les plus petit-e-s, l’argument invoqué est qu’ils-elles ne comprennent pas, ne maîtrisent pas ce type de notions abstraites, mais en même temps comment le pourraient-ils-elles puisqu’on ne veut pas les leur expliquer ? Pour les adolescent-e-s, cette raison est plus difficile à invoquer, aux vues des enseignements en histoire, géographie et donc géopolitique, éducation civique, juridique et sociale, sciences économiques et sociales pour certain-e-s. J’ai pourtant constaté à l’occasion de repas de famille que des jeunes de 16 et 17 ans étaient écarté-e-s des conversations portant sur les élections présidentielles à venir : toutes leurs tentatives de prises de parole ont été avortées (interruption, absence de réponse). Moi même, je n’ai un droit de parole (limité) lors des conversations lancées par mon grand-père, sur des thématiques telles que les conflits armés ou l’immigration que depuis peu. Les sujets de conversations des enfants semblent ne devoir porter que sur des domaines mineurs, voire pour les petits enfants quasi-uniquement sur leur expériences vécues, excluant tout sujet d’abstraction ou de réflexion : s’ils-elles peuvent raconter leur journée passée avec des ami-e-s ou ce qu’ils-elles ont appris à l’école, il semble qu’on leur reconnaisse difficilement un avis sur une chose ne les concernant pas directement (« qu’est ce que t’en sais ? »).
Le rappel à la différenciation : « c’est pas de ton âge »
Non seulement les frontières entre les catégories existent et délimitent deux mondes distincts, mais elles sont constamment rappelées à l’esprit : « on verra quand tu seras grand », « tu veux faire quoi quand tu seras grand ? », entendent régulièrement les enfants. À de nombreux repas de famille, il y a une table pour les enfants et une table pour les adultes, qui parfois ne mangent pas en même temps. Au restaurant, les parents disent tout naturellement aux petit-e-s « tu prend un menu enfant ? ».Tou-te-s les parent-e-s expliquent à leurs enfants qu’ils-elles n’ont pas le droit de boire de l’alcool ou de fumer. Et quand la petite Marie demande à sa mère « bah pourquoi tu le fais toi alors ? », celle-ci répond « c’est pas pareil pour les adultes. Quand Quentin, 16 ans, se dispute avec sa mère parce qu’elle refuse qu’il sorte le soir avec des amis, elle lui répond : « je te rappelle que tu es encore mineur ! ». Dans un espace de vie collectif, quelques ami-e-s et moi-même aimons jouer : chahuter, faire de la corde à sauter, se courir après, faire des batailles d’eau, etc. Fréquemment, nous sommes l’objet de réflexions taquines : « vous êtes des vrais gosses ! ». Un jour, nous jouions avec Alice, 6 ans, quand une amie est passée et nous a dit : « on se demande qui sont les plus gamins ! »
III. Statut juridique de l’enfant
Sur la base de la législation comme donnée objective, j’étudierai ici le statut spécifique de l’enfant, objet d’une juridiction spécifique le plaçant sous l’autorité parentale.
Le statut juridique du-de la mineur-e est caractérisé par l’incapacité juridique. Celle-ci signifie que c’est l’administrateur-rice légal-e qui représente le-la mineur-e dans tous les actes civils. Elle a pour but d’éviter que le-la mineur-e contracte des engagements sans discernement pouvant aller à l’encontre de son propre intérêt. Sauf décision juridique contraire, le-la mineur-e est sous l’autorité parentale, qui représente le droit de contrainte des parents sur leur enfant mineur-e. Elle est conçue comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Les parents sont tou-te-s deux administrateur-rice-s et représentant-e-s légaux-ales du-de la mineur-e.
Article 371-2 du Code Civil :
L’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.
Ils ont à son égard droit et devoir de garde, de surveillance et d’éducation.
Plus concrètement, l’autorité parentale consiste à :
– déterminer le lieu de résidence du-de la mineur-e et exiger qu’il-elle y demeure effectivement : le-la mineur-e n’a pas le droit de quitter le domicile parental sans autorisation.
– protéger l’enfant dans sa vie privée et ses relations à autrui : les parents ont par exemple le droit d’interdire à leurs enfants certaines fréquentations pouvant leur être nuisibles. Les parents ont également un droit de regard sur les relations de leur enfant, qu ’elles soient amicales ou sexuelles. Ainsi, les parents peuvent porter plainte contre la personne qui a des relations sexuelles consenties avec leur enfant mineur-e (que celle-ci soit mineure ou majeure).
– prendre en charge la santé de l’enfant : les décisions concernant la santé physique (opération, traitements) et mentale (placement en psychiatrie) appartiennent aux parents.
– assurer l’éducation de l’enfant : les décisions concernant la scolarité de l’enfant, telles que l’établissement fréquenté ou l’orientation dépendent des parents.
– gérer les biens du-de la mineur-e : les parents ont l’administration et la jouissance des biens de leur enfant mineur-e, ce qui signifie que toute transaction financière du-de la mineur-e nécessite l’accord parental (ouverture d’un compte en banque, achat de biens). De même, les revenus du-de la mineur-e (intérêt d’épargne, salaire) sont perçus par les parents, qui ont le droit de les utiliser à condition de satisfaire aux besoins du-de la mineure. Les parents peuvent demander la nullité en justice d’un achat ou d’une vente effectué par le-la mineur-e.
La personnalité juridique de l’enfant est liée à la notion de capacité de discernement du-de la mineur-e, c’est à dire le moment ou l’enfant est reconnu-e, indépendamment de son âge, capable de comprendre ce qui se passe et de prendre des décisions en conséquence. Dans le cadre d’une procédure juridique, cette capacité de discernement permet au-à la mineur-e d’être entendu-e mais ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Par exemple, en cas de divorce, l’enfant peut être entendu-e à sa demande, à titre consultatif, par le juge à condition d’être reconnu capable de discernement. Par contre, il-elle ne peut pas aller à l’encontre de la décision, par exemple si le lieu de résidence désigné ne lui convient pas.
Le statut de mineur-e montre déjà une représentation particulière de l’enfant, comme dépendant-e de l’adulte tant au niveau de ses choix que de sa protection.
Partie 2 : Rapports d’autorité entre enfants et adultes
Après avoir montré qu’enfant et adulte ont des statuts différents, il s’agit de voir ici en quoi ces statuts définissent un certain type de rapport entre enfants et adultes, à savoir le rapport d’autorité.
I. Évolutions du rapport d’autorité
Il s’agit ici de revenir sur les mutations du rapport d’autorité, notamment celle du père sur l’enfant, depuis l’Antiquité, afin d’inscrire le rapport-autorité dans sa continuité historique.
S’il est ici nécessaire de découper les évolutions par périodes, ce n’est que pour permettre de les situer dans un mouvement chronologique, mais la réalité est évidemment plus complexe. Les mutations décrites ici n’ont valeur que de tendances, et ne se succèdent pas mais au contraire se chevauchent, s’entrelacent et se mêlent.
Enfant dérive du latin infans ; qui ne parle pas. Depuis l’Antiquité, l’enfant est conçu comme fragile et improductif, valorisé-e non par ce qu’il-elle est mais en tant que descendant-e ou adulte à venir, et placé-e sous une autorité paternelle absolue et incontestable.
Ainsi, dans toute l’Antiquité, le patriarche a droit de vie et de mort sur femmes et enfants. En Grèce comme à Rome, le rituel de présentation veut que le père prennent dans ses bras le nouveau-né, le reconnaissant comme son-sa descendant-e. S’il ne le fait pas, et au contraire détourne le regard de l’enfant, celui-celle-ci est mis à mort ou abandonné-e. En Mésopotamie, le père dispose du droit de vendre comme esclave n’importe quel-le membre de sa famille. La notion de majorité n’existant pas, l’enfant ne s’émancipe de l’autorité paternelle qu’à la mort de celui-ci, ou au mariage pour les femmes. L’autorité, encore appelée à Rome puissance paternelle, se justifie par la supériorité « naturelle » de l’homme, et l’idée d’une mauvaise nature des femmes comme des enfants. L’autorité du père est redoublée de celle de l’État : à Sparte les enfants sont enlevé-e-s à leur mère dès 7 ans et leur éducation, axée sur la rigueur et la discipline, est confiée à la cité jusqu’à l’âge de 20 ans pour les garçons.
Au Moyen-Âge, si l’éducation des enfants est l’affaire des femmes, c’est toujours le père qui est garant de la morale et de la discipline, au point que c’est sa propre valeur qui est mise en accusation si il n’est pas capable de se faire respecter. La norme sociale veut qu’il fasse régner sa loi auprès de sa femme comme de ses enfants, par l’usage de la force physique si nécessaire, s’il veut éviter honte et déshonneur.
À partir du XVIe siècle, les bouleversements politiques et religieux amènent à un affaiblissement de l’autorité paternelle : par exemple l’homme n’est plus jugé responsable en toutes circonstances des agissement de sa femme et ne peut plus utiliser la brutalité comme bon lui semble. Les Lumières tenteront d’amener la notion de respect en substitut à celle d’autorité et de mettre en valeur l’intérêt de l’enfant.
Au XVIIIe siècle on assiste à une résurgence du modèle autoritaire par la réaffirmation du caractère sacré de l’autorité paternelle : la majorité passe de 14 ans pour les garçons, 12 ans pour les filles à 30 ans pour les garçons et 25 pour les filles. Certains politiques réclament alors le rétablissement du droit de vie et de mort sur ses enfants accordé au père.
Le Code Civil vient en 1804 confirmer cette tendance, en proclamant mineur-e-s l’enfant et la femme, les plaçant sous la tutelle complète du père de famille ; et en instaurant le droit de correction, qui permettra au père de faire arrêter ses enfants et demander leur internement dans une prison d’État sans avoir à fournir la moindre justification.
Dans les milieux bourgeois du XIXe siècle, la famille reste le siège de la morale dont le père est garant : c’est lui qui fixe les grandes orientations de l’éducation, transmet les valeurs. Femme et enfants lui doivent obéissance, aucun désaccord ne saurait être exprimé.
Parallèlement émerge un mouvement de contestation de cette autorité paternelle absolue, articulée notamment autour du châtiment corporel ; qui trouvera de nombreux débouchés dans les années 1970 à travers la critique virulente du patriarcat. En association avec l’apport des sciences humaines et l’intérêt central apporté à l’enfant se créée dans cette décennie l’idée d’une démocratisation de la famille et de son évolution vers une structure plus égalitaire, où les idées de dialogue et de coopération sont mises en avant.
Ces dernières années, on remarque que la question de l’autorité est au cœur des préoccupations éducatives : ainsi, Le monde de l’éducation consacre un dossier de 21 pages à la question de l’autorité, intitulé « il est permis d’interdire », s’interrogeant sur les moyens de rétablir l’autorité à l’école, de sortir du laxisme, fustigeant l’héritage de mai 68 et les générations d’enfants-rois qui en sont nées.
II. Conflits et manifestations de l’autorité de l’adulte
Cette partie aborde les conflits entre enfants et adultes et leur déroulement, considérant le conflit comme une forme d’interaction rendant le rapport d’autorité particulièrement visible.
J’entends par conflit une interaction au cours de laquelle une des parties exprime une insatisfaction quant à une situation et réclame son changement. Il s’agit donc, bien au-delà des formes exacerbées que sont les disputes, du plus simple désaccord. Ainsi, « brosse-toi les dents » quand l’enfant n’a pas envie peut-être un conflit. On a donc conflit à chaque fois que l’on est en présence de deux volontés antagonistes. La situation de conflit met particulièrement en relief le rapport d’autorité, puisque nous avons défini cette notion comme capacité à soumettre autrui à sa volonté.
Les conflits étudiés ici prennent la structure suivante : l’adulte demande ou exige quelque chose de l’enfant, ce dernier n’a pas envie de s’exécuter conformément à la volonté de l’adulte.
Si le schéma inverse existe, à travers des cas où l’enfant manifeste une volonté contradictoire avec celle de l’adulte et que celui-ci répond à l’attente de l’enfant, il ne nous intéresse pas ici puisque non significatif du rapport d’autorité exercé de l’adulte en direction de l’enfant, qui est notre objet. Il nous semble toutefois que ce genre de cas est d’une nature différente, l’enfant – contrairement à l’adulte – ne disposant pas de réels moyens de coercition.
La majorité des conflits survenant entre enfants et adultes sont caractéristiques du rapport et intrinsèquement liés à lui : c’est-à-dire qu’il ne s’agit pas des mêmes motifs que dans le cas d’un conflit entre des adultes, mais qu’ils sont spécifiques au statut de l’enfant. Par exemple, le conflit classique à propos du rangement de la chambre n’existe que dans la cellule familiale : jamais mon colocataire ne viendrait me demander de ranger ma chambre, s’accordant sur le fait qu’il s’agisse de mon espace privé et personnel et que son état ne le concerne en rien. Ils sont donc directement lié au statut de l’enfant.
Les motifs de conflits semblent infinis. Parmi les plus récurrents, on trouve :
– les repas : des conflits surviennent quand à l’alimentation et à son contenu, que ce soit à la maison ou à l’école. « J’aime pas les épinards » dit l’enfant en repoussant son assiette, et bien souvent le-la parent-e le force à manger (« tu goûtes au moins »). Avec les plus grand-e-s, cela devient très fréquent, portant sur la mauvaise alimentation du-de la jeune. Dans ce cas, l’adulte insiste à chaque repas pour que l’enfant mange des légumes, des fruits, des crudités.
– le travail scolaire : on trouve ici les conflits avec les parent-e-s (« t’as vu ton bulletin ! »), insistant pour que l’enfant travaille mieux, fasse ses devoirs, y consacre plus de temps ; ainsi que les conflits avec les enseignant-e-s portant sur les mauvais résultats, le manque d’attention, les devoirs non-faits, etc.
– le rangement : conflits portant sur l’entretien de la chambre, que ce soit avec les parent-e-s ou avec des animateurs-rices lors de colonies de vacances ; de même que sur le désordre laissé dans les parties communes. « Je passe ma vie à tout ramasser derrière lui » me confiait Catherine à propos de son fils de 15 ans.
– les activités de loisir : le temps passé devant la télévision, les jeux vidéos, les sorties entre ami-e-s, sont fréquemment objet de conflits. Souvent, il est reproché aux enfants d’y consacrer trop de temps, au détriment de choses jugées plus importantes : les études, la vie familiale, etc. Parfois, c’est l’activité elle-même qui est mise en cause, considérée comme néfaste pour l’enfant (fumer en est l’exemple typique, mais c’est également le cas pour une sortie en discothèque, jugée parfois dangereuse).
– les conflits entre enfants : bagarre dans la cour de l’école, disputes entre frères et sœurs sont fréquemment l’objet de l’intervention d’adultes en tant que médiateur-rice-s.
– l’autorité elle-même : il s’agit de tous les conflits trouvant leur origine dans un manque de respect estimé de la part de l’enfant. On trouve ici toutes les fois où un-e adulte exige d’un enfant qu’il-elle lui parle autrement, qu’il-elle s’excuse, qu’il-elle change d’attitude, cesse d’être insolent-e, etc.
Obéissance
Un jour, Hadrien, 5 ans, s’en allait de chez moi avec sa mère. Il m’avait dit au revoir mais ne m’avait pas embrassé, ce que sa mère lui a fait remarquer. Il a eu l’air visiblement gêné, a fait mine de ne pas avoir entendu, et est parti en direction de la porte. Haussant le ton, elle lui a dit « va faire un bisou ». Il s’est exécuté à contre-cœur.
La majorité des conflits sont à peine perceptibles puisqu’ils ne se développent pas : l’enfant n’a pas envie de faire la chose demandée par l’adulte mais la fait quand même, auquel cas nous sommes bien en présence de volontés antagonistes. C’est probablement ce qui explique que beaucoup d’individus aient du mal à répondre lorsqu’on leur demande de raconter le dernier conflit qu’ils-elles ont vécu : peut-être que tous ces moments où l’enfant se plie à la volonté de l’adulte ne sont même pas relevés. Ce type de situation correspond à la définition de l’autorité mobilisée ici, comme forme de pouvoir supposant l’adhésion de son destinataire, sans recours à la coercition.
Dans le même ordre d’idée, Mathieu, 12 ans, m’explique que beaucoup de conflits surviennent quant à son travail scolaire. Dans la majorité des cas, lorsque ses parents lui disent d’aller faire ses devoirs et qu’il n’a pas envie, il le fait tout de même. Quand je lui demande pourquoi, il m’explique qu’il préfère éviter la dispute, qui reviendrait quasi-quotidiennement s’il refusait : « de toute façon, j’ai pas le choix ».
L’obéissance semble pouvoir reposer sur deux choses : d’une part, la peur de la sanction, dans la mesure où l’enfant sait qu’un refus pourrait le-la mener à une punition. D’autre part, par la reconnaissance de la légitimité de l’exigence de l’adulte : bien souvent, l’enfant considère lui-elle-même que l’adulte a raison, et donc il est tout à fait normal qu’il-elle obéisse. Ainsi quand je demande à Camille, 6 ans, pourquoi les adultes lui disent de faire des choses alors qu’il n’a pas envie de les faire, il me répond : « parce que ils ont envie que je le fasse parce que c’est bien de faire ça. Et il faut le faire. »
Disputes
La dispute survient dans une minorité des cas, quand l’enfant refuse d’exécuter la volonté exprimée par l’adulte. Dans ce cas, le conflit devient ouvert. Généralement, le conflit monte alors crescendo, jusqu’à ce que l’adulte réussisse à faire céder l’enfant par l’un des moyens de pression dont il-elle dispose.
Il est à noter qu’il arrive que l’adulte cède. Il paraît y avoir deux cas de figure : premièrement le sujet ne tient pas réellement à cœur à l’adulte, et il-elle estime que l’enjeu ne vaut pas l’énervement causé. Par exemple, au moment du repas, François demande à son fils de 12 ans de manger les brocolis qu’il a laissés de côté. L’enfant refuse catégoriquement. Quelques propos virulents s’ensuivent. Finalement, François met les brocolis dans sa propre assiette en soupirant avec lassitude. Que l’enfant mange ou pas ne semblait avoir beaucoup d’importance : même sans les brocolis, l’assiette était bien remplie et équilibrée. Quand j’ai demandé à François pourquoi il avait cédé, il m’a répondu : « je vais pas commencer à me battre pour tout ». La notion de compromis semble intervenir dans ce genre de situation, quand l’adulte estime que l’objet n’a pas suffisamment d’importance pour prendre le risque de voir dégénérer la situation, et que la négociation peut permettre d’arriver à une situation qui lui convient.
Dans le deuxième cas de figure, l’enfant a une réaction tellement violente que l’adulte semble démuni : le refus est catégorique, et ni la menace ni la punition ne font plier l’enfant. Ce cas semble très rare, et se présente apparemment avec peu d’enfants. Un enseignant m’a confié que dans sa carrière (25 ans), il n’avait été confronté qu’une seule fois à un élève « avec qui il n’y avait rien à faire » : les menaces le faisait rire, les punitions n’était pas faites, les retenues se soldaient par une absence. En définitive, l’enfant est passé devant le conseil de discipline et a été exclu de l’établissement.
Menaces et punitions
« Continue comme ça et tu seras privé de dessert », « Maintenant ça suffit sinon on rentre » ; « Puisque c’est comme ça, pas de sortie samedi soir ». On peut considérer les deux comme liées, puisque la menace fonctionne par la peur de la punition. L’adulte dispose de tout un arsenal de punitions pour faire plier l’enfant en dernière ressource : pour l’enseignant-e, les outils sont inscrits dans le règlement (retenues, exclusion) ; pour les parent-e-s, la punition peut être la privation de tout ce dont l’enfant à envie : dessert, télévision, sortie, argent de poche, etc. Bien souvent, la simple menace suffit à modifier l’attitude de l’enfant, parce qu’il-elle sait que l’adulte peut la mettre à exécution, qu’il-elle en a les moyens et que lui-elle-même ne peut pas l’empêcher. Le principe de la punition implique une attitude de résignation de l’enfant : envoyer un-e enfant dans sa chambre ne rime à rien si l’enfant n’obtempère pas. Il faut qu’il-elle accepte la punition pour qu’elle fonctionne, ce qui suppose ici aussi une soumission. On quitte ici le domaine de l’autorité pour entrer dans celui, plus vaste, du pouvoir ; et dans l’emploi de moyens de coercition, qui peuvent aller jusqu’à la violence physique.
Choix de l’adulte – choix de l’enfant
À la médiathèque, une mère se dispute avec son enfant, d’une dizaine d’années : l’enfant veut emprunter un film, mais la mère en avait réservé un autre et veut prendre celui-ci. L’enfant s’énerve, insiste sur le fait qu’il a le droit de choisir son film, ce à quoi sa mère lui répond qu’il va beaucoup aimé ce film qu’elle a réservé pour lui. L’enfant argumente : « mais je m’en fiche qu’il soit mieux, c’est pas moi qui l’ai choisi ! ». En définitive, la mère prendra le film qu’elle a choisi. J’ai observé six conflits entre enfants et adultes portant sur le choix d’un ouvrage cette même après-midi à la médiathèque. Dans cinq des cas, c’est le choix de l’adulte que l’a emporté, soit par la persuasion, soit par l’imposition. Dans le dernier, l’enfant a crié vraiment très fort, et l’adulte a cédé, visiblement exaspérée.
D’une manière plus générale, on constate que les parents invitent eux-elles-mêmes les enfants à décider quand il s’agit de faits sur lesquels les parent-e-s n’ont pas de préférence. Par exemple « tu préfères des petits pois ou des haricots verts », « tu veux faire de la danse classique ou moderne ? ». Le premier cas de figure où les choses se compliquent concerne des éléments qui, comme précédemment, ne concernent pas directement l’adulte mais renvoient à certaines de ses envies. Par exemple le choix d’une activité quand la petite fille aimerait bien faire du judo, mais la maman préférerait de la gymnastique ; ou le choix d’un livre quand précisément, le papa a envie de faire découvrir celui qu’il trouvait si bien à son fils. Dans ces cas là, l’adulte peut au final forcer l’enfant sans même s’en rendre compte, alors que son but était simplement de le conseiller à la base, de l’orienter vers le mieux pour lui-elle. Dans un deuxième type de cas, l’adulte ne tient pas compte de la volonté de l’enfant parce qu’il ne peut pas le faire ou estime ne pas avoir à le faire : par exemple, lors d’un déménagement, où l’enfant ne serait pas consulté bien que concerné.
III. Dissymétries dans l’interaction verbale : « écoute un peu ce que les adultes te disent »
Ici, j’étudie certaines différences d’attitudes entre enfants et adultes dans les interactions mixtes, en m’arrêtant sur le statut de la parole de l’enfant.
Dans Les mots et les femmes, M. Yaguello met en avant certaines dissymétries entre hommes et femmes dans l’interaction verbale. En effet, des études portant sur des conversations mixtes montrent que les hommes sont responsables de 98% des interruptions. De même leur reviennent les initiatives, le lancement des sujets, et les prises de parole sont plus fréquentes de la part des hommes. Si on regarde du côté de l’interaction entre enfants et adultes, des faits similaires sont observables, la conversation apparaissant effectivement comme fréquemment dissymétrique : lors d’interactions entre un-e enfant et un-e adulte qui ne se connaissent pas trop, beaucoup d’enfants se montrent timides, réservé-e-s, mal-à-l’aise ; c’est dans ces cas là que l’adulte lance les sujets de conversation (« tu veux faire quoi quand tu seras grand-e ? », « tu es en quelle classe ? »), et il semble que ce soit lui-elle qui ait la responsabilité de la poursuite : enchaîner, veiller à ce qu’il n’y ait pas de silences, etc. L’interaction avec un adulte semble donc gênante pour l’enfant, au point que certain-e-s la fuient : ainsi, Julien, 17 ans, bien qu’il la croise régulièrement, n’ose pas dire bonjour à la mère de sa petite-amie. Quand elle essaie d’engager la conversation avec lui, il se montre fuyant, se contentant de répondre aux questions posées, ce qu’il explique par une timidité qu’il reconnaît ne pas avoir avec les jeunes de son âge. Cela semble moins vrai quand il s’agit d’adultes proches de l’enfant, avec qui celui-celle-ci entretient des liens affectifs (famille notamment). Toutefois, j’ai eu l’impression (qu’il faudrait creuser) que si avec leurs proches les enfants n’hésitent pas à poser une question, à raconter des choses, ils sont moins prompts à engager la conversation sur l’adulte : questions sur l’activité professionnelle, le lieu de vie, les goûts, etc.
L’observation des interactions mixtes (enfant-adulte) donne à voir qu’il existe une manière spécifique de s’adresser aux enfants, notamment aux plus petit-e-s. Spécifique sur le choix des mots d’une part, mobilisant des termes simples, des phrases courtes, mais surtout spécifique par le ton employé, que je qualifierais d’ « affectuo-condescendant » mais qui me paraît difficile à décrire : M. Yaguello note qu’on a « tendance à parler aux femmes comme on parle aux enfants, aux immigrés et aux vieillards gâteux », et c’est effectivement ce ton que tout le monde connaît, que l’on singe parfois, qui a l’air de s’adresser à quelqu’un qui n’a pas les mêmes facultés de compréhension que le-la locuteur-rice, et qui semble constituer l’infériorité de celui-celle à qui l’on s’adresse. Quand je réfléchissais à cette idée et cherchais un moyen de l’expliquer, je l’ai imité à un ami et lui ai demandé un qualificatif pour le désigner : le premier qui lui est venu était « infantilisant »... C’est un ton que souvent les enfants n’apprécient pas : « c’est bon, je suis plus un bébé », « tu peux pas me parler normalement ? ». Quand j’ai utilisé ce même ton pour expliquer quelque chose à un ami à moi, il m’a lancé « arrête de me parler comme à un débile » : il me semble que ce type d’exemples illustre bien en quoi ce ton est perçu comme dévalorisant, et par les enfants comme une manière de les renvoyer à une image de tout-e-petit-e-s.
L’usage de l’impératif est également une caractéristique des interactions mixtes, utilisé par les adultes pour s’adresser aux enfants : « va faire tes devoirs », « met pas tes doigts dans ton nez », « file dans ta chambre ». Valérie, 12 ans, m’a fait remarquer que si sa mère n’arrêtait pas de lui adresser ce genre de phrases, ce qui est leur principal motif de conflit, jamais elle elle ne dirait « Maman, va prendre ta douche ! ». Et on remarque effectivement que l’impératif, grammaticalement mode de l’ordre, est parfaitement légitime lorsqu’il est employé par l’adulte. Par contre, l’inverse est perçu comme déplacé, voire insolent. J’ai été témoin de la scène suivante : un père (que par ailleurs j’ai entendu à de maintes reprises employer l’impératif pour parler à son fils de 11 ans) est entré dans une rage noire parce que son fils lui avait dit « pousse-toi ». Le ton n’avait rien d’agressif, l’enfant voulait juste passer et la position de son père l’en empêchait. Dans le flot de parole du père en colère, demandant à l’enfant pour qui il se prenait, lui expliquant qu’il était son père et non son copain, une m’a marqué : « tu ne me parles pas à l’impératif ! ». C’était donc bien l’objet de l’énervement.
Dans les disputes entre enfant et adulte, il est fréquent d’entendre de la bouche de ce-cette dernier-e « Et ne me répond pas ! » quand l’enfant essaie de se justifier, de montrer qu’il a raison. Il y a là une inégalité flagrante : l’adulte adresse ses griefs et critiques à l’enfant, et quand ce dernier essaie de se défendre, on le lui reproche. J’ai souvent entendu « on ne répond pas aux adultes » proféré comme un proverbe. Le qualificatif qui y est associé est celui d’insolent-e, terme récurrent sur les bulletins d’élèves dit-e-s difficiles. Le dictionnaire en donne la définition suivante : « dont le manque de respect est offensant », et précise pour insolence « manque de respect qui a un caractère injurieux (de la part d’un inférieur ou d’une personne jugée telle) ». La première chose que l’on peut dire, c’est que la tentative de réponse ou de justification d’un enfant face à un adulte est perçue comme un manque de respect, tandis qu’entre deux adultes en cas de désaccord elle paraît tout à fait légitime. La seconde, c’est que l’emploie du terme insolence consacre bien, conformément à sa définition, le statut d’infériorité de l’enfant. Autre élément significatif : l’exemple de phrase comportant insolent dans le dictionnaire est « un enfant insolent ». Ma curiosité m’a poussé à aller consulter d’autres termes synonymes ou propres : le même exemple est employé pour impertinent-e et effronté-e, qui, tout comme impudent-e ou malpoli-e, sont des mots généralement employés pour qualifier des enfants. Dans le même ordre d’idée, il est fréquent que l’enfant n’ose pas répondre à l’adulte, ne se le « permette » pas, comme me l’a expliqué Simon, 13 ans, à propos des professeur-e-s, parce que les enfants savent qu’ils-elles n’en pas le droit.
Le vouvoiement est un indice supplémentaire de cette dissymétrie, la norme voulant que les enfants vouvoient les adultes qu’ils ne connaissent pas quand ceux-celles-ci les tutoient. Le vouvoiement est une marque de respect, et sa non-réciprocité montre une certaine inégalité de statut. Ainsi, Katia, 15 ans, a tutoyé sa professeure d’anglais lors d’une dispute, en lui disant « de quel droit tu me parles comme ça ? ». Elle a été collée deux heures. Le motif inscrit sur son bulletin de colle était « Katia se permet de tutoyer ses enseignants ».
Dans le même ordre d’idée, les titres Monsieur ou Madame/Mademoiselle sont objets d’un traitement différentiel : les enfants sont tenus de les utiliser pour s’adresser aux adultes, enseignant-e-s ou personnes inconnu-e-s. La réciproque n’est pas vraie : il est parfaitement admis qu’un enseignant appelle ses élèves par leur prénom. J’ai observé des cas ou ils étaient employés pour s’adresser aux enfants, mais avec ironie : « Monsieur fait sa colère maintenant », « je ne voulais pas déranger Madame ».
Le statut de la parole de l’enfant : les enfants bavardent – les adultes discutent
Autre point d’analogie possible : le stéréotype de la femme la dépeint comme bavarde, celui de l’enfant aussi : bavarder et ses synonymes papoter, babiller, caqueter, jacter, jacasser, et un peu plus lointain pinailler, s’emploient rarement pour qualifier une conversation entre deux hommes adultes. De même, « tu ne sais pas tenir ta langue », « tourne sept fois ta langue dans ta bouche avant de parler » sont des phrases fréquemment adressées aux enfants. Ce constat renvoie à la prise au sérieux de la parole, à l’idée de « parler pour ne rien dire », d’un contenu insignifiant (M. Yaguello souligne que le même stéréotype a cours à propos des afro-américains). On peut l’interpréter comme une dévalorisation de la parole de l’enfant, considérant que ce qu’il-elle a à dire n’est pas de grande importance. Il me semble que c’est la même idée qui est présente quand des adultes interrompent les conversations d’enfants pour leur dire quelque chose : quand les enfants font remarquer qu’ils-elles sont en train de discuter, il est fréquent que l’adulte justifie son intervention par son caractère important, et il est rare qu’il-elle s’excuse. Par contre, l’inverse est généralement mal accepté : « tu vois pas qu’on discute ? »
« la vérité sort de la bouche des adultes »
La parole de l’adulte semble avoir toujours plus de poids, plus de valeur, plus de crédibilité que celle des enfants, dont le sérieux, la pertinence, sont plus aisément mis en doute. Finalement, on pourrait dire qu’elle « fait autorité ».
IV. Spécificités du rapport d’autorité
Dans cette partie, je m’attache à détailler certaines particularités du rapport d’autorité liant l’enfant à l’adulte, et les questions qu’elles soulèvent.
L’autorité démocratique
M. Fize identifie deux types d’autorité : l’autorité absolue (celle du patriarche à l’époque antique) et l’autorité modérée, également nommée autorité démocratique, qui serait la forme régissant les rapports entre enfants et adultes aujourd’hui. C’est également ce que souligne F. De Singly en parlant de « démocratisation de la famille » : l’autorité légitimée aujourd’hui serait une autorité juste, tempérée, basée sur la négociation et la prise en compte du point de vue de l’enfant. L’enfant doit adhérer au discours de l’adulte, l’autorité ne peut plus s’imposer par la force. C’est ce point de vue que défend Mme Alina tout au long de l’entretien que nous avons effectué : l’adulte (ici l’enseignant-e) se doit d’être crédible, cohérent, de négocier avec l’enfant.
« une société individualiste, dans le cadre de la seconde modernité doit proposer le cadre juridique, politique, social au sein duquel une vie commune, respectueuse de chacun, sans hiérarchisation des statuts, est possible dans la famille et dans l’ensemble des autres espaces sociaux. L’enfant mérite d’être traité différemment en raison de sa faiblesse »
Si le titre de l’ouvrage Enfants, adultes, vers une égalité de statut ? comporte un point d’interrogation, F. De Singly semble avoir déjà sa réponse, tendant à l’affirmative : il explique qu’en effet, l’enfant est maintenant associé aux décisions qui le-la concerne, qu’il est libre de consommer, qu’il-elle est considéré comme acteur-rice.
Toutefois, M. Fize, plus que d’une tendance à l’égalisation de statuts, parle d’une « domination masquée », et nos observations tendent à lui donner raison. Premièrement, parce que l’autorité qualifiée d’absolue, si elle se fait plus rare, est loin d’avoir disparu : on constate encore l’existence de nombreuses situations où le pouvoir de l’adulte paraît arbitraire. Ainsi, j’ai vu à la sortie du supermarché une mère arracher un paquet de bonbons des mains de sa fille, le jeter par terre et lui donner une gifle, simplement (selon ce qu’elle disait) parce qu’elle avait dit à sa fille d’attendre d’être à la maison pour ouvrir le paquet. Ce genre de scène, dont la violence semble disproportionnée à la faute, n’est pas rare. Deuxièmement, parce que la citation de F. De Singly contient, en même temps qu’elle affirme une tendance à la disparition de la hiérarchisation, l’affirmation de la légitimité de celle-ci par la faiblesse de l’enfant.
Ainsi, si l’autorité prend une forme plus atténuée, il n’en reste pas moins que ses fondements apparaissent comme naturels et que sa légitimité n’est pas mise en doute. Il s’agirait dans ce sens plus d’un « rééquilibrage du rapport de force », comme l’avance M. Fize, atténuant la domination subie par l’enfant. mais loin de l’annihiler.
L’autorité comme nécessité
L’autorité semble en effet toujours conçue comme une nécessité : aucun-e des acteurs-rices rencontré-e-s ne l’a mise en question, qu’il s’agisse d’enfants ou d’adultes, d’enseignant-e, d’animateurs-rices ou de parents. Elle semble intrinsèquement liée au statut de l’enfant, passant de la différence de statut à l’inégalité de statut.
La « crise de l’autorité » qui semble si préoccupante aujourd’hui ne peut-elle pas être interprétée comme le rappel de cette nécessité ? Pour exemple, on peut citer la position du ministre de l’Éducation Nationale, F. Fillon, critiquant le fait que les élèves remettent en cause les décision de leurs enseignant-e-s, leur notation, leurs sanctions ; et expliquant que cette négociation n’est pas acceptable :
« Le maître n’est plus respecté dans son statut. Il doit souvent démontrer et même défendre la légitimité de son autorité. Les élèves n’admettent plus a priori la supériorité du discours du maître sur leurs propres opinions. [...] Le respect de l’autorité, c’est un impératif pour toute la société [...], tous les adultes dans les établissements scolaires doivent incarner l’autorité aux yeux des élèves ».
Une femme d’une soixantaine d’années m’expliquait que quand elle était jeune déjà, les « vieux » ne cessaient de fustiger la jeunesse pour son manque de respect, expliquant qu’avant, les jeunes savaient ce que c’était que l’autorité. Il semblerait que l’on trouve déjà trace d’une critique de l’affaiblissement de l’autorité dans les jeunes générations à l’Antiquité... Ce discours n’a-t-il pas fonction de réaffirmer la légitimité de l’autorité ?
L’autorité comme consensus
On remarque que la notion d’autorité, quand il s’agit de qualifier la relation entre adultes et enfants, semble consensuelle : que ce soient les milieux bourgeois ou populaire, que ce soient les partis politiques de droite ou de gauche, tous s’accordent à consacrer la famille et l’école comme titulaires de l’autorité, présentée comme nécessité du développement de l’enfant. Si elle ne passe pas toujours par les mêmes mécanismes de légitimation, le résultat est toujours le même : l’enfant a besoin, pour son développement, d’une autorité adulte.
La seule contestation, remise en cause de l’autorité semble émaner de milieux contestataires minoritaires : pédagogies nouvelles, écoles autogérées, milieux libertaires, etc. Il serait intéressant de se pencher sur ces critiques et sur le modèle alternatif qu’elles proposent ; sur les réflexions théoriques mais également sur la pratique, car le peu que nous en avons vu tend à montrer que même dans ces micro-sphères, l’autorité est bien présente dans les faits.
L’autorité multiple
L’autorité, comme tout rapport de pouvoir, peut être analysée en fonction des ressources qui la fondent. De celles citées par G-N. Fischer, il semble que le rapport adulte-enfant les possède toutes : les moyens de sanctions (punition et récompense) sont bien aux mains de l’adulte ; interdictions diverses, retenues des enseignant-e-s, fessée des parents, etc. Dans le rapport, l’adulte a le monopole des moyens de coercition et de la violence. La détention de l’information et de la connaissance, que l’on peut mettre en lien avec le statut d’expert et la compétence reconnue caractérisent le statut de l’enseignant-e, mais également celui des parent-e-s, même si cela est moins flagrant : pour les petit-e-s enfants, c’est généralement vers leurs parent-e-s qu’ils-elles vont chercher des réponses, qui seront conçues comme vérités absolues. Le processus d’identification (« quand je serais grand, je veux faire comme mon papa »), qui érige le parent en modèle ; de même que la structure affective plaçant l’enfant dans une relation de dépendance vis-à-vis d’une personne vue comme centrale, sont également typiques du rapport entre enfants et parent-e-s, et parfois existent par rapport à d’autres adultes. Et enfin, la légitimité, c’est-à-dire l’existence d’un certain nombre de fondements théoriques, rationnels ou idéologiques faisant apparaître le pouvoir comme normal et nécessaire, réside au cœur même des représentations de l’enfant.
Si on cherche à analyser ce rapport d’autorité à la lumière de la typologie opérée par M. Weber, il semblerait qu’il entre dans les trois modèles : autorité traditionnelle, puisque le pouvoir détenu par l’adulte semble se perpétuer depuis des siècles, si ce n’est depuis toujours ; charismatique puisque articulée sur les figures centrales du père, de la mère, de l’instituteur-rice auxquel-le-s sont reconnus par l’enfant un statut spécifique et idéalisé ; rationnelle dans la mesure ou elle est encadrée d’un dispositif juridique et de normes explicites.
Le châtiment corporel
Selon une enquête réalisée en 1999, 80 % des parent-e-s frappent leurs enfants. En France, les enfants représentent la seule catégorie qu’il n’est pas interdit de frapper. Selon le Litec du droit civil, « les usages tolèrent encore au profit des parents, mais non des enseignants, un droit raisonnable de correction corporelle – au delà de quoi commence le délit de coups et blessure ».
La dépendance
« On attend tout des enfants, mais on fait en sorte qu’ils demeurent des enfants totalement dépendants. » (Mendel G., Pour décoloniser l’enfant)
L’enfant est dépendant-e de l’adulte au niveau juridique : il-elle est dans toute procédure nécessairement représenté par un adulte (parent, tuteur-rice, avocat-e). L’enfant est dépendant-e sur le plan économique : sa survivance est assurée par ses parent-e-s, qui peuvent lui interdire toute transaction financière. Il-elle est également dépendant-e dans son apprentissage, dans ses relations sociales qui sont conditionnées par l’accord parental, dans ses loisirs. Le statut de l’enfant est caractérisé par un besoin de l’adulte, besoin qui n’est pas réciproque ; relation qui est de fait inégale. Tout un discours est développé sur l’autonomie de l’enfant, mais quel sens peut-on y donner ? N’y a-t-il pas un paradoxe à apprendre l’indépendance dans la dépendance ? Peut-on apprendre l’autonomie de quelqu’un-e d’autre, sous la tutelle de quelqu’un-e d’autre ?
La domination masquée
Un enfant qui ne voudrait pas voir son père, dans le cas d’une famille divorcée, y serait contraint par sa mère. Si ce n’était pas le cas, la loi condamnerait la mère pour non-présentation de son enfant, conformément au droit de visite. Ici, la juridiction française ne fixe aucune obligation à tenir compte des sentiments de l’enfant.
Finalement, si on regarde de près, rien n’oblige les adultes à prendre en compte l’enfant : les enfants n’ont de liberté que celle que l’adulte accepte de leur accorder. A l’école, le contenu de leurs enseignements, tout comme leurs modalités, leur est imposé. En cas de désaccord, le règlement prévoit toute une série de sanctions, qui soit feront plier l’élève à la règle, soit mèneront à son exclusion. À la maison, les parents disposent de tous pouvoirs décisionnels : lieux de vie, sorties, orientation scolaire, activités extra-scolaires. L’enfant ne peut rien faire à partir du moment où ses parents s’y opposent. Au centre aéré, en colonie de vacances, à la MJC, l’enfant est sous la responsabilité d’un-e animateur-rice : si il-elle a le choix de ses activités, c’est parmi celles proposées par l’adulte, et selon les modalités définies par l’adulte.
Si on prend la définition sociologique de domination, « fait, pour un groupe social, d’exercer une influence déterminante sur une catégorie sociale, une classe, un genre, une nation », alors on peut parler de l’enfance en tant que catégorie socialement dominée.
Partie 3 : Mécanismes de légitimation et représentations de l’enfant
Une fois constatée l’existence de rapports d’autorité, je me suis interrogée sur leur légitimation, qui me semble résider dans les représentations de l’enfant.
I. L’enfant dans le langage : les dissymétries sémantiques
Dans cette partie, je survole le champ sémantique d’enfant et l’image qu’il véhicule.
« La langue nous renvoie une certaine image de la société et des rapports de force qui la régissent ». Comme évoqué précédemment, le langage joue un rôle dans la constitution des catégories, à la fois en tant que véhicule et que générateur. Dans Les mots et les femmes, M. Yaguello se livre à une approche socio-linguistique du genre, analysant les différenciations opérées par la langue. J’utilise dans cette partie ces travaux comme cadre d’analyse, à la fois pour cerner ces mécanismes de différenciations et pour les mettre en lien avec le rapport de pouvoir en jeu.
« La langue est un système symbolique engagé dans des rapports sociaux ; aussi faut-il rejeter l’idée d’une langue neutre et souligner les rapports conflictuels »
« La langue est aussi [...] un miroir culturel, qui fixe les représentations symboliques, et se fait l’écho des préjugés et des stéréotypes. »
« L’idéologie est nécessairement verbalisée. La langue se nourrit des idéologies, en même temps qu’elle les véhicule et les entretient »
M. Yaguello explique que le parallèle qui peut être établi entre toutes les formes d’oppression se retrouve dans le langage, dans la structure de la langue, dans les connotations des mots comme dans la répartition de la parole dans les conversations.
Les mots peuvent comporter différentes composantes : une composante dénotative, qui renvoie au sens, strictement descriptif ; une composante connotative, correspondant à la valeur du mot sur une échelle morale ou sociale ; et une composante associative, renvoyant à la place du mot dans un champ sémantique et aux relations de complémentarité, d’analogie, d’antinomie. Ce sont les deux dernières qui sont particulièrement intéressantes pour saisir les rapports de pouvoir contenus dans la langue : « Les adjectifs qui désignent les sexes et les âges de la vie ont des connotations péjoratives : sénile, puéril, infantile, féminin, femelle ; seuls mâle, masculin, viril sont positifs ».
Enfant :
I.
– être humain dans l’âge de l’enfance, de la naissance à l’adolescence. → bambin, bébé, fille, garçon, petit. Familier : gosse, mioche, môme.
Un enfant au berceau. Un enfant calme, câlin, capricieux, turbulent. Livres d’enfants, pour enfants. Lit, voiture d’enfant. Il n’y a plus d’enfant se dit quand un enfant fait ou dit des choses qui ne sont pas de son âge. Il me prend pour un enfant, pour un naïf. Ne faites pas l’enfant, soyez sérieux.
– personne qui a conservé des traits propres à l’enfance. Il sera resté toute sa vie un enfant. → enfantin, puéril. Contraire : mûr.
– enfance : première période de la vie humaine, de la naissance à l’adolescence.
Retomber en enfance se dit d’un vieillard dont les facultés mentales s’affaiblissent.
– enfantillage : manière d’agir, de s’exprimer, peu sérieuse, qui ne convient qu’à un enfant. → puérilité.
– enfantin : qui est propre à l’enfant, a le caractère de l’enfance. Péjoratif : qui ne convient guère qu’à un enfant. (choses à faire) très simple, très facile. → élémentaire.
II.
– être humain à l’égard de sa filiation, fils ou fille.
Que dire de cette définition ? Tout d’abord, on note que le premier sens d’enfant le-la définit comme catégorie et le second renvoie à sa relation à l’adulte (enfant de…) ; de la même manière que femme définit en premier la catégorie par le sexe, en second son rapport à l’homme (femme de…, comme synonyme d’épouse). L’inverse n’est pas vrai : adulte n’est pas synonyme de parent, et homme n’est pas synonyme de mari ou époux. Dans le cas des genres, des slogans féministes tel que « je ne suis pas la femme de... » mettent en avant que cette dissymétrie reflète l’inégalité de statut entre homme et femme, la deuxième étant considérée comme sous la dépendance du premier. Deuxièmement, les termes dérivés de enfant et appartenant au même champ sémantique puéril-e et enfantillage sont dotés d’une connotation péjorative. Si ce n’est pas intrinsèquement le cas d’enfantin, la définition précise qu’on peut également en faire un usage péjoratif. Et effectivement, dire d’une chose qu’elle est enfantine, dans le même sens que « simple comme bonjour » signifie implicitement une dévalorisation des activités propres à l’enfance et des capacités de réflexions qu’elles nécessite : n’importe qui pourrait le faire, même un enfant. Ensuite, parmi les exemples de phrases, on voit une utilisation d’enfant comme terme dépréciatif quand il est appliqué à un adulte, renvoyant à la naïveté, au manque de sérieux ; de même que l’expression « retomber en enfance » exprime une diminution des facultés intellectuelles. On est loin d’une vision embellie de l’enfance !
Adulte :
– qui est parvenu au terme de sa croissance. Âge adulte, chez l’être humain, de la fin de l’adolescence au commencement de la vieillesse. → mûr. Être adulte, avoir une psychologie d’adulte. Contraire : infantile.
– homme, femme adulte. Les enfants n’aiment pas rester avec les adultes. C’est un adulte à présent. Contraire : adolescent, enfant.
Par contre, le seul renvoi synonymique d’adulte est mûr-e, qui a une connotation laudative. Si ces définitions contribuent à distinguer les catégories, elles renvoient également une certaine image de ces catégories : plutôt positive en ce qui concerne l’adulte, moins en ce qui concerne l’enfant. Le choix de ces définitions et de leur dissymétrie n’est pas neutre pas plus qu’il n’est un hasard :
« le dictionnaire est une création idéologique. Il reflète la société et l’idéologie dominante. En tant qu’autorité indiscutable, en tant qu’outil culturel, le dictionnaire joue un rôle de fixation et de conservation, non seulement dans la langue mais aussi dans l’idéologie ».
Pour pousser plus loin ce constat, j’ai essayé de regrouper et de classer ici les différents termes utilisés pour enfant ou adulte, synthétisant des mots utilisés par les acteur-rice-s interrogé-e-s et observé-e-s et ceux trouvés dans différents dictionnaires des synonymes.
ADULTE : Si on exclut la série des termes descriptifs des rapports de parenté, comme parents, mère, oncle, etc. puisqu’ils ne désignent pas les adultes en général, il semble que l’on ne trouve que grand-e ou grande personne. Ces termes sont généralement utilisés pour désigner une personne référente, responsable : « il faut demander aux grands » ou « ne traverse pas sans une grande personne », donc une connotation plutôt laudative. Le seul terme péjoratif que nous ayons relevé est vieux-vieille, qui semble plus utilisé par des adolescent-e-s que par des petit-e-s enfants.
ENFANT : D’abord, on trouve l’opposition à grand et ses dérivés : petit-e, petiot-e, pitchoune, dotés d’un sens plutôt affectueux. Ensuite, à mi-chemin entre tendresse et condescendance, bouille et chérubin, dont la caricature serait la grand-mère pinçant la joue de l’enfant en s’exclamant « oh la bonne bouille ! ». Bien souvent, les enfants n’apprécient pas du tout ce genre de termes, de même que les expressions du type « mon petit cœur », « mon petit chou », jugées ridiculisantes. Ensuite, des termes plutôt neutres sémantiquement, mais généralement connotés par le type d’énoncé dans lequel ils sont employés : ainsi bambin et gamin-e prennent généralement un sens positif dans « le bon gamin », gosse et mioche plutôt négatif dans des phrases du type « la sale gosse ». On peut relever aussi la série des chenapan, diablotin, galopin, associé à l’idée de « faire des bêtises », mais utilisé aujourd’hui généralement avec un ton amusé. Enfin, les termes ouvertement péjoratifs, voire insultants : morveux, chiard, gueulard, morpion, merdeux.
On retrouve bien ici l’idée avancée par M. Yaguello : de nombreux termes utilisés pour qualifier les enfants ont une connotation dépréciative, quand ce n’est pas le cas de ceux (bien moins nombreux) qui désignent les adultes : la linguiste explique en effet que pour toutes les catégories socialement dominées, on remarque une dissymétrie sémantique, les termes désignant les dominant-e-s ayant une valeur neutre ou laudative, tandis que beaucoup de ceux appliqués aux dominé-s ont une connotation dépréciative.
« L’oppresseur dispose généralement d’un registre de mépris infiniment plus étendu à l’égard de l’opprimé que celui-ci à l’encontre des oppresseurs [...] Le droit de nommer est une prérogative du groupe dominant sur le groupe dominé. ».
« Arrête de faire l’enfant ! »
La dissymétrie sémantique va jusqu’à faire d’enfant une insulte : dans des querelles entre adultes, il arrive que celui-celle dont le comportement est mis en cause soit qualifié-e ainsi. Chez les enfants eux-mêmes ce statut d’enfant peut-être péjoratif : ainsi, j’ai vu des collégiens (environ âgés de 12-13 ans) se lancer « t’as 8 ans d’âge mental ». Le fait que cette catégorie puisse faire l’objet d’expressions dévalorisantes semble montrer qu’elle renvoie à une position d’infériorité.
II. Deux conceptions antagonistes de l’enfant : « sale petit démon » / « adorable chérubin »
Il s’agit ici de présenter les deux grandes conceptions de l’enfance qui ont cohabité au fil des siècles, et de voir quels liens elles entretiennent avec l’autorité.
A. L’enfant à dresser
La conception théologique classique de l’enfant dominante au Moyen-Âge, qui doit beaucoup à Saint-Augustin, présente l’enfant comme un être mauvais par nature, symbole incarné du pêché, qu’il convient de redresser par la force et la contrainte afin d’en faire une personne bonne et vertueuse. Cette idée conduit à une discipline sévère, recourant fréquemment au châtiment corporel, destinée à corriger l’âme de l’enfant. C’est cette représentation négative qui transparaît derrière l’étymologie du mot « éducation » : educare signifie en latin redresser ce qui est tordu, mal-formé. A ceci s’ajoute une vision de l’enfant comme être imparfait par rapport à l’adulte, incapable, futile, déraisonnable.
Cette vision est parfaitement illustrée par la Bible dans le Livre des proverbes :
L’Éternel châtie celui qu’il aime, comme un père l’enfant qu’il chérit. (3.12)
Celui qui ménage sa verge hait son fils, Mais celui qui l’aime cherche à le corriger. (13:24)
N’épargne pas la correction à l’enfant ; Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. (23:13)
La verge et la correction donnent la sagesse, Mais l’enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. (29:15)
On pourrait penser qu’un certain déclin du religieux rend ces proverbes obsolètes : ce serait négliger que d’une part, certains catholiques basent aujourd’hui encore leurs comportements sur l’interprétation de ces textes, et d’autre part – et principalement – que même si les textes ne sont plus forcément cités en référence, notre culture toute entière est imprégnée de la tradition judéo-chrétienne, et que nombre de ses principes persistent même s’ils ne sont plus énoncés explicitement.
Si ce genre de propos se fait rare, cette conception se retrouve en filigrane derrière des notions plus actuelles : ainsi ces dernières années ont connus l’émergence de l’idée d’enfant-roi, sujet de nombreuses publications, articles, reportages, émissions télévisées, etc. qui imposent rapidement cette nouvelle vision de l’enfant ; au point que M6 crée Super Nany, un reality-show mettant en scène une auxiliaire puéricultrice volant au secours de familles dépassées par des enfants despotiques, accompagné des suggestions de pédo-psychiatres. Dans une profusion d’ouvrages, aux titres aussi évocateurs que L’enfant roi, tout tout de suite, De l’enfant roi à l’enfant tyran, Le drame de l’enfant sans limites, L’enfant chef de famille, des spécialistes expliquent que le laxisme post-68 a conduit à des générations sur-protégées, gâtées, ne supportant plus la frustration et tentant de faire régner leur loi au sein de la famille ; répondent aux parent-e-s désarmé-e-s et appellent à une restauration de l’autorité, insistant sur la nécessité de poser des limites au moyen d’une revalorisation de la punition.
On peut se demander aussi dans quelle mesure la vision freudienne de l’enfance – dont l’influence et la présence dans la conception actuelle de l’éducation semble manifeste – entre dans cette catégorie, du pervers polymorphe à la nécessité de la frustration, du contrôle des pulsions, de l’apprentissage de la censure du Ça ; qui se font dans le rapport à l’autorité parentale.
Les débats récents sur la délinquance, plaçant le-la mineur-e au centre du débat sous l’étiquette de mineur-e délinquant-e semble refléter cette même vision, présente aussi bien dans la loi sur la prévention de la délinquance incluant son dépistage précoce (dès 36 mois) que dans la création de nouveaux centres de détentions pour mineur-e-s.
Cette première vision de l’enfant entretient un rapport évident avec l’autorité : puisque les enfants sont terribles, les adultes référents doivent être fermes, leur inculquer le respect et les valeurs morales, par la force si nécessaire.
B. L’enfant à protéger
Le XVIIe siècle est marqué par la généralisation d’un sentiment nouveau porté à l’enfance, attribuée par P. Ariès au développement d’une certaine tendresse maternelle. Puis de nouvelles images religieuses, notamment appuyées sur l’enfant Jésus, contribuent à répandre l’image de l’enfant comme un être pur et fragile, puisqu’il n’a pas encore personnellement commis de pêchés ; qu’il convient de protéger. Le soucis de protection juridique de l’enfance semble apparaître très tôt : des lois interdisent l’avortement et l’infanticide au IVe siècle, sous peine d’excommunication, les premières législations par rapport au travail des enfants apparaissent au milieu du XIXe siècle – mais ne s’institutionnalisent réellement qu’au XIXe.
On peut associer à cette vision toutes les considérations sur la fragilité de l’enfant, les inquiétudes concernant sa santé, son psychisme, nécessitant des soins spécifiques. Ainsi j’ai vu des familles emmenant leur enfant chez le médecin au moindre début de toux, ce que les parent-e-s ne feraient pas pour eux-elles-mêmes. De même le recours aux psychologues semble en plein essort, comme en atteste l’existence de nombreux Centres-Médico-Psycho-Pédagogiques (CMPP).
Pour exemple, Réponse Parents consacre un numéro spécial aux adolescent-e-s, avec pour titre « les aider à grandir » : l’adolescence y est présentée (comme souvent) comme une crise, une période de bouleversements. Si cinq pages traitent de la sexualité des adolescents, quelques autres parlent des conflits et affrontements avec la famille qui caractérisent cette période. Tout le reste (environ soixante pages) appelle à la vigilance des parent-e-s, explique comment détecter les signes et réagir face aux risques encourus par le-la jeune : dans le détail, sont traités les troubles alimentaires (l’anorexie et la boulimie), le suicide, la consommation de drogues (tabac, alcool, cannabis et drogues dures), le danger des mauvaises fréquentations pour un jeune influençable, l’automutilation, l’échec scolaire, la violence, etc. L’adolescent-e est bien ici représenté-e comme un-e être en danger, que les parent-e-s doivent à tout prix protéger.
Médiatiquement, on nous dépeint le tableau d’enfants en danger, que ce soit au travers du prisme des comportements à risques de l’adolescent (anorexie, suicide), de risques domestiques (ingestion de produits toxiques), de la maltraitance, des abus sexuels et de la pédophilie, etc. G. Neyrand explique que cette nouvelle « image de l’enfant victime », si elle s’appuie sur divers facteurs, attire l’attention sur la nécessité d’une prise en charge institutionnelle pour protéger l’enfant, mettant ici encore en relief l’innocence et la vulnérabilité de celui-celle-ci.
Ici, le discours est centré sur le bien de l’enfant, sa protection, son bon développement. Si le lien avec l’autorité est moins flagrant que précédemment, il est tout de même présent comme sous-entendu implicite : parce que l’enfance correspond à une période de vulnérabilité, elle doit être protégée, et cette protection passe par une mise sous tutelle, une dépendance à l’adulte qui saura prendre les meilleures décisions pour l’enfant, à la place de l’enfant.
« Protéger l’enfant : ainsi la société occidentale justifie-t-elle la domination exercée sur le mineur, quel que soit son âge. Ainsi explique-t-elle les mesures d’éducation qu’elle prend à son égard. La fragilité constitutionnelle et, plus encore, morale de l’enfant est invoquée pour légitimer sa dépendance envers sa famille et, dans nombre de sociétés, envers l’État, dominateur suprême. » (Fize M, A mort la famille)
III. Besoin de l’adulte et autorité
Je me penche ici encore sur les représentations de l’enfance en tant que mécanisme de légitimation, en interrogeant les capacités estimées à l’enfant et son besoin supposé de l’adulte.
L’enfant et le fou
Sur une banque internet de proverbes, j’ai fait une recherche à enfant. Une fois retirés les proverbes étrangers, ne traitant pas de l’enfance et ceux dont je n’avais pas compris le sens, il m’est resté ceux-ci :
Il y a une providence pour les fous, les enfants et les ivrognes.
Les enfants et les fous sont devins (disent la vérité).
Les fous et les enfants pensent qu’on ne voit jamais la fin de vingt ans et de vingt francs.
L’enfant et le vieillard aiment qu’on les écoute.
Quand on envoie les enfants au marché, les marchands sont sûrs de gagner.
Les enfants vivent peu quand ils ont trop d’esprit.
Les enfants sont ce qu’on les fait.
On remarque que les trois premiers mettent ouvertement en parallèle les enfants avec les fous-folles, individus socialement reconnu-e-s comme dépourvu-e-s de raison et inaptes à l’autonomie. On peut ajouter à cette idée celui comparant enfant et vieillard, si ce dernier est associé à l’idée de sénilité. Les deux suivants mettent en avant la même image : l’enfant est un être naïf-ve, manquant de lucidité et de discernement. Cette analogie est courante : la Bible place sous le terme « simple » à la fois fous et enfants ; le code Napoléon consacrait l’incapacité juridique des femmes, des enfants et des fous, tou-te-s considéré-e-s comme mineur-e-s. N’est-ce pas ce même sens qui se cache derrière la notion juridique actuelle de capacité de discernement ? Bien qu’exprimée différemment, et ne revêtant apparemment pas de connotation péjorative, il me semble que c’est également ce type de représentation que l’on retrouve quand on présente l’enfant comme incapable de distinguer le réel de l’imaginaire.
L’adulte en devenir
L’enfant est présenté comme un adulte en devenir, comme le soulignent tous les discours sur la création de sa personnalité, la recherche de son identité. Ici, l’adulte – qu’il soit enseignant-e ou parent-e – est présenté comme un guide, qui doit accompagner l’enfant. Mais accompagner signifie orienter ses choix, ses décisions, et suppose un rapport asymétrique : l’enfant est dans une position de dépendance, tributaire de l’autre. Mme Alina fait elle-même le lien entre cette représentation et le rapport d’inégalité qu’elle sous-entend : quand je lui demande ce qui caractérise cette période de la vie où sont engagé-e-s ses élèves, elle me répond « ils se construisent, ils se cherchent. Et ils nous demandent notre expérience. On est toujours effectivement quelqu’un qui est au dessus ».
En outre, il faudrait interroger le sens même de la représentation, que cette citation d’un psychologue illustre parfaitement : « l’enfance n’est pas un statut [...] ; c’est un état provisoire de la personne. En d’autres termes, l’enfant est une personne en devenir. » Il semble ici que l’enfant ne soit pas défini par ce qu’il-elle est mais par ce qu’il-elle sera, par ce qu’il-elle s’apprête à devenir ; en clair un adulte. Mais dire « une personne en devenir » n’implique-t-il pas que l’on ne soit pas encore une personne ? L’enfance alors ne serait que la phase de préparation, une sorte de préliminaire avant l’entrée dans la « vraie » vie.
Cette légitimation de l’autorité par le statut d’ « apprenant » est particulièrement visible dans ces propos de pédagogue :
« Ce n’est pas le pouvoir du plus fort ou du plus retors, mais le pouvoir d’une personne « autorisée » à exercer l’autorité. A l’école, bien sûr, les élèves ne sont pas encore des citoyens, ils ne sont pas les égaux des adultes, puisque, les armes de la négociation et de la discussion, ils sont justement là pour les apprendre. La relation maître-élève est fortement asymétrique, mais si elle veut préparer la démocratie, le respect de la loi et le respect de l’autorité, elle doit distinguer et articuler deux plans : les règles que l’école impose aux élèves (l’autorité) et les règles qu’elle leur permet petit à petit de s’imposer (l’autonomie). » (Maulini O., cité dans « Les pédagogues : contre le dressage, pour la démocratie », in Le Monde de l’éducation, septembre 2004)
Cette idée amène à considérer le rapport éducatif : malgré certains discours, l’éducation reste conçue comme transmission unilatérale, de haut en bas ; du-de la détenteur-rice de savoir à celui-celle qui n’est pas prêt-e pour affronter le monde. On peut reprendre ici le dernier des proverbes cités ci-dessus, « les enfants sont ce qu’on les fait », sous-entendant que l’enfant est pareil à une boule de pâte à modeler, à modeler si on veut en faire quelque chose. Et c’est à l’adulte de modeler. Qu’il s’agisse du-de la parent-e, en charge de préparer son enfant à la réalité de la vie, de lui donner un cadre pour qu’il-elle puisse se développer, parce qu’il-elle a plus d’expérience, ou de l’enseignant-e, détenteur-rice du savoir nécessaire à l’enfant ; ce que l’enfant doit savoir, a besoin de savoir est tout entier déterminé par l’adulte et passe par lui-elle.
« Au départ, la relation parent-enfant est une relation non-symétrique où l’apport en expérience et en vécu donne licence, du côté du parent, à l’exercice d’un pouvoir qu’il est très aisé de consacrer par une institution hiérarchique et contraignante. » (Fize M, La démocratie familiale)
C’est cette idée d’expérience qui vient légitimer l’autorité. Comme le dit Valérie, les adultes « comprennent des trucs que nous [les enfants] on est pas censés comprendre » , tandis que les enfants doivent « apprendre la vie ».
« C’est pour ton bien ! »
Et c’est donc tout logiquement que l’adulte prend les décisions à la place de l’enfant, parce qu’en tant que personne mûre, responsable, « finie », il-elle a plus de lucidité sur les choses que l’enfant, encore naïf-ve, vivant dans un monde un peu à part, un peu coupé des réalités de la vie. C’est comme ça que les adultes fixent à l’Éducation Nationale ce que doivent apprendre les élèves, que les adultes-parents peuvent interdire telle sortie ou telle fréquentation à leurs enfants, parce qu’ils savent que ça leur serait néfaste ; et si l’avis de l’enfant concerné-e est contradictoire, c’est qu’il manque de lucidité, de discernement – comme le dit la loi.
Ainsi, Marie a été placée à 15 ans dans un service psychiatrique, sur demande de ses parents et contre sa volonté, à la suite d’une dépression. Elle m’a expliqué l’avoir vécu comme un enfermement et un abandon, qu’elle n’a toujours pas pardonné à ses parents. Aujourd’hui (deux ans plus tard), elle n’arrive toujours pas a dialoguer avec ses parents sur ce sujet : eux lui expliquent qu’il-elle ont fait ce qui était le mieux, craignant qu’elle ne se mette en danger ; quand elle considère toujours qu’il-elle ont eu tort et ne l’ont pas écouté quand elle tentait de leur expliquer que l’hospitalisation était pour elle encore plus préjudiciable.
Dans ce genre de cas, la parole de l’adulte est difficilement remise en cause, le statut même de l’enfant lui donne toute crédibilité et toute légitimité : ainsi, quand je demande à Émilie, 17 ans, si elle considère que l’enfant doit toujours obéir à l’adulte, elle me répond « c’est un adulte, il est censé... savoir plus de trucs qu’un mineur... Si il le demande c’est qu’il y a une raison ».
Des représentations évoquées, aucune ne met en valeur l’autonomie de l’enfant, sa personnalité propre ; et toutes le-la rendent dépendant-e de l’adulte. Le discours sur l’enfant, produit par les adultes – conjointement par le sens commun, la pédagogie, la psychologie – mettent l’accent sur son immaturité en négligeant ses capacités, et donc sur son besoin de l’adulte en tant que référent-e, en tant que personne qui pose les limites, qui fixe le cadre, qui borne le chemin que l’enfant a à parcourir jusqu’à sa vie d’adulte.
IV. La violence symbolique
Il s’agit ici d’évoquer, à travers le concept de P. Bourdieu, comment l’enfant accepte et entretient le rapport de pouvoir qu’il subit.
M. Fize met en avant « la tentation autoritaire » des adolescent-e-s : ses recherches rapportent en effet que ceux-celles-ci expriment le besoin d’une autorité pour les encadrer, fixer des interdits. Comment est-il possible de comprendre cela ?
Il semble que le discours produit par l’adulte sur la faiblesse de l’enfant et ses incapacités soit largement intériorisé par ce-tte dernier-e, et au delà de ça entretenu : ainsi j’ai remarqué plusieurs fois qu’en présence d’un-e adulte référent-e, l’enfant s’en remettait à lui pour une activité qu’il-elle aurait eu de façon autonome si l’adulte n’était pas là. Par exemple, lors d’une promenade en forêt, Marc, 8 ans, jouait sur un tas de bois, sans la moindre difficulté. Je l’ai ensuite rejoint et nous sommes descendus ensemble. Marc ne prêtait alors absolument pas attention à ce qu’il faisait, au point que j’ai dû à moitié le porter pour éviter qu’il tombe. Il était pourtant tout à fait capable de se débrouiller, puisqu’il l’avait fait auparavant. Néanmoins, c’est lui qui m’a demandé de lui donner la main, et quand je lui ai demandé pourquoi, il m’a répondu « j’y arrive pas ». À de nombreuses reprises, j’ai constaté des faits similaires : un enfant veut faire quelque chose (mettre ses lacets, réparer un jouet), et avant même d’essayer, il-elle appelle un adulte à l’aide, expliquant lui-elle-même « je suis trop petit ».
Dans plusieurs de ses travaux sur la domination, P. Bourdieu met en avant la notion de violence symbolique, définie comme l’adhésion du-de la dominé-e aux catégories de pensée du-de la dominant-e : le-la dominé-e intègre l’image dévalorisée que lui renvoie le-la dominant-e et légitime ainsi lui même sa domination.
« les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles » ; « le propre des dominants est d’être en mesure de faire reconnaître leur manière d’être particulière comme universelle »
C’est ce qui transparaît des propos d’Émilie, Pauline et Barbara, m’expliquant qu’il est indispensable qu’un-e enseignant-e montre de l’autorité, sinon c’est « n’importe quoi ». Le discours sur la nécessité de poser des limites pour encadrer les enfants est largement repris par ceux-celles-ci. Antoine, 14 ans, m’a ainsi expliqué qu’un-e enseignant-e qui n’avait pas d’autorité – c’est-à-dire « gueuler quand il faut » – n’avait pas de crédibilité et ne pouvait espérer se faire respecter de ses élèves.
Au delà de la légitimation de la nécessité du rapport d’autorité, c’est celle de l’infériorité de l’enfant qu’on trouve : Élise, 10 ans, m’explique que sa copine de classe, dont la chatte attend une portée, lui a dit que les chats pouvaient avoir des bébés plusieurs fois dans l’année. Elle ajoute que c’est une menteuse, parce qu’un ami de sa mère lui a dit que c’était impossible. Quand je lui demande pourquoi elle croit plus cette personne que son amie, elle me répond « bah parce que lui c’est un grand, il est plus intelligent ». Dans le même sens, Pauline, 17 ans me dit littéralement : « le mineur, il est rien » sans l’aide du-de la majeur-e.
Par ailleurs, une des particularités du rapport entre les genres est que la femme elle-même s’approprie le rôle qui lui est désigné et le revendique. La domination symbolique se fait encore plus facilement dans le cas où l’image attribuée à la catégorie dominée est valorisante : ainsi l’enfant ne se perçoit pas comme oppressé-e, dans la mesure où ceux-celles qui détiennent l’autorité sur lui-elle témoignent à son égard de la considération. La représentation de l’enfant, si elle contient des éléments légitimant sa mise sous tutelle, lui accorde également une place de choix dans la société, comme objet des attentions de tou-te-s.
V. La « naturalisation » de la catégorie enfance
Dans cette dernière partie, je développe que le fondement premier de la légitimité de l’autorité est qu’elle est conçue comme naturelle, renvoyant ainsi à notre point de départ, la différenciation entre les catégories.
G. Neyrand explique la « naturalisation » des rapports entre enfants et parents par la transposition du modèle des sciences humaines – et notamment de la psychanalyse articulant le développement de l’enfant sur son rapport à l’autorité paternelle – au sens commun :
« Cette représentation sociale particulière que constitue un modèle familial dominant organise la perception de la famille en la faisant apparaître naturelle. Ce modèle articule dans une structure hiérarchique déterminée les rapports entre le père, la mère et l’enfant en donnant à chacun une place définie et spécifique »
On constate en effet que dans bien des cas, les acteur-rice-s éprouvent des difficultés à expliquer l’ordre des choses, les raisons qui justifient l’existence d’un rapport d’autorité. Ainsi, quand j’insiste auprès de Valérie pour qu’elle m’explique pourquoi, selon elle, sa mère éprouve sans cesse le besoin de lui dire de faire des choses qu’elle ferait d’elle-même, elle ne trouve rien d’autre à répondre que « parce que c’est ma mère ». Les mécanismes de légitimation que nous avons abordé ci-dessus, tels que la fragilité de l’enfant, son irresponsabilité ou son besoin de limites sont présentés comme vérités universelles et incontestables, et non comme constructions sociales ou résultats de théories particulières. À de nombreuses reprises au cours de cette enquête, particulièrement par rapport à la légitimation de l’autorité, les enquêté-e-s ont semblé trouver mes questions saugrenues tant la réponse leur semblait évidente. Je me souviens particulièrement d’une fois où je demandais à un adulte pourquoi il était nécessaire de punir l’enfant (ce qu’il avait lui-même affirmé quelques minutes auparavant) : il est resté sans voix, manifestement perplexe, et puis m’a bégayé quelque chose comme « bah... parce qu’il faut bien poser les limites, je sais pas moi... Comment ferait-on sinon ? ».
Dans l’Arrangement des sexes, E. Goffman explique la spécificité de la domination masculine par la valorisation des femmes : « les femmes sont une catégorie défavorisée particulière, en ce qu’elles sont les seules parmi ces catégories – à la seule exception des enfants – à être, dans la société occidentale, idéalisées comme des objets purs, fragiles et précieux ». On peut noter en effet que, contrairement aux autres groupes socialement dominés, les enfants ne bénéficient pas d’une image négative : ils-elles sont considéré-e-s comme la richesse des familles, comme l’avenir de la société et jouissent d’une attention particulière. Les enfants sont généralement objets de tendresse, d’affection, ce qui n’exclut pas l’existence d’un rapport inégal : comme nous l’avons vu, c’est parfois au nom de l’attachement porté à l’enfant qu’on le prive d’autonomie, considérant que l’adulte – enseignant-e ou parent-e – est plus à même de déterminer son bien. On voit donc ici que relation privilégiée et rapport de pouvoir sont loin d’être incompatibles, et que c’est par des mécanismes subtils que l’intérêt de l’enfant donne la légitimation à l’exercice de l’autorité. C’est précisément ce qui sous-tend, par exemple, la notion juridique de détournement de mineur : c’est parce que le-la parent-e aime son enfant, qu’il-elle veut le protéger et cherche son intérêt, qu’il-elle exerce son droit d’interdire à l’enfant certaine fréquentation, allant ainsi à l’encontre de l’envie de l’enfant.
Par ailleurs, dans la préface de l’ouvrage, C. Zaidman met en avant l’idée de « with-then-apart », reprenant l’idée de E. Goffman selon laquelle hommes et femmes, contrairement aux autres groupes antagonistes, vivent dans un rapport de proximité et non de ségrégation ; ce qui est également le cas entre enfants et adultes. D’où une caractéristique spécifique du rapport : la domination n’est pas à étudier dans des pratiques discriminatoires ou des affrontements ponctuels, mais au cœur de la vie quotidienne, dans l’existence même d’une différenciation et de l’élaboration de représentations distinctes du rôle de chacun-e ; dans la mise en scène de la catégorisation.
Ce qui est éminemment problématique dans le rapport entre enfant et adulte, tout comme entre femme et homme, c’est le passage opéré entre une différenciation biologique minime et une différenciation sociale majeure, au point que la classification opérée par l’organisation sociale donne l’illusion d’une pleine adéquation avec la différence naturelle. Or le simple fait que l’enfance en tant que période de la vie puisse être considérée comme construction sociale l’invalide : un-e individu de 10 ans pouvait être reconnu-e capable au Moyen-Âge d’activités dont il-elle est aujourd’hui exclu-e en raison même de son statut d’enfant. E. Goffman explique que la différenciation s’opère par le biais de notre système d’identification : c’est par l’étiquetage que nous attribuons à un-e individu le statut d’enfant, en fonction de son apparence, et que nous le-la désignons comme tel-le. Il s’agit donc d’un apprentissage, au cours duquel nous intégrons et nous nous approprions les catégories sociales en vigueur pour les appliquer ensuite aux situations rencontrées. Dans ce sens, l’idée d’un rapport « naturel » entre enfant et adulte n’est que la construction idéologique légitimant l’ordre social.
« En vertu de son « infériorité naturelle », l’enfant, qui est soumis à un rapport de domination constant, doit se conformer, se soumettre, obéir. Les institutions d’éducation : famille, école, lui renvoient en permanence son statut de mineur. » (Fize M., A mort la famille)
Éléments de conclusion : Apports et limites de la recherche, perspectives
Le serpent qui se mord la queue
Le schéma dégagé semble être le suivant : il existe une différenciation entre la catégorie enfant et la catégorie adulte, qui est le produit, au delà du biologique, d’une construction sociale. La différence de statut devient, par la définition même de l’enfance, une inégalité de statut. Sur cette dissymétrie se constitue un rapport de domination, dans lequel la forme spécifique de pouvoir que constitue l’autorité tient une place fondamentale. Si ce rapport est possible, c’est parce qu’il est légitimé, à savoir reconnu et entretenu par tou-te-s les acteur-rice-s concerné-e-s, enfants comme adultes. La légitimation trouve ses fondements dans les représentations sociales de l’enfant, représentations qui participent de la séparation des catégories, nous ramenant ainsi au point de départ. Ce schéma constitue donc une boucle, représentation des catégories et rapport d’autorité s’entretenant mutuellement : le choix de l’ordre de présentation effectué ici, s’il me semblait le plus logique, est donc nécessairement arbitraire. Il me semble que pour comprendre ce qui se joue au niveau de l’autorité, il est nécessaire de restituer ce type de rapport dans l’ensemble qui le génère.
L’intérêt d’un regard sociologique
D’une certaine manière, cette recherche, basée sur les rapports entre enfants et adultes, a pénétré dans une sphère peu investie par la sociologie, à travers un objet qui semble traditionnellement traité sous un angle psychologique. J’espère que ma recherche m’aura au moins permis de dégager ce qu’il y a de fondamentalement social au cœur de ce sujet, dans la mesure ou au centre de ce rapport d’autorité réside une catégorisation, produit autant que génératrice d’un ensemble de représentations sociales. Il était donc intéressant de contredire cette sorte de monopole de la psychologie ou des sciences de l’éducation pour mettre en lumière une analyse sociologique.
Une esquisse de recherche
Ce travail est plus à considérer comme une ébauche, une sorte de premier jet permettant de poser les bases pour une recherche à venir. La première raison tient bien sûr au calendrier fixé pour cette recherche à la difficulté que j’ai pu avoir dans ce cadre à tenir les échéances. Mais pas seulement. La raison principale doit être cherchée dans l’objet en lui-même : fidèle à moi-même d’une certaine manière, j’ai – comme on le dit si souvent aux enfants – eu « les yeux plus gros que le ventre », en refusant de découper un objet qui semblerait, par son étendue, plus approprié à un travail de thèse.
Toutefois, en tant que première approche, il me paraît toujours intéressant d’avoir essayé d’adopter ce point de vue large, en montrant que la spécificité du rapport concernait bien les enfants et les adultes en général, et non certains types d’acteur-rice-s en particulier. J’ai donc plus concentré mon regard sur ce qui est commun, ce qui apparaît comme transversal – d’une certaine manière idéal-typique – malgré la diversités des situations et des rapports, ce qui n’est pas sans poser quelques problèmes. Ainsi, il m’a souvent été difficile de mettre en parallèle des situations aussi diversifiées que j’ai pu en étudier, d’en dégager les traits tout en ne pouvant pas me perdre dans leurs détails et variations. De fait, tous les points abordés ici peuvent être vus comme sorte de prémisses, d’entrée en matière, et nécessiteraient d’être approfondis, creusés, détaillés.
Un deuxième temps de cette recherche pourrait justement être l’étude des particularités, des spécificités propres pour chaque type d’acteur-rice-s et de formes relationnelles. En effet, le rapport d’autorité ne revêt pas du tout les mêmes formes dans la relation parent-e/enfant que dans la relation professeur-e/élève, et ne repose pas non plus sur les mêmes éléments, les rôles étant définis différemment. De même les représentations varient en fonction des différentes phases de l’enfance, et le rapport aux capacités et à l’autonomie reconnue s’en trouve modifié. J’ai pu apercevoir que le rapport à l’autorité varie en fonction de la construction genrée – pour ne pas dire du sexe – ce qui peut probablement être détaillé et mis en lien avec la socialisation différenciée, l’héritage du patriarcat, la notion d’Œdipe, etc. Il serait intéressant par ailleurs de se pencher plus en avant sur l’adolescence, d’interroger cette notion de crise – il n’est d’ailleurs probablement pas anodin qu’on qualifie cette période d’ « âge ingrat » – qui semble coïncider avec le déclin du statut particulier de l’adulte, l’estompement de la frontière entre les catégories ; et le début de la remise en cause de l’autorité. La question des mutations des formes familiales (modifications du rapport homme-femme, familles mono-parentales ou recomposées, etc.) pourrait également être mise en perspective. En définitive, de nombreuses pistes encore à explorer...
Le piège de l’adulto-centrisme
Un premier problème à ce niveau là réside dans le fait que l’accès direct à l’enfant est difficile, voir impossible pour les plus jeunes, qui sont toujours en présence d’un-e adulte. Dans ce cas là, l’entrée en relation avec l’enfant implique l’accord de l’adulte et donc sa confiance – à la fois confiance par rapport au-à la chercheur-se, mais également par rapport à l’enfant et à son discours. De fait, le rapport est altéré, puisque l’adulte se fait l’intermédiaire de l’accès à l’enfant, d’où un certain positionnement, déjà, de l’enfant par rapport au-à la chercheur-se. Il arrive même que, lorsqu’on essaie de discuter avec l’enfant, l’adulte (particulièrement le-la parent-e) s’invite dans la conversation, perturbant ainsi la relation de dialogue par sa présence, alllant jusqu’à reprendre l’enfant ou répondre à sa place.
Un autre problème peut paraître évident mais mérite tout de même d’être souligné : aux yeux de l’enfant, le-la sociologue est un adulte. Or, j’ai souligné ici l’existence de dissymétries dans l’interaction1 mixte, plaçant l’enfant dans une position d’infériorité qui peut l’amener à la gène ; j’ai en effet constaté des situations de dialogue entre moi et un-e enfant où il était flagrant que ce-tte dernier-e cherchait ses mots, pesait ses réponses, avançait avec prudence sans jamais se lâcher. Ici, les difficultés posées par l’entretien, liées à l’image que l’enquêté-e pense devoir renvoyer au-à la chercheur-se, sont particulièrement difficiles à surmonter.
Enfin, les données accessibles au-à la chercheur-se sont essentiellement produites par les adultes. En effet, étant moi-même adulte, je ne peut percevoir du comportement de l’enfant que celui qu’il-elle adopte en présence d’adultes ; et il y a fort à supposer que ce comportement diffère de celui qu’un-e enfant peut avoir avec d’autres enfants, hors du regard de l’adulte, auquel je ne peux accéder. Au final, le discours et les représentations de l’adulte qu’échangent les enfants me sont interdites. Ainsi, si je peux surprendre dans le bus une conversation entre des jeunes expliquant qu’ils en ont vraiment assez des adultes, et qu’ils-elles sont tous pires les un-e-s que les autres, il est peu vraisemblable qu’un-e enfant me tienne ce type de discours lorsque je l’interroge.
Mais surtout, les discours et les représentations étudiées sont essentiellement produites par l’adulte : c’est le monde adulte qui définit le statut et le rôle des enfants, ceux-celles-ci les intériorisant à leur tour, nous ramenant à la notion de violence symbolique. De fait, on ne trouve pas réellement de visions d’enfant, justement parce que leur statut détermine qu’il apprennent de l’adulte.
Ces considérations nous ramènent à un problème plus vaste, qui probablement concerne toutes les recherches basées sur l’existence de deux catégories distinctes, se définissant mutuellement pas l’exclusion de l’autre ; renforcé par les rapports antagonistes qui peuvent exister. Le sociologue est lui-elle-même, statutairement, d’un côté ou d’un autre de la barrière. Tout comme on peut supposer que les résultats d’une étude sur le genre varierait selon que le-la sociologue qui la mène est un homme ou une femme.
Contre le sens commun
La question de la distinction des catégories en tant que processus social, de même que celle des mécanismes de légitimation de l’autorité semblent très difficile à interroger du fait de leur « naturalisation ». La notion d’enfance apparaît d’une certaine manière comme ciment de l’ordre social, rattachée à l’institution-famille comme à l’institution-école ; imprégnée dans le sens commun au point qu’il est difficile de la mettre en question. La dimension d’évidence qu’elle revêt amène dans de nombreuses situations à des difficultés de réponse des enquêté-e-s. Plusieurs fois, des acteur-rice-s se sont montrés perplexes face à mes interrogations, m’avouant ne jamais s’être posé la question. De nombreuses réponses s’articulent ainsi sous la forme de « parce que c’est comme ça », comme des vérités que seul-e un-e simple d’esprit ou un-e extraterrestre (ou peut-être un-e enfant ?) pourrait ne pas saisir. Ainsi, certaines questions que j’ai soulevé – du type « pourquoi l’adulte peut punir l’enfant et pas l’inverse » – ont semblé paraître aux yeux des enquêté-e-s comme des aberrations. Cette difficulté me semble d’une certaine manière le propre du travail sociologique, mais apparaît comme particulièrement exacerbée par rapport à cet objet.
Le paradoxe du statut de l’enfant
Il s’agit d’un point qui me pose particulièrement question à la fin de cette recherche, et qui sans doute mériterait d’être creusé. Ce qui me paraît important aujourd’hui de mettre en valeur – mais peut-être est-ce l’influence de la sociologie du genre – réside dans la construction des catégories, c’est-à-dire dans le processus d’apprentissage et d’intériorisation des rôles spécifiques, dans le passage de l’opus operatum au modus operandi, pour reprendre P. Bourdieu. Et de ce point de vue là, la grande particularité de la catégorisation en termes enfant-adulte, par rapport à d’autres types, trouve son fondement dans le caractère provisoire de cette catégorisation. Si la distinction entre homme et femme revêt une certaine permanence, le propre de l’enfance est d’être une période transitoire. Il nous faut ici interroger comment un enfant apprend à être un enfant, tout en considérant qu’il apprend simultanément à être un adulte par sa socialisation.
Les femmes et les non-blancs ayant crié assez fort, on leur a finalement consenti le statut d’opprimés. Mais on ne pense pas encore aux enfants, car ils se taisent.
De tous les opprimés doués de parole, les enfants sont les plus muets.
Les cris et fureurs qui émanent du groupe ne sont pas perçus comme protestation inarticulée, mais comme un fait de nature : les enfants, ça crie. Nul être pourtant ne crie sans raison.
« Les enfants » (la seule définition précise et recevable du terme étant celle de la Loi : personnes de 0 à 18 ans) ne disposent pas de moyens de s’exprimer. Ils n’y sont pas invités, les décisions qui les concernent étant prises sans leur avis. Ils croient qu’ils ne savent pas, étant dits ignorants bien qu’on les instruise six heures par jour. Et par-dessus tout ils n’osent élever la voix, étant pour leur survie dans la dépendance totale des adultes, qui ne permettent pas la mise en question de leurs Œuvres - ces œuvres qui seront l’héritage forcé des gens aujourd’hui jeunes, et muets.
Ce sont les adultes qui parlent pour les enfants, comme les blancs parlaient pour les noirs, les hommes pour les femmes. C’est-à-dire de haut, et de dehors.
Entre les adultes qui parlent des enfants comme ils les veulent, et les enfants qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes, la passe est étroite.
Et la mystification se porte bien.
Il faudrait pourtant sortir de là.
Mais être « adulte » après tout n’est qu’un choix, par lequel on s’oublie, et se trahit. Nous sommes tous d’anciens enfants. Tout le monde n’est pas forcé de s’oublier. Et dans la situation dangereuse où le jeu adulte aveugle nous a menés, et veut entraîner les plus jeunes, l’urgence aujourd’hui presse un nombre croissant d’anciens enfants qui n’ont pas perdu la mémoire de basculer côté enfants.
Ayant longuement vécu dans la cité, on connaît la mécanique du jeu adulte. On peut en montrer les rouages. Comme ancien enfant qui a gardé la mémoire, on se souvient que la dépendance nous mettait un bâillon, et que l’éducation nous bandait les yeux, nous imposant non seulement des conduites mais des façons de sentir, conformes au projet adulte, et qui invalidaient notre expérience. On peut le dire, et confirmer l’expérience. On ne parle pas du dehors, « sur » les enfants, on parle du dedans, et de soi.
Ce n’est pas un travail objectif. Mais les enfants ne sont pas des objets.
C’est dans cette marge étroite que se situe cette tentative : il faut commencer quelque part.
Cela implique que, si pas comme enfant, c’est comme ancien enfant qu’il faudrait regarder ce qui suit.
Une parmi des anciens enfants
Christiane Rochefort
Les enfants d’abord
Grasset, 1976
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (650.2 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (594.4 ko)