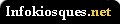A
ASCAB, pérégrinations de trois saisonnières dans le pétrin
mis en ligne le 18 avril 2024 - anonymes
En cet été caniculaire de l’année 2022, nous nous sommes retrouvées à travailler ensemble dans un fournil. « Nous », c’est trois meufs dans la trentaine, gravitant autour du réseau de l’internationale boulangère mobile, boulangeant depuis plus ou moins longtemps, au chômage ou au RSA au moment de l’embauche. Nous avons toutes les trois appris par de longues périodes de bénévolat dans des fournils et nous voulions continuer de nous former en touchant un salaire. Pour certaines d’entre nous aussi, il y avait la curiosité de découvrir une organisation en scop.
La scop en question, c’était entre autres du pain au levain cuit au feu de bois et pétri à la main, des blés population, un label nature et progrès et tout le tintouin. Une scop qui nous a recrutées via le réseau de l’IBM. Même si on s’attendait dès le départ à un travail saisonnier éprouvant, on n’imaginait pas des conditions de travail aussi dégradées et un déni aussi crasse de la part de nos employeur·es. Très simplement, on s’est dit qu’on ne tiendrait pas l’été. Alors en plus de bien serrer les pâtons pour faire de jolis pains, on s’est serré les coudes. Et c’est ce qui nous a permis de tenir le coup : on était bien contentes d’être trois paires de coudes avec le même statut d’employées saisonnières !
Au fil de nos discussions, on a eu envie de relier ce vécu d’une saison en boulange avec les réflexions en cours au sein de l’IBM sur le travail (professionnalisation du réseau, liste noire de certains fournils…). Nous avons eu besoin de partager avec le réseau quelque chose que nous ne voyons pas comme « une mauvaise expérience professionnelle », mais comme quelque chose de symptomatique de la limite très fine qui peut exister dans certains imaginaires entre « militantisme » et entrepreneuriat. On s’est dit que ça pourrait faire du bien de développer une réflexion collective sur les tendances à la dépolitisation de la « boulange militante », voire à la reproduction et à la participation aux mêmes logiques de ce contre quoi on se bat.
Même si on parle toutes les trois de différents endroits et rapports au travail, on partage un horizon politique : celui qui nous a amenées à nous rapprocher de l’Internationale boulangère mobile. Ce à quoi on aspire, c’est que nos pratiques tendent vers nos idéaux politiques. Et donc boulanger sur des lieux de luttes, pour les luttes, mutualiser des outils et des pratiques, adapter notre manière de boulanger à nos capacités et à nos besoins. On ne peut pas, dans cette optique, se satisfaire du modèle de l’entreprise, qu’elle soit individuelle ou collective, parce qu’elle implique la reproduction du modèle capitaliste, et entretient la frontière entre qui a le droit de travailler et de consommer ou pas, et qui a le droit à une vie digne, voire à une vie tout court.
Une fois que c’est dit, il nous paraît important de clarifier que notre but ici n’est pas de distribuer des points de bonnes ou mauvaises pratiques, mais simplement de rappeler l’existence de la conflictualité inhérente au salariat. Nous ne voulons pas non plus attaquer des individus : le salariat est une nécessité pour beaucoup d’entre nous ; le modèle de l’autoentreprise, une possibilité pour certain·es de sortir du salariat ; et celui de la scop, une manière de « gagner sa vie » beaucoup plus éthique, et souvent plus heureuse et plus politisante que la plupart des autres. On peut aussi rappeler que « sortir » du travail en (sur) vivant avec un RSA n’est pas une option pour tout le monde.
Ainsi, ce qu’on veut faire ici, ce n’est ni une simple dénonciation des méthodes d’une entreprise en particulier, ni un vrai travail d’enquête. C’est plutôt, en partant d’une expérience spécifique, montrer structurellement ce qu’est une scop, ce que ça n’est pas, et ce que ça peut perpétuer. Spoiler : le capitalisme, le management néo-libéral, et des pratiques antiféministes et validistes ; et de là, pouvoir s’outiller et s’organiser.
On s’excuse d’avance pour les ruptures de style, les contradictions et les longueurs ! On a adoré écrire un texte ensemble mais on n’a pas l’habitude de faire ça, pas le même rapport à l’écriture et pas forcément la même vision sur tout !
Acacapitalisme
Le pain, le gain, le blé, la monnaie
Commençons par un court rappel sur le capitalisme et sur le travail, qui nous paraît bien nécessaire pour parler des scop. À l’intérieur du système capitaliste, la survie des individus ne dépend pas des services ou marchandises produites et consommées, mais de leur vente. Je peux décider de faire du pain pour me nourrir ou nourrir les autres, mais cette condition est subordonnée à ce que cette activité me rapporte un salaire. Pour qu’une entreprise puisse exister, elle doit être rentable. L’économie se tape que ce sont de gentil.les zadistes qui montent leur boulangerie en scop : la seule chose qui importe, c’est d’être compétitif·ves afin de survivre économiquement. Et le salariat, c’est la force de travail échangée contre de l’argent, sans lequel on peut bien aller crever. En ce sens, d’un point de vue marxiste, le travail n’est pas une catégorie neutre, et ce qu’on entend par travail a pris naissance avec le capitalisme : les sociétés ont toujours produit des choses pour vivre, mais cela n’a rien à voir avec le salariat, qu’on peut définir comme le temps humain converti en plus-value permettant la reproduction du système capitaliste. L’existence du travail est la condition de la perpétuation de l’exploitation (la survie de chacun·e est dépendante d’avoir un travail rémunéré, quel qu’il soit) et des injustices (qui a accès à tel ou tel travail ? Qui a le droit de travailler ? Quelle activité est considérée comme un travail ?).
Ces considérations préliminaires nous paraissent importantes parce que la critique sociale revendique majoritairement des formes d’égalité sociale et économique à l’intérieur de la pensée capitaliste, avec le travail pensé comme un principe universel et intemporel. Dans les pensées de « gauche », le travail est toujours considéré comme le problème mais la réponse est toujours de travailler autrement ; et il est courant, pour beaucoup de personnes, de se considérer comme anticapitalistes tout en pensant que le travail, sous certaines conditions (que ce soit l’autogestion des moyens de production, plus de démocratie dans l’entreprise, des horaires aménagés…) ne poserait aucun problème. Il nous paraît donc indispensable de faire l’effort collectif de penser au-delà des rapports marchands, même si c’est difficile.
À partir de là, on peut parler des entreprises « alternatives » ou « militantes », et plus spécifiquement, pour ce qui nous intéresse, des scop. On voudrait apporter un contrepoint à l’idéalisation de ce modèle, en abordant le fait qu’elles s’intègrent dans l’économie néo-libérale actuelle et participent même à la renforcer, et peuvent aussi renforcer les dynamiques d’exploitation. On voudrait aussi voir en quoi le modèle de la coopérative peut aussi être un outil de pacification sociale et de canalisation des luttes.
Eh quand tu mens comme ça
Une scop, ou « société coopérative de production », est une société commerciale de type SA ou SARL [1], qui comme n’importe quelle entreprise, est soumise à la concurrence et à l’impératif de réaliser des bénéfices. La principale différence se situe dans les valeurs qu’elle porte (la « démocratie participative »), rendues possibles par une plus grande gestion de l’entreprise par les salarié·es : la scop se distingue des sociétés classiques par une détention majoritaire du capital et du pouvoir de décision par des « salarié·es -associé·es ». Le taux de sociétariat est de 69 % en 2021 [2], et les scop, par réalisme économique, peuvent employer des personnes n’ayant pas la qualité d’associé·es. Les CDD sont courants et pratiqués quasi exclusivement pour les emplois saisonniers : ainsi, dans la scop ou nous avons travaillé, 30 % du chiffre d’affaires est réalisé en juillet-août (pour une production en saison allant jusqu’à plus d’une tonne et demie de pain par semaine), et le maintien d’un salaire de 12 euros brut à l’année pour les cinq salarié·es - associé·es dépend de l’embauche de personnes en CDD sur la période estivale.
Historiquement, la scop dérive des coopératives ouvrières qui ont essaimé un peu partout au début du 19e siècle, et qui luttaient pour le contrôle par les ouvrier·es des moyens de production [3] (étape obligatoire vers l’abolition du salariat pour certain·es, possibilité d’accès à une forme de patronat collectif pour d’autres, on se demande bien laquelle de ces deux conceptions l’a emporté). Les associations ouvrières ont tour à tour été réprimées et autorisées, puis se sont développées parce que c’était beaucoup plus intelligent pour l’État de les intégrer au système de production plutôt que de les interdire. Ainsi, en 1901, par le biais de la loi sur la liberté d’association, l’État français entérine la reconnaissance de projets plus ou moins utopiques — coopératives ouvrières, mutuelles, etc. Selon les dires de Pierre Waldeck-Rousseau, lors de la défense du projet de loi à l’Assemblée nationale, « la coopération est un outil de paix sociale et un facteur de promotion individuelle ». Il s’agit bien de neutraliser les projets émancipateurs issus de la classe ouvrière en les vidant de leur portée révolutionnaire. De la même manière, la popularité des scop aujourd’hui ne vient pas de nulle part : en 1978, une loi définit leur statut et amorce leur développement, de concert avec le début de la casse du service public consécutif à la crise économique. L’État transmet ainsi aux acteur·ices privé·es, coopératives de production et secteur associatif, ce qui était jusque là de son ressort [4].
Dans les années 2010, les scop ne sont plus des projets « en marge » : elles sont sujettes à de grandes campagnes de communications de la part de l’État, et sont encadrées par des lois relatives à l’économie sociale et solidaire qui est devenue un marché lucratif. Aujourd’hui, les scop ne se sont jamais aussi bien portées : en 2022, on compte en France 4 400 scop, 82 000 salarié·es, et un chiffre d’affaires de 8,4 milliards d’euros [5]. Les scop sont reconnues par les pouvoirs publics, le monde de l’entreprise et la littérature managériale comme un « modèle pour l’entreprise de demain », et leur publicité est faite à travers de nombreux événements, salons et campagnes de communication. Marina Bertrel, dans son article « La scop, d’un idéal social à un modèle entrepreneurial » [6], montre à quel point celle-ci produit de la valeur et de l’emploi. Innovante, compétitive, elle participe à une grande part de la vie économique et de la croissance française. Elle est vendue comme une solution face aux crises économiques, notamment parce qu’elle permet de sauver les entreprises des fermetures et délocalisations (14 % des effectifs créés proviennent de transmissions d’entreprises).
Mais si les scop ont la côte, c’est surtout grâce aux valeurs « alternatives » — et considérées comme « modernes » par le néo management — qu’elles portent, à savoir la démocratie, la solidarité, le développement durable ou encore la répartition des richesses. Pour Martina Bertrel, la scop « constitue un modèle alternatif intéressant pour les porteurs de projet souhaitant insuffler une dose de démocratie et de management participatif à leur future entité ». Pour les défenseur·es de l’ESS, « l’acapitalisme » serait une forme d’économie à visage humain, ou le bien de tous·tes primerait sur la recherche du profit [7]. Ce terme transmet un imaginaire positif et consensuel basé sur le mythe d’un capitalisme qu’il serait possible de réformer. La conflictualité, à l’inverse, est un principe bien plus difficilement récupérable, et elle est absente des discours des partisan·es de l’ESS : la lutte des classes a été évacuée au profit de la démocratie participative, et l’exploitation a été remplacée par le bien vivre ensemble. D’ailleurs, en 2010, la « coopérative ouvrière de production » change d’appellation et devient « société coopérative et participative ».
Y’a pas d’arrangement
La mise en avant des scop par l’État dérive du besoin d’innovation du capitalisme, qui se nourrit de la critique pour se renouveler. Et pour la plupart des personnes qui peuvent se poser la question du choix de leur travail, le modèle de l’entreprise qui avait cours au 20e siècle, basé sur la hiérarchie et le taylorisme, n’attire plus : le travail doit désormais être porteur de sens et synonyme de bien-être individuel. Dans les manuels de néo-management actuels, l’auto-organisation, la logique participative, l’autonomie et l’adaptabilité sont des principes nécessaires pour donner envie aux gens d’intégrer une entreprise. Par ailleurs, la perte de sens au travail, doublée des conséquences visibles du néo-libéralisme telles que les crises sociales et environnementales, rend attractives pour beaucoup l’autoentreprise ou la coopérative. À titre d’exemple, la revue « Ici bazar » [8] veut « explorer le monde du travail sous un angle constructif. Son ambition : parler du besoin de satisfaction, de responsabilité, de liberté, de penser et de faire du travail ». La néo-boulange est extrêmement attirante pour beaucoup dans ce contexte : c’est un « métier-passion », « qui a du sens » et qui opère un « retour à l’essentiel ». Elle attire inévitablement les gourous comme des mouches : des Daniel Testard ou autres Roland Feuillas allient à merveille discours mystiques, essentialistes, misogynes et traditionalistes sur leur métier de boulanger, développement personnel, formations payantes et opérations marketing, et ignorance totale des conditions d’existence de la majorité des personnes qui ne rentrent pas dans leur idéologie.
On notera, autant chez les néo-managers que chez les hippies auto-entrepreneur·ses, une récupération du lexique de la lutte des classes, transformé en slogans mous aseptisés de toute conflictualité. Le conflit, en effet, ne favorise ni la productivité ni le bon alignement des chakras. La prolifération d’autoentreprises et de scop de boulange, par contre, ne gêne ni l’État ni l’agro-industrie. On peut reprendre ici l’analyse de Notre pain est politique [9], qui rappelle que la croissance n’implique pas de produire moins, mais de vendre davantage, et est donc friande de nouveaux débouchés ; l’industrialisation et la standardisation de la boulangerie peuvent, au 21e siècle, coexister avec une diversification de la filière. Les entreprises « à taille humaine » produisant et vendant sur leur territoire ne sont pas des concurrentes de la grande distribution ; elles leur sont complémentaires, et touchent d’autres consommateur·ices : la segmentation des marchés permet la coexistence de pain destiné à une « clientèle soucieuse de l’environnement et de la santé », et de pain peu nourrissant à l’indice glycémique élevé pour les autres.
Terminons en rappelant que bien que les patron·nes existent dans les scop, le principe de la coopérative est la gestion de la société capitaliste par les producteur·ices elleux mêmes, et que la seule autogestion qui y existe est l’autogestion de l’exploitation. Les salarié·es ont des parts dans l’entreprise et sont leurs propres managers, ce qui a pour conséquence directe que les salarié·es des scop ont une préoccupation de la réussite économique de l’entreprise plus forte que dans les autres entreprises [10]. Pour reprendre les mots de la brochure « Contre le mythe autogestionnaire » : « la gestion des processus productifs et d’échange [par les producteur· ices] est un arrêt du processus révolutionnaire, un renforcement de l’ordre établi qui renvoie le prolétariat à la seule place que lui laisse le capital, celle de producteur de valeur, quitte à lui laisser le rôle de gestionnaire » [11].
« Je suis pas patron, je suis anarchiste »
My love has got no power, he’s got his strong beliefs
Les impératifs de rentabilité qu’implique forcément le modèle capitaliste ont pour conséquence des conditions de travail dégradées. Surtout, les entreprises « de gauche » adoptent, consciemment ou non, des méthodes managériales spécifiques, dont on a bien fait les frais. Dans la scop où nous avons travaillé pour des durées plus ou moins longues (deux à six mois), nous avons fait le constat d’un grand écart entre le discours et l’image revendiquée par les salarié·es-associé·es et les conditions de travail réelles. Tout se passait comme si on débarquait dans un univers à part, où le récit mythologique faisait office de convention collective.
Pour planter le décor, il est important de rappeler notre place dans l’entreprise : celle de travailleuses précaires ayant déménagé pour répondre à un besoin saisonnier de main-d’œuvre. 30 % du chiffre d’affaires étant réalisé l’été, c’est à cette condition que l’équilibre financier de la scop est atteint, et que le salaire annuel des cinq travailleur·euses associé·es est assuré. Il n’y a donc pas d’égalité de statuts, de rôles, ni même de stabilité financière entre saisonnières et permanent·es. Inégalité qui sera niée tout au long de notre expérience de travail.
Pour comprendre de quoi on parle, il faudrait déjà noter que le vocabulaire de l’entreprise dans cette scop est souvent banni : les notions de « salarié·es » et de « patron·nes » ne sont pas assumées. On préférera d’ailleurs utiliser, quand on y est vraiment obligé, le terme « employeur·euses » qui est plus policé. Ces termes sont notamment floutés par les statuts individuels particuliers prévus par la scop (salarié·es-associé·es, associé·es ex-salarié·es, salarié·es non associé·es, saisonnièr·es ou pas…). Ces termes sont ainsi rejetés par les permanent·es qui les identifient à des valeurs de droite. Pour donner un exemple éloquent, dans un échange de mail en fin de saison, alors que nous avions souligné une nouvelle fois des problèmes, nous avons pu recevoir dans un mail ce genre de remarque : « Dernière chose que je tiens à vous partager, mais que pour le moment je n’arrive pas à placer : j’ai vraiment l’impression d’avoir l’image du patron méchant, obnubilé par la production, responsable de votre fatigue et de vos blessures. Ben j’aime vraiment pas ça et je trouve pas ça juste. »
Le lien de subordination salariale qui nous concernait n’étant pas assumé, on voit bien comment se met en place une déresponsabilisation permanente des employeur·ses. Celle-ci s’articule de fait avec une méconnaissance (un désintérêt ?) du droit du travail. Dès le début de nos saisons respectives, nous avons par exemple constaté que les montants du salaire horaire annoncé et de celui qui figurait sur nos feuilles de paie ne correspondaient pas. La raison ? Un calcul maison, ajoutant au salaire horaire le montant de la prime de précarité, sous couvert « d’égalité salariale » avec les permanent·es ! Une première alerte qui met en lumière, très vite, la négation totale de nos situations singulières dans l’entreprise : celles de précaires qui, au terme de leur CDD, doivent replier bagage pour retourner à leur RSA et à leur indemnité chômage.
Cette illusion de l’égalité patron·nes/salarié·es conduit entre autres à ce que A. Brault-Moreau appelle le « management déguisé » ou « management de l’évitement » [12]. Là où on proclame un fonctionnement autogestionnaire sans se doter des outils de l’autogestion ni considérer les enjeux de pouvoir existants, on rejoint des formes de management proches du management libéral : « Loin d’une anomalie, une organisation floue, masquée ou non assumée du travail ou du collectif de travail peut constituer en soi un mode de gestion des travailleur·euses, le fonctionnement “normal” de la structure, voire un atout du point de vue de l’employeur. Le management déguisé permet en effet à celui-ci de se dégager de ses responsabilités et de laisser ses salarié·es en subir les conséquences : sur-responsabilisation, culpabilisation, auto-exploitation. »
L’exemple personnel de la collègue saisonnière débarquée à la boulange en plein feu du mois de juillet l’a bien montré : son arrivée a été marquée par l’absence de consigne claire, elle n’a bénéficié d’aucun temps de formation, et on attendait pourtant d’elle les mêmes gestes et cadences que les permanent·es, la rappelant systématiquement à l’ordre sur ce qu’elle ne faisait pas assez vite ou pas correctement. L’organisation du travail elle-même peut être regardée au prisme des formes d’organisations du travail valorisées par le management néo-libéral. Flexibles à l’extrême, les plannings de travail basés sur le principe de l’annualisation des horaires sont à double tranchant pour les travailleuses en contrat court. Cela suppose en effet que nous ne puissions jamais prévoir nos horaires ni l’intensité de travail attendue, et au terme du contrat le calcul des heures supplémentaires est rendu extrêmement complexe. L’une d’entre nous, qui a fini son contrat par un mois d’arrêt maladie, a du négocier longuement ses heures supplémentaires, mais aussi les calculer elle-même ; et donc se placer dans une posture inconfortable – celle de réclamer de l’argent dû – et culpabilisante.
Dans ce contexte, les multiples entorses au droit du travail constatées — heures de nuit et du dimanche non rémunérées, journées de douze heures, pas de pauses, non-respect du repos de onze heures entre les journées, plannings non faits ou changeant au dernier moment, heures supplémentaires non calculées… — trouvaient difficilement une place pour être exprimées. Les revendications que nous avons eu à porter très rapidement en termes de besoins matériels (un logement, une assurance pour nos véhicules), de différences de statuts (réaffirmer nos statuts de salariées précaires) et de droit du travail (cadences, sécurité au travail, salaires) sont donc venues rompre ce récit-fiction. Nous avons ainsi dû créer nous-mêmes les espaces de discussion et de revendications, car les réunions au cours de la saison n’étaient pas au programme de nos collègues/employeur·euses. Autant d’occasions de ramener de la conflictualité au pays du bon pain bio. Pour autant, le terrain des revendications dans un contexte professionnel qui se raconte comme progressiste et égalitaire est déjà en soi une lutte. Car quand il n’y a pas de patron·ne, à qui adresser les demandes ? À qui reprocher des manquements aux droits ?
Assez vite, le fait de revendiquer ce qui est pourtant une base légale obtenue de haute lutte par des travailleur·euses, est donc venu entretenir une méfiance et des rapports tendus. On faisait alors preuve d’un formalisme bien peu « anarchiste ». On refusait bêtement d’adhérer à un collectif très cool et très horizontal en réclamant davantage de verticalité.
J’aime les valeurs, j’aime les principes
L’autre aspect particulier à la scop de boulange qu’on a progressivement pu observer, c’est qu’il existe un quiproquo entretenu entre activité productive à visée commerciale (faire du pain, le vendre) et activité militante. Car comme dans beaucoup d’entreprises, des choix « éthiques » sont faits dans les modes de fabrication, d’approvisionnement, et de distribution pour vendre du pain de bonne qualité. Ils sont socialement valorisés et de plus en plus recherchés par une certaine clientèle. S’il peut s’agir d’authentiques choix de la part des producteur·ices, ils n’en restent pas moins des arguments marketing. Lors des ventes sur les marchés, on pouvait parler aisément avec les clients du statut coopératif, du label, des modes de production écologiques, etc. Or il y est bien plus difficile d’évoquer les conditions de travail et les atteintes aux droits. En partie parce que les acheteur·ses connaissent souvent les autres boulanger·es et entretiennent même parfois des amitiés avec elleux, mais aussi et surtout parce que le faire, c’est venir briser cette appartenance tacite au même monde de gauche, se voulant exempt de relations d’exploitation, fier de ses choix de consommateur·ices. Voilà donc un premier effet de ce qu’on peut appeler, en reprenant A. Brault-Moreau, le « left-washing » [13]. Et puis, du côté du fournil et de la boulange, peut-on vraiment parler d’activité militante ? Si la réponse semble évidente à ce stade, le statut coopératif, le label « Nature et progrès », le lien au réseau de l’IBM, entretiennent là aussi une confusion des registres.
Travailler pour cette scop (ou une autre du même type) serait donc vécu et pensé comme une forme d’engagement. Du point de vue des conditions de travail spécifiques à cette scop, on pourrait aussi se dire que des avantages existent pour toutes les personnes qui y bossent : remboursement des frais de déplacements domicile/travail, prise en charge de soins d’ostéopathie, accord d’entreprise permettant le maintien total du salaire en cas d’arrêt maladie (bientôt remis en question pour les saisonnières). Mais ces dispositions se font à la carte et ne constituent en aucun cas un dépassement par le haut du Code du travail. Elles agissent au contraire plutôt comme des compensations pour rendre acceptables des conditions pénibles et des pratiques hors des clous. Quand bien même faire du « bon pain en scop » a pu compter dans notre choix de faire une saison là, plutôt qu’à la Mie câline, aucune de nous ne considère qu’il s’agisse pour autant d’une activité engagée. Ce n’est clairement pas une perspective révolutionnaire qui a motivé la signature de nos contrats, mais bien celle d’une expérience professionnelle et, tout simplement, d’un salaire pour survivre. Et ce n’est pas non plus dans une optique totalement altruiste de transmission de savoir-faire que nous avons été embauchées, comme cela a pu transparaître parfois dans des discussions avec nos employeur·euses.
Ce « management déguisé » et le « left-washing » latent sont donc des contextes de travail où le conflit peine à exister, et où le syndicalisme est un vilain mot. On a ainsi pu entendre de la bouche d’un de nos employeurs à propos de la première réunion où nous réclamions la révision de notre salaire, et accompagné d’une moue de dégoût : « la première réunion que je qualifierais de “syndicale”… ». Car dans le grand roman de la boulange de gauche, s’il y a des problèmes, ils ne peuvent être que des problèmes d’individus et de personnalités incompatibles. Pourtant, on l’a vu, elle reproduit parfaitement les violences patronales qui ont cours dans la société et produit bel et bien des effets sur les personnes. Et en particulier, sur leur santé.
« Les tendinites, c’est psychosomatique »
Sweat, sweat to be a winner
Les accidents du travail, en France, sont responsables de plus de 700 décès par an (1264 décès si on y ajoute les accidents de trajet et les maladies professionnelles) [14]. Traités par les médias comme une fatalité voire comme la conséquence du manque de responsabilité des victimes, ils sont pourtant liés à des choix managériaux (les principales causes des accidents du travail sont la surcharge de travail, le manque de formation, les cadences, les contraintes physiques et les manquements aux règles de sécurité) et politiques (déresponsabilisation des entreprises et dans les décisions de justice, recours croissant à la sous-traitance).
Concernant le travail de boulanger·e spécifiquement, il est considéré comme particulièrement difficile : horaires atypiques, journées longues, entièreté du travail en station debout, port de charges lourdes, gestes très répétitifs, travail dans un espace chaud et confiné. Les situations à risques sont permanentes et entre les accidents du travail (déclarés) et les maladies professionnelles, 600 000 journées de travail par an sont « perdues » dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie [15]. Les accidents du travail concernent majoritairement les traumatismes internes, les plaies ouvertes, les entorses et les foulures, les chocs traumatiques. Ils sont en augmentation constante depuis plusieurs années, tout comme les maladies professionnelles. Les plus fréquentes sont l’asthme et l’allergie à la farine, les caries, les troubles musculo-squelettiques (tendinites, canal carpien, qui sont des maladies avec une évolution lente et sont récidivantes), les troubles veineux, et les risques psycho-sociaux liés au stress et au manque de sommeil.
Rappelons aussi que les accidents du travail sont en lien direct avec la précarité. En France, presque 45 % des accidents du travail concernent les ouvrier·es [16] ; le nombre d’accidents du travail chez les intérimaires est deux fois plus fréquent que la moyenne nationale [17]. Celleux-ci ne bénéficient souvent pas des mêmes garanties en terme de santé et de sécurité, et sont pris dans des impératifs d’efficacité et de rentabilité à court terme. Cette logique est complètement transposable dans notre cas : l’une d’entre nous a continué de travailler une semaine en ayant mal pour avoir des heures supplémentaires parce qu’elle avait besoin de cet argent, et ne pas le faire aurait pu éviter une tendinite toujours pas guérie à l’heure actuelle.
Dans une structure avec peu de salarié·es à l’année et le choix assumé d’une boulange sans mécanisation, on pourrait penser qu’une attention importante à la santé des travailleur·ses s’imposerait. En particulier en haute saison où la production double, et les risques psycho-sociaux avec. Au contraire, les cadences infernales de l’été ne remettent en rien en question les modes de fonctionnement habituels. Le stress de la cadence et la charge mentale conduisent inévitablement à plus de fatigue dans un métier déjà physique. Cela pousse à un dépassement de soi pour respecter un rythme insidieusement imposé : c’est ce qui est attendu, et valorisé.
« Très rapidement dans ce fournil on comprend qu’il faut aller vite. Pourtant la « haute saison » n’a pas encore tout a fait commencé ! On nous dit que c’est parce qu’on vient d’arriver et que petit à petit on va gagner en rapidité. La saison allant, on se rend bien compte que malgré une cadence effrénée on est toujours en retard sur le planning prévu. D’ailleurs, les permanent·es de l’équipe qui sont là depuis plusieurs mois voire plusieurs années ne parviennent pas non plus à respecter l’organigramme. On a tout le temps au moins 1h30 de retard ! On court après la montre, après les pâtes et c’est toujours le stress.
De manière très implicite, on nous demande d’être flexibles sur nos horaires et c’est quelque chose qui paraît logique pour tous·tes les associé·es. Tout le monde fait ça, il est donc évident que nous devons le faire aussi, que c’est la norme ici. On connaît globalement notre planning, les jours de repos et les jours travaillés. Mais on ne sait jamais à quelle heure on commence réellement. Souvent cette information nous est donnée la veille au soir (ou plutôt nous devons la trouver nous-mêmes) pour une prise de poste parfois tôt le lendemain matin. Ceci dans une logique de précision quant à la quantité de pain à produire sur la fournée du lendemain (le planning est fait en fonction des invendus, de la météo, du jour de la semaine, des commandes de dernière minute, etc.) En fonction de ces impératifs, l’heure de la première personne qui commence au fournil est déterminée, définissant celle des autres boulanger.es. Dans ces conditions, c’est dur de décrocher mentalement du boulot, d’organiser ses journées off. On est à disposition. C’est normal, c’est la saison !
Ajouté au stress de la cadence et à celui de la disponibilité s’est ajouté celui du flou organisationnel qu’il a fallu gérer dès le départ. L’accueil des nouvelles salariées se fait en même temps que la fournée, sans temps dédié. On capte par bribes l’organisation globale qui est noyée par une multitude d’informations données (divers documents informatiques, les prises de commandes, l’orga des marchés, les parcours de livraisons…). C’est sans cesse la pêche aux infos dans l’urgence, car il y a peu d’anticipation. Quel véhicule est disponible pour tel marché, telle livraison ? C’est une charge mentale supplémentaire que tout le monde doit gérer en permanence puisque l’entreprise n’a pas de véhicule dédié. Nous jonglons donc avec le véhicule d’un des salarié·es-associé·es, et les nôtres, pas assurés par l’entreprise, lorsqu’ils sont assez gros pour contenir le pain à vendre. »
Au fournil, la saison et son organisation, doublés du choix délibéré de refuser la mécanisation malgré les quatre à six fournées à assurer chaque jour, a eu des conséquences bien concrètes : un permanent de l’équipe a eu deux accidents de voiture en un mois en rentrant du travail, et il a également été arrêté un mois pour une tendinite au poignet ; l’une d’entre nous a dû consulter plusieurs fois l’ostéopathe pour des douleurs multiples l’empêchant, entre autres, d’assurer la journée complète de travail en station debout ; une autre est partie avec une tendinite au coude qui l’empêche encore de boulanger six mois plus tard ; la dernière n’a pas pu terminer son contrat à cause de multiples contractures musculaires dans le dos et d’un épuisement physique.
Ne t’arrête pas quand t’as mal, mais plutôt quand t’as tout donné
Ces accidents et maladies professionnelles sont des conséquences de conditions matérielles et de choix managériaux. Pourtant, ils ont été abordés par la scop comme des problèmes personnels. On a été sans cesse prises dans des doubles injonctions : il faut prendre soin de soi, aller bien, ne pas se faire mal, mais on devait en même temps se surpasser complètement sur tout. Il s’agit là encore de méthodes managériales pacificatrices complètement normales dans le monde de l’entreprise du 21e siècle, culpabilisant consciemment ou non les individus pour qu’ils se surpassent constamment, avec pour conséquence que ceux-ci auront moins tendance au combat politique pour demander des conditions de travail acceptables.
« Lorsqu’on parle avec nos employeur·ses on nous dit qu’il n’y a pas d’objectif de production, que ce n’est pas la peine d’aller vite et de stresser. Que l’argent passe après la santé… sauf qu’en même temps, on est obligées d’aller vite et de stresser, on n’a absolument pas le choix ! Certain·es feignent la grande surprise quand on ose parler de nos fatigues et problèmes de santé : « ah bon, vous avez mal ? Mais ce n’est pas normal, il ne faut pas, ça m’inquiète, ça n’est jamais arrivé », etc. Puis, iels nous sortent des discours individualisants sur ces problèmes. Nous avons pu entendre tout au long de la saison des remarques sur les bonnes pratiques, les bons gestes, les bonnes postures à adopter pour ne pas se faire mal ; on nous a même certifié que sans respecter ça c’était normal de se faire mal. Notre posture corporelle propre a même été interrogée. C’est peut-être la position de notre corps qui est en cause dans nos douleurs ! Ah zut alors ! Voire même des facteurs psychosomatiques ou des tensions familiales qui peuvent être à l’origine de tendinites ! C’est ce qui nous a été avancé lors de la dernière réunion d’équipe. On marche sur la tête, et ça fait mal aux cervicales. Pour faire face à de telles aberrations, il a fallu prendre sur nous pour rester polies. En gros, nous rendre responsables de nos douleurs leur ont permis de ne pas avoir à remettre en question le rythme et l’organisation du travail. »
L’individualisation des problèmes de santé va de pair avec le concept de résilience, qui est très prisé dans le milieu du développement personnel tout comme dans celui du management néo-libéral. On reprendra la définition de Frustration magazine : « Attitude d’un individu ou d’un groupe à prendre acte d’un traumatisme infligé par le système capitaliste et à se reconstruire de façon socialement acceptable — du point de vue des bourgeois. […] Face à la violence des choix politiques et managériaux, les salariés et citoyens sont sommés, individuellement, de se blinder, de prendre sur eux et de réguler leurs émotions pour ne pas faire chier le monde (bourgeois) et remettre en cause ce qui leur arrive. La résilience est donc l’inverse de la rébellion. » [18].
Sans contre-façon je suis un garçon
Le fait que ce soit mal vu de se plaindre des conditions de travail dans l’activité de boulanger·e ne vient pas de nulle part : la boulangerie est un métier masculin (6 % de femmes au fournil en 2022) [19], ce qui implique toute une batterie de comportements valorisés et intégrés par les travailleur·ses — et qui sont valables dans la majorités des métiers physiques dits « masculins » (les métiers physiques dits « féminins », que ce soit dans le soin à la personne ou le ménage, ne sont pas considérés comme tels). Ainsi, concernant la verbalisation des douleurs physiques et psychologiques, les pratiques viriles courantes dans un travail physique impliquent d’autant plus le déni de la souffrance et l’injonction à la force mentale et à prendre sur soi. C’est bien ce qu’on a pu observer chez l’un de nos collègues associés-salariés : repli sur soi, déni de la souffrance et de la douleur, dépression, alcoolisme, et au final, burn-out. De notre côté, il valait mieux cocher les bonnes cases, c’est-à-dire ne pas être fatiguées, ne pas se plaindre de douleurs, être de bonne humeur, ne pas avoir l’impression de travailler. On a entendu plusieurs fois que faire les marchés et les livraisons ne devait pas être vécu comme « du travail », puisque cela nous permettait d’être dehors, de se balader et de rencontrer du monde.
Les valeurs « masculines » sont valorisées. Travailler comme un homme, ça veut dire travailler beaucoup, quel que soit le niveau de fatigue ou de douleur. Ces valeurs se sont construites conjointement avec le développement du capitalisme et du travail d’usine : construction d’un ethos viril de l’ouvrier, relégation des « femmes » à la reproduction sociale (du moins celles qui le peuvent, les autres pourront tout de même travailler à l’usine, mais leur travail sera moins considéré et elles seront moins payées). L’identité masculine est construite par le travail physique ; elle est construite par l’exclusion (« une femme ne pourrait pas faire ce travail »). Le corps-outil est censé rendre fier, et cette construction est très utile parce que cette fierté est bien ce qui a fait tenir des millions d’ouvriers à travailler toute leur vie, et à en mourir.
Très étrangement, on voit ici que le système patriarcal et le système capitaliste entretiennent les mêmes valeurs. C’est ce que montre Haude Rivoal dans La fabrique des masculinités au travail : « la virilité est un idéal de performance, d’endurance, de puissance et d’autorité. Cet idéal s’accorde à merveille avec un environnement économique et social violent, à l’image de celui proposé par le capitalisme. » [20]. La performance, le dépassement de soi, la compétition (être rentable revient à être le meilleur) servent un point de vue rationnel et économique et leur but est de faire du profit.
Cependant, une entreprise de gauche en 2022 est forcément féministe et nous n’avons jamais été discriminées par nos collègues : personne ne doute que nous pouvons effectuer le même travail, ce qui est plutôt notable. On peut quand même se poser une question : quand une femme acquiert des savoir-faire dans des métiers dits d’hommes, est-ce que c’est une bonne nouvelle qu’elle devienne un homme comme les autres ? La masculinité se définit par ce que n’est pas la féminité (l’inférieur et la marge) : elle est la norme, et on a dû être la norme. Et si le concept d’égalité entre les membres de la scop a été largement utilisé et mis en avant, l’égalité était mesurée sur des critères d’ultra-validité et d’ultra-performance. Et la disqualification du corps non performant encourage le maintien de dispositifs virils, la perpétuation de normes telles que le dépassement de soi, ce qu’on a incarné tout l’été pour être validées.
« On est fin août, une de nous vient de finir son contrat. Deux permanent·es de l’équipe sont en vacances, un autre est arrêté pour une tendinite. Il ne reste plus que deux saisonnières dans le bateau, complètement crevées et qui ont des douleurs partout. On aurait dû être en arrêt maladie pour ne pas tirer encore un peu plus sur la corde, mais nous n’avons pas réussi et avons décidé de continuer, à un rythme de production réduit, certes, mais sans pouvoir s’autoriser à lâcher. Un mélange de culpabilité si le fournil ne tournait pas et de solidarité avec l’autre collègue (ne pas vouloir laisser l’autre seule). Et cela en se disant consciemment qu’on ne se faisait pas du bien... Les injonctions au travail ont la peau dure, et nous exploiter nous-mêmes quelque chose de non négociable. »
On peut conclure avec l’histoire une des salariées de la scop, boulangère à l’origine du projet qui a complètement arrêté de boulanger suite à des accidents du travail dont elle ne récupérera pas entièrement ; elle ne fait plus que de l’administratif pour rester dans la scop, et elle nous a dit qu’elle aimerait continuer à faire du pain, mais que ce n’est pas possible parce qu’elle ne pourrait pas avoir le rythme qu’il faut et qu’elle serait un poids pour ses collègues et pour l’entreprise. On peut pointer ici le caractère forcément validiste d’une structure qui existe pour faire du chiffre, au détriment des besoins des gens, et à quel point c’est triste.
[Conclusion]
Et nous voilà fin décembre, une première qui enchaîne la kiné sans voir aucune amélioration, touche 45 balles par mois depuis septembre et ne sait même pas si elle récupérera son RSA en janvier ; une deuxième qui ne touche toujours pas son chômage à cause du retard accumulé entre la CPAM et le conflit sur les heures sup’ et qui s’est débarrassé depuis peu et à force de kiné et d’ostéo de ses douleurs au dos ; une troisième qui a eu la chance de valider ses droits à l’indemnisation du chômage, mais n’a pas un SMIC pour voir venir et galère à retrouver un logement ; les trois se disent aussi qu’elles sont très en joie d’avoir rencontré deux copines avec qui rigoler et s’organiser, et d’être au final plus autonomes et plus badass dans un fournil.
Même si on s’est senties impuissantes et qu’on n’a concrètement gagné que des miettes (une « hausse » de salaire pour atteindre celui annoncé au départ, un peu moins d’heures de travail, des temps de pause qu’on a quand même rarement pu prendre), le fait d’être plusieurs salariées temporaires nous a bien permis un rapport de force qui, s’il était difficile de le nommer comme ça face à nos employeur·euses, a été déterminant pour poser des revendications et parfois obtenir des améliorations. Au-delà, cela nous a permis de nous sentir accueillies, d’échanger sur nos conditions de travail, sur nos rapports avec les membres de l’équipe permanente, de limiter la culpabilisation, de partager des infos et puis simplement de nous soutenir. D’autres situations de personnes employées par la scop n’ont pas toujours permis cette soupape (saisonnier seul l’été ou personne en apprentissage à l’année). C’est en pensant à elleux que nous avons souhaité écrire ce texte, conscientes que seules nous n’aurions pas pu, pas tenu, pas osé. Que nous aurions peut-être perdu confiance en nous-mêmes et en nos capacités, pensé qu’on « exagère » parce que tant d’autres tiennent. Nous pensons à Emmanuelle, qui a mis fin à ses jours en 2016 suite à son licenciement pour « insuffisance professionnelle » de la scop de boulangerie dans laquelle elle travaillait [21], et voulons également lui dédier ce texte. Enfin, nous pensons aux luttes actuelles du petit monde de la boulangerie alterno, et envoyons notre soutien aux grévistes de Patalevain à Toulouse, et de la Conquête du pain à Montreuil.
On souhaite surtout que ce texte contribue à une continuité de réflexions sur le travail dans le milieu de la boulange. On a plein de pistes qu’on aimerait continuer de développer ou voir se développer : la mise à disposition des documents concernant les accords d’entreprise ; la mise en place de syndicats ou de pratiques syndicales et la revendication de droits ; la formalisation d’espaces de revendication et de critique ; la pratique de l’autodéfense au travail (solidarité, vol, sabotage) ; pour les employeur·ses, la formation pour assumer ses responsabilités et respecter les droits des salarié·es, la transparence sur les choix économiques et organisationnels ; et pour tout le monde, la critique du modèle salarial et une réflexion sur la place du travail dans nos vies.
Du coup, dans l’optique de continuer à brasser ces questions, on a créé une boîte mail comme une bouteille à la mer, sans savoir clairement où ça nous mènera. Parce qu’on aimerait avoir des retours sur ce qu’on a écrit là, voir si ça fait écho à certain·es ou si au contraire d’autres ne s’y retrouvent pas et pourquoi. Parce qu’on imagine aussi y recueillir des témoignages d’autres expériences au taf en boulange, et pourquoi pas des contributions pour une future brochure plus approfondie sur le sujet. Et parce qu’on a même pensé, allez on ose tout, voir si du monde aurait le jus pour s’outiller collectivement en droit du travail, s’entraider dans les luttes internes et syndicaliser un poil nos milieux. Alors pour écrire, c’est ici : dupainetdesroses@@@riseup.net
[1] Société anonyme / société à responsabilité limitée.
[2] Voir le site internet de la Confédération générale des Scop et des Scic.
[3] Gilles Rasselet, Les transformations du capitalisme contemporain, éditions L’Harmattan, 2007, p. 224.
[4] Lily Zalzett et Stella Fihn, Te plains pas, c’est pas l’usine : l’exploitation en milieu associatif, Niet !éditions, 2022.
[5] Source : les-scop.coop.
[6] Marina Bertrel, "La scop, d’un idéal social à un modèle entrepreneurial", dans Entreprendre et innover 2013/1 (n°17).
[7] Simon Cottin-Marx et Matthieu Hély, "Le projet de l’économie sociale et solidaire : fonder une économie acapitaliste : Entretien avec Jean-François Draperi" dans Mouvements 2015/1 (n°81).
[8] Ici bazar, un autre monde du travail n°11, « Horizontale boulangerie », 2020.
[9] « Se faire du blé ? Multiplier les niches ou changer les modes de production et de distribution » dans Notre pain est politique, les blés paysans face à l’industrie boulangère, éditions de la dernière lettre, 2019.
[10] Jacques Landriot, « L’entreprise de demain existe… C’est une SCOP ! », Huffpost, 2022.
[11] « Contre le mythe autogestionnaire » (brochure sur infokiosques.net), 2011.
[12] Arthur Brault Moreau, Le syndrome du patron de gauche — manuel d’anti-management, éditions Hors d’atteinte, 2022, p. 55.
[13] Ibid, p. 111.
[14] "Les accidents du travail ne sont pas des faits divers. Entretien avec Matthieu Lépine", revue Ballast, 2021.
[16] "Les accidents du travail ne sont pas des faits divers. Entretien avec Matthieu Lépine", revue Ballast, 2021.
[18] « Faire preuve de résilience : s’en prendre à soi plutôt qu’aux bourgeois », Frustration Magazine, 2020.
[19] Chiffres de la Confédération Nationale de Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française de 2022.
[20] Haude Rivoal, La fabrique des masculinités au travail, éditions La Dispute, 2021.
[21] "L’histoire d’Emmanuelle, boulangère dans une Scop, qui a été licenciée, puis a mis fin à ses jours", dans Basta, 11 mai 2023.
)
Décembre 2022.
Contact : dupainetdesroses@@@riseup.net
À lire
- Alastair Hemmens, Ne travaillez jamais. La critique du travail en France de Charles Fourier à Guy Debord, éditions Crise & Critique, 2019.
- Notre pain est politique, les blés paysans face à l’industrie boulangère, éditions de la dernière lettre, 2019.
- Lily Zalzett et Stella Fihn, Te plains pas, c’est pas l’usine : l’exploitation en milieu associatif, Niet éditions, 2022.
- Arthur Brault Moreau, Le syndrome du patron de gauche — manuel d’anti-management, éditions Hors d’atteinte, 2022.
- Haude Rivoal, La fabrique des masculinités au travail, éditions La Dispute, 2021.
- Roswitha Scholz, Le sexe du capitalisme. “Masculinité” et “féminité” comme piliers du patriarcat producteur de marchandise, éditions Crise & Critique, 2019.
- « Contre le mythe autogestionnaire », infokiosques.net, 2009.
- « Bureau de désertion de l’emploi. Manuel non-exhaustif de débrouille individuelle et collective contre la société capitaliste », infokiosques.net, 2022.
Références musicales
- Soprano, « Le pain »
- Aya Nakamura, « 40 % »
- Zebda, « Y’a pas d’arrangement »
- Gala, « Freed from desire »
- Sexy Sushi, « J’aime mon pays »
- Marie Davidson, « Work It »
- Soprano, « Le coach »
- Mylène Farmer, « Sans contrefaçon »
ce texte est aussi consultable en :
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (648.9 ko)
- PDF par téléchargement, en cliquant ici (714 ko)